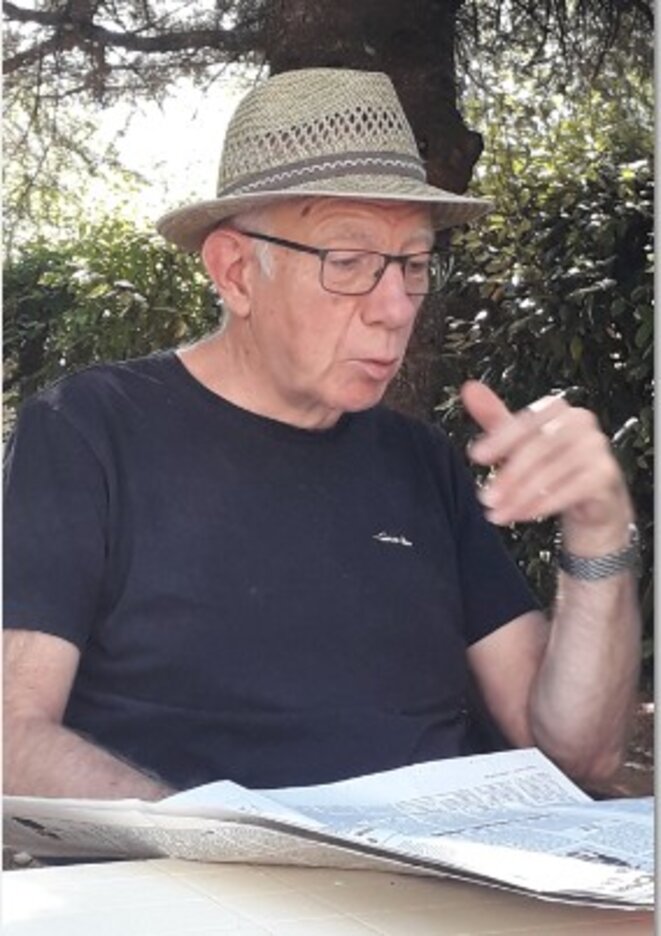Que peut-on attendre de la police ?
« Des flics, il en faut ? Ben, en tout cas, il y en a ! » (Coluche, sketch du CRS arabe).
« La police va arriver dans les quartiers à 17 heures et partir à 4 heures, parce que ce sont les horaires des voyous ». (Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur en 2005). A double lecture !
Clairement, la police est conçue pour qu’on la craigne. Elle est censée disposer du monopole de la violence. Serait-ce un moindre mal pour éviter les scènes de western, comme aux Etats-Unis où les ravages des armes à feu sont considérables ? Ou en Europe où c’est par des armes de contrebande qu’ont pu se perpétrer les attentats de ces dernières années. Il y a la police qu’on « est content de trouver quand on en a besoin », la police pour empêcher les gens de se foutre sur la gueule ou de nuire à autrui…
Admettons que nous pouvons avoir un rapport ambivalent avec la police et la justice, institutions pouvant dénouer certaines tensions dans la société et empêcher certaines abominations et crimes de se produire. La question de la déviance en société a toujours intéressé juristes, philosophes et tous les gens s’intéressant à la politique, certains se contentant d’une réponse expéditive, longues périodes de prison ou peine capitale. D’autres pensent à juste titre que les délits ont une source sociale et que des solutions de justice sociale diminueraient leur nombre. Mais quel que soit l’état d’égalité, de solidarité et de justice, il restera encore des criminels plus ou moins contrôlables. La question de quoi en faire ou comment y faire face est posée. Décliner un service public de police gardiens de la paix dans une société de justice, c’est une question passionnante, même si nous en sommes bien loin de cette société.
Après les attentats de 2015 et 2016, des jeunes ont voulu entrer dans la police ou la gendarmerie pour « aider et servir leurs concitoyens » : on ne va pas a priori cracher sur cette « Génération Bataclan » (même si on peut parier qu’un certain pourcentage de « Génération bleue marine » s’y est invitée). Mais questionner, oui !
Car, entrer dans la police (par concours ou comme réserviste ou encore en service civique) n’est pas anodin. La police ou la gendarmerie ne sont pas de sympathiques ONG. Ce sont bien des organisations gouvernementales, avec l’aspect « protection des personnes » indiqué plus haut, mais aussi l’autre aspect, inquiétant, celui de la répression et du contrôle. Si on s’attarde sur les XIX et XXièmes siècles, on sait le rôle néfaste qu’ont joué les forces de police contre le mouvement ouvrier, contre les juifs et les tziganes, contre les immigrés, en particulier algériens. Sans compter les « bavures » qu’on a pu connaître d’une période à l’autre.
Garder la paix ou la malmener ?
Ce n’est pas une nouveauté : la police est dure et depuis quelques années, elle a tendance à se re-durcir. Cela accompagne le durcissement de la législation et la politique du chiffre, mais il y a aussi ce qui n’est pas inscrit dans les textes de loi, sans toutefois généraliser : la culture de la violence souvent, un machisme des plus épais, une volonté d’humilier, l’esprit corporatiste, le mépris pour certaines populations, la peur des classes dites dangereuses aussi.
Evidemment, les tensions dans la société sont vives, avec le chômage de masse qui délite le lien social ou les attentats comme celui de Magnanville en juin 2016 contre un couple de policiers à leur domicile. Il est entendable qu’un flic ait peur dans l’exercice de ses fonctions. Ça n’excuse pas les exactions que certains d’entre eux commettent, ni la clémence de la « police des polices » ou de la justice face à ces actes ou encore la complaisance de syndicats de police qui jouent au service après-vente des bavures, justifiant parfois les propos racistes les plus ignobles. On se saurait croire que c’est la peur qui conduit des policiers à commettre des gestes irréparables dans de nombreux « faits divers » où la police est impliquée.
Témoignage d’un flic d’Aulnay sur ses quatre collègues, violeur et complices dans l’affaire Théo : « C'était vraiment des habitués. Dès qu'ils sortaient du commissariat et qu'il n'y avait plus d'autorité derrière eux, ils s'imaginaient être les maîtres dans la rue. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi ! Le plus vieux, il n'avait que sept ans de police. On les a un peu lâchés dans la nature... »
Mais faut-il réduire ce fait divers à une énième bavure commise par des « brebis galeuses » ?
Il y va quand même de l’organisation actuelle de la police et ses « corps » de « cow-boys ». Le « western » que j’évoquais plus haut n’est pas loin : les lois récentes renforcent une police à l’américaine, avec une définition plus « souple » de la notion de légitime défense ou l’armement des polices municipales. Il y a donc une responsabilité au plus haut niveau de l’Etat, qu’il faut dénoncer.
Les romans policiers racontent souvent des histoires de flics sympas, un peu rebelles, en bisbille avec leur hiérarchie qu’ils court-circuitent pour mener à bien leur enquête. La réalité est toute autre : elle serait plutôt de l’augmentation du nombre de policiers « rebelles de droite », rétifs à leur code de déontologie ou au code de procédure pénale. Des corps spécialisés dans la répression comme les BAC (brigade anti-criminalité) et la BST (brigade spécialisée de terrain, celle qui s’est fait connaître dans l’affaire Théo) se sont formés, notamment sous la houlette de Nicolas Sarkozy. Au début des années 1990, on pouvait encore voir un président du Gasprom invité comme intervenant à des formations de police : ce serait sans doute inconcevable 25 ans après.
Alors, que pouvons-nous attendre de la police ?
Qu’elle desserre l’étau ! Mais comment ? Il faut se poser la question de qui a le pouvoir sur la police. Y a-t-il une police ou des polices ? Obéissent-elles aux « valeurs républicaines » qu’elles sont censées défendre ?
Globalement, la police, comme institution se conformant au législateur, défend le statu quo social, même sous le discours des « valeurs républicaines » : la liberté (mais surtout d’entreprendre ou d’aller se faire exploiter), la propriété (comme c’est inscrit dans les premières constitutions post-Révolution française). Face à la police, il est évident qu’il vaut mieux être riche, installé, blanc et vivant dans un beau quartier que pauvre, jeune, noir ou arabe et vivant dans une lointaine banlieue.
Valeur républicaine aussi, l’égalité ? Sur ce point, on constate que la police amplifie les inégalités qui existent, du fait d’une société de classes doublée d’une société post-coloniale. Sur ce point et sur toutes les questions revendicatives sortant de l’espace stricto-parlementaire (défense des sans papiers, lutte contre la loi Travail ou le transfert de l’aéroport à ND des Landes par exemple), nous pouvons être certains de nous trouver face à la police et… BFM TV et consorts.
Mais desserrer l’étau ne consisterait-il pas d’abord à affirmer plus fortement la légitimité de nos luttes et leur caractère démocratique, de dénoncer les injustices et les scandales, mais de convaincre en évitant la violence, de susciter la réflexion, de provoquer pacifiquement, de ne pas faire miroir à ceux qu’on dénonce, d’élargir le mouvement à des personnes moins politisées ?
Il ne s’agit pas de nous départir de notre part de radicalité, mais de faire contrepied au pouvoir, voire jouer de ses contradictions, même si on sait pertinemment que des actions se voulant pacifiques peuvent être réprimées et criminalisées. Il sera temps alors de méditer cette phrase de Louise Michel : « Les bouleversements sociaux, comme les tremblements de terre, suivent une même ligne volcanique ; ils se propagent surtout par l’électricité de la pensée ainsi que par des fils conducteurs ». Ainsi, même dans un face à face tendu, il faut garder notre fil conducteur, la cause qu’on défend, et se servir de notre cerveau pour rester solidaires et groupés, refuser les provocations…