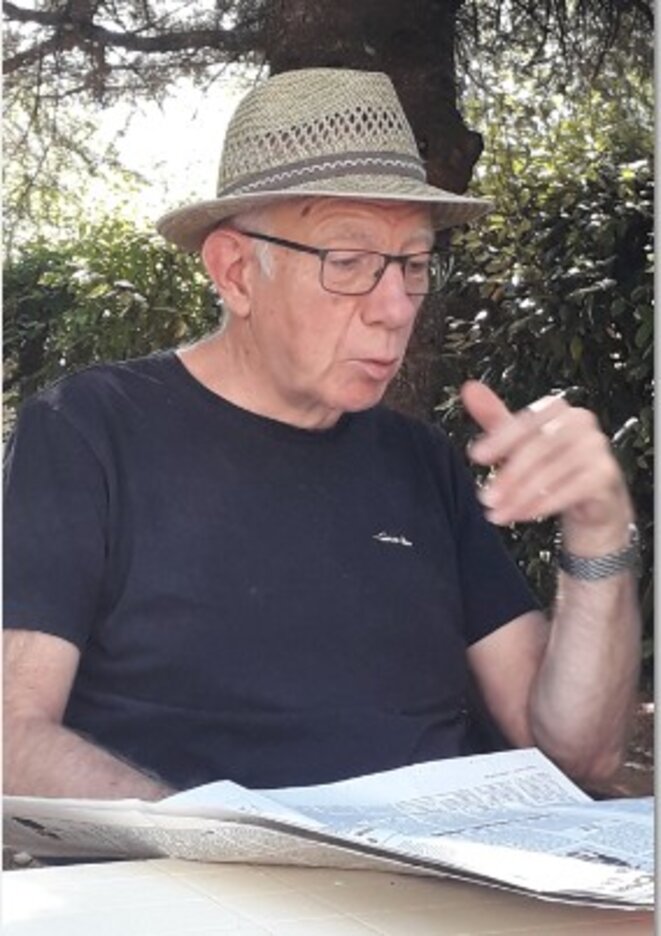Le contexte dans lequel Retailleau s'exprimait, c'est l'immigration et son contrôle ou plutôt « la lutte contre l'immigration », en demandant l'extension des référendums au sujet de l'immigration, avec des propos tels que : « l’immigration n’est pas une chance », « On peut l’étendre [la durée de rétention] de beaucoup, en doublant » cette durée à cent quatre-vingts jours ».
Ça faisait suite au meurtre de l'étudiante Philippine en septembre, le suspect étant un jeune marocain frappé par une OQTF, laquelle ne fut pas exécutée. En résumé, Retailleau s'appuie sur un fait divers particulièrement violent pour tenter de durcir les lois françaises sur l'immigration, soit une punition collective à partir d'un cas exceptionnel.
Marine Le Pen en pseudo-défenseuse de l’État de droit
Réponse de Marine Le Pen rapportée par l'AFP, lors d'un meeting RN le 6 octobre à Nice, se voulant en désaccord avec Retailleau : « Je dois exprimer une divergence majeure avec notre ministre de l’Intérieur. Ce n’est pas l’État de droit en tant que tel qui doit être contesté, c’est tout le contraire. Nous en sommes les garants, au sens que lui ont donné les plus brillants philosophes européens des siècles passés ».
Vous avez bien lu : c'était lors d'un meeting RN, pas du Congrès de la Ligue des Droits de l'Homme.
La patronne du RN ajoute : « L’État de droit, c’est la soumission de tous aux règles démocratiquement définies, et c’est l’une des immenses conquêtes de la civilisation européenne ».
Nous y voilà ! en disant ceci, Marine Le Pen inverse la notion d'État de droit, car les définitions généralement admises indiquent que l'État de droit est un « État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée », selon le juriste autrichien Hans Kelsen (1881-1973) qui a théorisé cette notion.
En gros, quand on parle d' État de droit, il s'agit de limiter les pouvoirs de de l'État vis à vis des individus, passant par la soumission de l'État à des règles de droit selon une hiérarchie des normes, dont l'égalité des droits des personnes (physiques ou morales) face à l'administration et la justice, la possibilité de faire un recours face à une décision judiciaire ou administrative, le droit des minorités face aux majorités, l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs exécutifs et législatifs (le référendum étant lui-même une manière de légiférer), la responsabilité des gouvernants quant à leurs décisions.
La « soumission », voilà le problème.
Quand j'entends ce mot, mon oreille se dresse, mon poil se hérisse, qu'il s'agisse de questions politiques, démocratiques, religieuses, voire d'ordre inter-personnel.
Il est évident que les personnes ont intérêt à respecter des normes. le Code de la Route est un exemple : sans son respect, la circulation serait impossible.
Autre cas : le Code du Travail s'applique autant aux employeurs qu'aux employés. Ici, néanmoins, il correspond à un rapport de forces dans la société, la lutte des classes, avec des conquêtes du mouvement ouvrier, que le patronat tente par la suite de remettre en cause. Ainsi, le droit de grève est inscrit dans la loi. Mais aussi, la loi indique que « le contrat de travail est un contrat de subordination » de l'employé vis à vis de son patron, cette subordination donnant alors des obligations pour l'employeur en contrepartie, telles que l'obligation de cotisations sociales et d'assurer la sécurité au travail de chaque employé.
De l'autorité :
La « soumission », c'est l'autre nom de l'obéissance, le fait de reconnaître une autorité et de s'y résigner. Reconnaître une autorité n'est pas négatif en soi, si on lui confère de la légitimité, une compétence, un savoir. A priori, j'ai tendance à reconnaître l'autorité scientifique quand elle élabore des lois de la nature, des théories confirmées par des expériences (mais des théories ne valant que jusqu'à ce que des expériences indiquent leur insuffisance ou leur incomplétude).
Il en va tout autrement quand l'entité se voulant autorité abuse de sa situation pour affermir sa domination et ses privilèges. Si on parle par exemple d'expertise scientifique, elle peut être légitime en éclairant des décisions politiques, mais trop souvent, elle sert d'alibi à des choix techno-industriels contestables.
Il y a donc lieu d'agir contre, parfois sous la forme de désobéissance et de révolte, que ce soit dans le pays, l'entreprise, la famille, le couple.
Les formes de la désobéissance et de la révolte, individuelles ou collectives, peuvent se conformer à des règles de droit. Mais à qui convient-il de définir ces formes ? L’État ? Quand on constate la montée de l'autoritarisme, de la militarisation, de la violence étatique, y compris dans les pays dits démocratiques, on ne peut que se méfier.
Non : la lutte justifie d'explorer des chemins non balisés. Ceci dit, des garde-fou éthiques sont nécessaires : on ne peut dire que « la fin justifie les moyens » sans affirmer en retour que « les moyens conditionnent la fin ». Par exemple, la lutte doit éviter la violence contre les personnes. Parfois, il est difficile de l'éviter, quand on se fait gazer, nasser, criminaliser, blesser, tuer. Mais en aucun cas, la violence ne doit devenir une finalité.
« Je ne suis humain et libre moi-même qu'autant que je reconnais la liberté de tous les hommes [et j'ajoute toutes les femmes] qui m'entourent. Ce n'est qu'en respectant leur caractère que je respecte le mien », écrivait Bakounine, trop souvent associé à tort à la violence. C'est ça l'éthique.
Se soumettre ou pas à l'ordre tel qu'il existe, là est la limite de l'État de droit.