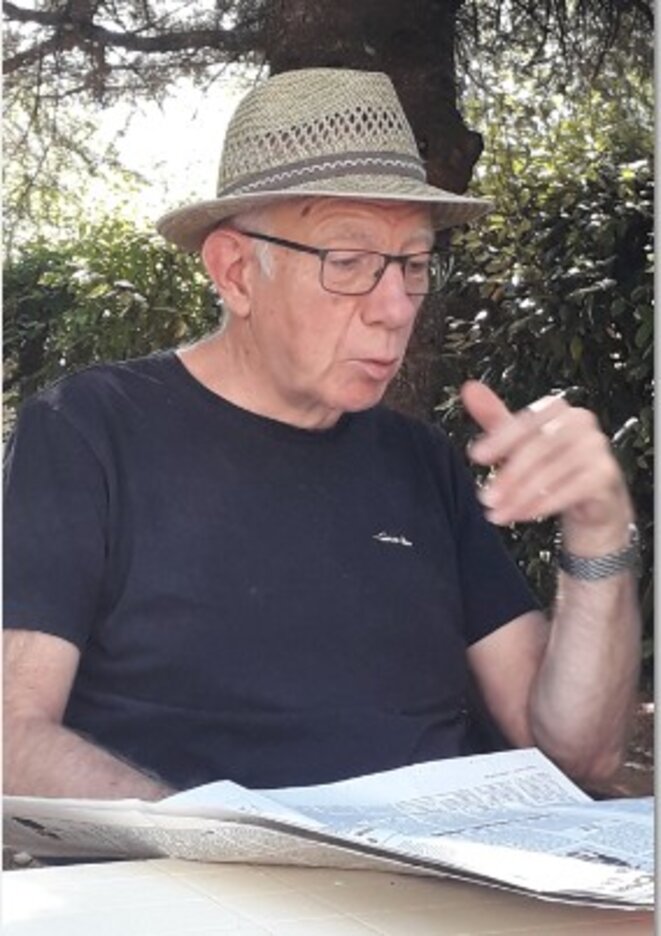Je connaissais déjà le personnage. J'appréciais même ses cours à l'Université populaire de Caen, diffusés sur France-Culture.
NOTES DE LECTURE :
L’Editorial :
Dès l’édito intitulé « la haine de soi française », Onfray se plaint de s’entendre dire qu’il serait d’extrême-droite, idée véhiculée par « quelques demeurés de la fachosphère de gauche ». Il n’empêche que la vraie extrême-droite, à l’instar d’Eric Zemmour, boit du petit lait à chacune de ses interventions.
Dans cet édito, il commence par s’attaquer au « gauchisme culturel » dont l’aboutissement ne serait rien que le terrorisme islamiste : « Les terroristes islamistes qui haïssent la France ne font jamais que reprendre le discours d’intellectuels qui, eux aussi, et depuis des décennies, détestent notre pays et ne perdent pas une occasion de répandre ce mépris ».
Admettons qu’Onfray ne soit pas d’extrême-droite. La preuve, il admire le Général de Gaulle et « le gaullisme qui fut souverainisme et grandeur, amour de la patrie et célébration de l’Histoire, éthique de la volonté et vertu de l’excellence, goût du sublime et tension vers les cimes ». N’en rajoutez plus. Interdiction de parler en mal de l’homme du 18 juin 1940 et de la résistance à l’occupation nazie. Ce n’est pas nouveau d’ailleurs cette fascination d’Onfray pour le Général.
Dans son livre « Le Désir d’être un volcan. Journal hédoniste » (Grasset, 1996), Onfray consacrait un chapitre au Général : « En politique, il vise le sublime, catégorie esthétique par excellence, à partir de laquelle il ordonne le réel »… « J’aime cet homme qui regarde la mer comme Hercule les travaux qui l’attendent et dira non aux totalitarismes d’où qu’ils viennent, antifasciste par essence, républicain de conviction, démocrate dans l’âme. Il ne voulait rien d’autre que l’indépendance, la liberté, l’autonomie : ni une nouvelle Révolution nationale, ni le bolchévisme, ni l’american way of life. Qui ne souscrirait à pareil programme ? ».
Ainsi, ce n’est pas une nouveauté que ce « souverainisme » de Michel Onfray et ce culte de la personnalité autour du Général de Gaulle, une fois gommés ses mauvais côtés, tels que la Françafrique personnalisée par les réseaux Foccart faisant et défaisant les présidents de pays d’Afrique francophone, les réseaux de barbouzes regroupés dans le Service d’Action Civique (SAC).
Il est étonnant aussi de voir dans le même éditorial Onfray faire l’éloge de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, « deux monuments injustement méconnus de la philosophie qui, entre autres pépites intellectuelles, ont dévoilé les ravages de la technique, les dégâts de la propagande, les dommages causés à la nature, la toxicité de la nourriture industrielle, la destruction des paysages, l’avènement du nihilisme, la folie de la société de consommation, la destruction des campagnes ». Comme s’il n’y avait pas de lien de causalité entre le programme gaulliste des années 1960 et tout ce qui est décliné ci-dessus.
Du Onfray tout craché, toujours à mener la bataille contre les contradictions des autres et incapable de voir celles de ses propres propos.
De quelques articles :
Les articles s’égrènent, certains sont intéressants comme cet article de Séverine Auffret, professeur agrégée de philosophie, intitulé « Ces femmes françaises qui ont marqué leur siècle » : une série de portraits allant de Jeanne D’arc à Louise Michel en passant par Olympe de Gouge ou la suffragiste Hubertine Auclert.
Ou encore celui de Kévin Boucaud-Victoire consacré aux « origines du mouvement social français ». Bien entendu, ce mouvement ouvrier était selon l’auteur « volontiers patriote » : « volontiers patriote, attachée aux communes et à la politique de proximité, la rébellion sociale du XIXème fut ainsi un grand cri populaire en faveur de l’autonomie et de la liberté ». De belles références à la Commune de Paris et au syndicalisme révolutionnaire, mais pas de référence à l’internationalisme du mouvement ouvrier, si ce n’est la conclusion de l’article sur la victoire idéologique du marxisme-léninisme qui « emportera avec elle les rêves d’autonomie de la classe ouvrière française », c’est bien triste.
Je n’ai pas encore tout lu la revue en détail, tel cet article de l’économiste Jacques Sapir intitulé « Du ‘génie’ politique national ». ou celui d’Henri Pena-Ruiz sur la Commune de Paris ou d'Olivier Dard intitulé « Peut-on encore comprendre la France coloniale ? ». Je m''abstiendrai donc de commentaires sur ceux-là.
Je m’arrêterai avec l’article « de fond » écrit par Michel Onfray dans ce numéro : « La ligne philosophique claire ».
Le chapeau de l’article donne la mesure de ce qui va suivre : « Qu’est-ce qui caractérise la philosophie française, quand on la compare aux philosophies étrangères et plus particulièrement avec la philosophie allemande ? Sans doute d’abord et avant tout la clarté, qui va de pair avec le bon sens. Ce fil rouge permet de proposer un rapide panorama des auteurs qui ont marqué la pensée hexagonale, jusqu’à en définir le génie ».
De comparaison, ce qu’Onfray en fait est plutôt de l’opposition. Comme si la philosophie d’auteurs de culture allemande (Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer, Freud, Leibniz, Husserl, Heidegger, etc) n’avait pas interagi avec la philosophie d’auteurs français et vice-versa.
Michel Onfray part d’une « hypothèse » : « d’une part, une ligne claire caractérise la philosophie et d’autre part, cette ligne s’est trouvée brisée par Sartre avec l’œuvre que l’on sait saluée par le journal collaborationniste français Comoedia, qui ne fait pas de l’homme de la nausée l’auteur de l’année 1943 sans de bonnes raisons ».
L’année 1943 marquerait donc une rupture dans la philosophie française.
Il y aurait ainsi une ligne claire (comme l’école de BD franco-belge) qui caractérise la philosophie française : « s’il fallait un mot pour la définir, ce serait la lisibilité. La pensée française, la philosophie française se caractérise donc par sa visibilité »… « D’un côté Montaigne qui avance avec force « sauts et gambades » ; de l’autre Hegel qui force le réel à entrer dans le béton de son architecture ».
La notion de « bon sens » revient régulièrement dans son texte : « Chercher une méthode, la raconter en français, partir de soi, célébrer le bon sens, observer le monde dans sa vastitude, viser les perspectives existentielles, s’affranchir des tutelles : il y a tout le programme de la philosophie française ».
Onfray échappe-t-il à la critique qu’il adresse à Hegel : « forcer le réel à entrer dans le béton de son architecture » ?
Quand il écrit ceci : « il existe donc une antériorité de la philosophie politique française sur la construction européenne du socialisme, de l’anarchisme et du communisme » ou encore ceci : « Le socialisme français sous ses formes libertaires est pratique, pragmatique, concret et sûrement pas idéaliste. Lui aussi se trouve rédigé dans une langue simple et claire. L’hégélianisme de Marx conduit au goulag via cette religion de la négativité ; le pragmatisme du socialisme libertaire de Proudhon n’a fait couler aucune goutte de sang ».
Quel génie, ce Onfray, chantre d’une philosophie française seule contre toutes. Au passage, comme pour de Gaulle, Onfray évite de parler des mauvais côtés de P-J Proudhon, son antisémitisme et sa misogynie.
« Les choses [de la philosophie française] se gâtent, je me répète, avec la fascination des philosophes français pour leurs homologues allemands qui, depuis Kant et son criticisme jusqu’à Heidegger et son ontologie phénoménologique, en passant par l’idéalisme allemand de Hegel, Fichte et quelques autres, ont fait de la philosophie une discipline aux confins des glossolalies ».
Définition de « glossolalies » dans le Larousse : « Phénomène extatique, constaté dans de nombreuses religions et sectes religieuses anciennes et modernes, dans lequel le sujet émet une série de sons ou de mots dont les auditeurs ne peuvent saisir le sens sans le concours d'un autre sujet possédant le don de l'interprétation. Chez certains malades mentaux, utilisation d'une langue inventée, incompréhensible pour les autres ».
En bref, Onfray est à l’image d’Onfray : cassant comme les angles droits de ses légendaires lunettes. Il a une très haute opinion de lui-même et de la France, sans voir de contradictions dans son discours et de gêne dans son « bon sens », cette manière de clore les débats. Ça n’invalide pas l’intérêt des ouvrages qu’il propose, mais pourquoi se priverait-on de lectures d’auteurs non-français ?
La conclusion du numéro :
Elle est écrite par Stéphane Simon (le co-éditeur de la revue) : « Renouer avec la volonté d’être civilisation », où il est question du voyage avec Onfray en Arménie (en novembre 2020) : « Mon cœur se serre à l’évocation de la grandeur de cette nation qui n’est pourtant pas la mienne » confrontée à « l’Azerbaïdjan, une nation créée de toute pièce le siècle dernier par la volonté de Lénine et Staline ».
Et de conclure donc que « Toutes les civilisations ne partagent pas les mêmes valeurs et, en cela, ne se valent pas : cessons de croire à ce nivellement démagogique. Il y a une façon de se sublimer pour un peuple qui s’appelle le génie. C’est à ce génie français que nous avons voulu déclarer notre flamme ».
Au final, le voyage de Michel Onfray et Stéphane Simon au Haut-Karabakh n’était-il donc qu’une sorte d’alibi, une mise en spectacle pour célébrer « le génie français » ?
Le « nivellement démagogique », c’est celui du duo Michel Onfray & Stéphane Simon : tout ramener à la nation française et au souverainisme, à une vision idéalisée de l’histoire et de la culture de ce pays, la négation des influences diverses qui forment la civilisation.