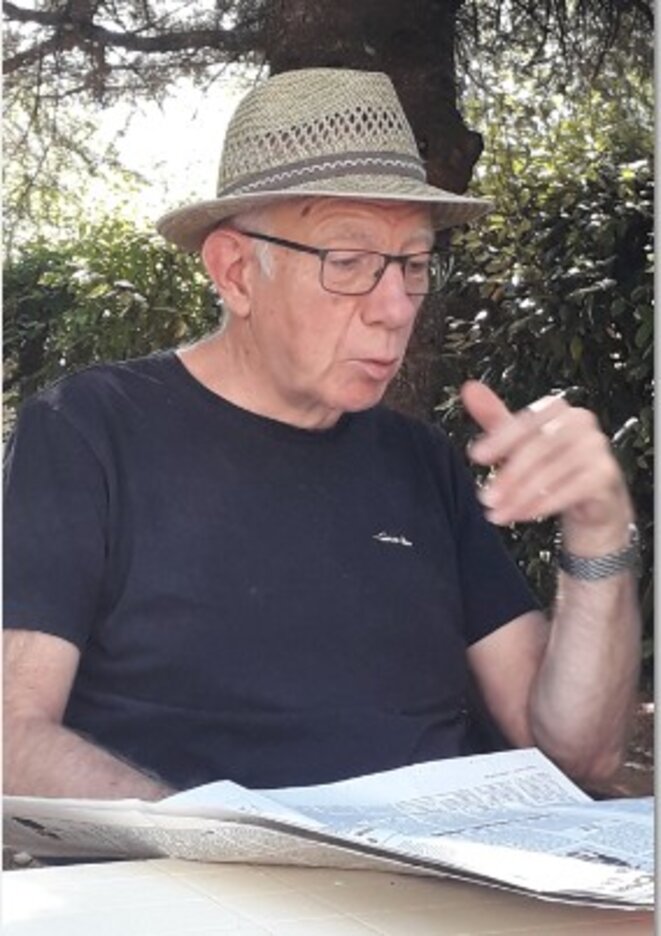De la mondialisation, nous connaissons son aspect le plus oppressant, celui de la toute puissance des firmes multinationales et de la finance. Une mondialisation plus discrète existe, celle des pauvres. Si les attentats (en Europe et aux Etats-Unis notamment) ont modifié profondément la carte géopolitique, les politiques migratoires qui se sont présentées comme une réponse ont elles-mêmes modifié les liens entre pays du Nord et du Sud. Ainsi, la politique des visas est relativement récente vis-à-vis de ressortissants de certains pays, comme l’Algérie, qu’on prendra comme exemple.
C’est en 1986, prenant prétexte des attentats survenus en 1985 sur le sol français, que le gouvernement français a instauré un régime de visas d’entrée court séjour pour les ressortissants algériens.
Ce système de visa a aussi modifié les échanges commerciaux, pas ceux des gros contrats qui répondent à des politiques d’Etat ou de grosses firmes, notamment les contrats gaziers, mais les « petits » échanges commerciaux, portés par des personnes immigrées ou de personnes étrangères faisant des allers-retours réguliers pour s’approvisionner. A l’époque (années 1970 et début des années 1980), la ville de Marseille et son quartier de Belsunce (tout comme Gênes ou Barcelone), était un lieu d’approvisionnement pour une foultitude de petits et gros négociants du Maghreb, faisant aussi vivre des familles immigrées en Europe, qui avaient les premières été touchées par les problèmes d’emploi et certaines trouvant là un moyen de se recycler. Par ces sortes de « comptoirs » du Nord et du Sud de la Méditerranée transitaient quand même près de 80% de l’économie domestique de ces pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne (textile, biens électroniques, voitures à l’unité, etc).
L’émergence des porte-containers, puis la possibilité de passer commande par Internet, mais aussi la politique des visas que la France et l’Europe ont mis en œuvre en 1986, ont marqué le déclin de ces activités, en particulier à Marseille. Comme « la nature a horreur du vide », les flux commerciaux se sont reportés dès lors, d’abord vers la Turquie, puis vers Dubaï et directement avec la Chine, avec notamment la région de Yiwu où vit une minorité musulmane de Chine. Un « axe Algérie-Dubaï-Chine » s’est créé, d’où ont émergé les plus audacieux de ces commerçants algériens, mais où la masse des petits s’est retrouvée marginalisée.
On voit ainsi comment cette politique de contrôle de l’immigration et des visas a changé la donne multimillénaire qui existait à travers la Méditerranée. On ne dénoncera également jamais assez les dégâts en terme de vies humaines que cause cette politique de visas (qu’il s’agisse des Algérien-ne-s ne pouvant sortir du pays dans les années 1990 lors de la guerre civile ou des migrant-e-s mourant dans le Sahara ou en Méditerranée depuis 20 ans).
Article librement inspiré du livre « La mondialisation des pauvres – Loin de Wall Street et de Davos » - Armelle Chopin et Olivier Pliez – La république des idées – Seuil 2018.