Ce billet propose une bible utile des manifestes à garder sous la main, à faire circuler ─ selon son degré de courage ─ sous le manteau ou publiquement, comme autant de récits fondateurs, féconds et générateurs d'initiatives citoyennes. Libre à chacun d'enrichir le corpus.
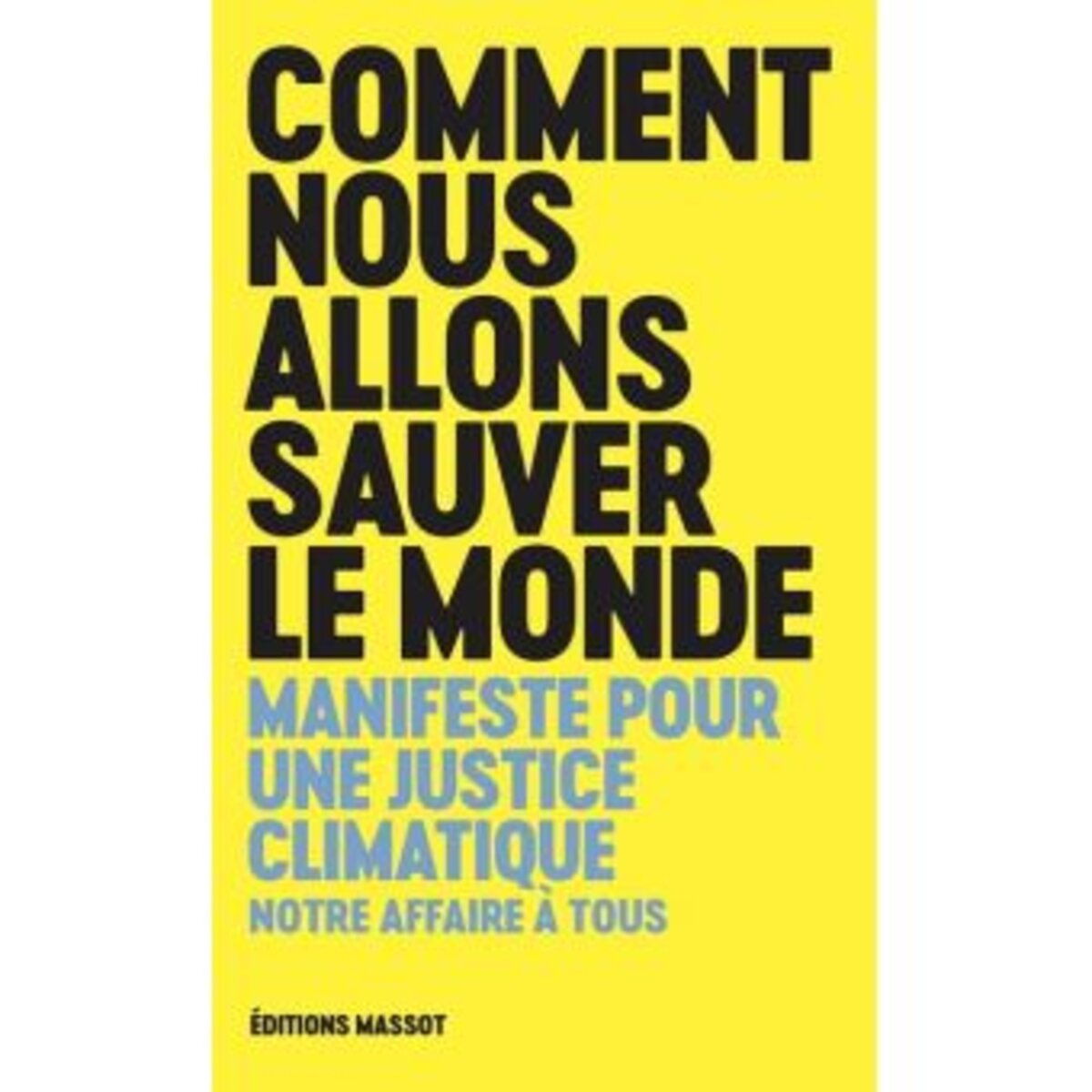
Notre affaire à tous
Le 14 mars 2019 sortait en librairie Comment nous allons sauver le monde (Manifeste pour une justice climatique) publié aux Éditions Massot. Un texte fondateur écrit par le collectif Notre affaire à tous, dont nous avons entendu parler récemment au sujet de « L' Affaire du siècle ». Notre Affaire à Tous, associé à la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont réuni plus de deux millions de soutiens dans le cadre d’un recours en justice contre l’État pour « inaction climatique »[1].
Le collectif ne se contente pas d’une action ciblée, il multiplie les recours juridiques contre les gouvernements, l’Union européenne, les multinationales et invite les citoyens à rejoindre la mobilisation :
« Nous sommes des millions partout dans le monde à comprendre l’urgence, à entendre le compte à rebours sous nos pas et ceux de nos enfants. Une nouvelle génération est là, qui n’est pas définie par son âge, mais par sa façon de tout repenser. Une toile se tisse autour de la planète, c’est le réveil, c’est la vie, le pas déterminé de la jeunesse qui manifeste et crie son inquiétude face à l’avenir qui se ferme. C’est la plainte des agriculteurs contre ceux qui ont empoisonné leur terre et leur corps, la voix forte des tribus des dernières zones préservées qui se redressent, le jugement des tribunaux qui enfin condamnent et donnent des droits à la nature, les scientifiques qui alertent et proposent des pistes pour en sortir. Il est fini le temps où les défenseurs de la planète étaient caricaturés en agents du passé, ils sont ceux du futur. Nous sommes le futur. Nous sommes la dernière génération, la dernière chance donnée au monde. Ce combat-là n’annule aucun des autres, il les contient tous ».
Ce manifeste est « un cri de révolte face à l'inaction dans le pays des droits humains et de l'accord de Paris[2]. En s'appuyant sur de nombreuses études, il fait un constat de l'état de notre planète et démontre la nécessite de se mobiliser »[3].
De l'indignation à l'implication
Après Indignez-vous[4] de Stephane Hessel en 2010 et le plus discret Impliquons-nous (dialogue pour le siècle)[5] d’Edgar Morin et Michelangelot Pistoletto en 2015, un seuil symbolique vient d’être franchi : l’histoire contemporaine ne sera pas écrite par quelques penseurs observant la scène de loin pour dresser le tableau le plus objectif possible, elle s’élaborera collectivement en actes par des praticiens, tout un chacun.
Comme le disaient déjà Edgar Morin et Michelangelot Pistoletto « dans la période de transition historique que nous traversons, le temps n’est plus à l’indignation : il est nécessaire d’envisager une transformation d’envergure planétaire qui exige des changements dans notre façon d’agir et de penser. Impliquons-nous ! »
Vient le temps de la mobilisation, celui des actes, des actes collectifs de grandes envergures tels qu'évoqués par Notre Affaire à tous :
« Finissons-en avec ce nous les humains qui n’avons rien voulu voir, nous les consommateurs aveugles, abreuvés de publicité (...) qui faisons la puissance des lobbies à force d'inertie (...) Créons un Nous de résistance et de vigilance (…) Ne nous contentons pas de boire nos cocktails sans paille, de trier nos déchets, de mettre du bio dans notre assiette, de préférer le train à l’avion. Nos gestes individuels n’y suffiront pas. Nous devons exiger une réplique à la hauteur du drame qui s’annonce. »[5]
Six mesures salutaires
Le collectif appelle à « six actions politiques prioritaires pour réconcilier transition écologique et justice sociale » et lutter contre un système caduc qui provoque « pollution, maladies, inégalités et injustices ». Le programme propose la rénovation énergétiques des logements, le développement des énergies renouvelables et la priorité donnée aux moyens de transports les moins polluants.
Rien de nouveau sous le soleil, diront les détracteurs. En quoi les mesures proposées susciteraient de grands changements ? Ne sont-elles pas des bouteilles à la mer jetées en vain, prêtes à se briser face au raz-de-marée d'un système qui, vivant ses derniers soubresauts, ne veut pas ployer et déclenche la tempête ?
Le manifeste tranche par sa radicalité salvatrice : il appelle à la mise en place d'une fiscalité écologique socialement juste, en s'attaquant aux problèmes structurels. Il réclame la suppression des niches fiscales et avantages fiscaux accordés aux activités et industries polluantes, mais également la fin des cadeaux aux grandes entreprises. Il met l'État et ses représentants face à leurs responsabilités en leur demandant d'assurer leur fonction première, se mettre au service de l'intérêt général. Cette mission ne peut s'opérer qu'en cessant de soutenir des activités climaticides[6] et écocides[7], donc en contraignant les multinationales et les banques, les acteurs principaux des dérèglements.
La légitime défense
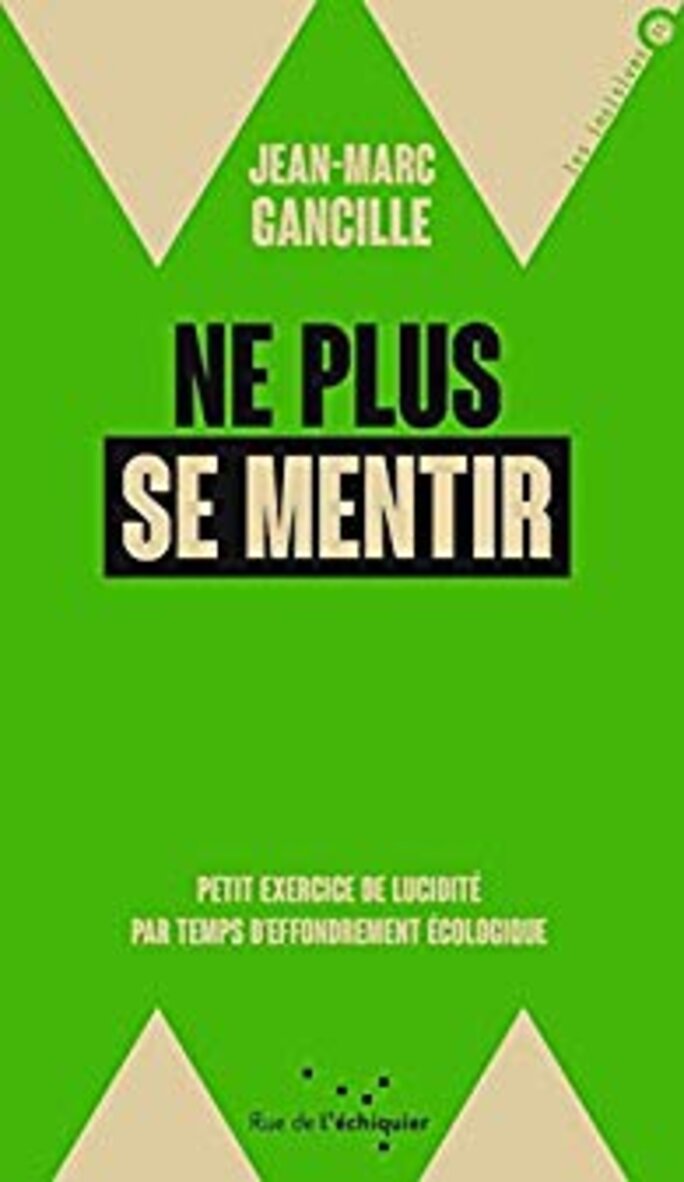
Allons plus loin. Pour les sceptiques, ceux qui targueraient le premier manifeste d'utopiste, une seconde lecture s'impose : Ne plus se mentir : petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique. L'auteur, Jean-Marc Gancille invite à percer les « baudruches idéologiques qui nous font perdre un temps précieux et dépenser de l’énergie en vain ». Il s'agit bel et bien d'exercer une « légitime défense contre le système » : l'action combative et la démonstration de notre force collective face aux intérêts particuliers[8].
« Chercher des manières plus vertes de maintenir le statut quo d’une société marchande qui nous impose de vivre dans le mythe d’une croissance infinie n’est pas une solution…»
Le manuel de résistance contemporaine
Pour ceux que la radicalité effraie, une approche douce s'avère bénéfique pour la santé. Elle s'adresse à ceux « qui croient qu'il est encore temps d'agir pour minimiser les chocs à venir ». Dans un Petit manuel de résistance contemporaine[9], Cyril Dion propose de déconstruire les fondements même de nos sociétés, pour les rebâtir sainement. La fiction « libérale, capitaliste, consumériste » est puissante. Élaborée et alimentée par les films, les articles, les pubs et autres supports, elle a colonisé nos imaginaires en profondeur. D'où la force d'inertie qui nous paralyse. Un travail de grande envergure s'impose ! Et pourtant, c'est d'abord en répertoriant de nombreuses pistes d’actions individuelles et collectives qu'il invite à se mobiliser. Ces actions sont des prises de position, des choix assumés joyeusement qui, mis bout à bout, brisent nos servages.
L’Homme construit son identité individuelle et collective (son passé, son présent mais aussi son futur) par le récit. Il invente des fictions pour se structurer. Il a besoin de modèles de références pour se projeter. Il convient donc d'en établir de nouveaux, plus viables. Penser les alternatives proposées comme des récits, moteurs pour l’évolution de la société n'est pas une gageure. C’est quotidiennement que nous « participons à construire le monde dans lequel nous voulons vivre ». « L’épanouissement personnel et collectif ne se fait pas aux dépens des autres ou de la nature, il contribue à leur équilibre » rappelle l'auteur, optimiste.
« Pour les tenants de l'effondrement, nous pourrions reformuler (...) nous devons préparer l'après-effondrement ; le moyen le plus puissant de calmer l'angoisse et de donner de l'énergie à ceux qui pourraient construire la résilience dès aujourd'hui ou à ceux qui survivront aux chocs de demain est certainement des fictions fondées sur la coopération, imaginant un monde post-catastrophe qui ne soit pas uniquement dystopique mais où les humains apprendraient de leurs erreurs et imagineraient de nouvelles façons de vivre ».[9 bis]
Le marché aux pleurs
Comme l’écrit Georges Didi-Huberman, auteur entre autres de Peuples en larmes, peuples en armes et Quelle émotion ? Quelle émotion![10], nous ne devons pas nous laisser happer par la tristesse ambiante, celle véhiculée par les médias, le « marché aux pleurs ». Nous devons opposer à l'effroi, cette émotion tétanisante, une autre émotion, mouvante.
Facile à dire ! Comment se débarrasser de l'angoisse, chasser la peur ambiante ?
En s'appuyant sur les émotions qui nous saisissent actuellement. Ces « émotions » peuvent devenir des motions , des mises en mouvements ─ selon la traduction anglaise, révéler ainsi notre puissance d’agir. À condition de ne pas nous laisser aller au défaitisme et à la rumination du « depuis des années, c'est le même cirque. Cela ne changera jamais. C'est trop tard ».
En nous délaissant de l'individualisme contemporain, en nous défaisant des diktats de réussite, de course à la richesse, de plan de carrière, en nous saisissant de notre capacité à créer du lien, à rejoindre l'indignation et les émotions des autres pour créer un « nous ». L' émotion féconde dit « nous » afin de se constituer en « praxis »11] : les indignés passent des lamentations individuelles puis collectives à la colère, puis de la colère au soulèvement. Naît alors ce que le philosophe et penseur appelle le « peuple en armes de la révolution qui vient ».[12]
Le Petit guide
Les meilleurs armes ne sont pas celles de la violence, pas celles qui conduisent à la destruction, mais celles du sens commun, de la lucidité, de l'esprit critique et de la créativité. La réhabilitation du monde dépend de ses qualités.
Aucun angélisme. Construire des « à-côté » du système est vain. Le système happe ou dévore irrévocablement les refuges temporaires. Il faut déployer des stratégies pour rouiller la machine, la mettre hors circuit, la stopper dans sa déroute puisqu'elle nous précipitera avec elle dans un abîme, si ce n'est pas déjà le cas.
Comme le dit Vincent Verzat, un activiste pacifique de la chaîne Partagez c'est sympa, « Il faut changer de game ». [13] Le Petit guide (pour plus d'autonomie, de créativité, d'efficacité, de radicalité et de solidarité dans la lutte) de ce collectif est d'une efficacité redoutable. En un schéma de deux pages d'une simplicité absolue, il nous offre des outils pratiques « en vue de déconstruire nos habitudes, d'inventer des stratégies et des modes d'action » militantes et non violentes.
Nous avons les solutions, chacun de nous à des solutions à développer, elles restent encore à inventer. Pour vivre heureux, ne vivons pas caché(e)s. Assumons la vertu du militantisme. Assumons la vertu de l'activisme pacifique. Assumons la vertu de la désobéissance civile. Des vertus cardinales, génératrices de justice, d'une justice rendue contre ce et ceux qui dévorent la Nature, contre ce et ceux qui broient les hommes, d'une justice sociale et climatique. Comme le prône le collectif Notre Affaire à tous, soyons « des perturbateurs », « essaimons », « fondons notre bonheur sur le combat ». Le combat : incarner « l’intérêt général puisque les gouvernements l’ont depuis longtemps oublié ».[14] Cette affaire est la nôtre. Emparons-nous d’elle.
Sarah Seignobosc
[1] Plus d’informations sur le site internet : https://notreaffaireatous.org/
[2] « L' accord de Paris » est le premier accord universel sur le réchauffement climatique. Il fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la Conférence de Paris sur le climat (COP21) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Depuis sa création en 2015, 197 délégations ont signé ou se sont engagées à le signer, ce qui fait de ce texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité, comme le résume la présentation Wikipédia. Malgré la mobilisation, peu d’États tiennent leurs promesses. Pour exemples, les émissions françaises de CO2 ont augmenté de 1,7% en 2017 par rapport à 2016, au lieu de diminuer. Les engagements pris pendant « l’accord de Paris » ne sont pour l’instant pas suivis.
[3] Extrait tiré de la présentation de Comment nous allons sauver le monde (Manifeste pour une justice climatique) publié aux Éditions Massot.
[4] Source Wikipédia : Cet opuscule, d'une trentaine de pages défend l'idée selon laquelle l'indignation est le ferment de l'« esprit de résistance ». Il appelait à un engagement personnel, à ne pas accepter le creusement des inégalités de richesse, critique la politique d'immigration, regrettait le poids du monde financier dans les choix politiques et dénonçait l'affaiblissement de l'héritage social du Conseil national de la Résistance (sécurité sociale et régime de retraite).
[5] Publié chez Actes Sud en octobre 2015, ce manifeste invite à s’impliquer activement dans les grands enjeux du siècle à venir. Il se présente sous forme d’un dialogue ou débat d’idées entre le penseur français et l’artiste italien fondateur de la Cittadellarte, un laboratoire d’art et de créativité dont les initiatives ont pour objet la mise en œuvre d'interventions artistiques dans toutes les sphères de la société civile.
[6] Définition du terme « climaticide » selon la source Wikipédia : dérèglement organisé et planifié du climat mondial du fait des émissions croissantes de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère alors même que la responsabilité humaine du réchauffement climatique est désormais avérée à la suite de la publication des rapports du GIEC (le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l'ONU).
[7] Définition du terme « écocide » selon la source Wikipédia : néologisme construit à partir des mots « écosystème » et « génocide ». Ce mot a pour racine « Eco » qui en grec « ΟΙΚΟΣ » signifie la maison et « cide » du latin « occidere » qui signifie tuer. L'écocide désigne un acte de destruction ou d'endommagement important d'un écosystème lié à un facteur anthropique, notamment par l'exploitation excessive de celui-ci dans le but de subvenir à d'autres processus ou systèmes. Le concept de crime d'écocide est débattu depuis 1947 au sein de la Commission du droit international pour préparer le Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
[8] Le livre est publié aux Éditions Rue de l'échiquier. Date de parution : 3 mars 2019.
[9] Le Petit Manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion est publié dans la collection « Domaines du possible » aux Éditions Actes Sud. Date de parution : mai 2018.
[9 bis] Extrait de Le Petit Manuel de résistance contemporaine.
[10] Quelle émotion! Quelle émotion? est disponible dans la collection " Les petites conférences" chez Bayard depuis 2012. Peuples en larmes, peuples en armes paraît aux Éditions de Minuit en 2016.
[11] Définition usuelle du terme « praxis » : action en vue d'un résultat pratique. Du grec, « π ρ α ξ ι ς » et « π ρ α ́ σ σ ω » qui signifient « action » et « agir ».
[12] Extrait de Peuples en larmes, peuples en armes de Georges Didi-Huberman publié aux Éditons de Minuit en 2016.
[13] Consulter le billet « On change le game » de Partager c'est sympa. Pour télécharger le Petit Guide : https://ieet.fr/PetitGuide. Pour voir la vidéo qui a initié ce guide : https://youtu.be/lvdckQKKz_Q
[14] Extrait du Manifeste pour la justice climatique du collectif Notre Affaire à tous.



