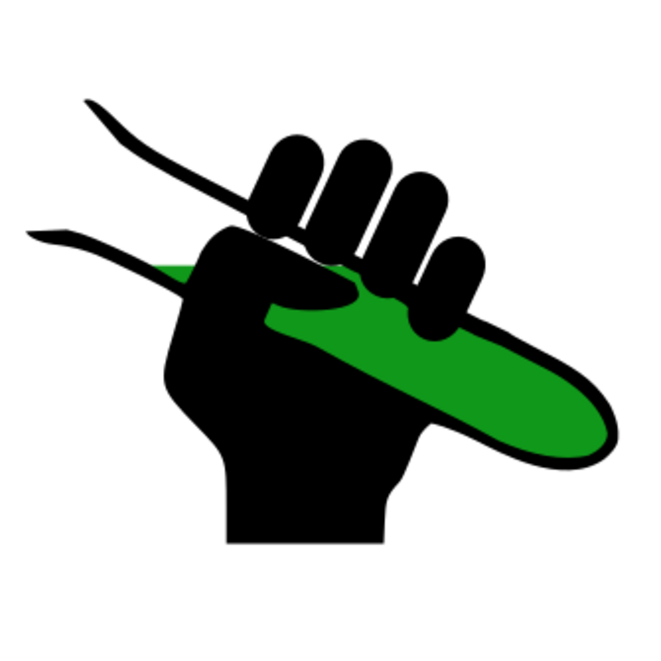Ce texte est la version longue d'une tribune parue dans Libération le 25 février 2025 et signée par plus de 400 scientifiques. La présente version contient des sources, plus de détails, ainsi que des réflexions complémentaires.
Contexte
Le CERN (organisation européenne pour la recherche nucléaire), à la frontière franco-suisse, est le plus grand centre international de recherche en physique des particules. Il a été créé en 1954 avec 12 états-membres, et en compte actuellement 24. Sa plus grande infrastructure actuelle, le LHC (Large Hadron Collider), est un anneau circulaire enterré de 27 km de circonférence qui a permis en 2012 de démontrer l’existence du boson de Higgs, une particule responsable de la masse de toutes les particules élémentaires constituant la matière. Aujourd’hui, le CERN défend un projet visant à construire un tunnel beaucoup plus grand, de 90 km de circonférence, destiné à héberger successivement deux équipements qui fonctionneraient jusqu’à la fin du siècle : le FCC-ee (2045-2070) et le FCC-hh (2070-2095).
L’étude de faisabilité de ce projet, en cours depuis 2021, doit se terminer au printemps 2025. Le CERN a commencé à communiquer auprès du grand public, notamment auprès des habitant·e·s de la région concernée par l’éventuelle construction, à savoir Genève, le pays de Gex et la Haute-Savoie, suscitant la réaction de collectifs comme Co-CERNés, ou Noé21 qui a élaboré une contre-expertise détaillée. La décision du lancement du projet sera prise par les états membres du CERN en 2027-2028, pour une mise en chantier envisagée dans les années 2030. Il existe actuellement un projet concurrent, lancé par la Chine, les États-Unis ayant annoncé qu’ils n’en construiraient pas un sur leur territoire mais seraient prêts à s’impliquer dans une future « usine à Higgs » ailleurs.
Un projet démesuré
Le CERN était jusqu’à récemment particulièrement discret quant au FCC, mais dorénavant la transparence est de mise sur l’ensemble des aspects techniques, ce qui permet de mesurer le gigantisme du projet dont le coût de construction est estimé à 16 milliards d’euros (pour la seule phase FCC-ee). Les défis sont considérables, avec 16 millions de tonnes de matériaux à excaver et stocker en surface, un passage du tunnel sous le lac Léman dans une région sismique, une consommation énergétique évaluée à 1,4 TWh/an en moyenne pour la seule phase FCC-ee et 4 TWh/an (l’équivalent de la consommation de presque 2 millions de Français, ou un peu moins de 1% de la production électrique française) à pleine puissance en phase FCC-hh, nécessitant un refroidissement hydraulique à la hauteur. Le collisionneur engendrerait de fortes émissions de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie, dont le chiffrage en millions de tonnes ou dizaines de millions de tonnes reste à établir. Enfin, l’extraction des quantités gigantesques de métaux nécessaires aurait des impacts indirects dans les pays fournisseurs : dommages humains, environnementaux et sociaux, le plus souvent irréversibles, avec une large emprise temporelle et géographique.
Pourquoi construire le FCC ?
Selon les physicien·nes défendant le projet, le FCC, projet-phare du CERN, s’inscrit dans une stratégie reposant sur « un plan visionnaire et concret qui permette de faire avancer de manière importante la connaissance humaine dans le domaine de la physique fondamentale ». La construction de cette infrastructure permettrait d’éprouver le Modèle Standard – la théorie décrivant actuellement le comportement des particules élémentaires – dans des gammes d’énergie qui n’ont jamais été atteintes jusqu’à présent. Tout résultat expérimental qui dévierait de cette théorie indiquerait la nécessité d‘une nouvelle théorie. Ces expériences permettraient également de mieux comprendre le Big Bang.
Du point de vue épistémologique, le FCC serait un objet bien différent du LHC. Son prédécesseur avait pour objectif de finaliser la validation expérimentale du Modèle Standard, en découvrant dans un domaine d’énergie où l’on s’attendait à le trouver - s’il existait - le boson de Higgs, dernière particule du modèle qui restait à observer. Ce qui se passe dans le domaine des plus hautes énergies est bien plus incertain : si des théories actuelles envisagent l'existence de nouvelles particules, l'énergie nécessaire pour les produire est incertaine. Il est tout à fait possible que, dans les expériences qui seraient réalisées au FCC, le Modèle Standard soit vérifié, sans autre découverte. Si les attentes scientifiques reposent pour l’instant sur des spéculations, le FCC aurait en revanche des impacts écologiques et sociaux bien réels à court terme.
Un pari risqué
Les promoteurs du FCC, dont la construction et l’exploitation s’étaleraient sur plusieurs décennies, escamotent un certain nombre de risques. Le premier est d’ordre financier. A ce stade l’Allemagne, un des principaux contributeurs du CERN, juge le plan de financement extrêmement vague et a exprimé ses réticences à s’y associer. De plus, l’histoire des grandes infrastructures est jalonnée d’importants dépassements budgétaires : le LHC a par exemple vu son coût final augmenter de 50% par rapport au budget initial ; l’expérience de fusion nucléaire ITER voit son budget à mi-parcours multiplié par trois par rapport aux estimations initiales ; avant d’être abandonné au cours de sa construction, le projet américain cousin du LHC (le SSC pour Superconducting Super Collider) avait vu son budget prévisionnel plus que doubler. Par ailleurs, les équipements du FCC nécessiteront des quantités considérables (non divulguées à notre connaissance) de métaux critiques. Le cuivre illustre très clairement la menace : son prix a augmenté de 130% l’année dernière face à la forte demande, et l'American Copper Council prédit une multiplication par plus de 15 dans la prochaine décennie, alors qu’en parallèle l’IFPEN estime que 78 à 89% des ressources connues seront consommées d’ici 2050 afin de se conformer aux politiques climatiques de production d’énergies renouvelables. Dans de telles conditions, il paraît hasardeux d’équilibrer un budget en supposant que le prix du cuivre ne va pas s’envoler, et que l’offre permettra de satisfaire la demande de tous les acteurs.
Plus généralement, nous entrons dans une période d’incertitude pour nos sociétés, leur stabilité et les conditions de vie : réchauffement climatique, ravages écologiques, tensions sur l’énergie et les ressources, hausse des rivalités régionales, paupérisation des classes moyennes, explosion des dettes publiques et hausse des populismes rendent les projections sur l’avenir plus hypothétiques que jamais. Le FCC s’inscrit mieux dans le paradigme de croissance continue et de stabilité géopolitique que dans un régime chaotique, hypothèse d’autant plus hardie au regard des échéances longues du projet, de quelques décennies pour la phase FCC-ee, au-delà de 2070 pour la phase FCC-hh. Il n’est donc pas inconcevable que la première étape, le FCC-ee, soit aussi la dernière, et que le reste du projet soit abandonné, alors que l’ensemble des dépenses et des dommages liés à sa construction resterait bien réel.
Des justifications qui peinent à convaincre et font diversion
Les réponses des communicant·es du CERN aux différentes objections formulées sur ce projet peinent à convaincre car elles témoignent d’une pensée en silo, qui ne tient pas compte du contexte général d’urgence écologique. Prenons le seul exemple de la consommation énergétique. Des énergies renouvelables y pourvoiront, nous dit le CERN ? Outre le fait que leurs impacts environnementaux et sociaux ne sont pas nuls, cette ressource énergétique est aussi limitée : si elle est destinée au FCC, elle n’alimentera pas de trains, de pompes à chaleur ou d’autres infrastructures nécessaires à la transition énergétique. Des progrès technologiques diminueront la consommation ? C’est possible, mais la consommation restera élevée dans l’absolu malgré les efforts. Qu’importe, nous dit-on, la chaleur produite par les installations sera valorisée pour chauffer des logements. Pourtant, les résultats des études commanditées par le CERN pour la seule phase FCC-ee sèment le doute sur cette possibilité : déphasage entre production et demande, faible densité linéaire de chaleur produite, taux de valorisation médiocres, stockage énergétique complexe. Malheureusement, il est plus probable que les TWh annuels du FCC soient en grande partie refroidis par des eaux de surface qui seront ensuite partiellement évaporées ou réinjectées en surface, à moins que le refroidissement n’opère en circuit fermé.
Conscient·es d’une pertinence scientifique de niche et de son coût faramineux, les dirigeant·es du CERN sont tenté·es de justifier leur projet auprès des financeurs et des politiques en invoquant des bénéfices collatéraux. C’est ainsi que, lors de la présentation publique du projet, Raphaël Bello, directeur des finances et des ressources humaines du CERN, mobilise des justifications comme le rayonnement touristique (avec la construction d’un grand musée destiné à attirer du public et à servir de vitrine aux travaux du CERN), les retombées économiques, la formation, la concurrence et le leadership… De tels arguments ne tiennent pas. Prenons le cas de l’emploi : l’invoquer permettrait de justifier n’importe quelle activité (construction de plateformes pétrolières, élevage industriel…), quel que soit son impact écologique. Le tourisme, quant à lui, participe de façon de plus en plus alarmante aux émissions de CO2. Quant à la défense du leadership, l’idée de gagner une course avec la Chine depuis son annonce du projet concurrent CEPC nous semble contraire à l’esprit de coopération qui devrait animer la communauté scientifique : si l’objectif est vraiment d’apporter des connaissances fondamentales en physique, qu’importe si ces découvertes sont faites en Chine ou en Europe.
Un projet de research-as-usual
Les appels des scientifiques spécialistes du climat et de la biodiversité sont clairs : il nous faut rapidement et immédiatement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ainsi que nos impacts sur le vivant. Ces recommandations ont été traduites par des accords internationaux comme l’Accord de Paris ou par des politiques européennes visant à un arrêt de l’artificialisation des sols. De plus en plus de scientifiques considèrent que la recherche doit faire sa part dans cet effort, comme le montre le succès des propositions du collectif Labos 1point5, les réflexions qui émergent en astrophysique ou en Sciences de la Terre, ou les prises de position des comités d’éthique d’organismes de recherche. Comme dit dans la prospective CNRS en physique, il n’y a aucune raison que la physique des particules reste en dehors de l’introspection à laquelle est conduite la communauté scientifique.
Allons-nous continuer la recherche ?
Le cas du CERN et de la physique des particules démontre, avec le projet du FCC, les contradictions qui traversent le monde scientifique en général : comment pourrions-nous demander une réduction radicale des impacts écologiques des activités humaines en maintenant nos activités scientifiques, en toute inconséquence ? Pour autant, nous n’appelons pas seulement à un devoir d’exemplarité ou de cohérence. Puisque la réorientation ou le ralentissement de telles activités de recherche ne mettent en péril aucune activité vitale, la recherche constitue un excellent terrain d’expérimentation des transformations nécessaires partout ailleurs. Le CERN a démontré pendant des décennies une très grande créativité et développé d’extraordinaires capacités, à la fois techniques et en termes de coopération internationale. Nous ne doutons pas qu’il puisse se réinventer et proposer d’ambitieux projets alternatifs au FCC, soit en exploitant différemment les infrastructures actuelles, soit en s’investissant dans d’autres objectifs scientifiques plus directement liés aux crises environnementales.
Questionner le FCC ouvre ainsi la boîte de Pandore et rejoint les interrogations formulées par Alexandre Grothendieck. Considéré par beaucoup comme le plus grand mathématicien du XXe siècle, il donnait en 1972 au CERN une conférence iconoclaste, intitulée « Allons-nous continuer la recherche ? ». A cette époque, Grothendieck s’inquiétait surtout des applications militaires de la recherche. Aujourd’hui les impacts environnementaux, par leurs effets directs (les infrastructures) ou indirects (ses applications), s’y adjoignent naturellement parce que ces dommages sont dans les deux cas conçus comme des externalités de la production scientifique, alors qu’ils sont bel et bien consubstantiels de la production scientifique contemporaine.
Il ne s’agit pas d’appeler à cesser toute forme de recherche fondamentale, mais plutôt de questionner ce qui est pris pour une évidence : l’idée qu’une recherche « pure », noble, justifierait la mise à disposition de tous les moyens que ses spécialistes jugent appropriés, sans que les citoyen·nes ordinaires ne participent à la décision. Est-il judicieux d’allouer au fonctionnement du FCC une énergie équivalente à celle d’un petit réacteur nucléaire quand la décarbonation énergétique est à la peine ? Est-il pertinent d’allouer autant de moyens financiers et humains au FCC alors que de larges pans de la recherche directement en prise avec l’urgence écologique - en particulier dans les sciences humaines et sociales - sont ignorés, et que le projet lui-même va contribuer à la destruction du vivant ? Si les humains ont la sagesse dans les décennies qui viennent de prendre des décisions permettant d’éviter de rendre la terre inhabitable, notre espèce aura encore des dizaines de millions d’années devant elle pour tenter d’élucider les premières microsecondes suivant le Big-Bang. Ou peut-être que cette parcelle de connaissance nous restera à jamais inaccessible, et qu’il nous faudra réussir à l’accepter ?
Un appel à la réflexion collective
Le CERN organise actuellement des réunions d’information au sujet du FCC, mais sans que son bien-fondé y soit questionné. Pourtant, il nous semble que les discussions autour de l’opportunité de ce projet et, plus largement, la réflexion sur la recherche scientifique à l’heure de l’Anthropocène, concernent l’ensemble des citoyennes et citoyens. Nous, scientifiques, pensons qu’il faut savoir renoncer au FCC jusqu’à la résolution de la crise environnementale, afin de prendre le temps d’une réflexion collective et élargie sur l’ensemble des enjeux soulevés par ce projet, mais aussi au-delà, sur la place de la science dans la société viable, équitable et conviviale que nous souhaitons voir éclore.