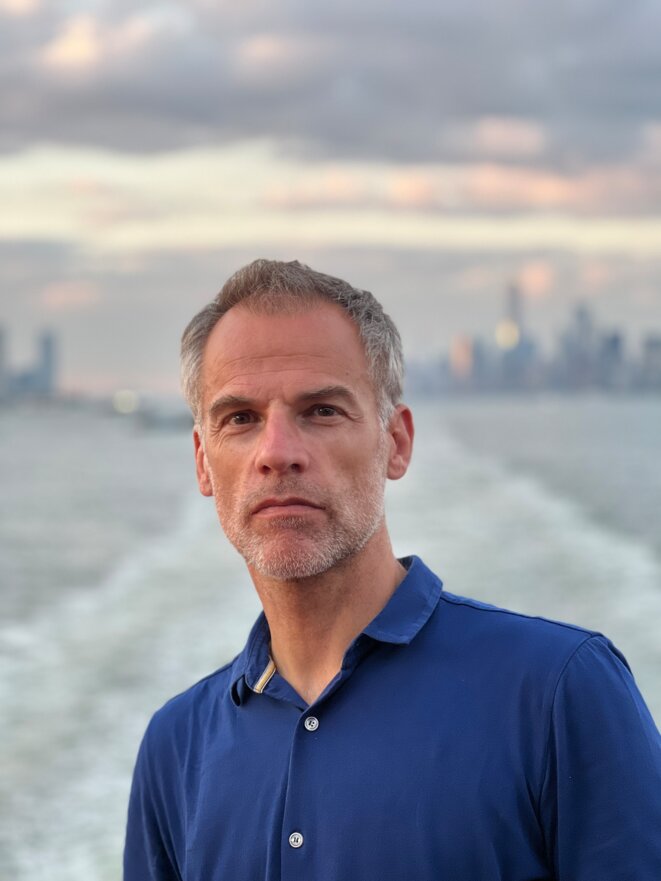Un aspect important de l’histoire du sport réside dans sa fréquente proximité avec la guerre, et par suite dans les rapports du sport à la violence.
Les pratiques sportives de combat, à main nue ou avec arme, sont très répandues. Si elles deviennent un jeu, puis s’orientent vers une logique sportive, elles sont généralement le fruit de l’entraînement à la guerre, parfois de sa répétition générale.
Un combat ou une compétition ne sont pas une guerre
La lutte ne connaît probablement pas d’égale. Toutes les civilisations en proposent une déclinaison. C’est dans le sens que prend cette pratique que portent les interrogations. Du Sumo du Japon médiéval, à la musculation traditionnelle de la "zourkhaneh" (maison de force en persan qui puise ses racines dans la société martiale de la Perse préislamique), des ancêtres du judo, du taekwondo, cher à la Corée du Sud, du Ju-Jitsu qui traversent les frontières et les océans de l’Asie à la lutte en Egypte, ou au pugilat minoen et gréco-romain, l’affrontement brut des corps, sans artifice, semble être une constante de la condition humaine.
Un même matériel
Empruntant au matériel et à l’esprit guerrier, de nombreuses activités sportives voient également le jour, du sabre ou du Kyudô (tir à l’arc) japonais au chevalier jouteur jusqu’à l’escrime et aujourd’hui le biathlon. Il y a dans ces activités une volonté manifeste d’exprimer la violence tout en la contenant.
L'exemple des tournois du Moyen âge montre que les mêmes hommes s'affrontent à la guerre et dans les tournois puis les joutes. Pour autant, l'évolution du matériel, qui devient clairement distinct entre l'armure et la lance de joute et celles de la guerre, indique une différence fondamentale : dans un cas la mort de l'adversaire est un paramètre largement envisageable, dans l'autre, il s'agit à tout prix de l'éviter (même si les dérapages et les accidents subsistent ça et là).
Civiliser la violence ?
Norbert Élias considérait le sport comme un mode original pour civiliser la violence, pour structurer le champ social et participant du « jeu diplomatique international ». Peut-être est-il allé un peu vite. Activité préparatoire, exutoire, substitut, outils politique de contrôle, annonceur ou continuateur de la violence : sport et violence sont connectés sans que rien ne permette à ce jour d’établir des conclusions définitives sur de réels liens de cause à effet.
Encore faut-il s’accorder sur une définition de la violence qu’on peut envisager comme le propose le sociologue Michel Wieviorka dans La violence (2004) : « atteinte par la force à l’intégrité physique, intellectuelle ou morale d’une personne (…) qui s’applique à d’innombrables phénomènes (…) toutes sortes d’événements et de conduites individuelles ».
De cette proximité entre sport et violence, on comprend les nombreuses tentatives du politique pour canaliser la violence sociale vers les terrains de jeu. Les expériences menées aboutissent à des résultats mitigés mais permettent de s’interroger sur le rôle des fêtes sportives comme éventuels substituts à la violence ou à la guerre, reportant les conflits sur des terrains plus acceptables.
Par ailleurs, comme l’écrit l'historienne Claude Gauvard dans Violence et ordre public au Moyen Âge (2005) : « Le concept de violence appartient à l’historien, avec tout ce qu’il contient d’arbitraire mais aussi de mollesse, car sa place aux côtés de la force, de l’agressivité, de la contrainte et de la domination se révèle effectivement incertaine ».
Qui a vécu la guerre...
Pour celle ou celui qui a vécu la guerre, l'affirmation, « le sport, c'est la guerre » étonne. Elle lui semble même ridicule. Le discours médiatique, qui a compris qu'il avait à faire, comme au temps des gladiateurs, à un public avide de sang, n'est pas avare en comparaisons, paraboles et images. Le sport ne repose pas sur une logique de domination définitive ni de destruction de l'autre.
Le sport n'est pas la guerre même si leurs chemins se croisent régulièrement.
Chemins croisés
Le dernier avatar est celui de l'usage politique du sport dans la guerre et la place des athlètes russes et peut-être biélorusses dans les J.O. de Paris de 2024. Une chose est sûre : sport et guerre se croisent et la charte olympique n'est pas respectée...
Tout comme la guerre semble être une composante anthropologique de l'être humain, incapable de maitriser ses pulsions de domination, le sport apparait également comme une autre composante de l'être humain.
L'art pariétal plusieurs fois millénaire tout comme les premiers écrits montrent que dès que l'homme peut s'exprimer sur sa condition d'être humain, le sport n'est jamais loin, n'en déplaise à Gilgamesh et son ami / adversaire à la lutte Enkidu.