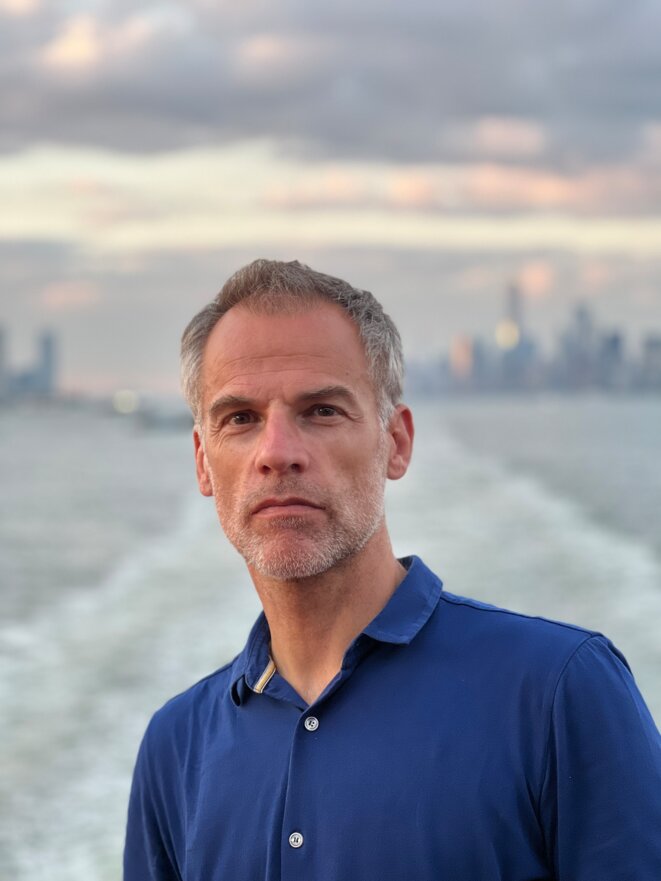Lorsque le Circus Maximus de la Rome antique accueillait jusqu’à 300 000 personnes pour assister aux courses de char, le pouvoir politique savait qu’il ne pouvait manquer l’événement et même qu’il devait essayer de l’utiliser à son compte. Dans Le pain et le cirque, sociologie historique d'un pluralisme politique (1976), Paul Veyne écrivait pour Rome que « le gouvernement n’accordait pas du Cirque au peuple pour le dépolitiser mais, à coup sûr, il l’aurait politisé contre lui s’il lui avait refusé le Cirque ».
Un rôle d'apaisement ?
Il est probable que le sport joue un rôle politique d’apaisement sans qu’on puisse considérer les rencontres comme des instruments parfaitement contrôlés des machines gouvernementales.
« Granz deporz est de veoir con fet trabuchier et cheoir chevax et chevalier ansanble » écrit Chrétien de Troyes dans Le chevalier de la Charrette (fin XIIe siècle) lorsque Lancelot renverse successivement tous les chevaliers lors du tournoi de Noauz.
Le spectacle du sport a intégré des pans entiers de notre culture sans qu’on s’en aperçoive toujours. « Qu’on en critique les dérives ou qu’on s’en émerveille, le sport est unanimement reconnu comme un spectacle », écrit Georges Vigarello (Du jeu ancien au show sportif, la naissance d’un mythe, Paris, 2002). S’il se pratique, il est également destiné au regard des spectateurs qui peuvent être saisis par une performance, la beauté gestuelle ou une attitude hors du commun. Le sport offre ainsi des temps et des lieux de rassemblement. Tantôt pratiqué sur des installations qui lui sont entièrement consacrées, tantôt organisé dans des endroits aménagés spécialement pour l’occasion, le sport se pratique, se regarde, se décrit et se commente. Chaque grand événement est mis en scène avec attention. Le plaisir des yeux des spectateurs est primordial en même temps que le suspens doit les maintenir en haleine. Les organisateurs, largement aidés par les différents médias, s’ingénient à présenter les sportifs en héros, tels les gladiateurs antiques. Organisateurs, sportifs, spectateurs : cette communauté d’individus partage des références culturelles et sociales. Autour du spectacle sportif, un pan entier de culture partagée se dessine. Le héros, tantôt humain auquel le public peut s’identifier, tantôt presque "inhumain" indiquant le chemin de la perfection, partage son talent, son jeu, son temps avec le public. Même pratiqué seul et à l’abri des regards, le sport fait encore fonctionner l’imaginaire à travers la figure du champion idéal.
Sans considérer le sport comme un organe de transmission directe des décisions politiques, il s’agit d’une arène politique, parce que la plèbe et son souverain y sont face à face. Le spectacle du sport s’envisage donc comme partie prenante du processus de représentation et de structuration du pouvoir.
La rencontre sportive est un moment de personnification du pouvoir. Lors de la sédition Nika en 532, l’empereur Justinien avait failli faire les frais du mécontentement du public à l’hippodrome.
La sédition Nika : 1500 ans de politisation du sport !
Aux premières heures du Moyen Âge, d’intenses activités de jeux sont données à Constantinople. L’épisode de la sédition Nika, soulèvement populaire dans la capitale de l’empire romain d’Orient, fait vaciller le trône de Justinien en 532. Les témoignages de Jean Malalas, Procope de Césarée, Théophane le Confesseur et du Chronicon Paschale aident à comprendre comment la révolte éclate à l’occasion des courses annuelles du mois de janvier à l’hippodrome. Parmi les épreuves sportives qui se tiennent régulièrement, les courses de char ont attiré beaucoup de monde. Les ligues de supporters, reconnaissables à leur couleur, sont constituées en reflet des rivalités socio-économiques locales. Les partisans des Verts, qui appartiennent aux franges populaires de la population, sont mécontents, peut-être en raison de la pression fiscale que l’empereur fait peser sur eux. Ils le font savoir dans l’enceinte sportive en se retirant tous simultanément des tribunes. Avant de signifier publiquement leur désaccord, les Verts avaient pris soin de présenter des doléances à l’empereur, sans succès. Inquiet de la tournure des événements à l‘hippodrome et mesurant le danger de la situation, Justinien fait saisir des meneurs, bientôt condamnés à mort. En réponse, dans une alliance de circonstance des Verts avec les Bleus, ceux-là plutôt d’origine patricienne, toute la ville se trouve en flamme et en proie à l’agitation pendant cinq jours. Les Verts proclament un nouvel empereur, Hypatios. Justinien ne devra son maintien qu’aux troupes du général Bélisaire, stationnées à quelques kilomètres de la ville, revenues in extremis. Elles massacrent les Verts, pris comme dans une nasse, alors qu’ils s’étaient réunis dans l’hippodrome, haut lieu de la représentation du pouvoir impérial.
Du pain et des jeux... enfin presque.
L’immixtion du sport dans le jeu politique, économique et social d’une société n’est pas un phénomène nouveau ni réservé à une aire géographique. On pourrait s’en tenir à ces mots de Juvenal qui écrivait au IIe siècle de notre ère dans sa 10ème satire : « panem et circenses », devenue une maxime prête à l’emploi pour expliquer toute situation, d’hier ou d’aujourd’hui, qui met en relation le spectacle du sport et le pouvoir politique. L’expression populaire « Du pain et des jeux » qui en découle signifierait qu’il suffit pour gouverner les masses de les distraire et les nourrir. L’interprétation est discutable : dans Le Pain et le Cirque. Sociologie historique d'un pluralisme, Paul Veyne a montré que des phénomènes sociaux beaucoup complexes sont à l’œuvre et que les rapports entre sport et pouvoir, entre sport et société, entre sport et individus, ne sont pas réductibles à un slogan, à une séquence médiatique, ni à ce qu’on en perçoit de prime abord dans les grandes compétitions internationales et les exploits des champions.

Agrandissement : Illustration 1

En 2023, le président de la République Emmanuel Macron, avec des conséquences moindres, a subi les sifflets copieux du public au stade de France lors du match d’ouverture de la coupe du monde de rugby. Le revers de la médaille en quelque sorte. Et aussi un enseignement : qui croit embrigader son peuple par le sport peut se bruler...
Cependant, en dépit de quelques accrocs, la fête sportive est une occasion de souder quantité de soutiens, de partisans, autour d’un leader. Le sportif véhicule parfois une image de force, de puissance, de domination, de laquelle on essaie de tirer vers soit quelques fruits.
Que dire d’une équipe sportive et sa force d’entraînement… Une équipe de sport est parfois jusqu’à l’excès le ciment d’une identité nationale. Dans l’Italie fasciste comme dans l’Argentine des colonels, les victoires des équipes nationales de football ont servi la propagande. Nombre d’édiles locaux ou de capitaines d’industrie utilisent leur position à la tête d’un club pour promouvoir leur image ou asseoir leur pouvoir. C’est également une manière d’occuper le terrain médiatique. Un possible paravent à l’émergence d’autres sujets. Partout le sport pointe son nez sur la place publique, bien plus au large que dans les seuls étroits terrains et stades !
Un rapport d’information du Sénat intitulé « Sports, argent, médias » (2004), rapporte les propos du sociologue Patrick Mignon : « le sport tel qu'il existe exprime parfaitement, dans la mesure où il est spectacle, la relation qui le lie à la société qui l'a vu naître : il s'agit d'exprimer et de mettre en scène les valeurs cardinales de la société, ce que sont les egos et ce qu'est la justice. En effet, le sport est une activité où s'affrontent des egos et dans laquelle le résultat est incontestable puisque cela obéit à des règles valables pour tous ».
Les relations entre sport, spectacle et pouvoir sont très anciennes.
Des pharaons égyptiens représentés en train de courir aux chevaliers joutant devant l'arène politique, les relations entre sport, spectacle et pouvoir sont permanentes. Le moment médiéval des joutes est particulièrement éclairant à ce sujet :
Les dynamiques sportives sont sollicitées dans l’établissement des relations entre élite dirigeante et population. Elles le sont également dans le jeu politique mondial. Le sport est de longue date un outil de diplomatie et de relations internationales.
Plusieurs siècles avant notre ère, les femmes et les hommes s’éprouvent en Chine dans de nombreuses pratiques, entre gymnastique, activités d’entretien et préparation militaire. Plusieurs sports de combat ou jeux de balles peuvent être recensés. Cependant, la précipitation avec laquelle la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a reconnu en 2006 le cuju (jeu de balle chinois) comme premier ancêtre du football montre que même l’histoire du sport n’est pas à l’abri, si ce n’est d’instrumentalisation, des dernières modes ou dynamiques politiques. On peut observer quantité d’usage du sport à des fins diplomatiques, de Thucydide qui décrit les Jeux Olympiques de 428 avant notre ère comme « un temps de contacts diplomatiques pendant cette trêve sacrée qui n’exclut pas les querelles liées à la guerre » (du Péloponnèse) jusqu’à la guerre commerciale actuelle entre les pays de la Péninsule arabique, à qui s’achètera les plus grandes stars du football pour leur championnat respectif, afin de prouver à leur peuple que leur pays est le meilleur, pour se singulariser dans la surenchère médiatique et s’affirmer dans le concert des nations et pour prouver sa supériorité financière, valeur cardinale de la géopolitique mondiale.
Le sport est politique mais les politiques ne le savent pas...
Les lieux, les institutions, les femmes et les hommes de pouvoir essayent ainsi de retirer des bénéfices politiques ou diplomatiques du sport. Ce n'est pas nouveau. Les Jeux Olympiques et la lutte fiévreuses entre maire de Paris, présidente de la Région Ile de France et Gouvernement en sont une illustration. L'instrumentalisation de la compétition pour affirmer la domination du camp de la bienveillance - l'Occident - contre les méchants - Russes ou Biélorusses, avec le risque d'un effet contraire à celui escompté, est bien là. L'entorse aux règles de l'Olympisme est peu de chose tant qu'elle satisfait aux jeux du spectacle et du pouvoir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur le sujet, il est difficile de faire l'économie de la lecture de La société du spectacle de Guy Debord (1967), structuré comme suit :
- I. « la séparation achevée »
- II. « la marchandise comme spectacle »
- III. « unité et division dans l'apparence »
- IV. « le prolétariat comme sujet et comme représentation »
- V. « temps et histoire »
- VI. « le temps spectaculaire »
- VII. « L'aménagement du territoire »
- VIII. « la négation et la consommation dans la culture »
- IX. « l'idéologie matérialisée »