Le premier, trapu et au débit de parole vif, certainement un ailier, porte un t-shirt blanc sans marque mais avec une croix bien apparente. Avant de commencer à parler, il lance un petit coup de tête accompagné d’un regard vers la porte où les affiches de la France Insoumise étaient placées : « Je peux vous parler cinq minutes ? » dit-il très poliment.
« Bien sûr » lui dis-je avec le sourire.
J’avais repéré le groupe trente minutes avant. C’était quand les derniers militants finissaient de ranger les boissons, affiches et banderoles. Ils étaient une petite dizaine, peut-être huit, à être passés devant la Maison du Peuple pour se diriger vers Giotto Pizza, pour y célébrer la victoire face à l’équipe des Angles (24-22). Leurs voix s’étaient faites plus basses devant les militants, certains se taisaient même alors que les éclats joyeux se faisaient entendre à quelques mètres de là. Comme quoi, il peut se passer beaucoup de choses en traversant la rue. Quelle était l’origine de ce soudain silence ? Nous-mêmes parlions assez simplement. Je dirais qu’ils se trouvaient, peut-être pour la première fois, directement en contact avec la « chose politique ». Une chose étrange, faite par des gens qui ne le sont pas moins. Et je les comprends ! N’est-il pas plus sain et satisfaisant dans la vie de jouer un match de rugby plutôt que de déplorer l’état du monde, la laideur de notre nouveau gouvernement et les saletés qu’ils préparent ? Sous le soleil, l’air et l’activité apportent certainement plus de joies dans la vie que nos noires réflexions biliaires. L’humain n’est-il pas d’abord un animal qui cherche le bonheur ?
Les voilà donc revenus à deux après deux bières. Le premier, avec son t-shirt blanc, et un second avec une chemise hawaïenne, qui reste en retrait, en observation. Le troisième nous rejoindra plus tard. Ce sera donc Antoine, nous le nommerons ainsi pour faciliter la lecture, qui débutera la conversation. « Pourquoi faut-il voter pour vous ? » lance-t-il mi-goguenard mi-intrigué.
« Il y a plein de raisons de voter pour nous, par exemple sur l’augmentation du SMIC et des salaires. Mais dis-moi plutôt ce que tu fais dans la vie, ça m’aidera à te répondre sur ce qui te concerne. »
« Moi, le problème » – il esquisse un sourire – « c’est que je ne comprends pas comment on continue de faire venir tant d’immigrés. C’est un problème quand même. Attention, je ne suis pas raciste, ma mère est en Espagne… »
Je le coupe et lui dis : « Moi, c’est ma grand-mère qui est née en Espagne. »
« … ah c’est cool. »
« Ouais, on est un peu pareil, des enfants d’immigrés, mais continue, je t’ai coupé… »
« La famille de ma mère, ils sont venus d’Espagne parce qu’ils fuyaient Franco. »
« Ah ouais, moi, ils sont venus en France avant. Dans les années 1920, il y a eu une grande famine dans la région de Murcie. Du coup, ils sont venus en France parce qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants meurent de faim. Et toi, tes grands-parents, ils ne voulaient pas qu’ils meurent à cause de la guerre. C’est normal, non, de ne pas vouloir que ses enfants meurent ? Aujourd’hui, c’est pareil pour les émigrés. »
« Ouais, tu as raison, mais c’est pas pareil quand même. Les Espagnols, les Italiens, c’est un peu comme les Français, et là, ce n’est pas pareil. Les émigrés, ils viennent et profitent des aides. »
Michel Feher a écrit Producteurs et Parasites, l’imaginaire si désirable du Rassemblement national chez La Découverte. En quelques secondes de discussion, je retrouve, comme je m’y attendais, les motifs de ce que décrit le philosophe. Durant la campagne, accumulant les rencontres, j’avais déjà décrit lors d’un meeting à Aniane ce phénomène où des propos racistes sont tenus dans les dix premières secondes d’une discussion. J’y vois un signe de reconnaissance sociale : « Toi que je ne connais pas mais qui est blanc comme moi, dis-moi que nous avons un problème avec les Arabes et que nous sommes de la même classe sociale. Celle qui est blanche, qui travaille et qui ne fait pas chier le monde. » Et si on se refuse à acquiescer, on est alors un « bobo, un intello, un fonctionnaire, un naïf, un mec qui vit dans un autre monde… bref un mec de gauche, dit autrement, la gauchiasse. » Michel Feher, reprenant aussi les travaux de Félicien Faury, appelle les personnes qui se positionnent dans l’espace social « les producteurs », c’est-à-dire les Français qui se lèvent tôt, pas ceux de Bernard Arnault, des bobos et des clodos. Ces producteurs qui triment lisent la société avec autour d’eux des parasites. Ceux d’en bas, les « cas-sos » qui profitent des aides sans travailler, les étrangers et ceux qui « foutent le bordel ». On peut aussi y mettre certains fonctionnaires, car ils vivent « de nos impôts et de notre travail ». Mais il y a aussi les parasites d’en haut : ceux qui font circuler et profitent, « s’en mettent plein les poches » en faisant circuler le capital financier ou le capital culturel (« bobos parisiens » ou « artistes » aux mœurs douteuses).

Agrandissement : Illustration 1
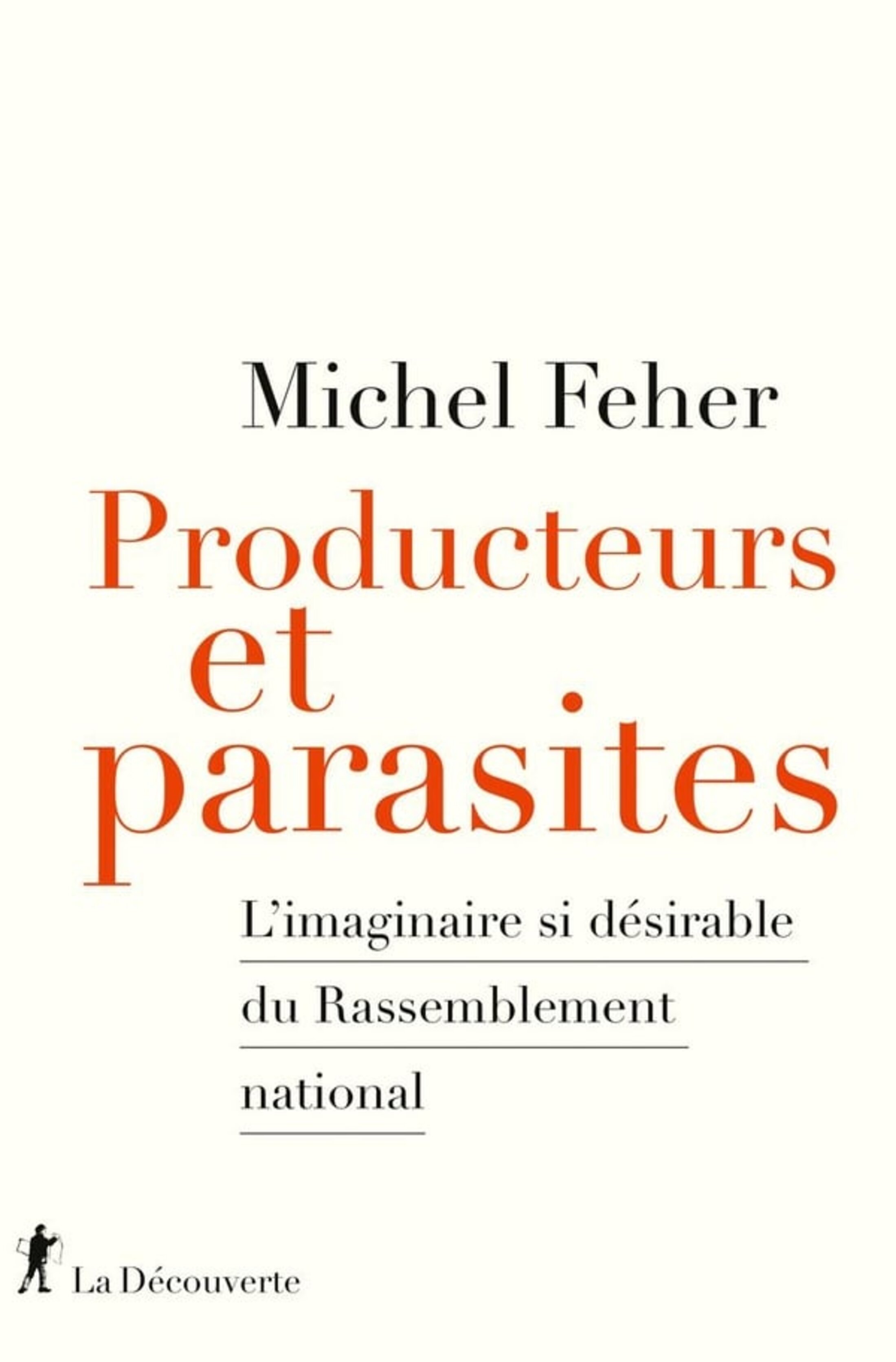
Notre interlocuteur, comme tout être humain, cherche à savoir s’il doit me mettre dans la catégorie du « eux » ou du « nous », d’autant plus que je suis blanc et qu’avec mon accent, mes gestes et mon phrasé, j’ai un certain capital d’autochtonie. Cette proximité est un élément essentiel dans le combat politique, car on ne peut voter que pour celles et ceux dont on se sent proche. Il faut se reconnaître ou obtenir une reconnaissance politique, publique. Cela ne garantit pas le vote, mais à côté d’autres signes de reconnaissance, celui-ci existe. Or, ce que montrent aussi bien Faury que Feher, c’est que le discours du RN offre plus de bases de reconnaissance dans une large classe moyenne que le discours de gauche.
Mais revenons à celui que j’ai appelé Antoine. Nous parlons assez vite de sécurité puisqu’en me disant que les immigrés d’hier ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui, il évoque les prisons pleines d’étrangers, ce qui nous donne l’occasion de parler de la mafia (mot italien), des conditions de la délinquance, etc.
« Que fais-tu dans la vie ? »
« Je devais être gendarme, mais j’ai démissionné. » Un peu plus tard, il dira qu’il a perdu son permis de conduire « d’un coup », avec une condamnation car « c’était grave » (il ne dira pas quoi). Au final, il n’a pas démissionné de la gendarmerie mais n’a pas pu finir son cursus à cause de la condamnation. Je lui pose alors cette question :
« Faut-il te renvoyer en Espagne ? »
« Si j’ai fait le con, j’assume, je dois retourner en Espagne ! » dit-il, un peu désœuvré. Je clame :
« Mais non ! Ton pays, c’est la France ! Ta vie, tes habitudes, tes amis et ta famille, ils sont en France. Quand on a fait une connerie, on assume et après, quand on a payé sa peine, on doit pouvoir vivre normalement en espérant qu’on a compris. »
Je me tourne alors vers le troisième jeune qui était arrivé au cours de la conversation pour écouter et était déjà intervenu pour appuyer le propos de son camarade en me parlant des « cas-sos » qui habitent dans les HLM, « là-haut dans le quartier », « parce que des Arabes qui ne foutent rien, il n’y en a pas qu’en ville. » C’est un première ligne, grand, costaud, rond et blond, lourdaud dans ses gestes, avec une tête encore enfantine qui porte la gentillesse sur lui. Je lui lance :
« Et toi, t’as jamais fait une connerie ? T’as jamais mis une tarte dans la gueule d’un mec ? »
Il a un mouvement de recul (sur lui-même) et Corentin, nous l’appellerons ainsi, me dit :
« Heuuuu, ben si. Tu vois, mais eux, ils ont agressé avec un couteau. »
« Ah oui, quand même, » dis-je.
« On ne leur a rien fait. »
« C’est sûr qu’on ne donne pas les moyens à la justice de suivre correctement ceux qui font des conneries. Et puis, nous, on veut que les policiers et les gendarmes fassent moins de papiers et de statistiques pour être plus présents, être à proximité des gens. C’est plus tranquille si tu vois les gendarmes qui passent trois fois à pied plutôt qu’une fois en voiture, non ? »
« Ben ouais, mais vous voulez pas désarmer la police ? Ça, il faut pas. »
« Oh que non, dis-je, c’est des mensonges qu’on raconte à la télé ça. Quand il y a une prise d’otages, ce sont des policiers spéciaux, avec des équipements et des armes spéciales. Eh bien, nous, on dit que quand il y a des manifestations, il faut des policiers pour les manifestations qui ne soient pas armés parce que dans d’autres pays, comme l’Angleterre, ils ne sont pas armés et ça se passe mieux. »
« Ouais, bof… s’il y a un problème dans la manif… tu vois, moi, je ne suis pas contre les émigrés. Dans notre équipe, il y a un Sénégalais, il est gentil, il bosse, c’est mon pote, quoi. Il est cool. Eh bien lui, c’est pas un problème qu’il soit en France, lui. »
« Eh bien, tu vois, tu estimes la personne, son état d’esprit. Ça dépend pas de sa couleur de peau ou de son origine. On juge une personne pour ses actes, ce qu’elle fait, pas d’où elle vient. Et toi, au final, tu es comme ça. T’as pas besoin de regarder l’origine. »
« Ouais, c’est vrai », dit-il un peu fier que je reconnaisse qu’il suivait une autre logique que celle qu’il défendait d’abord. Il garde un sourire pensif.
Mais j’ai laissé dans l’ombre le deuxième rugbyman, grand, costaud, brun, barbu, observateur, réfléchi dans ses poses et sa manière de parler faite de questions suivant une sorte de méthode maïeutique où il cherche à tester la résistance de son interlocuteur. Je dirais que c’est plutôt un troisième ligne.
« Le problème aussi que l’on a, c’est que certains nous empêchent d’avoir les moyens de bien éduquer les jeunes… » (je lui avais dit que j’étais instit) « … parce qu’ils ont plein de pognon et qu’ils le cachent. »
Le parasite du haut ! Michel Feher aurait adoré cette conversation qui n’est que l’idée en acte qui était en puissance chez ces trois jeunes hommes fort sympathiques. Mais ce discours contre ceux d’en haut n’était pas tant produit avec des accents marxistes, mais plutôt avec un désir d’ordre face à ceux qui ne foutent rien ou ne produisent rien. Je lui racontai alors comment j’avais mis en place un territoire zéro chômeur longue durée à Lodève, comment 160 personnes au chômage depuis plus de cinq ans travaillaient et qu’il « fallait commencer par donner du travail à celles et ceux qui veulent bosser avant de pointer du doigt les chômeurs ».
On a là l’illustration de ce qu’est l’objectif politique de celles et ceux qui emploient l’expression « valeur travail ». Il s’agit de se placer dans la lignée catholique où un peu de souffrance au quotidien sauve, où c’est le fait de travailler qui est une valeur en soi, peu importe le travail. La gauche doit parler de la valeur « du » travail, c’est-à-dire la transformation du monde que je produis par mon travail, quel sens et quelles richesses mon activité transformatrice produit, quelle part de la valeur produite est captée par celui qui me fait travailler et quelle part j’en tire. Ainsi, nous avons pu échanger sur la question des conditions de travail qui conduisent ou pas les gens à accepter un travail. L’échange fut fouillé avec Bastien, je lui choisis ce nom. L’échange se termina sur une note complotiste :
« Pourquoi ne pas filmer tous les dépouillements pour vérifier qu’on ne trafique pas les votes ? Moi, je suis sûr qu’il y a de la triche. C’est pas possible », évoque-t-il à propos de l’échec du RN à gagner l’élection. Franchement, on soigne les étrangers gratuitement, ça serait plus utile de payer des caméras pour filmer et vérifier après, moi je le ferai, que le vote s’est bien passé. »
« Tu sais ce que je te propose ? Tu vas à la prochaine élection, n’importe laquelle, et tu fais toute la journée en tant qu’assesseur, en appelant les gens à voter avec le cahier, et tu fais le dépouillement, tu verras comment ça se passe. »
« Ouais, mais faut le voir partout, pas que dans mon bureau de vote. »
« Alors, faut être un groupe de copains et se répartir les bureaux de vote pour vérifier. Tu veux mettre des caméras partout, toi ? »
« Pourquoi, c’est pas bien ? ».
Je n’ai pas l’impression de l’avoir convaincu.
« Je suis attaché à la Vérité. Le monde irait mieux si on suivait la Vérité. »
La soirée avançant, la nuit s’était résolue à tomber malgré nous, les copains du rugby les appellent, nous repartons bons amis. Je les remercie d’être venus nous voir et d’avoir eu la curiosité de venir discuter avec nous. Ce fut certainement le moment le plus authentiquement politique de la journée. C’est la preuve que les militants de gauche doivent aller dans des lieux qui ne les mettent pas nécessairement à l’aise, qu’ils doivent penser à ouvrir des lieux accueillants et qui permettent, par des activités différentes, populaires, de croiser les publics.
Ceux qui lisent le racisme actuel au regard du racisme « historique » se trompent. Ces jeunes ne sont pas embrigadés dans les idéologies nazies ou fascistes qui les guideraient dans leurs pensées, comme les masses des années 30. C’est un racisme souple et flexible, sans hiérarchie des « races », ni thèses faussement scientifiques sur la forme du crâne, les gènes des uns et des autres. C’est plus de l’ordre du culturel, mais en s’accommodant facilement des formes culturelles les moins dérangeantes dans le quotidien. Cela laisse croire à la thèse de Vincent Tiberj, selon laquelle ce sont les élites qui s’extrême-droitisent, alors que le peuple serait de plus en plus ouvert à la diversité.
Mais quels enseignements pratiques pour agir dans un autre sens puis-je tirer de ces échanges ?
Je crois qu’il fut un temps où il y avait des collectifs de travail et que, dans ces collectifs, il y avait toujours un syndicaliste, un bonhomme ou une bonne femme de gauche, qui était là et qui donnait un cadre, des références aux jeunes. Il y avait peut-être l’instit dans le village ou un maire socialiste, communiste, qui ne cachait pas ses convictions en disant « Oh moi, je ne fais pas de politique ». Il y avait des associations qui agissaient pour les jeunes et qui savaient et disaient pourquoi ils agissaient, qui n’oubliaient pas que leurs actions étaient politiques car ils créaient du commun par l’éducation populaire.
Aujourd’hui, sans cadre, les jeunes utilisent les cadres qui existent depuis la nuit des temps mais surtout au fond des tripes : l’ethnocentrisme, le « eux »/« nous » de la religion, de l’origine, de la couleur de peau plutôt que le « eux »/« nous » dans les rapports de production, les rapports de classe qui sont des constructions politiques. Le premier jeune, avec sa croix apparente sur son t-shirt blanc, Antoine, m’a dit au début de la discussion : « Mes grands-parents étaient de gauche car ils s’étaient battus contre Franco. Mes parents ont toujours voté à gauche, mais, comme ça, sans vraiment savoir, sans savoir m’expliquer pourquoi. Moi, je suis un peu de la gauche extrême et un peu de la droite extrême. Et toi, explique-moi pourquoi c’est mieux de voter à gauche ? »



