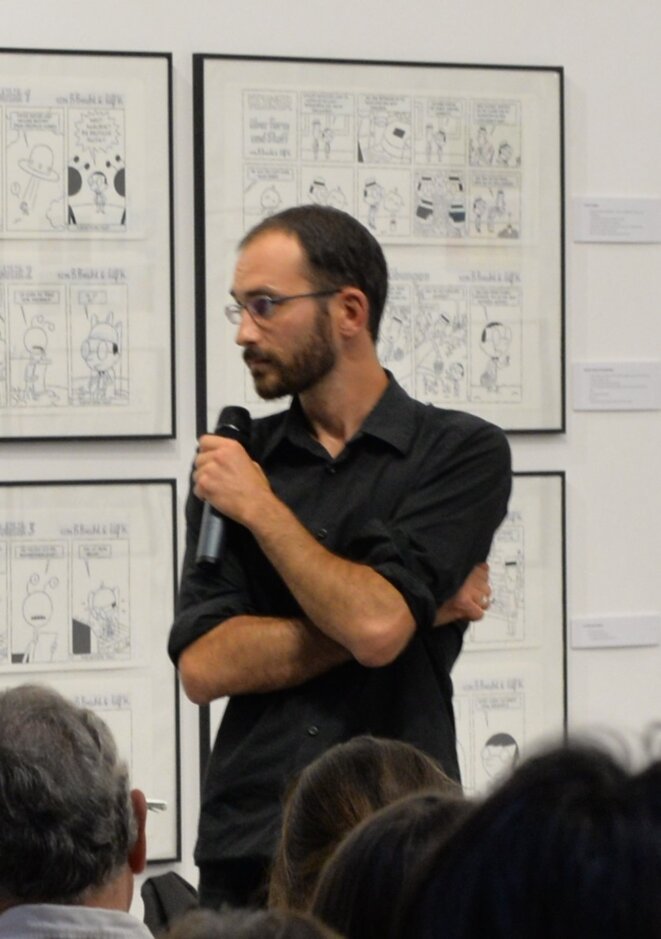Pour découvrir mes autres publications (livres, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
Comme tant d’autres, je m’emploie actuellement à chercher des solutions pour faire reculer le vote RN et mener la gauche à la victoire. Dans cette perspective, un sujet mérite sans doute que nous lui consacrions notre attention : celui de l’insécurité.
Pour illustrer mon propos, je relate ici quelques situations qui ont été vécues par moi-même ou par des gens très proches.
- Deux hommes sont dans une voiture, ils klaxonnent un véhicule qui est conduit dangereusement. Le second véhicule s’arrête net et trois hommes en sortent, furieux. Ceux-ci s’approchent de la première voiture et donnent de nombreux coups de pieds dans la carrosserie et les rétroviseurs. Les occupants du premier véhicule verrouillent les portes et restent à l’intérieur pendant quelques minutes, le temps que l’assaut prenne fin et que les agresseurs repartent.
- A un arrêt de bus, le soir, une femme avec un bébé appelle à l’aide. Un homme ivre est en train de l’insulter copieusement et de lui cracher au visage. Un passant vient contenir l’agresseur pour laisser à la femme le temps de s’éloigner.
- Un homme se gare dans un lotissement, d’une manière qui bloque le garage de l’un des riverains. Quand ce dernier lui demande de déplacer son véhicule, l’homme l’invective et s’approche de lui pour le frapper. Un voisin s’interpose, une bagarre éclate. L’homme repart en prévenant qu’il reviendra "avec tout son quartier". La police est contactée mais ne se présente pas. Le numéro d’immatriculation de l’agresseur leur est communiqué, sans qu’il n’y ait de suite.
- Un groupe d’amis discute dans un parc public, tard le soir. Un groupe de jeunes gens qu’ils ne connaissent pas s’approche d’eux sous un prétexte quelconque. Soudain, tout bascule : les jeunes hommes passent à tabac les hommes plus âgés, tandis que les filles tiennent les femmes à l’écart. L’une des victimes, sérieusement blessée, devra être hospitalisée.
La gauche ne semble pas s’intéresser à l’insécurité. Tout se passe comme s’il s’agissait d’un « thème de droite », sur lequel la gauche n’aurait rien à dire. Or, nombre de nos concitoyens se trouvent très préoccupés par cette question qui agit comme un puissant moteur du vote RN.
Au cours de leur vie, beaucoup de gens sont choqués par des actes de violence qu’ils ont subis, que leurs proches ont subi ou qui leur ont été relatés. Cela génère une aspiration à plus de sécurité – doublée du sentiment que les pouvoirs publics « ne font rien ». Ces gens se tournent alors vers des partis qui leur promettent de rétablir l’ordre et de pacifier les rues, en alourdissant les peines pour les délinquants et en expulsant les étrangers – jugés responsables de cette situation.
Face à cela, la gauche tend à nier le problème. Je faisais récemment du porte à porte dans une cité HLM avec un camarade du Nouveau Front Populaire : nous engageons la conversation avec un électeur RN, qui exprime à quel point il est outré de voir des jeunes de son quartier se permettre de rouler à fond dans les ruelles et de provoquer la police.
Mon camarade se met alors à lui expliquer qu’il ne doit pas croire tout ce qu’il voit à la télévision, que le problème de l’insécurité est largement exagéré. Alors que notre interlocuteur nous parle de ce qu’il vit dans son propre quartier, qu’il connaît évidemment mieux que nous, que fait-on ? On balaye son point de vue, on l’informe que ses préoccupations n’ont tout simplement pas lieu d’être.
Comment peut-on imaginer faire reculer le vote d’extrême-droite en agissant ainsi ? Parmi les aspirations exprimées par les électeurs RN quand on leur donne la parole, il en apparaît qui sont irrecevables (notamment le souhait de « dégager les bougnoules ») et d’autres dont on doit reconnaître qu’elles sont légitimes.
Pour quelle raison la sécurité physique des personnes serait-elle moins importante que d’autres formes de sécurité, comme la sécurité de l’emploi ? En quoi le droit de sortir de chez soi sans subir une agression serait-il moins « noble » que celui d’être soigné quand on est malade ? Paradoxalement la gauche parvient à s’intéresser aux violences qui sont commises au sein du foyer (la violence contre les femmes, en particulier) mais pas à celles qui ont lieu dans la rue.
Cette cécité est d’autant plus regrettable que les premières victimes de l’insécurité dans l’espace public sont les femmes et les habitants des quartiers populaires, deux catégories de la population dont la gauche prétend se soucier en priorité.
Certains objecteront peut-être qu’il n’y a rien à faire car l’insécurité a toujours existé. Cet argument n’est pas valide : je ne sais pas si les rues sont plus ou moins sûres aujourd’hui qu’il y a cinquante ans, mais nous n’avons pas besoin de le savoir pour décider d’agir. De la même manière que nous n’avons pas eu besoin que les violences conjugales et l’exploitation des travailleurs s’aggravent, pour décider de lutter contre ces problèmes-là.
Il est vrai que les grands médias, et en particulier les chaînes de télévision, mettent exagérément en avant les faits divers de violences et produisent ainsi un effet grossissant qui accroît le sentiment d’insécurité de nos concitoyens. Ces exagérations reposent néanmoins sur une réalité, une réalité qu’il serait dangereux de continuer à nier.
Ce qui nous distingue radicalement de la droite ne doit pas être notre refus de traiter certains problèmes, mais notre volonté de les traiter en cohérence avec les valeurs qui nous animent – la solidarité et l’humanisme. De surcroît nous pouvons arguer que nos politiques contre l’insécurité seront non seulement plus humaines, mais également plus efficaces.
Plus efficaces, car les tenant du tout-répressif ont été largement contredits par l’épreuve des faits : en France, l’insécurité persiste malgré l’héritage du quinquennat Sarkozy et la sévérité accrue du traitement des actes délinquants. Aux Etats-Unis, la violence dans les rues atteint des niveaux effrayants, malgré la cruauté du système carcéral et les pouvoirs étendus confiés à la police.
Faire le choix d’une lutte humaniste contre l’insécurité, c’est avoir à sa disposition de nombreuses solutions qui permettent d’intervenir en prévention de l’acte délinquant, ainsi qu’en réponse à celui-ci une fois qu’il a été commis. D’abord, des solutions de long terme pour agir en amont : une politique forte de mixité sociale, pour que cessent d’exister les quartiers pauvres qui concentrent les problèmes sociaux ; des moyens à la hauteur de nos ambitions en matière de scolarité, pour s’assurer qu’aucun enfant ne soit laissé sur le bord du chemin ; des moyens également pour la psychiatrie infantile et le travail social, pour venir en aide à ceux qui trébuchent.
A cela on peut ajouter des réformes visant à rétablir la confiance des citoyens envers la police afin que personne ne se sente traité comme un citoyen de seconde zone ; des politiques volontaristes en faveur de l’emploi des moins diplômés, de manière que tout le monde puisse trouver sa place dans le monde du travail ; une réduction des inégalités de revenus, afin que même le métier le plus humble permette de vivre décemment.
Ensuite, des solutions pour agir en aval de l’acte délinquant : une augmentation conséquente du budget de la justice qui permettrait de mettre fin à l’engorgement des tribunaux, et ainsi de juger les accusés dans des délais raisonnables ; une augmentation des moyens humains de la police, afin que les agents disposent du temps et des compétences requis pour assurer les missions qui leur sont confiées ; une augmentation également des moyens des services de réinsertion, qui doivent pouvoir réaliser une action éducative de qualité auprès des condamnés ; une réforme de la politique d’emprisonnement visant à réduire la quantité de peines courtes (peut-être plus désocialisantes qu’autre chose) et à favoriser systématiquement la réhabilitation des détenus par le travail, les activités éducatives et le soin psychique.
Bien sûr nous serons toujours confrontés aux reproches de « laxisme » et « d’angélisme » de ceux qui désirent avant tout punir pour punir. A ceux-là il faut rappeler que le principal objectif d’une politique pénale ne doit pas être d’infliger la souffrance (faire souffrir ceux qui ont fait souffrir, œil pour œil et dent pour dent, à la manière de l’Ancien Testament) mais de protéger les membres de la société.
Or, on ne protège pas la société en s’acharnant sur ceux qui ont fauté, au risque de les désocialiser et de les rendre plus hostiles encore. Protéger la société requiert au contraire de les réhabiliter et de les réinsérer, de manière que l’ancien délinquant puisse revenir habiter dans la cité et être un bon voisin. Evidemment, cette ambition transformatrice nécessite des ressources importantes. Cela ne constitue pourtant pas un problème, attendu qu’il s’agit d’un investissement dont les avantages à long terme – sur les plans humain et budgétaire – dépassent certainement les dépenses engagées à court terme.
On peut se réjouir que plusieurs des mesures évoquées dans cet article fassent déjà partie du programme du Nouveau Front Populaire, et en effet c’est un bon début. Mais l’insécurité reste pour la gauche un thème embarrassant, dont nos camarades peinent souvent à reconnaître qu’il a toute sa place dans le débat public.
Tout se passe comme si, dans notre famille politique, l’insécurité était un fantasme auquel il ne faudrait surtout pas donner consistance : « ne parlons pas de cette chose, cela risquerait de la faire exister ». L’électeur préoccupé par ce sujet ne va pourtant pas chercher midi à quatorze heures : il se tourne vers les partis qui en parlent, même s’il ne sait pas à quel point leurs solutions seront efficaces.
Pour gagner les prochaines élections, il ne suffira pas de dénoncer le racisme et le cynisme de nos adversaires. Il faudra aussi montrer aux électeurs que nous prenons leurs problèmes au sérieux – sans pour autant céder sur nos valeurs.