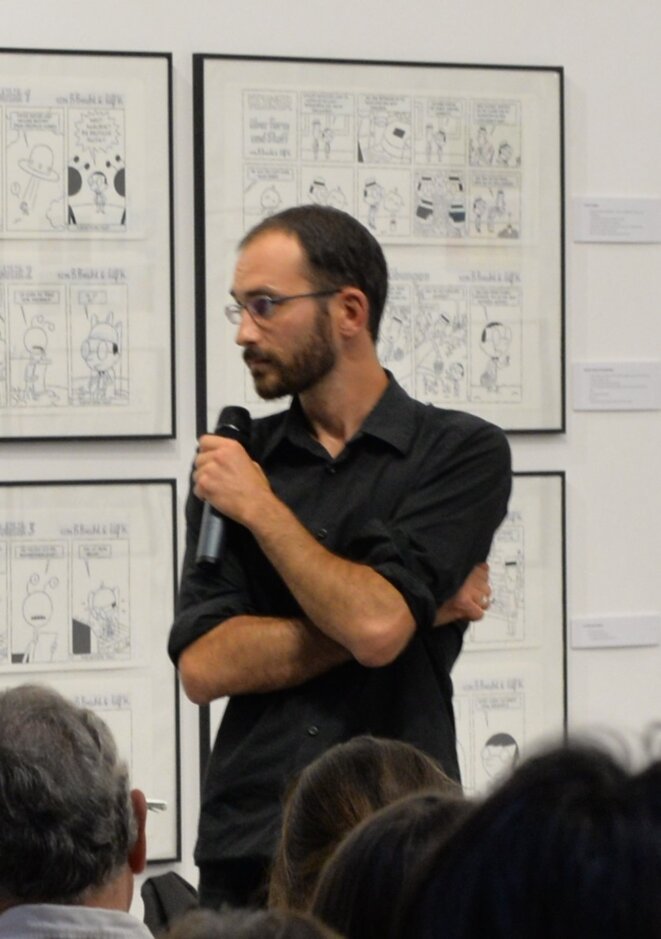Pour découvrir mes autres publications (livres, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
Sur cent Français, combien pourraient dire qui était Condorcet ? Injustice de l’histoire, la notoriété de l'homme n’est certainement pas à la hauteur de son héritage. Car à la différence de Voltaire ou de Diderot, dont les noms figurent en bonne place dans nos manuels d’histoire, le marquis de Condorcet (1743-1794) demeure peu connu. Savant, philosophe et homme politique, cet intellectuel engagé a fait partie des plus grands esprits de son temps, et s’est impliqué au premier plan de la Révolution pour s’assurer que celle-ci accouche d’un monde plus juste.
Son métier premier est celui de mathématicien. Secrétaire perpétuel de l’académie des sciences, ami intime de d’Alembert, il contribue brillamment aux avancées de sa discipline. Ses travaux sur le calcul intégral font sa renommée dans toute l’Europe, et il entreprend même de fonder les sciences humaines en décidant de prendre la société et la politique comme des objets qu’on peut étudier scientifiquement.
Très proche de Turgot, ministre progressiste, il prend le goût de la politique et cherche à orienter la destinée du pays en soumettant à son ami d’incessantes propositions destinées à améliorer le sort du peuple. Après 1789, Condorcet est élu député à l’Assemblée législative puis à la Convention. A l’aube de cette nouvelle ère, le chantier est immense. Ses priorités : abolir l’esclavage, réformer le droit criminel, et assurer l’instruction des jeunes générations.
L’esclavage est pour lui une abomination, une infamie dont la morale exige qu’on la fasse disparaître. Membre de la Société des amis des Noirs, il défie les immenses intérêts économiques basés sur l’esclavage : « Si nous ne pouvons manger du sucre qu’à ce prix », clamait-il dès 1774, il faut savoir renoncer à « une denrée souillée du sang de nos frères. » Il raille l’argumentaire des colons, qui prétendent que « vingt-deux millions de Blancs ne peuvent être heureux à moins que trois ou quatre cent mille Noirs n’expirent sous les coups de fouet. »
Condorcet ne craint pas de prêcher dans le désert. A une époque où l’écrasante majorité de ses contemporains voit l’esclavage comme un mal nécessaire, il prend la plume pour dénoncer cette « horrible barbarie ». Dans son Epître dédicatoire aux nègres esclaves, il s’adresse aux victimes de l’esclavage : « Votre suffrage ne procure point de place dans les colonies ; votre protection ne fait point obtenir de pensions ; vous n’avez pas de quoi soudoyer des avocats : il n’est donc pas étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur cause, que vous n’en avez trouvé qui se soient honorés en défendant la vôtre. »
En matière de droit pénal, Condorcet et ses amis s’inspirent de l’Angleterre, où les droits des accusés sont mieux assurés. Scandalisés par le despotisme des parlements – assemblées de nobles qui rendent la justice – ils dénoncent les nombreuses exécutions d’individus manifestement innocents. Ils plaident pour l’abolition de la torture, l’instruction publique des procès et l’instauration des droits de la défense. Ils réclament des garanties aujourd’hui évidentes : que les accusés sachent ce qu’on leur reproche, qu’ils puissent faire entendre leurs témoins et être défendus par un avocat [1]. Opposé à la peine de mort (« des meurtres ordonnés au nom de la loi »), Condorcet souhaite qu’on inflige plutôt des peines « qui permettent la correction et le repentir ».
L’héritage le plus important de Condorcet se trouve certainement dans ses travaux sur l’enseignement. Il est le premier à proposer en France un système d’instruction publique gratuit et commun à tous les citoyens. Rationaliste, peu enclin à s’emporter dans le torrent des passions du moment, Condorcet voit à long terme : tandis que le pays s’embrase face à la double menace d’une invasion étrangère et d’une guerre civile, il se consacre à organiser l’instruction publique.
Pour lui, « la Révolution n’aura vraiment fondé la liberté que dans la mesure où elle aura libéré les hommes de la pire servitude, celle qui permet toutes les autres : l’ignorance. » Sa contribution jette les bases de ce qui deviendra, cent ans plus tard, l’école républicaine. Pour Nicolas de Condorcet, l’instruction doit être libre, laïque, protégée de tout dogmatisme et ouverte à la raison critique. A l’école, même les textes fondateurs de la République doivent pouvoir être remis en cause ! [Badinter, p. 454] L’école doit armer contre l’erreur, sans dire où est la vérité.
Pas une injustice n’échappe à sa plume : Condorcet défend les Noirs, les juifs, les protestants, les femmes, les homosexuels [2] et même les animaux [3]. Universaliste, il espère « la destruction de l’inégalité entre les nations. » Soucieux du sort des plus modestes, il se rallie au principe de l’impôt progressif [Badinter, p. 640], et peste contre les riches : « nous savons combien les métiers qui les ont enrichis sont moins nobles que les métiers utiles qui nous donnent à peine de quoi vivre. » [4] [Badinter, p. 147]
Il sait que la nécessaire égalité devant la loi restera formelle tant qu’elle ne sera pas complétée par une réelle jouissance des droits. En ces temps où naît l’industrie, il se soucie de l’effet abrutissant que le travail répétitif pourrait avoir sur les ouvriers, et souhaite que ces derniers bénéficient d’un accès à l’instruction tout au long de leur vie. Préfigurant la Sécurité sociale, il appelle à l’établissement d’un « système fraternel de secours publics ». Il imagine des caisses où les travailleurs pourraient accumuler leur épargne afin que les vieux et les malades aient de quoi subsister [Badinter, p. 440, 442, 606, 666].
Condorcet fut également, selon ses biographes, le plus grand féministe de son siècle : il est le seul à avoir défendu l’égalité absolue des sexes [Badinter, p. 261]. A cette époque, s’il fallait déjà de l’audace pour se prononcer contre l’esclavage, il en fallait plus encore pour défendre les droits des femmes. En 1788, il déclare que jamais un Etat démocratique n’a réellement existé, puisque jamais les femmes n’ont exercé les droits de citoyen. « Je crois, dit-il que la loi ne devrait exclure les femmes d’aucune place. » Bravant les plaisanteries et l’indifférence de ses contemporains, il réfute méthodiquement tous les arguments opposés à l’émancipation des femmes. Maintenant qu’on a proclamé l’égalité, comment la refuser à la moitié de l’humanité ? [Badinter, p. 264, 338]
Parmi tous les révolutionnaires, Nicolas de Condorcet est aussi le premier à demander l’instauration d’une république, dès 1791 – alors qu’aucun d’entre eux n’ose même prononcer le mot sans s’en excuser. Malgré la fuite du Roi à Varennes, même Danton et Robespierre jugent que les temps ne sont pas mûrs pour appeler à la chute de la monarchie. Pourtant, Condorcet prend la parole pour faire exactement cela : « A ce moment crucial pour la Révolution, alors que ses chefs trahissent ou se dérobent, se lève un homme seul, le dernier des Encyclopédistes, l’ami de Voltaire et de d’Alembert, l’incarnation de l’esprit des Lumières qui ont éclairé ce XVIIIème siècle finissant. » [Badinter, p. 376-381]
En 1793, la Terreur approche à grands pas. Alors que la tension entre les factions révolutionnaires arrive à son paroxysme, Condorcet entreprend avec l’abbé Sieyès de publier des réflexions de fond sur le droit, l’économie et l’instruction publique. Avec Danton, il appelle à l’apaisement [Badinter, p. 636]. Au-delà de leurs différences, et sans rien céder sur ses convictions, il cherche à unir les républicains pour éviter à la Révolution de chuter dans l’abîme. Il plaide pour le pluralisme, dans un moment où les divergences d’opinion seront bientôt punies de mort : « On peut, avec un amour égal pour la liberté, différer d’avis sur la légitimité des moyens de l’assurer et de la conquérir. »
Lorsque les Girondins sont éliminés par les Montagnards, Condorcet ne peut se résoudre à garder le silence. Député indépendant, il n’est pas sur la liste de ceux qu’on arrête. Comme tant d’autres, il pourrait détourner le regard, mais il choisit plutôt de prendre la plume : il en perdra la vie. D’abord, il proteste publiquement contre la violence de cette purge. Puis, dans un pamphlet, Condorcet dénonce la nouvelle constitution rédigée à la hâte par les Montagnards, et soumise au peuple dans un moment où les libertés ont été suspendues. Quelques semaines plus tard, il fera l’objet d’un décret d’arrestation.
Objet de la haine de Robespierre, traqué par les maîtres du moment, il sera contraint de vivre caché pendant de longs mois. Reclus dans une petite chambre, transi par le froid d’un hiver rigoureux, il a consacré les derniers mois de sa vie à expliciter ses choix politiques. Il mettra aussi ce temps à profit pour poursuivre ses travaux de mathématiques – prenant même le risque de faire parvenir secrètement ses hypothèses à des collègues pour avoir leur avis – et pour rédiger un ouvrage de philosophie de l’histoire [5]. Mais la Terreur s’intensifie, et l’étau se resserre. Désespéré, épuisé, il tente de s’enfuir. Nicolas de Condorcet meurt dans la geôle d’un petit village, et son corps est mis à la fosse commune dans un lieu oublié. [6]
Pourquoi, aujourd’hui, parler de Condorcet ? Bien sûr, son héritage intellectuel est immense, et nombre d’idées que nous tenons aujourd’hui pour acquises lui sont en partie dues. Mais ce n’est pas ce qui m’a donné envie d’écrire un article sur lui. Ce qui m’a frappé en découvrant son histoire, c’est que Condorcet, par les choix qu’il a faits, par les positions qu’il a défendues, incarne admirablement bien les valeurs qui me tiennent à cœur.
Champion des opprimés, farouche pourfendeur de toutes les injustices, Condorcet a consacré son existence à dénoncer l’oppression partout où elle se trouve. Sincèrement tolérant et résolument engagé pour le pluralisme, il défendait même le droit d’expression de ses pires ennemis : « l’erreur, comme la vérité, a droit à la liberté. » Sa mission de représentant du peuple, il la résumait ainsi : « mettre tous les soins à connaître la vérité, toute ma politique à la dire. » Indépendant des clubs et des factions, opposé à l’esprit de secte, Condorcet n’était que du parti de sa propre raison.
Fils spirituel de Voltaire, Turgot et d’Alembert, il n’a cessé toute sa vie de défendre l’héritage de ces trois hommes qui lui ont transmis l’amour de la vérité, la passion du bien public et le refus de l’injustice [Badinter, p. 53]. Résolument optimiste, même aux heures les plus sombres, il croyait en la perfectibilité infinie de l’esprit humain. Pénétré d’amour pour l’humanité, dans son œuvre ultime, il prophétise le jour « où le soleil n’éclairera plus que des hommes libres. » Que ses mots nous inspirent, que sa conduite nous guide, face aux défis qui se dressent devant nous, deux cents ans après son passage.
Bibliographie :
Condorcet, un intellectuel en politique, Elisabeth Badinter et Robert Badinter, 1988, éditions Fayard
Par Nicolas de Condorcet :
Remarques sur les pensées de Pascal, 1776
Réflexions sur l’esclavage des nègres, 1781
Lettres d’un bourgeois de New Heaven, 1788
Cinq mémoires sur l’instruction publique, 1792
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1795 (posthume)
[1] Condorcet demande également l’instauration de jurys tirés au sort. Préoccupé par le mépris des gens de la bonne société pour la vie des membres du petit peuple, il formule une idée originale : que les magistrats soient à peu près du même rang social que les accusés qu’ils sont sensés juger [Badinter, p. 86].
[2] « Il condamnera à plusieurs reprises la répression de l’homosexualité librement consentie et celle de l’adultère féminin. » [Badinter, p. 22]
[3] « Il a renoncé très tôt aux plaisirs de la chasse, et il évite de tuer des insectes. A la veille de sa mort, il écrira à sa fille : ‘‘Que ton humanité s’étende même sur les animaux. Ne rends point malheureux ceux qui t’appartiendront ; ne dédaigne point de t’occuper de leur bien-être ; ne sois pas insensible à leur naïve et sincère reconnaissance ; ne cause à aucun des douleurs inutiles ; (…)’’. » [Badinter, p. 69]
[4] Dans ses Lettres d’un bourgeois de New Heaven, publiées en 1788, il estime que « l’égalité républicaine ne peut exister dans un pays où les lois civiles, les lois de finances, les lois de commerce rendent possible la longue durée des grandes fortunes. » [Badinter, p. 264]
[5] Intitulé Esquisse d’un tableau des progrès historiques de l’esprit humain. Il s’agit d’une histoire de l’humanité, colorée par l’optimisme de Condorcet quant aux progrès inévitables de la liberté et de la raison humaine. Depuis sa cachette, il élabore également un manuel scolaire : Moyens d’apprendre à compter sûrement et avec facilité.
[6] Sa sépulture est au Panthéon depuis 1989, mais son corps n’a jamais été retrouvé.