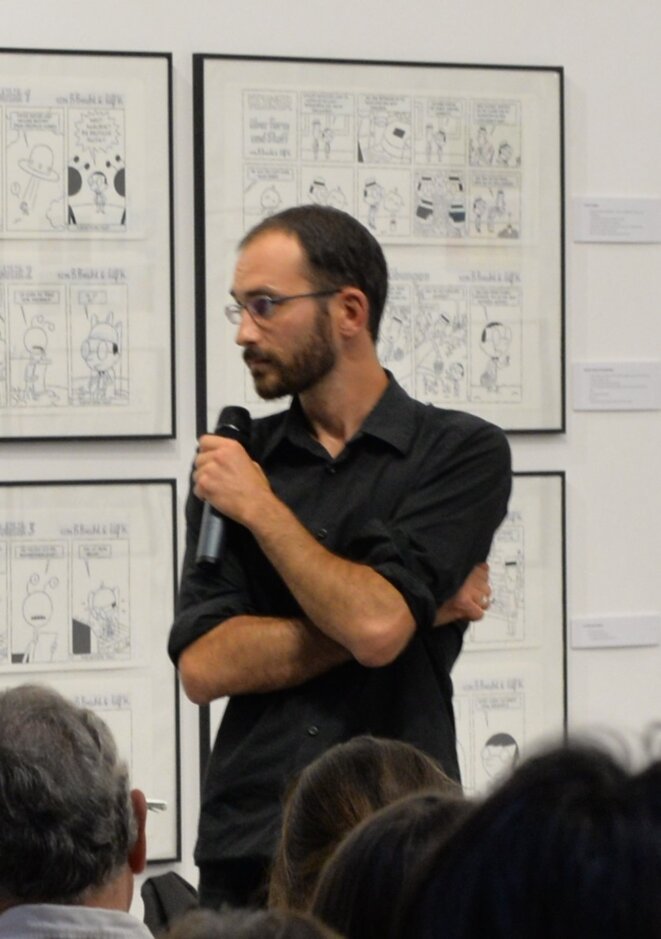Pour découvrir mes autres publications (livre, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
L’écologie, c’est toujours pour demain. Les budgets alloués à la transition écologique sont perpétuellement insuffisants, et une multitude de considérations de court terme (croissance du PIB, échéances électorales, préservation d’emplois existants, augmentation des profits de la classe possédante) se voient systématiquement accorder la priorité vis-à-vis des enjeux environnementaux. Lorsqu’un gouvernement doit réaliser des arbitrages entre différents ministères, c’est rarement celui de l’écologie qui obtient gain de cause. Les lobbies industriels, les gouvernants conservateurs et les citoyens à courte vue se cramponnent au statu quo : selon eux, les mesures en faveur du climat sont toujours trop complexes, trop coûteuses, trop difficiles à mettre en œuvre. Pour eux, l’urgence climatique peut toujours être remise à plus tard.
Mais les faits sont têtus : pour limiter le réchauffement climatique à 2°C [1], nous devons diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre. 80 % des ressources fossiles doivent être laissées dans le sol. Dans les années 1980, nous en savions déjà suffisamment sur le changement climatique pour reconnaître la nécessité de changer nos modes de production et de consommation. Quarante ans plus tard, les atermoiements n’ont plus leur place dans ce monde qui brûle. Nous devons évoluer, ou en subir les conséquences. Les solutions au changement climatique sont connues, l’argent nécessaire pour investir dans la transition écologique existe bel et bien. La seule chose qui nous manque, c’est la volonté politique de faire ce qui doit être fait.
Face au changement climatique, il n’existe pas de solution magique, car les gaz à effet de serre sont émis de manière diffuse par une grande quantité de sources différentes. La seule manière de les réduire est donc d’agir en mettant en place une multitude de mesures qui concernent cette multitude de sources. Réduire les émissions de 10 % par-ci, de 5 % par-là… de sorte que le cumul de tous ces petits progrès finisse par nous permettre d’en réaliser un grand.
Cet article présentera, dans cinq domaines, les évolutions qui sont nécessaires à la préservation du climat : nous parlerons de bâtiments, de voitures, de viande, de camions et d’avions. Ces évolutions nécessitent des efforts, des investissements courageux, et ne représentent certainement pas une « voie de la facilité ». Elles constituent cependant la seule voie possible, à moins que nous ne souhaitions que nos enfants grandissent sur une planète devenue invivable.
Les bâtiments : rénover et tarifer
C’est l’arlésienne des gouvernements successifs. Depuis plus de dix ans, la rénovation énergétique des bâtiments est présentée comme une priorité, des objectifs chiffrés de rénovation sont établis, mais notre pays n’avance que laborieusement dans ce domaine pourtant capital. Il faut préciser que la consommation énergétique des bâtiments génère 28 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Les bâtiments dans notre pays sont notoirement mal isolés : si en Allemagne on chauffe en moyenne avec 118 kilowattheures par m² et par an, ce chiffre monte à 250 pour la France – nous dépensons donc deux fois plus d’énergie que nos voisins, juste pour nous chauffer.
Ce n’est pas que l’effort de rénovation en France soit inexistant : chaque année, entre 300 et 400 000 logements font l’objet d’une rénovation thermique. Le problème est que l’urgence nous impose des objectifs bien plus ambitieux : sur les 30 millions de logements que compte notre pays, il faudrait en rénover 700 000, voire un million par an… ce qui signifie doubler ou tripler le rythme actuel. Et une telle accélération du rythme ne pourra pas s’improviser, car pour absorber une telle demande, de très nombreux artisans doivent être formés, et il faut du temps pour que les entreprises du secteur grossissent ou se multiplient.
Actuellement, les pouvoirs publics déploient des aides pour inciter à la rénovation. Certificats d’économies d’énergie, Prime Rénov’ et autres prêts à taux zéro se cumulent pour nous donner l’impulsion d’installer du double vitrage, de refaire l’isolation des combles ou de réaliser un gros chantier tel que l’isolation thermique par l’extérieur. Cependant, cette politique peine à obtenir les résultats escomptés : la complexité des aides tend à décourager les particuliers, les locataires n’ont pas forcément l’autorisation de rénover les logements dans lesquels ils vivent, et les copropriétés sont réticentes à engager des travaux d’ampleur.
Mais ces obstacles peuvent être dépassés. En unifiant les aides, en simplifiant les démarches, en permettant aux locataires de se passer de l’autorisation de leurs propriétaires, en accompagnant les copropriétés et en rendant obligatoire la rénovation des logements les plus mal isolés, beaucoup de progrès peuvent être accomplis. L’importance du but poursuivi – l’objectif d’intérêt général que représente la lutte contre le changement climatique – justifie amplement que des mesures fortes soient prises. Quitte à interdire aux propriétaires de laisser en l’état leurs passoires thermiques.
La réglementation et l’accompagnement ne régleront cependant pas tout, car la plupart des personnes susceptibles de rénover leur logement feront leur choix en fonction de la rentabilité de l’opération. Or, si les travaux d’isolation apportent un bénéfice certain en termes de confort, la rentabilité de l’investissement financier peut mettre du temps à se concrétiser (entre 20 ou 30 ans dans la plupart des cas, le temps que la baisse des factures d’énergie permette de rembourser l’investissement mis dans les travaux). Pour favoriser un recours de masse à la rénovation énergétique des bâtiments, il ne serait donc pas excessif de doubler le montant des aides financières, de sorte que cet investissement devienne rentable à un horizon beaucoup plus court, de l’ordre de 10 ou 15 ans.
L’amélioration de l’isolation thermique des logements rencontre cependant une sérieuse limite, qui est désignée par le nom « d’effet rebond » : quand une maison est mieux isolée, le montant des factures d’énergie ne diminue pas forcément. Pourquoi ? Parce que les habitants sont enclins à profiter de ce nouveau confort, et ont pris l’habitude de consacrer une certaine quantité d’argent à leurs dépenses de chauffage. Ainsi, là où ils chauffaient à 19°C en faisant la chasse au gaspi, les habitants d’une maison dont l’isolation a été renforcée auront tendance à se relâcher et à monter le thermostat à 21°C, réduisant ainsi considérablement le bénéfice écologique de la rénovation – en fin de compte, leur consommation d’énergie n’aura baissé que légèrement. Or, si l’Etat dépense des milliards pour encourager la rénovation des bâtiments, ce n’est pas pour que les gens aient le loisir de passer l’hiver en T-shirt, mais bien pour réduire la consommation énergétique globale de la population.
C’est pour contrer ce phénomène d’effet rebond que les mesures en faveur de l’isolation des bâtiments doivent être nécessairement couplées avec d’autres mesures, qui visent à dissuader les consommations superflues d’énergie. La plus importante d’entre elles est certainement la mise en place d’une tarification progressive de l’énergie. De quoi s’agit-il ? Actuellement, les fournisseurs d’électricité et de gaz facturent à leurs clients un montant proportionnel à la quantité d’énergie consommée : ceux qui économisent l’électricité et ceux qui gaspillent abondamment payent le même prix par kilowattheure consommé.
La tarification progressive de l’énergie suit une autre logique, qui incite chacun à maîtriser sa consommation tout en garantissant un tarif plus juste pour les ménages modestes : il s’agit de définir un volume d’énergie « de base », considéré comme nécessaire pour assurer les besoins de chaque ménage, et de mettre en place un tarif réduit pour les consommations qui se situent dans la limite de ce volume de base. Les consommations qui dépassent ce volume, quant à elles, sont considérées comme superflues (logement surchauffé, usage abusif de la climatisation, douches très chaudes et à rallonge, multiplication des points lumineux et des appareils électriques, acquisition d’appareils énergivores, et toutes sortes de gaspillages) et subissent une sur-tarification.
En pratique, voici à quoi peut ressembler la tarification progressive de l’énergie : imaginons un couple avec un enfant, qui vit dans une maison individuelle et recourt exclusivement au chauffage électrique. Supposons que le volume de base pour ce type de situation soit fixé à 5000 kWh/an. Si la famille en question consomme 4000 kWh d’électricité dans l’année, l’ensemble de sa consommation sera facturé à un tarif avantageux (disons 0,06 € TTC par kWh) car elle n’a pas dépassé le volume de base. Sa facture sera donc moins lourde que dans le système actuel, où aucune différence n’est faite entre les consommations essentielles et les consommations superflues. En revanche, si la famille consomme 8000 kWh, le calcul sera différent : les 5000 premiers kWh seront facturés au tarif réduit, mais tout ce qui dépasse le volume de base fera l’objet d’un tarif plus élevé (disons 0,20 € TTC par kWh). Au bout du compte, la famille qui consomme beaucoup paiera une facture plus élevée que dans le système actuel.
Bien entendu, la tarification progressive de l’énergie doit être conçue pour inciter le plus efficacement possible les ménages à réduire leur consommation d’énergie, tout en évitant de pénaliser de manière injuste les personnes qui n’ont pas d’alternative. Par exemple, ce système de tarification doit prévoir un volume de base plus élevé pour les régions du pays où l’hiver est plus rude : évidemment, on a besoin de plus d’énergie pour se chauffer dans un village des Alpes que sur la Côte d’Azur.
De plus, le volume de base doit être calculé en fonction du nombre d’habitants du foyer. De nombreux détails et paramètres sont à définir pour permettre l’application d’une telle réforme, mais aucune de ces complications ne semble insurmontable. En 2012, la majorité socialiste à l’Assemblée nationale avait fait voter la mise en place d’une tarification progressive du gaz et de l’électricité. Cependant, le Conseil constitutionnel avait opposé son véto [2], et la majorité de l’époque n’a en fin de compte jamais remanié le texte pour parvenir à dépasser cet obstacle. Le passé est ce qu’il est, mais rien n’empêche qu’à l’avenir une nouvelle majorité remette sur la table le projet d’une tarification progressive de l’énergie, et la fasse enfin aboutir.
Les voitures : moins nombreuses et plus vertueuses
L’automobile est l’une des plus grandes « cibles » de la transition écologique, et aussi l’une des plus symboliques. Entre la multiplication des trajets superflus, les bouchons interminables et la prolifération des 4x4 hyper-consommateurs de carburant, il est clair que les pistes d’action ne manquent pas pour réduire la pollution dégagée par l’usage de la voiture. Un premier chiffre nous permettra de bien saisir l’ampleur de l’enjeu : 22 %. C’est la part prise par les véhicules particuliers dans l’ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre. Un second chiffre nous donnera une idée de l’ampleur des progrès possible : - 95 %. C’est l’évolution de la consommation de pétrole de notre pays d’ici à 2050, telle qu’elle est envisagée dans le scénario de transition énergétique élaboré par l’association négaWatt. [3]
Comment un tel prodige est-il réalisable ? Si la disparition des chaudières au fioul et la réduction du nombre de vols en avion (voir plus loin) font partie de la solution, il est clair que cette baisse massive de la consommation de pétrole repose essentiellement sur une transformation de nos modes de déplacement. Cette transformation est rendue possible par toute une série de mesures, que je vais présenter dans les paragraphes qui suivent.
D’abord, il nous faut réduire le nombre de voitures en circulation. C’est dans les villes que la voiture est le moins à sa place : elle occupe l’espace, empoisonne nos poumons, occasionne du bruit et des congestions. La moitié des trajets effectués en voiture en ville font moins de 3 km, ce qui signifie qu’ils pourraient tout simplement être effectués à vélo. Le remplacement des voitures par des vélos n’est cependant possible qu’à certaines conditions : il faut que l’environnement urbain soit adapté pour offrir des voies cyclables pratiques, nombreuses et sécurisées. Chaque quartier doit disposer de parkings à vélo en quantité suffisante, avec des emplacements protégés pour limiter le nombre de vols. Par chance, de tels aménagements sont peu onéreux.
Les progrès possibles dans ce domaine sont immenses : pour s’en convaincre, il suffit de s’intéresser à la « part modale » du vélo dans les différentes villes de France. Strasbourg est de loin la championne : 15 % des trajets effectués dans la ville le sont à vélo. Pour les autres, on trouve des chiffres bien plus modestes – 8 % à Bordeaux, autour de 5 % pour Chambéry, Grenoble ou Rennes, et seulement 3% à Paris ou à Lyon. Qu’en est-il à l’étranger ? Les exemples à suivre ne manquent pas, avec 20 % de part modale pour le vélo à Tokyo et à Munich, 44 % à Amsterdam et 55 % dans la ville de Copenhague. Rien de nous empêche d’atteindre ces niveaux, du moment que nous décidons collectivement de réaliser les investissements nécessaires et d’évoluer vers une véritable « culture du vélo », qui privilégie ce mode de déplacement chaque fois que c’est possible.
Pour ceux qui sont peu enclins à utiliser le vélo ou la trottinette (que ce soit pour des raisons de santé ou de commodité) il est évidemment possible de recourir aux bons vieux transports en commun. Au contraire du vélo, l’investissement dans les transports collectifs s’avère plutôt coûteux. La construction d’une seule station de métro peut coûter plus de cent millions d’euros, et les opérateurs des transports en commun ont besoin de subventions importantes pour proposer à leurs clients des tarifs qui restent attractifs.
Le développement de l’offre de métros, bus et tramways reste cependant indispensable pour répondre à la diversité des besoins de la population. Cela implique des fréquences élevées (ne pas avoir à attendre vingt minutes pour le passage d’un tram), des amplitudes horaires importantes et des efforts pour assurer la sécurité des passagers, afin que l’usage des transports en commun ne soit pas synonyme d’exposition à la violence urbaine.
Il est également nécessaire de proposer une solution aux gens qui n’habitent pas en ville, mais qui voudraient éviter d’avoir à s’y rendre en voiture. Pour cela, il est nécessaire d’investir dans des parcs-relais situés à la périphérie des villes, en connexion directe avec des moyens de transport rapide (comme le métro). Ces infrastructures doivent également comporter un nombre suffisant de places, être bien signalées (l’automobiliste doit être certain de trouver l’entrée du parc, ainsi qu’une place pour s’y garer [4]), ouvertes sur de larges amplitudes horaires et bien surveillées, de sorte que les usagers puissent y laisser leur véhicule en toute sérénité.
Il n’est sans doute pas réaliste de viser une disparition totale de la voiture en ville, car certaines personnes pourront difficilement se reporter sur d’autres modes de transport. Pour celles-ci, le développement des Zones à Faible Emissions les incitera à choisir les véhicules les moins polluants, à motorisation hybride ou électrique. La voiture électrique ne règle certes pas le problème de la production d’énergie (si demain les Français roulaient tous avec des véhicules électriques, il faudrait démultiplier le nombre de centrales nucléaires), mais représente un moindre mal dans les zones urbaines, où elle permet de limiter les émissions de particules polluantes et les nuisances sonores causées par les voitures thermiques.
Evidemment, le problème de la pollution automobile ne se pose pas que dans les grandes villes. Pour réduire le nombre de voitures en circulation, les pouvoirs publics doivent soutenir activement le développement du covoiturage. Cela vaut notamment pour les trajets domicile-travail : de très nombreuses personnes font quotidiennement les mêmes trajets, sans se rendre compte qu’ils pourraient covoiturer afin de réduire leurs coûts financiers, en même temps que leur impact environnemental. Le développement du covoiturage peut passer par l’allocation de subventions aux particuliers (ce qui se fait déjà en Île-de-France), par l’instauration de voies de circulation réservées aux véhicules à occupants multiples (ce qui offre un gain de temps aux covoitureurs), mais aussi par des campagnes de communication destinées à rassurer les automobilistes et à les encourager dans cette évolution. [5]
Pour les trajets du quotidien, mais aussi pour les longs trajets, il importe de favoriser l’usage du train. Cela implique de construire suffisamment de parkings à proximité des gares, mais aussi de faciliter le rangement des vélos dans les trains, de manière à encourager l’usage combiné du train et de la bicyclette. Le recours au train est peu séduisant quand les fréquences sont trop faibles, les trains trop bondés aux heures de pointe, et les amplitudes horaires trop réduites (par exemple dans les petites gares, quand il n’y a qu’un train toutes les heures et que le dernier passe à 20h… sachant que certains trains sont parfois supprimés).
Pour détourner les gens de la simplicité offerte par l’usage de la voiture, l’offre de trajets en train doit présenter des fréquences importantes et de larges amplitudes horaires. On doit enclencher ici un cercle vertueux : plus l’offre sera en phase avec les besoins des voyageurs, plus les trains seront fréquentés… et plus leur exploitation deviendra rentable. A contrario, une ligne ferroviaire délaissée n’attire que les personnes qui n’ont pas d’autre alternative, et n’a aucune chance de se rapprocher de l’équilibre financier. Pour concurrencer efficacement la voiture, le train ne doit surtout pas être synonyme de rigidité, d’impondérables et de complications.
En-dehors des villes, du fait de l’éparpillement des lieux de travail, de loisir et d’habitation, il est probable que la voiture restera le mode de déplacement le plus utilisé. C’est pourquoi il est nécessaire de réduire également l’impact environnemental de ces véhicules. D’abord, nous pouvons mettre en place une mesure simple et sans coût financier : il s’agit simplement de réduire la vitesse maximale sur l’autoroute, de 130 à 110 km/h. A lui seul, ce changement de la réglementation permettrait une réduction considérable de la consommation des voitures, de presque 2 L par 100 km.
Par ailleurs, nous disposons d’un puissant levier d’action à travers le système du bonus/malus sur l’achat des véhicules neufs, en fonction de leurs émissions de CO2. Malgré les incitations existantes et les progrès réalisés par le passé, les émissions des véhicules neufs repartent à la hausse ces dernières années. Cela est dû notamment à l’explosion des ventes de SUV (Sport Utility Vehicule), qui sont plus lourds et plus hauts que les autres voitures.
Pour contrer cette évolution et garder une chance d’atteindre nos objectifs carbone, il est nécessaire de renforcer très nettement le bonus-malus écologique. Les véhicules les plus polluants seraient beaucoup plus difficiles à vendre, tandis que la masse des acheteurs se tournerait vers les modèles les plus vertueux – voitures légères, à motorisation hybride ou électrique. En complément de cette mesure, l’association négaWatt recommande aussi l’interdiction de la publicité pour les véhicules assujettis au malus écologique. Faut-il interdire certains types de publicités au nom d’un objectif d’intérêt général ? C’est du moins ce que nous faisons depuis 1991, avec l’interdiction de la publicité en faveur du tabac.
Toutes mesures confondues, le scénario de transition énergétique élaboré par l’association négaWatt vise une réduction de 60 % de la consommation moyenne des voitures. Dans le scénario, ce gain massif d’efficacité est combiné avec un changement de type de carburant : les véhicules thermiques ne consomment plus du pétrole, mais du gaz renouvelable (gaz naturel véhicule, ou GNV). Le GNV est une énergie « verte » issue de la méthanisation de déchets agricoles, de déchets ménagers et de boues de stations d’épuration [6]. Il permet de réduire drastiquement les émissions de carbone dues aux transports, en prenant la place des carburants d’origine fossile. [7]
C’est en conjuguant tous ces changements, et en réalisant tous ces investissements, qu’il est possible de réduire de 95 % notre consommation de pétrole. Bien sûr, l’ensemble de ces mesures présente un coût financier important. Mais on doit bien se rappeler qu’il s’agit d’investissements, pas de dépenses courantes. Le prix de la lutte contre le changement climatique est bien moindre que le coût du changement climatique lui-même, surtout quand on prend en compte l’ensemble de ses dimensions – le coût financier de ce dérèglement, mais aussi tout ce qu’il engendre de destruction des écosystèmes et de drames humains.
La viande : en finir avec l’élevage industriel
Cela peut surprendre, mais il se trouve que la consommation de viande compte pour 14,5 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Cette grande quantité d’émissions est due en bonne partie aux rots des bovins (constitués de méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2), mais également aux importations massives de nourriture destinée à l’élevage industriel. Concrètement, il s’avère qu’une grande part de ces importations est constituée de soja OGM acheminé par bateau depuis l’Amérique du Sud.
Les importations européennes de soja ont été multipliées par cinq depuis le début des années 70. La France, à elle seule, en importe environ quatre millions de tonnes par an. Cette nourriture riche en protéines permet d’approvisionner à moindre coût les animaux parqués dans les élevages industriels. L’un des aspects sombre de ce système, c'est que la culture intensive du soja en Amérique du Sud contribue très fortement à la déforestation de l’Amazonie. Soit directement, quand on détruit la forêt pour planter de nouveaux champs. Soit indirectement, quand l’expansion des zones cultivées pousse les habitants de ces régions à défricher la forêt afin de trouver un endroit où ils pourront vivre.
La déforestation entraîne non seulement de graves pertes de biodiversité, mais elle occasionne également de très importantes émissions de gaz à effet de serre (le carbone stocké dans les arbres est rejeté dans l’atmosphère). Ajoutons à cela que la consommation globale de viande en France est nettement supérieure aux apports recommandés par les nutritionnistes, et accroît par conséquent les risques de cancer ainsi que de maladies cardio-vasculaires… et il devient clair que la réduction de notre consommation de produits carnés est une double nécessité, à la fois sanitaire et écologique. Dans le scénario de transition énergétique de l’association négaWatt, notre consommation de viande est divisée par deux entre maintenant et 2050.
Mais comment agir sur la composition de nos assiettes ? Comment orienter efficacement les choix individuels pour réduire notre consommation totale ? Une première mesure forte consisterait en l’interdiction de l’élevage industriel sur notre territoire. Les différents modes d’élevage des animaux sont bien identifiables, selon qu’il s’agisse de batteries (cochons alignés et empêchés de se déplacer, poules coincées dans des cages de la taille d’une feuille A4), d’exploitations avec accès limité à l’extérieur, ou d’élevage en plein air. En bannissant les modes d’exploitation dans lesquels les animaux vivent entassés et privés d’accès à l’air libre, nous ferions également un grand pas en avant dans l’amélioration de la condition animale.
Evidemment, cette interdiction devrait entrer en vigueur de manière planifiée, afin de laisser aux producteurs le temps de transformer leurs exploitations. Elle aurait pour effet d’abolir les méthodes d’élevage les moins onéreuses, et donc de retirer du marché les grandes quantités de viande à bas prix – et de mauvaise qualité – qui constituent le gros de notre consommation. La demande se reporterait vers des modes d’élevage plus vertueux, mais la quantité achetée tendrait à se réduire, du fait du coût supplémentaire que cela induirait pour les consommateurs. En conséquence, les volumes de soja importé ne pourraient que décroître – il n’y aurait donc plus besoin de déforester sans cesse pour étendre les terres cultivées.
Pour ne pas exposer les producteurs français à une concurrence déloyale, il serait nécessaire de surtaxer les produits importés issus de l’élevage industriel. En pratique, il s’agirait d’ajouter une taxe supplémentaire (par exemple, 5 € par kilo) qui frapperait tous les produits ne pouvant justifier d’un mode de production non-industriel. Un organisme serait chargé de contrôler les exploitations, et de délivrer des certificats. Dans l’idéal, à terme, l’interdiction de l’élevage industriel devrait être étendu à l’ensemble de l’Union Européenne, de sorte que la question de la certification ne se pose plus que pour la viande produite en-dehors de l’Union.
En complément de l'interdiction de l'élevage industriel, on peut opérer une réorientation des commandes publiques. L'Etat et les collectivités locales ont un pouvoir d’influence non négligeable sur la production alimentaire, puisqu’ils gèrent de très nombreux lieux de restauration collective (cantines des écoles, des collèges, des lycées, de l’administration et des universités). Dans tous ces lieux, il conviendrait de proposer un menu sans viande lors de chaque service, de sorte que tous ceux qui le souhaitent puissent se restaurer d’un repas complet sans avoir à consommer de la viande.
Non seulement cette réforme réduirait la quantité globale de viande commandée par la puissance publique, mais cela encouragerait également une très vaste population (les fonctionnaires bien sûr, mais également tous les enfants et les jeunes gens qui mangent à la cantine) à réduire leur consommation de viande. Les réticences à l’égard des menus végétariens reposent souvent sur des idées reçues (repas sans saveur, trop peu protéinés, etc.), et les cantines publiques sont en bonne position pour aider ceux qui y mangent à dépasser leurs préjugés dans ce domaine. Faudrait-il passer à l’étape supérieure, en établissant un jour par semaine où les cantines ne serviraient aucune viande ? [8] Cela contribuerait à réduire la consommation de viande, en obligeant les plus réticents à essayer eux aussi un repas végétal, ne serait-ce qu’une fois par semaine. [9]
Les camions : du rail, mais pas que
Sur les routes, le ballet incessant des camions achemine d’un endroit à l’autre une infinité d’objets petits et gros, à tous les stades possibles de la production. Matières premières, pièces à assembler, produits finis… Pétrole, nourriture, produits de consommation, matériaux de construction… Parmi les différents modes de fret possible, le camion se taille la part du lion : 75 % des produits transportés sur le continent européen le sont par camion, tandis que le reste est acheté par bateau et par train. Or, cet état de fait n’est pas sans conséquences sur notre environnement : de ces trois manières de transporter les marchandises, le camion est la plus polluante. A eux seuls, les véhicules poids lourds représentent un quart du total des émissions de gaz à effet de serre générés par la route, et environ 8 % de l’ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre.
La solution la plus évidente, pour préserver le climat, serait de transférer l’ensemble du fret de la route au rail – c’est-à-dire de remplacer les camions par des trains. Or, le fret ferroviaire présente plusieurs inconvénients. D’abord, il est moins flexible que le transport routier : les marchandises doivent être chargées sur les trains à l’aide de grues, puis déchargées dans des terminaux adaptés et situés le long des voies ferrées – alors qu’un camion peut être chargé et déchargé n’importe où et plus rapidement.
Cette difficulté pourrait être réduite pour les longues distances, puisque le temps consacré au chargement/déchargement n’a plus beaucoup d’importance quand on considère des trajets de 1000 ou 2000 kilomètres. Malheureusement, le fret ferroviaire présente le défaut d’être notoirement lent, avec une vitesse moyenne de 18 km/h sur les trajets internationaux. La raison en est que le réseau ferré européen souffre de nombreuses incompatibilités. Chaque pays ayant développé son système ferroviaire indépendamment des autres, on trouve sur notre continent une grande hétérogénéité au niveau des équipements (largeur des voies, voltage, matériel d’alimentation électrique, etc.).
De plus, au contraire du secteur de l’aviation, la signalétique ferroviaire n’est pas harmonisée au niveau international, ni même au niveau européen. Il faut donc disposer d’un conducteur qui maîtrise la langue et la signalétique du pays que l’on va traverser. Les faibles performances du rail en matière de vitesse s’expliquent ainsi facilement : la moitié des convois de fret ferroviaire étant amenés à franchir des frontières, les trains sont considérablement retardés par la nécessité de changer de wagons, de locomotive, et de conducteur. Si l’on ajoute à cela la priorité accordée aux trains de passagers (ce qui se comprend, mais rallonge encore la durée des convois de fret) et les retards qui concernent 20 % des trains de fret en France, on comprendra la réticence des entreprises à se tourner vers ce mode de transport.
Après avoir dressé ce tableau peu engageant de la situation du fret européen, il importe de pointer les progrès possibles. La fédération Transport et Environnement regroupe une cinquantaine d’associations européennes, et a étudié ce sujet de manière approfondie, en concertation avec les acteurs du secteur. Il en ressort que plusieurs améliorations conséquentes sont à notre portée : d’abord, rien ne semble pouvoir empêcher l’adoption d’une signalétique unifiée pour les trains à l’échelle de l’Europe, si cela est impulsé avec suffisamment de volonté politique.
Ensuite, il importe de mieux prendre en compte le point de vue des utilisateurs du fret (les entreprises qui cherchent à faire transporter leurs produits) en mettant à leur disposition des informations claires et complètes concernant les prix, les trajets possibles et l’emplacement des terminaux dans lesquels les marchandises peuvent être chargées et déchargées. Cela constituerait un remarquable pas en avant par rapport au système actuel, opaque et nébuleux. De plus, la possibilité pour chaque client de suivre par GPS l’avancement du train dans lequel sont transportés ses produits, contribuerait à rendre moins problématiques les retards pris au cours du trajet. Cela éviterait aux clients la sensation déplaisante de rester dans le noir, et leur permettrait de revoir leur organisation en fonction de l’heure d’arrivée réelle de leurs marchandises.
Sur le plan matériel, des changements significatifs doivent être mis en œuvre. D’une part, il serait utile d’augmenter la longueur des trains. Le fret ferroviaire, aux Etats-Unis, est trois fois moins cher qu’en Europe… et c’est en partie dû au fait que les trains états-uniens sont trois fois plus longs que les nôtres. En adaptant les infrastructures et les règles de sécurité, des trains plus longs permettraient de faire des économies d’échelle et de réduire le coût du transport. D’autre part, le déploiement de certaines innovations technologiques accroîtrait considérablement les performances du fret ferroviaire : c’est le cas par exemple du chargement des trains par le côté, qui permet un gain de temps tout à fait conséquent, et réduit la nécessité de disposer de grues dans chaque terminal.
Si l’amélioration de l’offre de fret ferroviaire est une priorité, il est également nécessaire de faire payer aux utilisateurs du transport routier le vrai prix de leur activité. Cela passe par la mise en œuvre d’une taxe qui répercuterait sur le client le coût qu’il impose à la société en termes d’émissions de gaz à effet de serre, sur le principe « pollueur-payeur » [10]. Dans ce domaine, on peut s’inspirer de la redevance poids lourds déjà appliquée sur les camions qui traversent le territoire suisse.
Selon le scénario de transition énergétique élaboré par l’association négaWatt, « cette redevance doit prendre en compte le kilométrage effectué, le poids total en charge du véhicule concerné et son impact environnemental (émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, consommation d’énergie primaire par km parcouru, etc.). » L’application de cette redevance aurait deux fonctions : d’une part, renchérir le coût du fret routier pour inciter les entreprises à se tourner plus volontiers vers le fret ferroviaire. D’autre part, lever des recettes fiscales qui seraient mises au service de la transition écologique (à travers le financement des infrastructures ferroviaires, ou des aides pour l’amélioration des performances environnementales des camions).
Il n’est pas possible de remplacer intégralement les camions par des trains : les limites du fret ferroviaire, que nous avons vues plus haut, semblent trop nombreuses pour être toutes dépassées. Un objectif réaliste serait plutôt d’élever la « part modale » du fret ferroviaire – actuellement, en Europe, 18 % des marchandises sont déplacées par le rail – pour atteindre un quart ou un tiers du total. Les camions continueront donc à assurer l’essentiel des transports, c’est pourquoi il est capital de s’intéresser aussi à l’amélioration des camions eux-mêmes.
Les fabricants de camions ont à leur disposition toute une série de technologies qui pourraient grandement améliorer l’efficacité énergétique de ces véhicules, mais qu’ils n’utilisent pas car ils sont peu incités à le faire. L’association négaWatt considère que, en utilisant pleinement les technologies disponibles, la consommation d’énergie des camions pourrait être réduite de 20 %. L’agence états-unienne pour la protection de l’environnement (EPA) estime que les émissions de gaz à effet de serre produites par les camions pourraient être réduites de 24 % en quelques années. La Commission Européenne, elle, a même estimé que les économies de carburant pourraient atteindre 40 % en seulement quinze ans.
Les innovations technologiques envisagées sont de toutes sortes : pneus à faible résistance au roulement (cette seule mesure permettrait d’économiser 7 % du carburant) ; amélioration de l’aérodynamisme du véhicule par l’adoption d’une forme arrondie (4 % pour celle-ci) ; turbomélangeurs ; régulation adaptative de la vitesse ; jupes de remorque latérales ; réduction catalytique sélective ; etc.
Certaines de ces technologies sont commercialisées depuis plus de dix ans, mais peinent à pénétrer le marché des véhicules poids lourds. Les transporteurs auraient pourtant tout à gagner à investir dans des camions qui en sont dotés, car cela leur permettrait de faire des économies substantielles : le carburant représentant plus d’un quart de leurs dépenses, l’acquisition de chaque véhicule à basse consommation leur permettrait par conséquent d’économiser environ six mille euros par an. Dans ce domaine comme dans d’autres, il semble que l’investissement dans les économies d’énergie doive être impulsé et accompagné par la puissance publique.
L’amélioration des performances environnementales des camions passera aussi par la mise en place de normes contraignantes et ambitieuses sur les émissions de CO2, ainsi que par le recours à des carburants beaucoup moins polluants. Le scénario négaWatt pose comme objectif de convertir les trois quarts des poids lourds à l’utilisation de gaz renouvelable, issu de la méthanisation de déchets agricoles, de déchets ménagers et de boues de stations d’épuration [11]. En résumé, la transition écologique signifie avoir sur nos routes des camions qui soient moins nombreux, moins consommateurs de carburant, et alimentés par des énergies renouvelables.
Les avions : des taxes et des trains
Ces dernières années, l’avion est devenu l’archétype du transport polluant. Les Suédois ont même inventé un mot qui traduit cette évolution – le flygskam, ou la « honte de voler ». C’est que la réputation du transport aérien n’est pas usurpée : par kilomètre parcouru, un homme qui voyage en avion émet à peu près autant de gaz à effet de serre (GES) que s’il se déplaçait seul en voiture. Par conséquent, un trajet en voiture réalisé à deux, pollue deux fois moins que si ces personnes avaient pris l’avion. S’ils se groupent à quatre dans un même véhicule, nos voyageurs polluent alors quatre fois moins que s’ils avaient utilisé l’avion. De surcroît, les avions contribuent également au changement climatique en générant de l’oxyde d’azote, de la vapeur d’eau et d’autres gaz à effet de serre. Tout combiné, l’impact total de l’aviation sur le climat est environ trois fois plus élevé que celui qui est strictement dû à ses émissions de CO2.
Certains viennent au secours de l’avion, en soulignant que ce secteur ne représente que quelques pourcents des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Trois remarques s’imposent ici. D’une part, les occidentaux ont un usage de l’avion bien plus intensif que le reste de la population mondiale : si l’aviation compte pour « seulement » 2,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce chiffre monte à presque 4 % en ce qui concerne l’Europe. D’autre part, le trafic aérien mondial bénéficie d’une croissance effrénée, avec une augmentation annuelle de 5,7 % en moyenne depuis 2013. Si la tendance se poursuit, le volume du trafic sera encore multiplié par 2 ou 3 d’ici 2050.
Plus généralement, l’argument selon lequel tel ou tel secteur pourrait bénéficier d’un statu quo car il ne représente qu’une petite minorité de la pollution totale, est absolument irrecevable. Le problème avec cet argument, c’est qu’il pourrait venir à la défense de presque tous les secteurs : au bout du compte, le trafic des véhicules poids lourds ne représente « que » 8 % du total de nos émissions de carbone. Le transport maritime, pas plus de 2 %. L’industrie du ciment, environ 4 %. Le propre des émissions de gaz à effet de serre (GES) – et l’une des raisons pour lesquelles nous peinons tant à lutter contre le changement climatique – c’est justement que ces émissions sont diffuses, issues de sources multiples. Ce n’est que l’accumulation de toutes ces sources qui entraîne le réchauffement de la planète.
Si nous décidons qu’un type d’activité doit être préservé, bénéficier d’un droit à ne pas réduire ses émissions, comment limiter cette exception à un seul secteur ? Aucun argument valide ne justifierait cette différence de traitement, et bientôt nous nous retrouverions à abandonner toute ambition de réduction de nos émissions. On retrouve un problème similaire dans les négociations internationales sur le climat : chaque gouvernement met en avant des raisons de minimiser sa contribution à l’effort collectif, soit parce qu’il a historiquement peu contribué à la crise actuelle, soit au contraire parce qu’il pollue beaucoup depuis longtemps et aurait donc du mal à réaliser un changement de cap radical. Au bout du compte, nous devons choisir entre deux voies : légitimer toutes les excuses (et aller droit dans le mur), ou les refuser toutes, et s’assurer que l’ensemble de l’humanité mette en œuvre les changements qui s’imposent.
En 2018, quand la majorité macroniste a décidé d’augmenter les taxes sur les carburants, elle s’est bien gardée de toucher à la fiscalité du kérosène. Peu d’entre nous savent à quel point les exemptions fiscales dont bénéficie le secteur de l’aviation sont généreuses : non seulement le kérosène est la seule énergie qui n’est pas taxée, mais la TVA ne s’applique pas sur les vols internationaux [12]. Au bout du compte, je suis plus taxé quand j’achète une baguette de pain, que quand je m’offre un aller-retour Paris-Montréal. [13]
Pire, cette niche fiscale massive offre un avantage considérable à l’avion par rapport aux autres moyens de transport : l’essence vendu aux automobilistes est visée par la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ex-TIPP) et par la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes). L’électricité utilisée par les trains est soumise à toute une série de taxes locales et nationales (dont la CSPE, la TCCFE et la TDCSFE). Pour le kérosène, rien.
Comment comprendre cette bizarrerie ? Il faut remonter à l’année 1944, quand le gouvernement provisoire de la République Française signe avec 51 autres pays la Convention de Chicago, destinée à développer le transport aérien international. Elle sera complétée par une série d’accords bilatéraux qui prohiberont la taxation du kérosène destiné aux vols internationaux. Voilà l’explication légale qui justifie le statu quo sur la fiscalité du kérosène. Cependant, les accords internationaux ne prévoient aucune interdiction en ce qui concerne le kérosène destiné aux vols intérieurs, celui-ci peut donc être librement taxé : c’est déjà ce que font plusieurs pays comme les Etats-Unis, le Brésil, le Japon, la Norvège ou les Pays-Bas… alors qu’en France les gouvernements successifs se sont toujours refusés à franchir le pas.
Il s’agirait d’une mesure d’autant plus pertinente sur le plan climatique, qu’une grande partie de la consommation d’énergie des avions est liée à la phase de décollage. En effet, les réacteurs de l’appareil doivent fournir un effort particulier pour atteindre la vitesse de croisière et monter en altitude, notamment du fait de la résistance de l’air qui est bien plus importante lorsque l’avion est encore près du sol (les avions de ligne volent généralement autour de 10 000 m, dans une zone de l’atmosphère où l’air est bien plus rare). Par conséquent, dans le cas d’un vol intérieur (prenons l’exemple d’un Paris-Nice qui dure 1h25), une part très importante du trajet est effectuée à basse altitude – ce qui réduit considérablement l’efficacité de la dépense d’énergie sur l’ensemble du vol. A contrario, pour un vol Paris-Bangkok (11h20), l’énergie dépensée lors de la phase de décollage compte bien moins dans la quantité de carburant utilisée par kilomètre parcouru.
Par ailleurs, la France est un pays de taille moyenne (dix fois plus petite que la Russie, le Canada, le Brésil, l’Australie ou la Chine) qui dispose de lignes TGV permettant de relier les différentes extrémités du territoire en un temps assez court, ce qui réduit considérablement l’intérêt de maintenir des liaisons aériennes internes. Pour toutes ces raisons, de plus en plus de personnes sont favorables à l’interdiction des vols intérieurs pour lesquels il existe une alternative raisonnable en train. A titre d’exemple, on peut citer les liaisons Paris-Bruxelles (55 minutes en train), Paris-Lyon (2h) ou encore Paris-Marseille (3h05).
Plus généralement, l’application de taxes sur le kérosène, ainsi que de la TVA sur les billets d’avion, devraient contribuer à détourner une partie des voyageurs de ce mode de transport. Mais il importe également de développer les alternatives : actuellement, il est très malaisé de se déplacer en Europe par le train, car les opérateurs nationaux sont peu coordonnés. Non seulement les prix sont élevés, mais la recherche d’un billet peut s’avérer compliquée. Les temps de correspondance ne sont pas toujours réalistes (qui est prêt à tenter une correspondance de dix minutes dans une grande gare étrangère ?) et la durée des trajets s’avère dissuasive.
Il est nécessaire que la puissance publique européenne enjoigne les opérateurs à travailler main dans la main pour mettre en place des liaisons ferroviaires efficaces, fiables et rapides. Le réseau ferré européen doit être capable de relier les grandes villes européennes, avec des prix et des temps de trajet compétitifs par rapport à l’avion. Cela implique aussi d’augmenter le nombre de trains de nuit, et d’offrir aux clients la possibilité d’acheter leurs billets (en ligne ou en agence) en toute simplicité et en toute confiance. En jouant à la fois sur le prix et sur la qualité, on peut raisonnablement espérer que de nombreux voyageurs délaisseront l’avion pour le train, réduisant ainsi considérablement les émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements sur notre continent.
L’association négaWatt préconise deux autres mesures fortes visant à contenir la croissance du trafic aérien : l’interdiction des projets d’extension d’aéroports, ainsi que l’interdiction de la publicité en faveur de l’avion. En effet, si nous décidons collectivement que l’avion est un mode de déplacement qui devrait être moins utilisé, il serait absurde de laisser les compagnies aériennes continuer à investir dans des publicités qui sont destinées à accroître la demande de transports polluants.
Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la décroissance du trafic aérien est indispensable : négaWatt estime que le nombre de vols internationaux devrait être réduit de 25 %, tandis que le nombre de vols intérieurs devrait être divisé par cinq. La taxation des billets d’avion jouera un rôle central dans l’atteinte de cet objectif [14]. Les compagnies aériennes sont évidemment vent debout contre ce type de mesures, et promettent une grave perte de compétitivité pour les inconscients qui oseraient s’engager dans cette voie.
Si l’on peut juger de tels avertissements tout à fait excessifs, c’est aussi parce que les expériences menées jusqu’ici ont donné des résultats rassurants : des États de petite taille comme la Suède et les Pays-Bas ont déjà mis en place ce type de taxes, et rien n’indique que cela leur ait porté préjudice. Certes, la France ne fait pas partie des pays pionniers en matière de fiscalité environnementale. Instaurer des taxes conséquentes sur les vols en avion ne nous permettrait pas d’atteindre le peloton de tête, mais au moins d’éviter de figurer parmi les traînards.
--------
J’ai essayé de présenter, au long de cet article, un panorama des mesures que nous devons prendre pour réussir la transition écologique dans cinq grands domaines – qui représentent, à eux seuls, les trois quarts de nos émissions de gaz à effet de serre. J’ai tenu à pointer les limites de ces mesures, et à indiquer au lecteur les difficultés que nous pourrions rencontrer dans leur mise en application. Mais si les obstacles qui se dressent devant nous sont bien réels, il importe de reconnaître que les possibilités de progrès le sont tout autant.
Oui, les solutions au changement climatique sont connues. Et l’urgence climatique nous contraint à agir. Il en découle que rien ne peut justifier l’immobilisme, ni la politique des petits pas (dont on peut se demander s’il ne s’agit pas de petits pas en arrière) qui a caractérisé le mandat du président Macron. Malgré les effets d’annonce et les objectifs ambitieux posés pour un futur lointain (de préférence 2040 ou 2050), le gouvernement actuel continue à se reposer sur d’hypothétiques « innovations de rupture » [15] qui nous permettraient de régler le problème du climat sans avoir à changer nos modes de vie. Il s’agit d’un pari déraisonnable, irresponsable et inutile, puisque les solutions à la crise climatique sont déjà à notre portée. Une question demeure : ceux qui remporteront les prochaines élections auront-t-ils la volonté de les mettre en œuvre ?
-----------
[1] En comparaison avec la température qui régnait à la surface de notre planète avant le début de l’ère industrielle. Au-delà de 1,5 ou 2 °C de réchauffement, le phénomène risque de s’emballer : certaines zones de forêt tropicale se transformeraient alors en déserts (émettant au cours de ce processus de grandes quantités de carbone, du fait de la disparition des arbres) ; le sol glacé de la zone arctique se mettrait à dégeler et à relâcher des milliards de tonnes de gaz à effet de serre actuellement séquestrés sous terre ; la glace située aux Pôles disparaîtrait en grande partie, cessant de réfléchir les rayons du soleil (ceux-ci seraient désormais absorbés par les océans) ; etc. Si nous atteignons 1,5 ou 2°C de réchauffement, le changement climatique pourrait donc commencer à s’auto-entretenir, et continuer à s’accélérer même si nous parvenons par la suite à réduire drastiquement les émissions générées par les activités humaines.
[2] De manière discutable, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi violait la constitution en n’appliquant pas la tarification progressive aux consommations professionnelles (ce qui serait une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques), et en établissant pour les copropriétés un système de répartition tarifaire qui n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif fixé par la loi. L’opposition du Conseil ne portant pas sur le principe même de la loi, il est tout à fait possible d’en proposer une autre version qui poursuive le même but sans présenter de disposition qui puisse être jugée contraire à la constitution.
[3] L’association négaWatt a été fondée en 2001 par un groupe d’experts dans le domaine de l’énergie. L’association élabore des scénarios détaillés de transition énergétique, qui visent à démontrer que la France peut sortir du nucléaire et se passer presque intégralement des énergies fossiles à l’horizon 2050. Fondé sur le triptyque « sobriété, efficacité, renouvelables », le scénario négaWatt prévoit que nous divisions notre consommation d’énergie par trois d’ici 2050. Le travail de prospective mené par l’association négaWatt est devenu, depuis plusieurs années, une référence incontournable dans le débat sur la transition énergétique.
[4] Rien n’empêche que le nombre de places libres puisse être consulté en temps réel sur une application mobile, comme c’est déjà le cas pour d’autres types d’équipements – comme les vélos en libre-service.
[5] L’association négaWatt préconise par exemple la mise en place d’un plan covoiturage expérimental pendant trois ans dans 10 à 15 territoires, de manière à faciliter la mise en place de dispositif innovants.
[6] Pour passer à l’utilisation du gaz, il n’est pas nécessaire de remplacer les véhicules : l’opération consiste à adapter le carburateur, et à ajouter un réservoir de gaz. Les poids lourds peuvent combiner l’utilisation du gazole avec celle du gaz, le gazole étant surtout utilisé au démarrage et à faible vitesse. Un grand avantage du gaz comme carburant pour les véhicules (outre son intérêt pour le climat dans le cas du gaz renouvelable) est qu’il ne produit que très peu de particules fines, et qu’il préserve donc la qualité de l’air.
[7] En 2050, dans le scénario négaWatt, les voitures thermiques ne représentent plus que 30 % du parc automobile, et ils sont tous dotés d’une motorisation hybride. Les véhicules électriques finissent par représenter les deux tiers du parc, avec cependant une limitation dans la taille des batteries et des véhicules pour ne pas générer de trop fortes tensions sur le marché mondial de métaux comme le lithium ou le néodyme.
[8] Sur le modèle du « Meatless Monday », mouvement international qui promeut l’instauration de repas sans viande chaque lundi. Pour en savoir plus, on peut se rendre sur le site de la campagne.
[9] Un bémol cependant : la consommation de viande est certes excessive dans l’ensemble, mais inégalement répartie – ceux qui en mangent le plus ne sont pas nécessairement ceux qui en ont le plus besoin. Alors que les hommes ont tendance à consommer de la viande en excès, un quart des adolescentes souffrent de carences en fer, et auraient donc intérêt à accroître leur consommation de viande rouge. La mise en place de « journées sans viande » dans les établissements scolaires risquerait-elle d’aggraver leurs problèmes de santé ? Cela reste à prouver, car le menu sans viande servi à la cantine ne représenterait qu’un seul repas par semaine – un repas sur quatorze, donc. De surcroît, ce ne sont pas les filles qui seraient le plus affectées par la mise en place d’une journée sans viande, car celles-ci en consomment déjà nettement moins que les garçons (environ un tiers de moins pour les viandes, hors volaille). Afin de savoir si les carences en fer des adolescentes peuvent vraiment constituer un argument contre l’instauration de journées sans viande dans les cantines scolaires, il conviendrait d’expérimenter cette mesure sur quelques territoires et de réaliser un suivi médical des élèves concernés, afin de savoir si la journée sans viande a un impact négatif sur leur santé.
[10] Dans le langage des économistes, on parlera « d’internaliser les externalités » : grâce à la taxation d’une activité, on réintroduit dans son prix des coûts qui n’y étaient pas inclus, tout simplement parce qu’ils étaient payés par des personnes qui n’ont rien à voir avec cette transaction (par exemple, les victimes du changement climatique en Polynésie ou au Sénégal).
[11] Pour passer à l’utilisation du gaz, il n’est pas nécessaire de remplacer les véhicules : l’opération consiste à adapter le carburateur, et à ajouter un réservoir de gaz. Les poids lourds peuvent combiner l’utilisation du gazole avec celle du gaz, le gazole étant surtout utilisé au démarrage et à faible vitesse. Un grand avantage du gaz comme carburant pour les véhicules (outre son intérêt pour le climat dans le cas du gaz renouvelable) est qu’il ne produit que très peu de particules fines, et qu’il préserve donc la qualité de l’air.
[12] Sur les vols internes, la TVA ne s’applique qu’avec un taux réduit, à 10 %… comme si les déplacements en avion étaient des produits de première nécessité (au même titre que la nourriture) ou une démarche d’intérêt général (comme les travaux d’isolation thermique). Il n’y a aucune raison de subventionner ainsi les déplacements en avion, et les billets d’avion doivent impérativement se voir appliquer le même taux de TVA que n’importe quel achat (qu’il s’agisse d’une cuisine intégrée ou d’une console de jeux).
[13] Avec une certaine dose de mauvaise foi, le secteur de l’aviation pousse des cris d’orfraie chaque fois qu’une taxe le concernant est envisagée. Les représentants d’intérêts interrogés dans les médias à ces occasions dépeignent une industrie écrasée par les taxes, survivant à peine à tous les efforts qui lui sont demandés par les pouvoirs publics. L’astuce, pour eux, consiste à amalgamer les modestes taxes qu’ils payent en raison des nuisances infligées par leur activité (écotaxe et taxe sur les nuisances sonores) avec les redevances qui leur sont facturées pour les multiples services dont ils font usage (frais d’aéroport, sécurité, financement des services de l’aviation civile, utilisation des routes, etc.). Or, une redevance n’est pas une taxe, pas plus que n’importe quel autre service facturé aux entreprises dans n’importe quel domaine (droits d’utilisation des marques et des brevets, location d’équipements, loyers versés pour les locaux, etc.). Cette présentation trompeuse permet aux compagnies aériennes d’affirmer que « l’ensemble des taxes et des redevances » compte pour la moitié du prix d’un billet d’avion (ce qui est vrai, même si les taxes ne représentent qu’une petite fraction de ces sommes) en comptant sur la méconnaissance du public pour donner l’impression que leur secteur est victime d’une fiscalité excessive.
[14] L’usage de carburants renouvelables pourrait à l’avenir contribuer à réduire l’impact environnemental du transport aérien, mais de grandes incertitudes demeurent sur ce point. Les carburants renouvelables issus de l’agriculture entrent en concurrence avec les cultures alimentaires et entraînent de la déforestation, tandis que les biocarburants avancés, qui n’occasionnent pas ce type de problèmes, sont encore loin d’avoir démontré leur faisabilité à l’échelle industrielle.
[15] Voir Fakir n° 102, février-avril 2022, p. 42