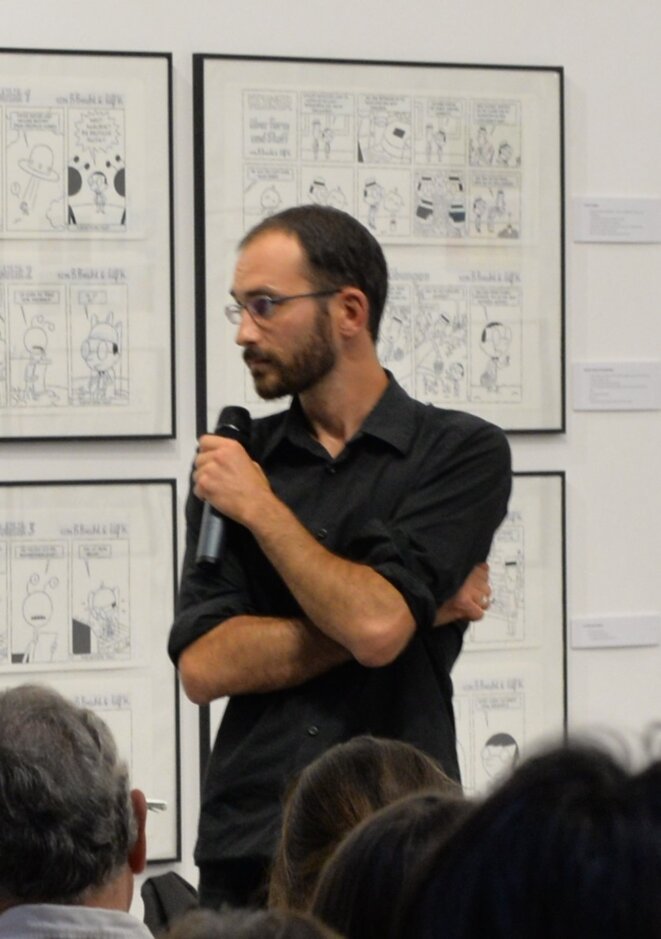Pour découvrir mes autres publications (livres, podcast) rendez-vous sur sylvain-bermond.fr
Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde.
En fait, c’est toujours comme cela que ça s’est passé.
Margareth Mead (1901-1978)
« De toute façon, ceux qui sont au pouvoir feront bien ce qu’ils veulent. » Parmi tous ceux qui s’engagent à un moment ou à un autre dans l’action collective, combien ont entendu cette phrase ? C’est la remarque d’un ami, d’un collègue, d’un oncle, qui ne trouve pourtant pas que le monde est bien tel qu’il est, mais qui ne croit simplement pas qu’on puisse y changer quelque chose.
Le changement climatique ? Un défi mondial impossible à relever, une révolution de consciences impossible à mener. Les inégalités ? Un état de fait impossible à modifier, puisque l’homme a de tout temps été un loup pour l’homme. Les droits des femmes, des minorités, des étrangers ? De nobles intentions, qui ne manqueront pas de se briser sur le mur du réel.
Autant de causes perdues, donc, que les plus réalistes d’entre nous écartent d’un haussement d’épaules. Ceux qui croient en la possibilité d’un monde meilleur apparaissent comme des naïfs, des idéalistes, voire de dangereux utopistes. S’ils osaient seulement regarder la réalité en face, ils tomberaient de haut en réalisant que leurs efforts sont vains.
Mais le sont-ils vraiment ? En vérité, j’ai bien du mal à comprendre que les discours fatalistes puissent être si largement perçus comme étant le fruit de la raison et du réalisme, alors qu’ils sont en fait complètement décalés de la réalité. Quand on s’intéresse à l’histoire, voilà ce que l’on constate : que le monde dans lequel nous vivons a été forgé, façonné, construit par des gens qui croyaient en la possibilité de le rendre meilleur.
Si ces gens n’avaient pas lutté comme ils l’ont fait, je ne serai pas en train de rédiger cet article pendant un jour de RTT, l’esprit serein, confortablement assis dans une maison spacieuse et typique de membre de la classe moyenne. Plus probablement, la liberté d’expression n’ayant pas été établie, je griffonnerais un pamphlet que je serais contraint de diffuser clandestinement, sous peine de finir dans une geôle.
Le partage des richesses n’ayant pas été obtenu, mon logement serait bien plus petit et bien moins agréable. Le droit au repos n’ayant pas été conquis, je ne serais sans doute même pas en train d’écrire, mais plutôt de m’échiner au travail douze heures par jour, sept jours par semaine et cinquante-deux semaines par an.
Avec le recul du temps, un tel scénario alternatif paraît invraisemblable : vues à distance, les luttes du passé ressemblent à des évidences, et l’homme d’aujourd’hui aura tendance à croire que les progressistes ont gagné parce qu’ils allaient simplement dans le sens de l’histoire. J’aimerais croire que l’histoire a effectivement un sens, et que ce sens est celui de l’accroissement infini du bonheur de tous. Mais je ne le crois pas.
Nous le constatons en ce début de XXIème siècle : les avancées que nous tenions pour acquises sont ébranlées, ou subissent de douloureux reculs. Le droit à l’avortement est menacé en Pologne et aux Etats-Unis. Les libertés civiles perdent du terrain, en Hongrie et en Israël. La guerre de conquête est réapparue aux portes de l’Europe. En France, les violences policières ont pris une ampleur alarmante depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, au point que de nombreux citoyens ont désormais peur de manifester. Il serait donc naïf, voire dangereux, de croire que les droits humains sont devenus si évidents qu’ils n’ont même plus besoin qu’on se tienne debout pour les défendre.
Quant aux luttes du passé, toutes ces conquêtes, elles n’étaient certainement pas des évidences pour les gens qui les ont portées. Combien de défenseurs de la liberté et de l’égalité ont flanché, ont douté, ont renoncé, quand ils faisaient face à des forces conservatrices que rien ne semblait pouvoir vaincre ? Combien de contemporains ont estimé à l’époque qu’il était vain de chercher à bouleverser l’ordre des choses, quand chacun sait que la domination masculine, l’esclavage, l’exploitation des travailleurs et l’oppression des minorités, ont toujours existé et existeront toujours ?
Cet article se penchera sur trois mobilisations, parmi la multitude de celles qui ont été documentés par les historiens. Trois victoires, trois conquêtes, dont on pourrait croire aujourd’hui qu’elles étaient évidentes. Mais elles ne l’étaient pas, de même que les combats que nous menons aujourd’hui paraissent souvent inutiles ou perdus d’avance. Pourtant, l’histoire nous enseigne cela : que la lutte est toujours difficile, mais que personne ne sait jamais comment elle finira.
1. Le travail qui mutile et qui tue
Dans les années 1840, quand un jeune maçon nommé Martin Nadaud se brise les deux bras en chutant sur un chantier de la capitale, celui-ci ne reçoit aucun dédommagement. Pour en obtenir un, il devrait prouver devant les tribunaux que son patron a commis une faute. Peine perdue ! Peu nombreux sont les ouvriers qui s’engagent dans cette procédure longue, coûteuse et hasardeuse – et encore plus rares sont ceux qui réussissent.
Quarante ans plus tard, Martin Nadaud siège à la Chambre des députés. Après avoir été emprisonné puis banni sous Napoléon III en raison de ses activités politiques, il est devenu professeur de français dans la ville de Londres. La chute du Second Empire lui donne l’occasion de revenir au pays et de se présenter aux élections législatives. En 1880, il dépose une proposition de loi visant à mettre en place une indemnisation obligatoire pour les victimes d’accidents du travail.
Il faut dire que l’époque semble propice à l’instauration de nouveaux droits sociaux : la IIIème République, encore récente, doit établir son assise en donnant des gages aux mouvements ouvriers qui prennent de la vigueur. Avec l’essor de l’industrie et de la mine, les catastrophes se multiplient et font de nombreuses victimes : explosions, incendies, effondrements… Ces évènements sont abondamment relayés par les médias, et provoquent sur l’opinion publique une forte impression.
Pourtant, les libéraux s’opposent farouchement à l’indemnisation systématique des accidents du travail. Ils renvoient le problème à des causes individuelles comme la négligence, la débauche et l’intempérance. Ils craignent une législation protectrice qui pourrait diminuer le sentiment de la responsabilité chez les ouvriers. Si ces derniers savent qu’ils recevront un dédommagement en cas de blessure grave, ne risquent-ils pas d’être moins vigilants ? [1]
La mise en place d’une protection pour tous créerait aussi une injustice entre les ouvriers, qui ne seraient plus traités selon leur mérite. C’est dans ces termes qu’un sénateur exprimait son opposition au projet de loi : « Le plus maladroit, le plus imprévoyant, le plus négligent, celui qui sera bien l'unique cause de son malheur sera pensionné tout comme un autre ».
On pourrait croire que l’exemple donné par l’Allemagne aurait inspiré les milieux politiques français. Le chancelier Bismarck s’était alors transformé en précurseur de la protection sociale, dans le but de couper les pattes à l’opposition socialiste. En 1884, le Reichstag avait validé une loi qui renversait la charge de la preuve : le patron était responsable de l’accident, sauf s’il parvenait à démontrer qu'il y avait eu faute de la part de l'ouvrier. Trois ans plus tard, l’Autriche avait suivi le pas, en instaurant une indemnisation obligatoire des victimes d’accidents du travail.
Las, dans un contexte de vive hostilité à l’égard de l’Allemagne, on stigmatise les « lois de Wisigoths » qui consistent à copier ce qui se fait chez nos ennemis. De surcroît, là où le chancelier Bismarck va jusqu’à envisager un « socialisme d’Etat », les libéraux français rejettent vigoureusement une possible expansion de l’action publique, qui constituerait un premier pas vers le collectivisme. Fermement campé sur ces positions-là, le centre du parlement fait longtemps barrage au progrès social.
Dans les années 1890, deux évènements contribuent à faire avancer les choses. D’abord, les socialistes réalisent une percée aux élections législatives de 1893 : ils recueillent plus de 600 000 voix, contre 175 000 lors des élections précédentes. L’explosion du nombre de députés socialistes provoque l’émoi d’une partie de la presse française. Même s’ils sont minoritaires et divisés en de multiples chapelles, la présence de ces députés rend visible au sein du parlement l’existence de la lutte des classes.
Trois ans plus tard, la Cour de cassation, à travers l’arrêt Teffaine, ébranle le régime de responsabilité civile qui avait cours jusque-là. Un mécanicien étant mort dans l’explosion d’un remorqueur à vapeur, la Cour décide que la responsabilité du propriétaire de l’engin est engagée même en l’absence de faute de sa part, au motif que chacun est responsable « des choses que l’on a sous sa garde ».
Cette jurisprudence ouvre une ère d’incertitude juridique pour les patrons, qui peuvent désormais être condamnés en raison des blessures causées par leurs machines. Dès lors, ils ont intérêt à ce que le législateur clarifie les limites de leurs responsabilités, et rende plus prévisibles les montants qu’ils seront amenés à verser lorsqu’un accident surviendra.
Ce n’est qu’en 1898, après un processus législatif qui aura duré dix-huit ans, que la loi « concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail » est définitivement adoptée. Comme en Allemagne, elle renverse la charge de la preuve : même en l’absence de faute de la part de l’employeur, celui-ci devra verser à l’ouvrier un dédommagement forfaitaire. Si l’ouvrier décède, le patron sera contraint de verser une part de la somme à sa veuve et à ses enfants. Les employeurs sont libres de souscrire des assurances, mais ils doivent également cotiser à un fonds géré par l’Etat.
Martin Nadaud, alors très âgé, mourra dans son village de la Creuse quelques mois après l’adoption de la loi. Votée à l’issue de débats d’une longueur canonique, limitée, retardée, mal accueillie par les patrons et par les syndicats [2], la loi sur les accidents du travail a pourtant inauguré l’ère de la gestion collective des risques sociaux.
Initialement réservée aux ouvriers de l’industrie, elle sera étendue très progressivement à d’autres secteurs, jusqu’à englober la totalité des salariés à la fin des années 1930. Rétrospectivement, cette loi apparaît comme un tournant capital de notre histoire sociale. Elle a constitué l’embryon du système de protection qui va révolutionner la prise en charge des risques de la vie, et dans lequel elle sera intégrée en 1946 : la Sécurité sociale.
2. Payés à ne rien faire
En 1853, l’empereur Napoléon III instaure un droit innovant pour les fonctionnaires de l’Etat : pendant quinze jours par an, ceux-ci seront rémunérés même s’ils ne travaillent pas – c’est la première fois que des Français ont des congés payés. Les salariés du privé, eux, n’ont droit à rien de tel, et il leur faudra attendre plus de quatre-vingts ans avant de bénéficier d’une législation similaire.
Entre-temps, les congés payés auront fait leur chemin dans de nombreux pays d’Europe. L’Allemagne les instaure en 1905, puis vient le tour des pays scandinaves et de l’Autriche-Hongrie. Quelques années après, la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Luxembourg, la Grèce, la Roumanie, l’Espagne et le Portugal leur emboîtent le pas [3]. Le pays de Voltaire, initialement à la pointe de cette évolution, ne semble pas disposé à en faire bénéficier tous les travailleurs.
Viennent les années 1930, au cours desquelles le péril fasciste n’en finit plus de prendre de l’ampleur. Encouragées par les succès de Franco et de Mussolini, les ligues nationalistes françaises sont prêtes à utiliser la force pour prendre le pouvoir… [4] et c’est justement cette menace, dans un des moments les plus sombres de notre histoire, qui va pousser les gauches à s’unir pour défendre la République.
Depuis 1920, le mouvement socialiste français est divisé entre deux partis qui sont devenus des frères ennemis. Les communistes (PCF) dénoncent la trahison de leurs ex-camarades de la SFIO, qui ont refusé d’être subordonnés à Moscou et qui participent à des gouvernements bourgeois. Tout change pourtant au moment où Staline révise sa position sur le danger fasciste : à partir de là, les communistes doivent s’allier avec la gauche de gouvernement dans le but de faire front commun.
A la surprise des socialistes, le PCF invite même le Parti radical (qui fait en réalité partie des modérés) à se rallier à eux. Après quelques hésitations, les radicaux acceptent. Il s’ensuit à Paris une grande manifestation unitaire au cours de laquelle tous les participants prêteront un serment solennel, et qui aboutira à la rédaction d’un programme commun. En 1936, l’alliance triomphe : les élections législatives aboutissent à la victoire du Front populaire, dont sera issu le gouvernement de Léon Blum, et qui est surtout connu pour avoir instauré les congés payés.
Or les congés payés n’étaient pas inscrits au programme du Front populaire. La CGT les revendiquait depuis 1926, la SFIO également, mais pas les communistes. Quelques propositions de loi avaient été déposées à ce sujet, cependant le Sénat s’y était opposé. Qu’importe, le mouvement viendra des travailleurs eux-mêmes : suite à la victoire électorale de la gauche, un immense espoir s’éveille chez les masses laborieuses. C’est le début du formidable mouvement des « grèves joyeuses », qui plonge pendant plusieurs semaines une partie du pays dans une ambiance de révolution festive – tandis que d’autres voient dans cette agitation le début d’une révolution bolchévique.
Les grévistes, au nombre de deux millions, occupent des entreprises. Ils organisent des bals et des pièces de théâtre dans les usines et les grands magasins. Peu ou pas encadrés par les organisations syndicales, beaucoup font grève pour la première fois. Le pays est alors paralysé, et les patrons hésitent à employer la force pour évacuer les usines.
Dès sa prise de pouvoir, au début du mois de juin, Léon Blum réunit les syndicats et le patronat pour négocier sous l’égide de l’Etat, afin de trouver une issue à ce mouvement. Les négociations aboutissent rapidement aux accords de Matignon, qui sont signés en échange de l’évacuation des usines. Ces accords historiques permettent le renforcement des libertés syndicales, une augmentation des salaires, la semaine de 40 heures (contre 48 auparavant) et… les congés payés.
La loi de création des congés payés est rédigée en une nuit, puis approuvée dans la foulée à l’unanimité de la chambre des députés. Ainsi, en quelques jours, une réforme considérée comme utopique est finalement adoptée. Le Front populaire ne durera que deux ans, mais il aura su s’appuyer sur la mobilisation spontanée des travailleurs pour réaliser une grande conquête sociale, qui ne fera que gagner en importance dans les décennies ultérieures. [5]
3. Un enfant si je veux
L’avortement, sous le régime de Vichy, était passible de la peine de mort. Il s’agissait d’un retour à l’extrême sévérité des peines pratiquées avant le 18ème siècle, cette fois dans un contexte familialiste et nataliste où l’interruption volontaire de grossesse (IVG) était qualifiée de « crime contre l’Etat ». Jusqu’aux années 1970, dans les périodes d’embellie relative où l’IVG ne conduit pas à la guillotine, elle est criminalisée et punie par une peine de prison.
Or, la détresse de très nombreuses femmes les conduit quand même à enfreindre la loi : au début du 20ème siècle, on estime à 500 000 le nombre d’avortements pratiqués chaque année en France. Soixante ans plus tard, ce chiffre avoisine un million, et plusieurs centaines de personnes par an sont condamnées par les tribunaux pour avortement.
C’est à ce moment-là que le mouvement féministe débute une puissante mobilisation, qui aboutira quelques années plus tard à la légalisation de l’avortement. Le coup d’envoi est donné le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur, qui titre : « La liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste ‘‘Je me suis fait avorter’’ ».
Toutes ces femmes, connues et inconnues (parmi elles se trouvent Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve et Françoise Sagan) témoignent d’avoir eu recours à l’avortement et s’exposent ainsi à des peines de prison. Les signataires du manifeste des 343 revendiquent le libre accès aux moyens anticonceptionnels, ainsi que le droit à l’avortement.
Le manifeste fait l’effet d’une bombe, et déclenche des réactions offusquées des milieux catholiques. Simone de Beauvoir reçoit de violentes attaques personnelles, lui reprochant par exemple de « brandir son utérus comme un trophée », et de transformer l’avortement en titre de gloire. L’indomptable Gisèle Halimi, signataire du manifeste, crée une association pour protéger les femmes modestes qui ont signé comme elle, mais qui n’ont pas les moyens de se défendre seules. Charlie Hebdo pose la question qui fâche : « Qui a engrossé les 343 salopes ? »
Dans les mois qui suivent, le Mouvement de libération des femmes (MLF) organise une grande manifestation festive, qui dans un désordre joyeux revendique le droit à l’avortement. Finalement, la justice ne poursuit aucune des signataires du manifeste. A la suite de cet épisode marquant, c’est le cas d’une adolescente de seize ans qui va catalyser la polémique : en 1972, lors du procès de Bobigny, la jeune Marie-Claire est jugée pour avoir avorté d’un viol. [6]
Or, sa mère, inculpée elle aussi, tombe à la bibliothèque sur un livre de Gisèle Halimi. Elle contacte la célèbre avocate, qui transformera cette affaire en un grand procès politique. Tandis que le MLF manifeste devant la salle d’audience, Gisèle Halimi fait le procès de la loi. Elle souligne l’inégalité criante entre les femmes aisées qui ont les moyens d’avorter à l’étranger, et les femmes modestes qui sont contraintes de transgresser la loi.
Le procureur avait commencé son réquisitoire en rappelant aux journalistes la loi qui encadre la liberté de la presse, et qui interdit de rendre compte des procès en matière d'avortement. Pour autant, les journalistes ne se laissent pas intimider : dans L’Express, Françoise Giroud met même au défi qu'on la poursuive à la fin de son article. Au bout du compte, aucun journaliste n'est inquiété.
Dans les jours qui précèdent le verdict, le tribunal reçoit de nombreux messages demandant la relaxe des inculpées. De nombreuses personnalités publiques viennent à la barre pour défendre ces femmes : prix Nobel, écrivains, comédiens et hommes politiques… Parmi eux, le professeur Paul Milliez explique « j’aurais accepté d’avorter Marie-Claire » – ce qui lui vaudra d’être sanctionné par l’Ordre des médecins [7]. Résultat : le tribunal relaxe la jeune fille, mais seulement au motif que celle-ci aurait été contrainte à l’avortement par son entourage, alors qu’en réalité c’est elle qui a convaincu sa mère de l’aider dans cette démarche.
Ainsi, le tribunal tente péniblement de sauver les apparences, mais il faut se rendre à l’évidence : la loi n’est plus appliquée, elle n’est plus applicable. Le ministre de la Justice donne consigne aux procureurs de ne plus poursuivre les avortements. Face à cette évolution, les réactions conservatrices sont vives et nombreuses.
A partir de 1971, l’association Laissez-les-vivre, qui rassemble notamment des médecins et des catholiques traditionnalistes, trouve une oreille attentive chez les parlementaires de la majorité gaulliste. A la suite du procès de Bobigny, le ministre de la Santé s’insurge dans France-Soir : il prévient que la légalisation de l’avortement mènerait inéluctablement aux horreurs eugénistes du régime nazi. [8]
L’année suivante, un groupe de médecins militants commence à pratiquer l’avortement par aspiration – une nouvelle méthode qui s’avère simple et peu chère à mettre en œuvre, et qui ne requiert pas d’anesthésie. Signataires d’un manifeste des 331, publié dans Le Nouvel Observateur en février 1973, ces médecins revendiquent d’avoir enfreint la loi et s’engagent à répondre de leurs actes devant la justice. Une fois encore, l’Etat est publiquement réduit à l’impuissance. [9]
Cette mobilisation acharnée pour le droit des femmes à disposer de leur corps sera traduite dans la loi, sous l’action d’une nouvelle ministre de la Santé : Simone Veil. Rescapée d’Auschwitz, figure morale de la politique, elle effectue alors une vaste consultation pour préparer sa loi sur l’IVG. Devant une assemblée presque exclusivement composée d’hommes, elle parle le langage de la santé publique : puisqu’on ne peut dissuader toutes les femmes d’avoir recours à l’IVG, il faut encadrer cette pratique.
La loi Veil est un texte de compromis, qui prévoit aux médecins une clause de conscience, et qui n’est proposée qu’à titre expérimental. Pourtant, les vingt-cinq heures de débat à l’Assemblée mettent à l’épreuve la ministre survivante de la déportation, face à laquelle certains députés n’hésitent pas à évoquer l’horreur des fours crématoires [10]. A l’issue de cette rude bataille parlementaire, la majorité de la droite vote contre, mais le soutien de la gauche (pourtant opposée au gouvernement) permet de faire passer le texte – à 284 voix contre 189.
La victoire obtenue par Simone Veil est partielle et précaire, mais sera consolidée quelques années plus tard : à la suite de l’imposante « marche des femmes » en octobre 1979, la loi sur l’IVG sera définitivement adoptée. D’autres avancées suivront, soutenues par un mouvement féministe pourtant moins vigoureux : remboursement de l’IVG par l’assurance-maladie à partir de 1982, délit d’entrave à l’IVG en 1993, et plus récemment la loi de 2016 contre les sites de désinformation ayant pour but de dissuader le recours à l’avortement.
Pour nombre d’entre nous, le droit à l’IVG paraît gravé dans le marbre. Mais nous aurions tort de nous assoupir, car aucune loi n’est irréversible. En Pologne, l’IVG n’est plus autorisée qu’en cas de viol ou d’inceste, suite à une récente décision du tribunal constitutionnel qui a resserré un cadre légal déjà très restrictif. Aux Etats-Unis, le droit à l’avortement ne reposait que sur une ancienne décision de la Cour suprême… une décision annulée l’an dernier par cette même Cour, dans un revirement de jurisprudence qui a fait grand bruit. Dans la foulée, l’IVG a été interdite par une douzaine d’Etats.
En France, la situation n’est pas critique, mais pas brillante non plus. Le mouvement anti-avortement n’a jamais baissé les bras : chaque année, une « Marche pour la vie » est organisée à Paris pour demander l’abrogation de la loi Veil. Il y a dix ans, Marine Le Pen défendait le déremboursement de l’IVG par l’assurance-maladie, afin de dissuader de prétendus « avortements de confort ». Christophe Bentz, député RN de la Haute-Marne, affirmait à la même époque que l’IVG était un « génocide de masse ». On doit en comprendre que les droits des femmes ne sont jamais acquis, et que les ennemis de la liberté ne désarmeront pas.
"Battez-vous comme nous nous sommes battus"
Bien souvent, celles et ceux qui se mobilisent pour rendre le monde meilleur se heurtent à des déceptions, et parfois la déception mène à l’abattement. La mine défaite, le citoyen rentre dans son foyer et prend ses distances avec la chose publique. La tentation est grande, alors, de se replier durablement sur sa vie privée, en laissant les cyniques et les rétrogrades accaparer le monde. C’est ainsi : pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien.
Qui pourrait croire que les héros du passé, les Martin Nadaud, les Léon Blum, les Gisèle Halimi et ces innombrables autres citoyens connus ou anonymes, n’aient jamais connu le découragement ? Qu’ils n’aient jamais été tentés par la résignation ? Heureusement pour nous, quels qu’aient été leurs doutes, ils n’ont pas sombré dans le fatalisme. Faire progresser la justice n’est pas facile pour nous, mais ça ne l’a pas été non plus pour ceux qui nous ont précédés.
« L’histoire ne se fait pas toute seule », écrivait Jean Jaurès. A partir de là, le plus déraisonnable serait de ne rien faire. Ce n’est que l’accumulation d’une myriade de batailles, géantes et minuscules, qui a rendu possibles les immenses progrès accomplis jusqu’ici. C’est grâce au courage et à la détermination des toutes ces femmes et de tous ces hommes, que nous jouissons aujourd’hui des droits civiques et sociaux qui rendent simplement le bonheur possible.
Si ces gens nous regardaient aujourd’hui, qu’auraient-ils à nous dire ? Peut-être ceci : « Battez-vous comme nous nous sommes battus. » Et, pour ceux qui ont tout sacrifié : « Nous sommes morts pour que vous soyez libres. » [11] Chaque époque est le théâtre d’affrontements dont l’issue n’est pas encore écrite – et qui ne sera de toute façon jamais irréversible. L’imprévisibilité du résultat ne doit pas occulter la nécessité de la lutte. Tout ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que beaucoup de combats finissent par une défaite. Et que beaucoup d’autres finissent par une victoire.
Bibliographie :
Histoire des mouvements sociaux en France, sous la direction de Michel Pigenet et Danielle Tartakowski, éditions La Découverte, 2014
La gauche en France, Michel Winock, éditions Perrin, 2006
[1] En 1894, l’économiste et ex-ministre Yves Guyot écrivait ainsi : « Les Allemands ont posé avec une grande netteté le principe que tout citoyen doit être assuré contre les risques de la vie. Vraiment ? Mais il y en a qui proviennent beaucoup de sa faute : intempérance, prodigalité, débauche. L'assurerez-vous et assurerez-vous sa famille contre eux ? Et l'assureur n'aura-t-il pas alors le droit d'atténuer ces risques en s'érigeant en censeur de chaque acte de l'individu ? Si on assure l'ouvrier, pourquoi pas aussi l'industriel et le commerçant ? Ne court-il pas des risques de ruine et de faillite qui ont leur répercussion sur la main-d'oeuvre ? L'Etat n'aura-t-il pas le droit de dire à l'un qu'il produit trop, à l'autre qu'il ne doit pas fonder tel établissement industriel ? (...) Mais cette substitution de l'Etat ou directement ou indirectement au patron, qu'est-ce, sinon la marche en avant vers le collectivisme ? » Commentant les statistiques des accidents du travail survenus en Allemagne entre 1886 et 1892, Guyot observait que, si les accidents suivis d'une incapacité totale n'avaient pas augmenté (1 548 en 1886, 1 507 en 1886), les accidents suivis d'une incapacité partielle étaient, eux, passés de 3 780 à 18 049 et ceux suivis d'une incapacité momentanée de 1 973 à 5 781. En Autriche, alors que les accidents mortels n'avaient augmenté que de 5 %, les accidents suivis d'invalidité peu grave avaient augmenté de 89 %. « Il résulte de ces chiffres, écrivait-il, que le système allemand de l'assurance, chez certains ouvriers, diminue le sentiment de la responsabilité et, même, chez d'autres, provoque l'accident volontaire. » Cité par Jacques Marseille dans Les Echos, 1898 : la loi protège le salarié, en ligne ici.
On pourra s’étonner que les économistes libéraux, tellement désireux de promouvoir le sentiment de responsabilité chez les petites gens, semblent si peu enclins à responsabiliser les patrons pour les dégâts qu’ils causent.
[2] Ni les salariés, ni leurs représentants n’ont été sollicités pour participer à l’élaboration de cette loi. Des voix s’élèveront parmi les syndicats, pour pointer les lacunes et les ambiguïtés du texte, moins ambitieux par certains aspects que ceux votés en Belgique et en Italie. Une période d’incertitude suivra la promulgation de la réforme, puisque les décrets d’application mettront presque un an à paraître, laissant ses opposants espérer que cette « loi de réclame » – votée quelques dizaines de jours seulement avant les élections – finisse par tomber aux oubliettes.
Les patrons, dans l’ensemble, ont très mal accueilli cette nouvelle législation. Dans un rapport de l’époque, le ministère du Travail relaie leurs critiques : « Les industriels (…) font ressortir que ces charges pourront les mettre en état d'infériorité vis-à-vis de la concurrence étrangère, surtout pour les industries dans lesquelles la main-d'œuvre entre pour une grande partie dans le prix de revient. » (Rapport sur l’application de la loi du 2 novembre 1892 pendant l’année 1898, p. 390-395, en ligne ici). Le patronat demande que ce soit la puissance publique (et donc le contribuable), plutôt que l’employeur, qui prenne en charge le coût financier des accidents du travail.
[3] Les Etats-Unis n’ont jamais instauré un minimum légal de congés payés pour les salariés. La plupart des employeurs accordent entre 5 et 15 jours de congés payés par an, mais un quart des salariés n’en a pas du tout. Dans les années 1990, selon une vaste enquête, les employés des petites entreprises ne bénéficiaient en moyenne que de 7,6 jours de congés par an. Une autre enquête, menée en 2014, établit que les salariés de ce pays ne prennent que la moitié des congés auxquels ils ont droit.
Cet état de fait s’explique par un rejet de l’intervention de la loi dans les contrats entre personnes privées, et aussi par une culture qui érige le travail en priorité quasiment absolue. Beaucoup d’Américains craignent même de prendre les quelques jours de congés auxquels ils ont droit, de peur d’être submergés de travail à leur retour ou d’être licenciés. Demander ses jours de congés, c’est prendre le risque de passer pour un employé paresseux ou peu impliqué. Cela signifie aussi « perdre des points » dans la compétition, souvent vive, entre salariés d’une même entreprise.
Après avoir émigré en Australie, un Américain se rappelle son expérience du travail aux Etats-Unis : « Je n’ai jamais eu le droit de prendre plus de cinq jours d’affilée ». Une barmaid américaine, elle, explique qu’elle n’a aucun congé payé. Chaque année, elle pose cinq jours de congés sans solde – mais pour cela, elle doit obtenir l’accord de son patron plusieurs mois à l’avance. Voir BBC, Life in a no-vacation nation, par Mark Johanson, 07/11/2014, en ligne ici.
[4] C’est surtout la journée du 6 février 1934 qui marque les esprits. Ce jour-là, à l’appel d’organisations de droite et d’extrême-droite, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se regroupent devant la Chambre des députés. Une partie des participants, dont certains sont armés, veulent renverser le régime. Essayant de pénétrer dans le parlement, ils affrontent la police – l’émeute fera 19 morts et plus de 2000 blessés. A la suite de cette crise, le président du Conseil démissionne et cède la place à un gouvernement d’union nationale.
[5] Le Front populaire avait instauré un droit à deux semaines de congés par an. Une troisième semaine sera ajoutée en 1956, puis une quatrième en 1969, et une cinquième semaine en 1982 après l’élection de François Mitterrand.
[6] Cette histoire est révélatrice de la hiérarchie des normes en vigueur à l’époque : l’auteur du viol ayant été arrêté par la police pour un vol de voiture, il dénonce sa victime dans l’espoir que les policiers le relâchent. Plusieurs agents se rendent alors au domicile de la jeune fille, et obtiennent des aveux. La victime du viol se retrouve ainsi sur le banc des accusés, menacée d’une peine de prison en même temps que ceux qui l’ont aidée à disposer de son corps (sa mère et trois de ses collègues).
[7] Le jour de l’annonce du jugement, des militantes féministes envahissent bruyamment le siège du Conseil de l’ordre des médecins, pour dénoncer son opposition à la légalisation de l’IVG.
[8] En 1973, le président de la République Georges Pompidou déclarait encore être « révulsé » par l’avortement.
[9] L’un des médecins signataires de cet appel, la grenobloise Annie Ferrey-Martin, sera inculpée pour avortement en mai 1973 après dénonciation. Quand les gendarmes perquisitionnent son domicile au matin, c’est le début d’une procédure judiciaire qui va durer trois ans et qui se terminera par un non-lieu. Dans l’intervalle, la loi Veil avait été votée.
[10] Le député gaulliste Jean Foyer, un ex-ministre qui mène l'opposition au projet de loi, interpelle Simone Veil de la manière suivante : « N'en doutez pas : déjà des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces « avortoirs », ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes et que certains de mes collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger. »
[11] Maxime Nicolle, figure des Gilets Jaunes, s’exprimait ainsi dans un live en février 2019 : « Il y a deux jours, j’ai eu un coup de mou, vraiment un gros coup de mou ; je me suis posé des questions, et je me suis dit ‘‘Est-ce que ça mènera à quelque chose ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que, avec tout ce que je me prends dans la gueule dans les médias, tout ce que les gens critiquent, est-ce que vraiment…’’ et en fait fuck ! Fuck, parce qu’il y a douze morts, parce qu’il y a des dizaines de mutilés, parce qu’il y a eu des milliers de morts dans l’histoire pour qu’on soit libres, et que ces gars-là si je les avais en face de moi et je leur disais ‘‘je vais arrêter’’, ils me diraient ‘‘attends mec : moi j’ai pris une balle pour que tu sois libre, moi je suis mort pour que tu sois libre’’, donc comment, moi, je peux arrêter ? » Cité par Laurent Denave, S’engager dans la guerre des classes, éditions Raisons d’agir, 2021, p. 99.