Comme de moins en moins de gens, j'ai une adresse mail @wanadoo.fr. Et pendant longtemps, j'ai visité chaque jour le portail Orange pour regarder mes mails. Je cliquais toujours sur une ou deux « actus ». Parfois même, je lisais les commentaires. Et je me rappelle d'une expérience... compliquée. De messages violents, souvent racistes, mesquins. L'indignation pure, sans empathie. Et je pense que c'est ce genre d'expériences qui m'a poussé à réfléchir sur Internet.
Parce que, dans mon imaginaire, Internet était un espace où l'on pouvait débattre. Concrètement, je ne savais pas comment, mais ça me semblait une avancée démocratique, un dispositif qui permettait aux gens de se parler, de raisonner publiquement et collectivement, même ceux qui n'en ont jamais eu l'occasion. Et les Printemps Arabes, ou les recherches que j'ai pu faire sans quitter ma chambre sur Occupy Wall Street à l'époque, m'ont conforté dans cette idée. Et pourtant, de là où j'étais, de la manière dont j'utilisais internet, je voyais surtout des faits divers débiles auxquels des gens répondaient des horreurs. Alors quoi ? Internet est-il vraiment un espace de débat politique ? Est-ce que cette métaphore que j'avais en tête d'une « agora numérique » est pertinente ?
Pour résoudre ça, deux questions : qu'est-ce que c'est vraiment une agora, et Internet correspond-il à cette définition ?
Le blog de Socrate
L'agora était une place au centre des cités de la Grèce antique, sur laquelle on discutait, vendait, achetait, et où étaient prises les décisions politiques et juridiques. L'Histoire s'en rappelle surtout pour son rôle dans le processus démocratique. C'est sur l'agora de la cité d'Athènes que serait né le concept de démocratie. Sur cette place se discutaient et se prenaient les décisions politiques et judiciaires. Socrate y a été condamné à mort.
Évidemment, ce récit a sa part de romantisme, et de nombreux·ses anthropologues en soulignent les traits dominateurs, bien loin du mythe de démocratie égalitaire qu'il transmet. La classe des citoyens ne comprenait en fait qu'une faible part de la population athénienne puisqu'elle excluait les femmes, les enfants, et les esclaves. David Graeber ou James C. Scott critiquent aussi la manière dont l'Occident se voit comme inventant et propageant la démocratie quand les populations colonisées par l'Europe ont souvent eu des pratiques bien plus proches d'une démocratie directe qu'Athènes1.
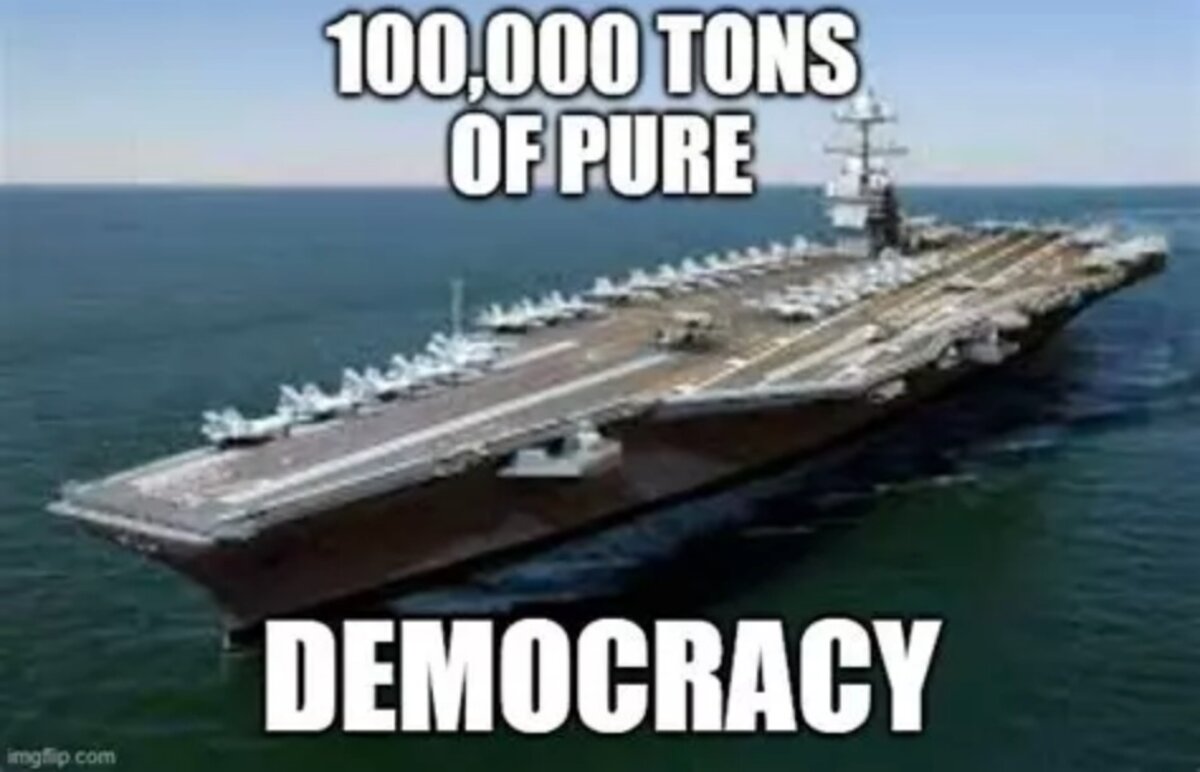
Agrandissement : Illustration 1

Débattre : gagner la confrontation ou se comprendre ?
Ce qui est intéressant dans cette métaphore de l'agora, c'est qu'elle crée l'idée d'un espace politique séparé du reste (économique, social, privé...). Dans cet espace, on s'informe, on débat, et on prend des décisions qui changent la manière dont la cité s'organise. L'agora est un « espace public », dans le sens d'Hannah Arendt ou Jürgen Habermas. Un espace où des citoyen·nes lambda, des « quidams », s'intéressent à des questions de société, se créent un avis ayant une incidence sur les décisions gouvernementales. Et où se crée une « opinion publique », résultat de la confrontation des opinions, et surtout de leur synthèse. Cette opinion tient sa valeur du fait qu'elle prend en compte les différents points de vue exprimés lors des débats, et les réalités des membres de l'assemblée.
L'intérêt de ces débats autour de la notion d'espace public est qu'ils donnent des conditions pour qu'un débat soit utile. On a toustes des images de débats télévisés inutiles où chacun·e cherche la faille dans l'argumentaire de l'autre, quand on ne balance pas tout simplement des chiffres faux. Jürgen Habermas par exemple, un philosophe allemand, donne des conditions pour qu'un débat soit utile. Les trois principales étant que les participant·es soient concerné·es par la question, qu'il y ait une réelle égalité entre participant·es, et que le débat soit organisé non comme une confrontation mais comme une tentative de synthèse rationnelle des différentes positions2.

Agrandissement : Illustration 2

Consommer de l'information, une manière de voter ?
Alors, l'agora numérique correspond-il à cette définition de l'espace public ? C'est une question complexe et très débattue. Il est évident qu'« Internet est un espace où il est plus facile qu’ailleurs de produire de l’information, où les barrières à l’entrée sont moindres. De nombreuses opinions s’expriment sur internet qui n’ont pas ou difficilement trouvé des espaces d’expression dans les médias classiques. »3 Dans ce sens, il tendrait vers une forme de démocratie directe. Le public s'est émancipé des médias dominants qui le reléguaient au statut « d'audience » passive4. Il existe de nombreux blogs ou forums dans lesquels s'expriment des opinions qui n'auraient pas voix de cité dans les médias dominants, et qui permettent de compléter voire contredire les informations triées par ceux-ci, parfois influencés par des intérêts économiques. « La richesse du web est d'avoir su faire exister, sous les contenus dominants, un espace intermédiaire où il est permis de partager et de discuter des sujets qui circulaient très mal dans l'espace public. »5
Cependant Internet reste tributaire de l'écosystème médiatique dans lequel il est né. On a désormais accès à une quantité quasi infinie de sites différents sur quasi tous les sujets. Mais la concentration des médias et le monopole des GAFAM (acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), crée des inégalités gigantesques en terme de visibilité. L'architecture d'internet, les habitudes de recherches sur les sites des grands médias, le monopole du moteur de recherche Google (utilisé dans 90% des recherches en septembre 20246) et le système d'hyperliens les renverra vers les mêmes sites, souvent des versions numériques des grands médias. Résultat : « un tout petit nombre de sites reçoit l’essentiel des liens et un très grand nombre en reçoit très peu »7.
Le rôle de trier l'information accessible aux citoyen·nes, autrefois celui des médias, est récupéré par les GAFAM. Les quantités de contenu produites sont énormes, mais le temps d'attention est limité. Dans l'économie numérique, qui hiérarchise la visibilité des contenus possède le pouvoir. « Même s'ils ne produisent pas directement de l'information, les réseaux sociaux se comportent plutôt en médias sociaux (social media) qui sélectionnent, filtrent, éditorialisent, orientent l'information selon des prismes et biais normalement préidentifiés, assumés. Dans le cas des médias sérieux, cela ne pose normalement pas problème. »8 Là où une déontologie journalistique plus ou moins rigoureuse permettait un tri des information qui avait au moins le mérite d'être clair et donc discutable, les réseaux sociaux modèrent en fonction de leurs intérêts, et donc de ceux des annonceurs. Les réponses réglementaires comme le Digital Services Act européen peinent encore à être mises en application.
Le modèle de financement par défaut des sites étant la publicité, ceux-ci cherchent à capter et garder l'attention des internautes. Ils organisent donc la conception des sites ou applis dans cette optique9. C'est ce que l'on appelle l'économie de l'attention. Les sites sont encouragés à créer ou partager des contenus toujours plus simplistes et racoleurs pour améliorer leur rendement économique, jouant sur nos émotions plutôt que sur notre rationalité. C'est ce que montre la mini-série Dopamine, en ligne sur Arte10. Cela participe à une dépolitisation des contenus et une diminution de la rationalité des débats.
Le dispositif d'Internet met aussi les internautes dans une position de consommateur·ices plutôt que de citoyen·nes11. La participation est encouragée par la consommation, que ce soit des contenus ou des produits physiques, mais pas par le débat. Les systèmes de commentaires ne créent que rarement des échanges au sens qui nous intéresse. Ce sont plutôt des suites d'adresses globales, vagues, sans réelle expression d'opinion, tournant rapidement à l'insulte12. Selon Christine Servais, elles servent surtout à créer des frontières entre groupes et opinions plutôt qu'à rassembler et argumenter.
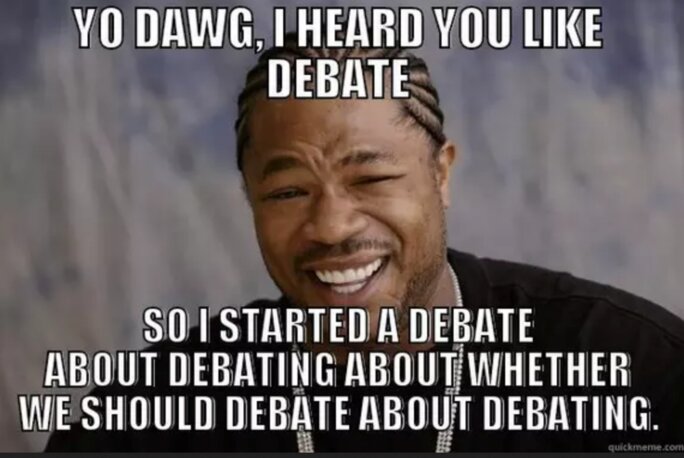
Agrandissement : Illustration 3

Il est difficile de conclure sur un sujet si vaste et complexe. Mais on peut en tout cas voir qu'internet n'est pas en soi un outil démocratique. La métaphore de l'agora ne vient pas de nulle part : grâce à internet, « de nouveaux dispositifs d’information sont apparus, de nouvelles formes de débats se mettent en place. »13 De nombreux outils comme les blogs, ou les forums, peuvent permettre une forme de débat très intéressante, s'ils sont modérés de la bonne manière. Mais internet est un média parmi d'autres et est héritier du système économique dans lequel il naît. Les utopies qui l'ont vu naître se heurtent à la concentration autour des GAFAM, qui ne fait que refléter la concentration des médias traditionnels dans l'économie capitaliste14. Le militantisme en ligne, s'il a permis à des mouvements altermondialistes de se diffuser dans les années 2000 à 2010, profite aujourd'hui majoritairement à des mouvements anti-démocratiques (notamment le terrorisme, tant islamiste15 que d'extrême droite16).
Bien comprendre ces phénomènes permettra peut-être à terme de changer les structures et réactiver le potentiel de la démocratie numérique. C'est en tout cas un pré-requis nécessaire pour comprendre ce qui se joue dans les discours politiques actuels.
Une des pistes pour changer le rapport de forces serait de renforcer les « communs numériques ». Les communs sont « des ressources gérées par une communauté »17. Wikipedia est un commun, dans le sens où il est géré collectivement par des centaines de milliers de bénévoles et quelques salarié·es, qui travaillent ensemble à l'amélioration du site, et décident de le mettre à disposition gratuitement. La gouvernance collective permet de dépasser l'individualisme et les intérêts particuliers, pour orienter la gestion vers la durabilité et le bien-être de la communauté.
C'est le modèle qui est en tout cas le plus proche de cette notion d'espace public, inspirée du mythe créé par l'agora athénienne. Cela permet quoi qu'il arrive d'éviter le modèle de financement par la publicité et ses conséquences sur la démocratie18. Ce qui est déjà un grand pas.
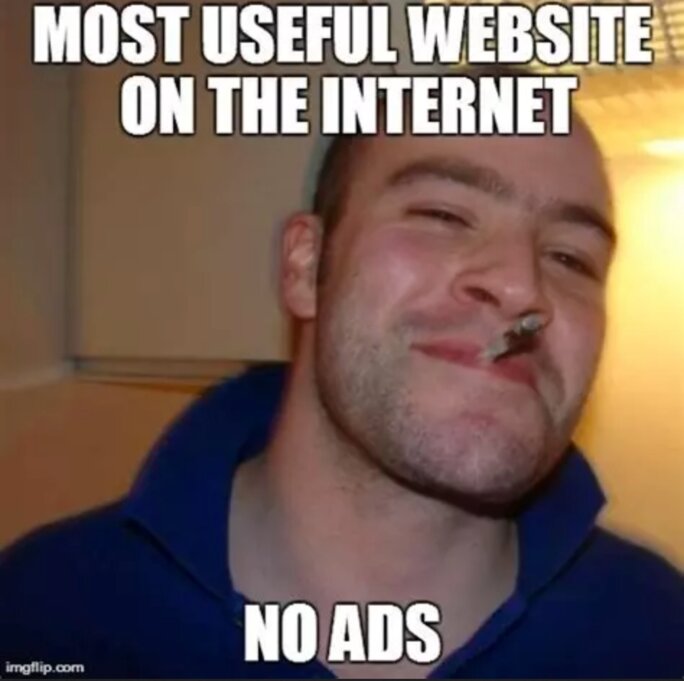
Agrandissement : Illustration 4
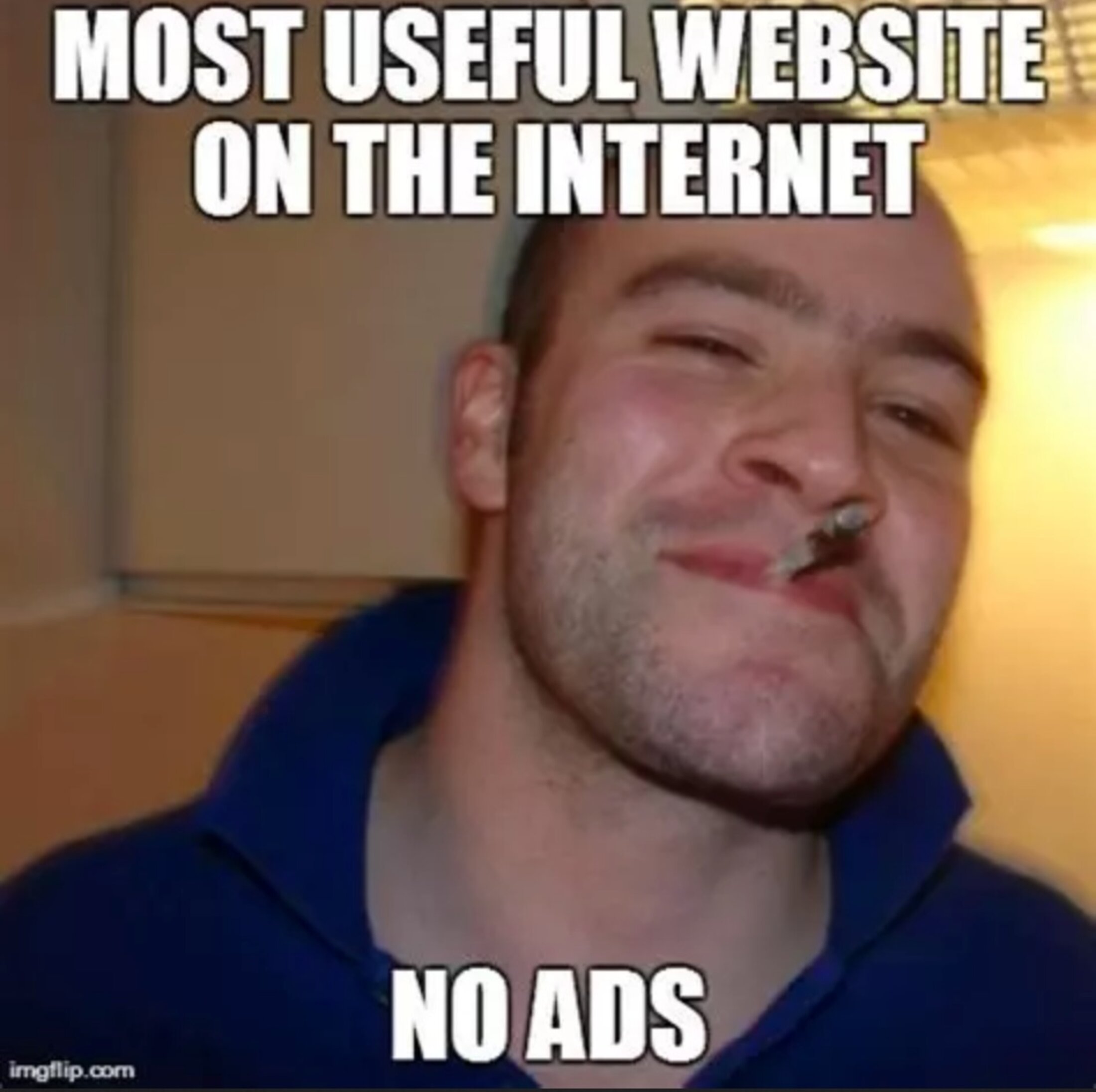
1 Voir James C. SCOTT, Zomia ou l'art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d'Asie du Sud-est, éditions du Seuil, 2019 ou David GRAEBER, La démocratie aux marges, Flammarion, 2018
2 Voir Jürgen HABERMAS, De l'éthique de la discussion, Flammarion, 1999
3 Patrice FLICHY, « Internet, un outil de la démocratie ? », La Vie des idées , 14 janvier 2008. ISSN : 2105-3030. https://laviedesidees.fr/Internet-un-outil-de-la-democratie
4 Dominique CARDON, La démocratie Internet, éditions du Seuil, La République des Idées, 2010
5 Patrice FLICHY, op. cit.
6 Source : StatCounter : https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
7 Patrice FLICHY, op. cit.
8 Asma MHALLA, Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats, Seuil, 2024, p. 112
9 Yves CITTON, L'économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme ?, La Découverte, 2014
10 Voir Léo FAVIER, Dopamine, Arte, 2021 https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
11 Cass SUNSTEIN, Republic.com, Princeton University Press, 2001, cité par Patrice FLICHY, op. cit.
12 « Aucun objet de discussion ne se maintient au-delà de deux ou trois échanges, la discussion devient sans objet et dévie vers la condamnation et l’insulte, prenant pour objet les participants eux- mêmes » Christine SERVAIS, « Scènes médiatiques et arènes de discours. Formes d’engagement dans un monde perdu », Réseaux, 2017/2 (n° 202-203), Éditions La Découverte, p. 115 https://shs.cairn.info/revue-reseaux-2017-2-page-79?lang=fr
13 Patrice FLICHY, op. cit.
14 Nikos SMYRNAIOS, Les GAFAM contre l'internet. Une économie politique du numérique, INA Éditions, 2017
15 Voir Matthieu GUIDÈRE, « Internet, haut lieu de la radicalisation », Pouvoirs, 2016, N° 158(3), 115-123 https://shs.cairn.info/revue-pouvoirs-2016-3-page-115?lang=fr
16 Voir mon article « Publicité sur Internet: un terrain favorable à l'extrême droite », https://blogs.mediapart.fr/tanguy-delaire/blog/131124/publicite-sur-internet-un-terrain-favorable-lextreme-droite ou le livre de la chercheuse Jen SCHRADIE, L'illusion de la démocratie numérique ; Internet est-il de droite ?, Quanto, 2022. Elle en fait un résumé très clair dans cette interview : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-code-a-change/pourquoi-internet-favorise-la-droite-2707050 Plus spécifiquement sur le terrorisme d'extrême droite, voir Christophe-Cécil GARNIER, « Soirées tuning, cours de drague et jeux vidéo: les nouvelles méthodes de recrutement de l'extrême droite », StreetPress, 4 septembre 2020 https://www.streetpress.com/sujet/1599222757-soirees-tuning-cours-drague-jeux-video-nouvelles-methodes-recrutement-extreme-droite-fn-rn
17 Serge ABITEBOUL, François BANCILHON, Vive les communs numériques, Odile Jacob, 2024, p. 22
18 Tanguy DELAIRE, « Publicité : l'industrialisation de la manipulation », Le Club de Mediapart, 23 novembre 2021 https://blogs.mediapart.fr/resistance-agression-pub/blog/231121/publicite-lindustrialisation-de-la-manipulation



