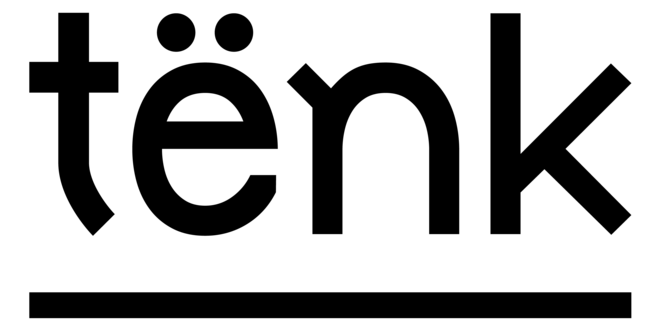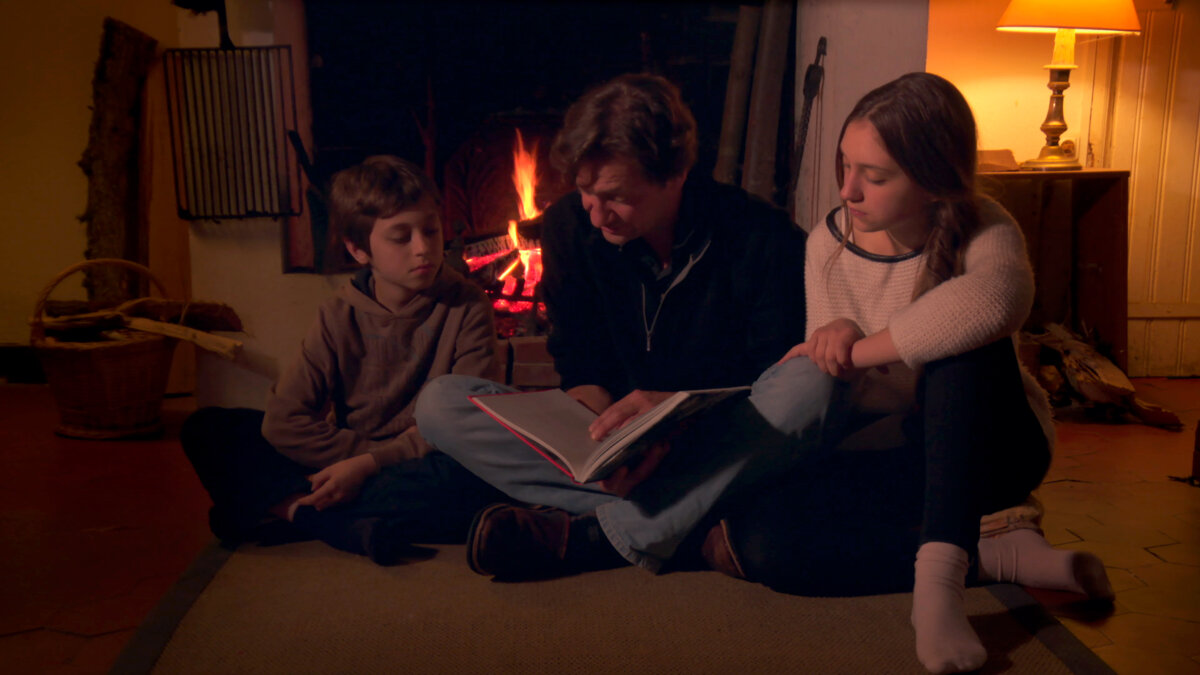
Agrandissement : Illustration 1
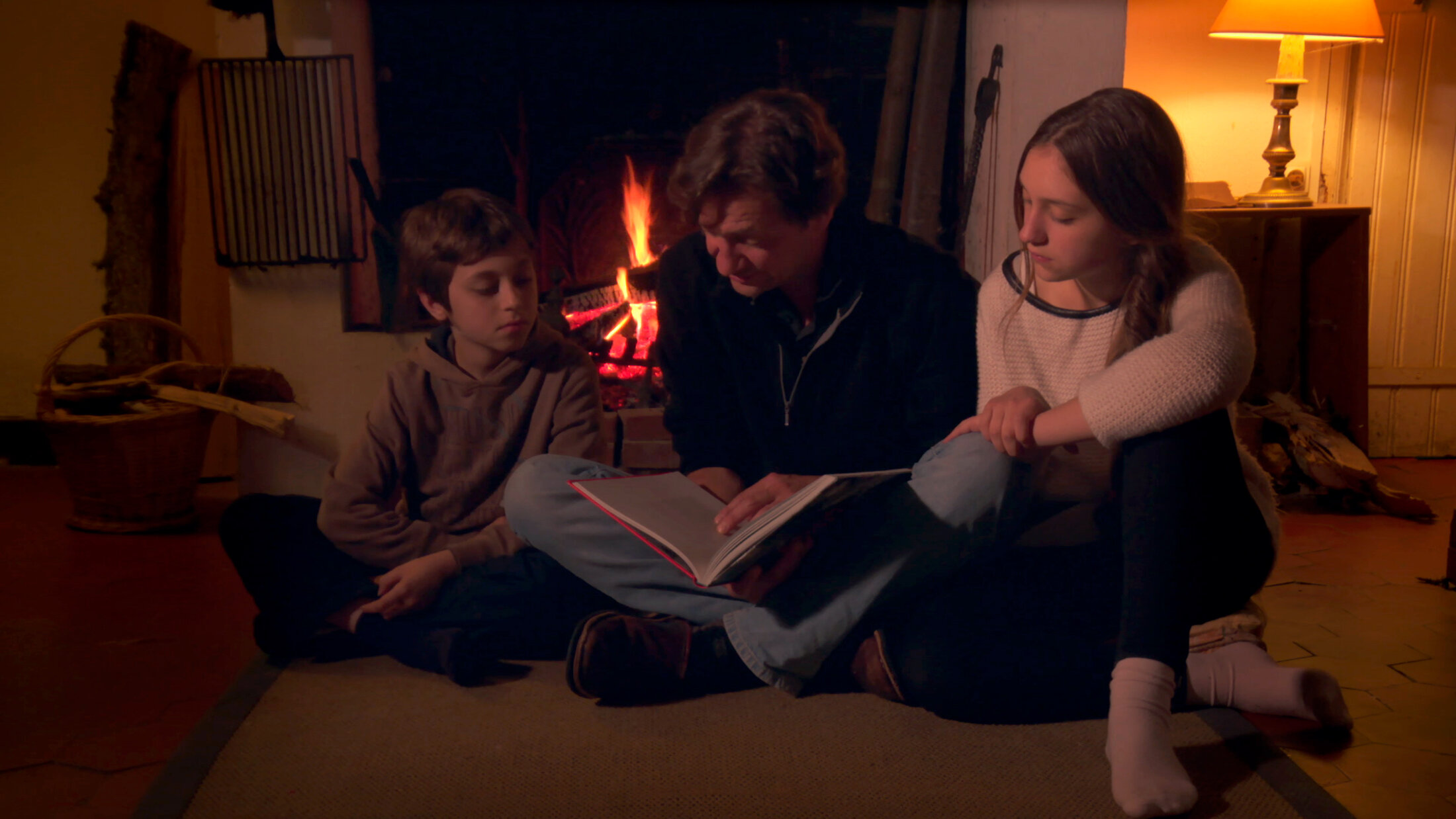
Retour en enfance, dans un univers où les robes des chevaux sont bleus ou rouges, et où celles des princesses changent de couleur… Cet univers, c’est Jacques Demy qui l’a créé en 1970 à l’occasion du tournage de Peau d’Âne, librement adapté et modernisé d’après le conte de Perrault. Pour l’occasion, décors de polystyrène sertis de strass, hutte de souillon, robes étincelantes de paillettes et miroirs fleurissent dans la forêt de Gambais, dans les Yvelines.
Quarante ans après, c’est au tour de l’archéologue néolithicien Olivier Weller de retourner sur les lieux du tournage qui ont vu naître le cake d’amour. Fasciné depuis l’enfance par l’univers kitsch bricolé par Demy, il entreprend entre 2012 et 2017 une véritable investigation autour des vestiges qu’a pu laisser le tournage. Car : "il reste toujours des choses !".

Agrandissement : Illustration 2

Nous voilà donc propulsés dans le grand domaine du château de Neuville où les images actuelles se calquent sur celles du film. À renfort de cartes topographiques, de mesures au laser et de balisage à la fourchette plastique, Olivier Weller se lance dans la quête de l’emplacement exact de la cabane de Peau d’Âne et des objets laissés ça et là par l’équipe : lames de rasoir, éclats de verre, grillage, vis de projecteurs… En parallèle des fouilles archéologiques, il mène une enquête plus littéraire autour des origines et significations du conte original.
Alors, film fétichiste ou jeu de piste grandeur nature mené par de grands enfants ? La réponse se trouve peut-être dans les multiples clins d’œil cinématographiques que le film fait à la fantaisie de Demy. Le regard caméra d’une statue qui nous dévisage. Une voix-off aux accents drolatiques qui mène la danse sur le ton malicieux et expressif du conte. Comme par magie, tout se métamorphose : la recherche archéologique devient une quête, les chercheurs les héros d’un récit initiatique, les rebuts des trésors. Une musique à suspens entrecoupée de pépiements d’oiseaux accompagne les experts en mesures topographiques. Le second degré, teinté de magie, transparait tout au long du film.
Le documentaire évoque ainsi la performance de Daniel Spoerri, Le déjeuner sous l’herbe (1983), au cours de laquelle une table de banquet et l’ensemble de ses plats sont enterrés et oubliés dans une tranchée, pour être déterrée trente ans plus tard. Cette archéologie des temps modernes questionne les thématiques de la mémoire, du passé, de ce qu’il en reste, de ce que l’on choisit d’en garder. Aux chercheurs qui entreprirent cette "première fouille de l’art moderne" l’artiste déclara alors : "Vous faites sérieusement quelque chose d’absurde."

Agrandissement : Illustration 3

•• Peau d'âme de Pierre-Oscar Lévy (100 min, 2017), disponible jusqu'au 2 mai sur Tënk
Chaque vendredi, tenez-vous informé-e-s de notre programmation et découvrez les derniers documentaires mis en ligne grâce à notre newsletter. Inscrivez-vous ici !