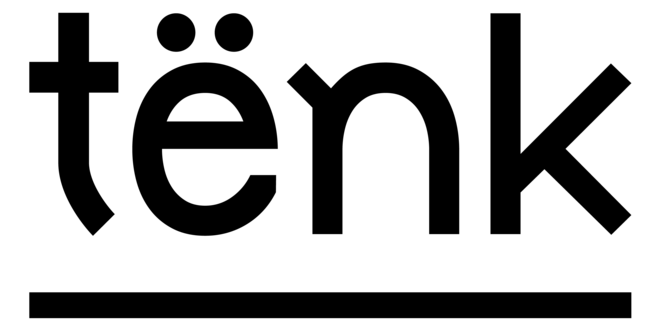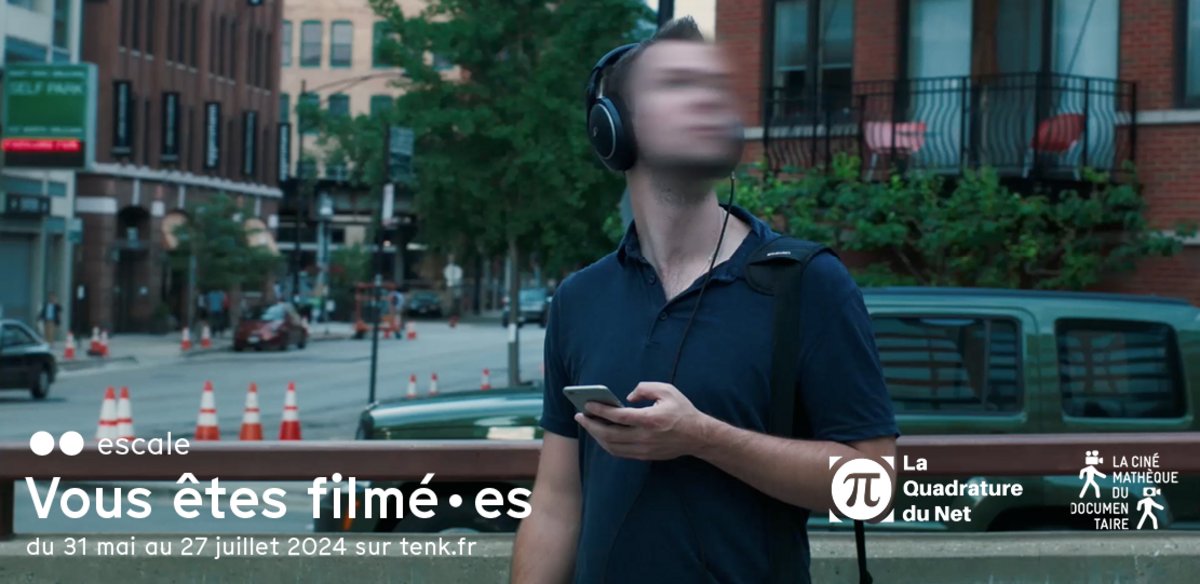
Agrandissement : Illustration 1
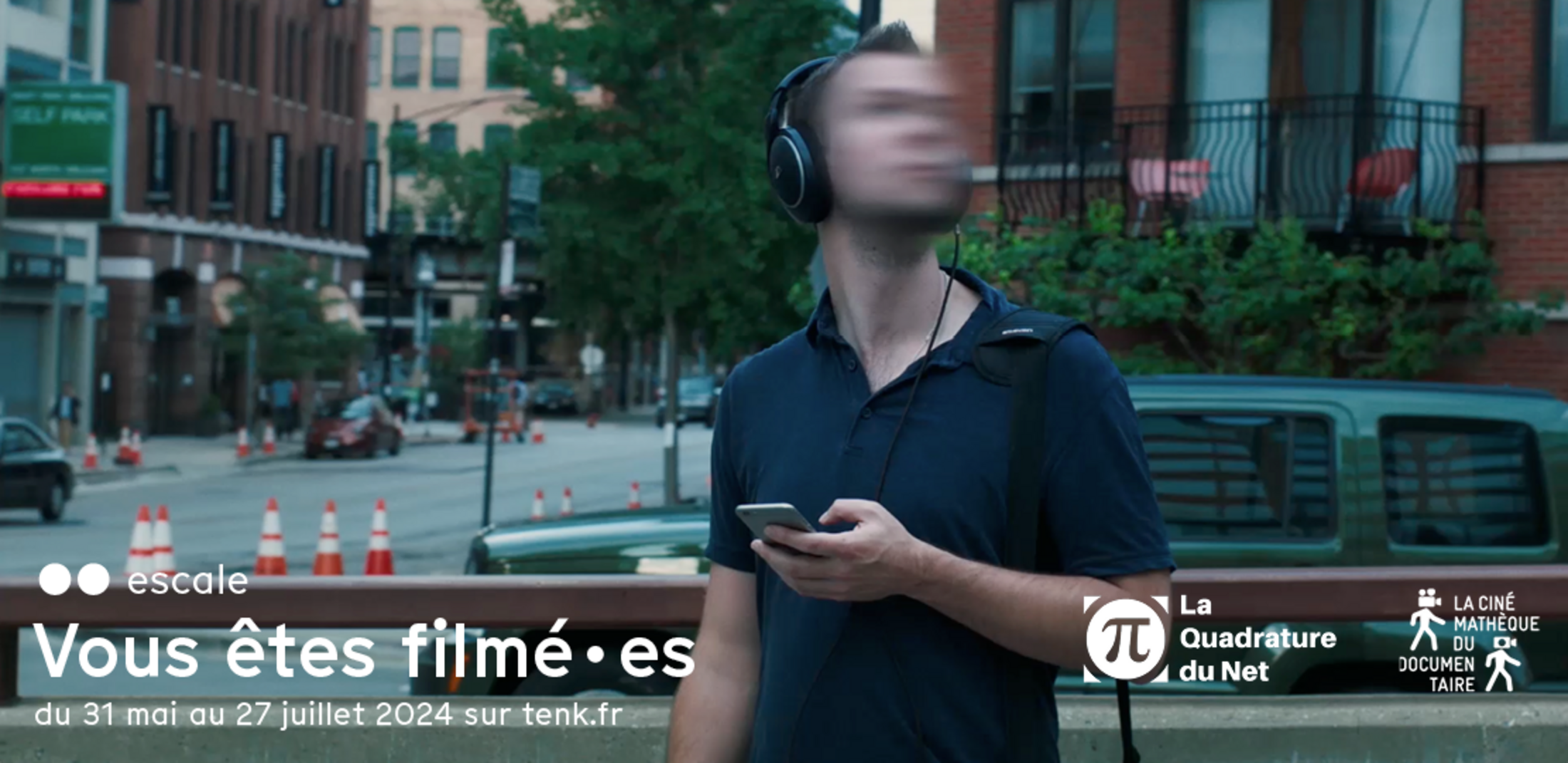
Sous couvert de sécurité et de contrôle, la surveillance prolifère.
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été l'occasion de voter une loi en procédure accélérée pour autoriser la vidéosurveillance algorithmique : des machines qui filment et analysent les mouvements. Des caméras augmentées ou intelligentes qui auront donc appris ce qu'est la norme.
Et lorsqu'il y a norme, il y a déviance, et lorsqu'il y a déviance il y a danger. Il faut donc suspecter les gens qui dévient.
Pour accompagner la programmation "Vous êtes filmé·es" Tënk a fait appel à La Quadrature du Net qui travaille depuis des années à la défense des droits humains face à la prolifération de la surveillance numérique. C'est la mission du projet Technopolice qui met l'accent sur la surveillance policière des espaces urbains.
Cette programmation tend un miroir aux surveillants et pointe du doigt ce pouvoir qui nous écrase de son gros œil.
Miroir ! Lorsque, dans Supervision, les activistes de Primitivi, collectif marseillais, glissent leur caméra à l'inauguration du nouveau terminal de vidéosurveillance de Marseille, où le gratin politique et mondain jouit du spectacle offert par les 180 caméras installées dans les rues (c'était en 2012 ; 12 ans après, il y en a 1 750).
Dans All Light, Everywhere, Theo Anthony rencontre un cadre zélé de l'entreprise Axon, leader du marché des bodycams policières aux États-Unis – ces caméras que les policiers portent en permanence – « pour notre sécurité » – lors de leurs interventions. Et qui fabriquent des images prétendument objectives. Mais c'est quoi, une image objective, lorsqu'elle est fabriquée par un pouvoir répressif ?
Je croyais voir des prisonniers, de Harun Farocki, nous rappelle l'origine carcérale de la vidéosurveillance. Lorsque le champ de la caméra dans la cour d'une prison correspond avec le champ de tir, difficile de parler d'image neutre...
Dans Prédire les crimes, on nous montre tout le système de contrôle et d'utilisation policière des données – que ce soient les images de surveillance, mais aussi tout ce que l'on abandonne de notre intimité sur les réseaux –, qui aboutit à une politique qui rappelle Minority Report.
Et le passé nous informe : dans An Ordinary Country, film fabriqué avec des archives du service de sécurité polonais des années 70. Planques, interrogatoires, enregistrements... l'intime et le banal est exploité pour traquer la possible dissidence, quitte à l'inventer de toute pièce.
L'Îlot, de Tizian Büchi nous emmène dans un quartier de Lausanne, deux vigiles chargés de sécuriser la rivière. Sécuriser une rivière, pourquoi ? Qu'importe : le film nous emmène à la rencontre des habitants du quartier. Ils nous racontent leurs histoires, ce qu'ils ont vu, ce qu'il se passe là. On se connaît tous. On sait des choses sur nos voisins. « Au-delà de l’État et de sa police, écrit La Quadrature du Net, [le film souligne] la multiplicité des formes de surveillance, la manière dont nous pouvons parfois nous en faire complices, et interroge la frontière entre surveillance et partage »...
Bons films, et bons JO !