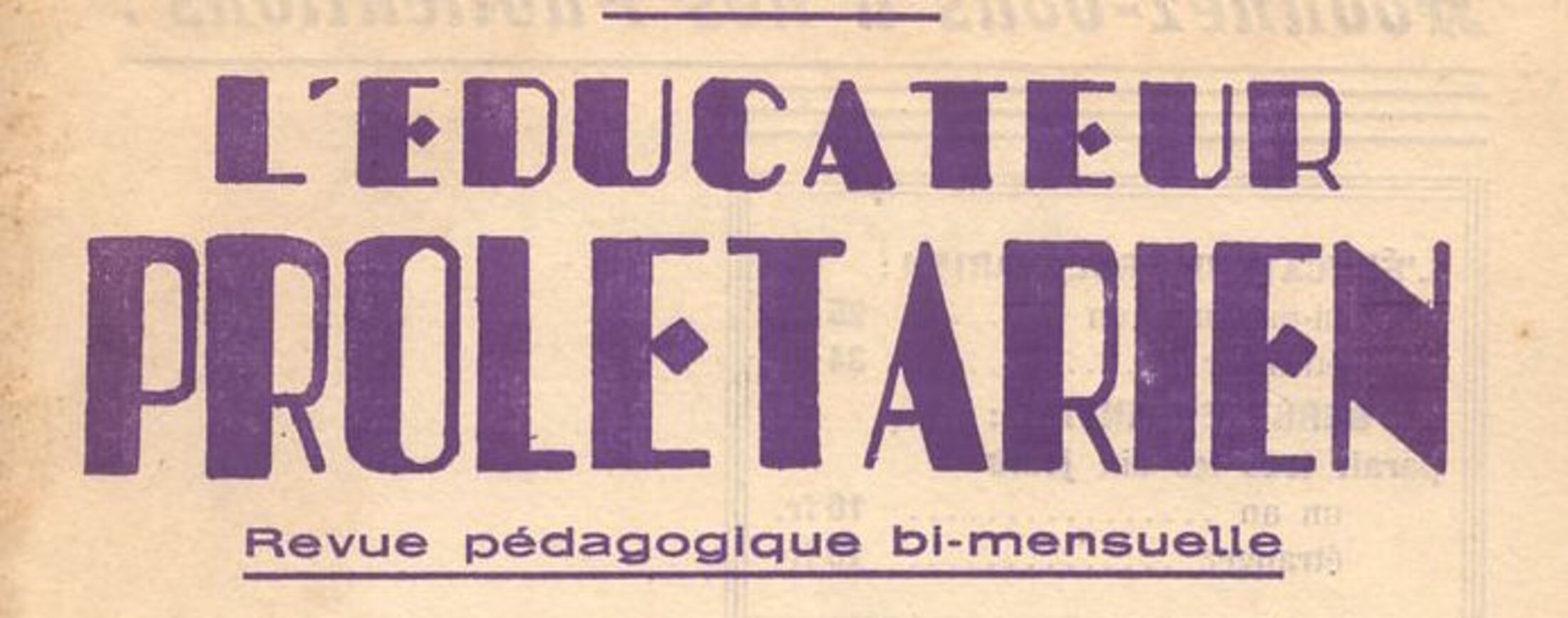Quelques mots d’introduction :
Rédigé par deux militant.e.s du syndicat parisien de SUD éducation il y a près de 20 ans, le texte ici mis en ligne a le mérite de revenir sur des questions centrales lorsqu’on parle d’inégalités à l’école. Bien sûr il pourrait être repris aujourd’hui et étoffé pour parler de l’empilement de « réformes » inégalitaires produites depuis par l’institution. Sans doute manque-t-il un développement sur la construction ségréguée du système scolaire (que les études récentes sur la carte scolaire des collèges parisiens a mise en lumière) et sur la reproduction des rapports de domination à l’école (on peut se reporter par exemple sur ce sujet aux travaux d’Ugo Palheta sur l’enseignement professionnel et son public). Mais les conclusions de ce texte n’en changeraient pas pour autant : oui, pour changer durablement l’école il va aussi falloir changer la société.
Il faut également lire ce texte au regard du contexte historique qui lui est propre : en 1997 les syndicats SUD éducation sont peu nombreux, n’ont que quelques mois d’existence et ne se fédéreront que l’année suivante, fin mai 1998 lors de leur premier congrès national tenu à Lyon. L’heure est encore aux débats fondamentaux permettant de fixer l’orientation du jeune syndicat. Ce qui peut expliquer le ton du texte, volontairement enlevé. La forme article en elle-même (avec son nombre de caractères limités) conduit nécessairement à ne pas pouvoir traiter l’intégralité du sujet annoncé en titre. Mais l’essentiel y est.
Enfin, le texte est ici intégralement reproduit. Je me suis seulement permis d’ajouter les intertitres (ainsi qu’une note personnelle).
T. R.
Soyons grossiers : l’école est une école de classe
Texte de H. C. et Y. B. (membres de SUD éducation Paris) paru dans le numéro 21 du journal national de SUD éducation de septembre 1997
L’école est une école de classe. Cela va sans dire, songeront nos camarades avertis… Oui, mais cela va mieux en le disant. D’autant que personne ne le dit plus. Or, SUD est bien décidé à proférer ce genre d’obscénités. Cela n’a rien d’une coquetterie de gauchistes nostalgiques : c’est au contraire le b-a-ba d’un syndicalisme qui entend inscrire son action dans l’objectif d’une transformation sociale globale.
Affirmation élémentaire, elle serait tout aussi exacte en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis. Un certain nombre de raisons historiques font qu’elle prend un relief tout particulier en France : loin d’y être un service, une institution comme une autre, l’école occupe dans notre pays une place beaucoup plus fondamentale. La mise en place de l’école laïque, gratuite et obligatoire y a été en effet une pièce déterminante de la constitution de l’État bourgeois moderne. La bataille (féroce, âpre, indécise) pour rompre les liens avec les restes de l’ancien monde, en l’espèce avec l’Église catholique alliée à la réaction orléaniste, s’est en effet en particulier concentrée sur ce point.
L’attachement « républicain » à cette école tient en partie à cela. Il est cependant troublant que l’on se réclame, jusque dans les rangs du « mouvement ouvrier », de l’école « de Jules Ferry », plutôt que d’en appeler à l’acte fondateur de la Commune de Paris, qui décréta précisément l’école gratuite, laïque, obligatoire, mais aussi « intégrale, [visant] à cultiver à la fois dans le même individu l’esprit qui conçoit et la main qui exécute. »
Il n’y a qu’un seul Jules Ferry : le constructeur de l’État bourgeois moderne
Étrange aussi cette fausse discussion sur la personne même de Jules Ferry : il y aurait le « bon » Jules, fondateur héroïque de l’école du même nom, et le « méchant » Ferry, enfumeur du Tonkin. Un dérapage, une erreur passsagère ? Non ! Il n’y a bien qu’un seul Jules Ferry : le constructeur lucide et patient d’un État bourgeois moderne, qui entreprenait de construire un empire, une industrie puissante, et de reconquérir les territoires perdus en 1870. Et l’école allait y jouer un rôle fondamental. De la leçon de morale (1) au cours d’éducation physique (2), en passant par l’apprentissage des chants patriotards et fanatiques (« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » et autres chefs d’œuvre de l’harmonie universelle…), on a préparé les héroïques fantassins de 1914, à la tête desquels se sont portés les glorieux instituteurs-lieutenants, qui les menèrent à la boucherie comme ils les avaient menés au Certificat d’études.
Étranges épousailles, parfaitement contre-nature. Rares furent ceux qui s’y opposèrent. Nombre d’entre-eux étaient membres de l’École émancipée, fondée en 1910 : ils combattaient d’un même mouvement pour achever le travail commencé en 1871 (dans le domaine de l’école en particulier, mais pas seulement) et contre la boucherie impérialiste…
C’est pourtant sur ce malentendu majoritaire que s’est construite une véritable escroquerie intellectuelle. L’école que nous connaissons, et dans laquelle, en gros, nous continuons d’évoluer, est le produit d’un compromis historique. Comme tout compromis, elle a représenté une victoire pour chacun des protagonistes associés à sa mise en place. Républicains bourgeois « éclairés » et militants ouvriers ont tous eu intérêt à la création de cette école. Ils ont combattu côte-à-côte contre un adversaire commun : la réaction cléricale et aristocratique. Ils ont gagné ensemble. Et cependant, leurs intérêts fondamentaux étaient aussi opposés que ceux des Communards et des Versaillais de 1871. Pour atteindre ses objectifs, la bourgeoisie a du accorder une pâle copie de cette école que revendiquait et que mettait en place la Commune de Paris. Elle a immédiatement entrepris d’en limiter les maigres effets. Tout cela n’a rien que de très normal. Ce qui l’est moins, c’est que les porte-parole « officiels » du mouvement ouvrier ont présenté cette école (qui était effectivement un acquis, certes partiel, mais bien réel) comme l’objectif atteint, comme un horizon indépassable. Nous vivons depuis sous ce régime idéologique qui voudrait nous faire croire qu’avec une peu plus de « moyens », avec quelques professeurs de plus, avec des classes moins chargées, nous aurions enfin l’école idéale, celle « de Jules Ferry », enfin réalisée.
L’éducation est nécessairement un enjeu politique
Aujourd’hui comme hier, des projets éducatifs s’opposent, comme s’opposaient et devraient encore s’opposer des projets sociaux, même si les termes de l’équilibre politique et économique ont évolué. Jamais il n’y a eu autant de jeunes scolarisés, jamais le système éducatif n’a été aussi brutalement sélectif. Sous couvert de « démocratisation », la fonction sociale de reproduction de ce système continue de s’accomplir. Or, cette massification n’a rien à voir avec la démocratisation de l’école. La dénonciation du système éducatif – instrument de reproduction des classes sociales – faite dans les années 70 a été étouffée par cette pseudo-démocratisation, massification qui a délibérément mis en marge tout élément qui tendrait à changer la nature du système. Sur ces 30 dernières années, elle s’est faite sans qu’aucun élément de fasse basculer le « compromis » vers une école du peuple : prolongation de la scolarité obligatoire mais…
- sur-saturation des établissements, par « manque » de prévision ou par regroupements de petites unités au nom de la rentabilité ;
- baisse importante du nombre relatif d’adultes professionnels enseignants ou non-enseignants dans les établissements du second degré, alors que la prolongation de la scolarité à 16 ans amenait toute une classe d’âge au collège ;
- non prise en compte dans l’institution du développement et des recherches, tant de la psychologie que des sciences humaines de ces dernières décennies, mais au contraire limitation de ces avancées dans des lieux isolés, sans développement, servant pour certains d’entre-eux de « vitrine » laissant croire à une progression généralisée du système ;
- dénaturation de certaines pratiques ou revendications en les reprenant officiellement hors contexte et sans moyens adéquats (en vrac, allant du « texte libre » de Célestin Freinet inscrit à l’emploi du temps jusqu’au « collège pour tous » de la réforme Haby) ;
- au nom de l’individualisation de l’enseignement, développement d’un système de sélection par l’échec qui renvoie à une responsabilité individuelle et masque la réalité des rapports sociaux ;
- au nom du respect de l’enfant, ouverture sur des projets qui nient le développement global de la personne (séparation précoce entre disciplines de la connaissance et disciplines de la sensibilité) et le principe d’égalité (par création de nouveaux types de personnels en partie à la charge des régions et/ou des municipalités).
Peut-on croire avec innocence encore longtemps que seuls, les militants pédagogiques aient acquis, toutes ces décennies passées, par leurs propres capacités d’analyse et d’étude, les éléments nécessaires à envisager un système éducatif basé sur la pédagogie de la réussite et de l’épanouissement, non-discriminatoire, situant délibérément l’enfant dans un collectif qui va produire les connaissances en même temps qu’il les acquiert, aidant à sortir des inégalités de naissance d’ordre socio-culturel… ? Déjà il y a un siècle, certains pressentaient que le pouvoir libérateur d’un système éducatif ne réside pas dans la quantité de savoirs qu’il transmet mais bien de la possibilité qu’il va ouvrir à l’élargissement des bases sociales des processus de production de ces savoirs. L’installation et le développement de la précarité et du chômage ont fait éclater le mythe de « l’école libératrice » !
Cependant, un siècle de modèle unique accroît la confusion et rend parfois difficile la réflexion pour toute une population, issue de ces générations formées dans et par « l’école de la République » à une époque où elle joua un certain rôle « d’ascenseur social » (monter dans les échelons d’une société inégalitaire et non aider les classes dominées à développer les savoirs qui transformeraient la nature inégalitaire du système… tel fut l’ascenseur social). Aujourd’hui, les données du compromis ressurgissent. Et les arguments d’analyse se sont affinés. Et les situations extrêmes d’impossibilité de fonctionner commencent à se multiplier. Il faut affirmer que le problème des conditions de travail ET le problème d’une autre pratique pédagogique sont liés et ne sont pas des problèmes individuels. Il faut affirmer qu’ils sont au cœur du problème de la finalité de l’école et que le syndicalisme se doit de les poser comme tels.
C’est un problème politique au sens le plus authentique du terme. Revendiquer uniquement en termes de moyens quantitatifs pour l’école revient à accompagner ce système en tentant de l’améliorer sur les marges (3). Peut-être faute de perspectives… Ou peut-être pour y avoir été trop inclus… Nous n’accompagnerons pas. Nous prétendons, à SUD, reprendre cette discussion si longtemps enfouie. Nous inscrivons notre combat dans l’objectif d’une autre école, qui ne peut exister que dans une autre société, débarrassée du profit, de la compétition stérile, de la sélection, d’une école qui ne se préoccupe plus que de l’épanouissement total de toutes les capacités que recèle chaque enfant, non pour le conformer à un modèle productif et compétitif, mais pour l’aider à conquérir sa liberté.
H. C. et Y. B., SUD éducation Paris, septembre 1997
(1) Binet, l’un des fondateurs de l’enseignement spécialisé, lancera par exemple en 1909 la première enquête nationale dans les écoles. Son sujet : combattre le « mensonge », c’est à dire éradiquer dans les « classes dangereuses de la société » (pas besoin d’une note, n’est-ce pas) non pas un vice condamnable, mais une procédure de résistance à l’autorité du maître, et bientôt à celle du patron…
(2) Pour les garçons : parcours naturel, lancer de grenade et combat au bâton-baïonnette ; pour les filles, exercice de préparation à la maternité : il fallait de la chair à canon !
(3) Remarque personnelle : le texte est ici un peu sévère... Même s'il ne dit pas qu’il ne faut pas revendiquer des moyens (ce qui est justement pointé plus haut) il peut paraître condamner les luttes partielles portant sur des revendications strictement matérielles. La réalité de terrain est souvent plus matérielle justement et il faut constamment rappeler la nécessaire « double besogne » héritée de la Charte d'Amiens (articuler revendication immédiate ET transformation sociale) qui continue d’inspirer les syndicats SUD et Solidaires (et fort heureusement bien d’autres équipes syndicales). Bref, on peut et on doit revendiquer des moyens dans l'école d'aujourd'hui... pour construire aussi le combat pour une autre école et une autre société !
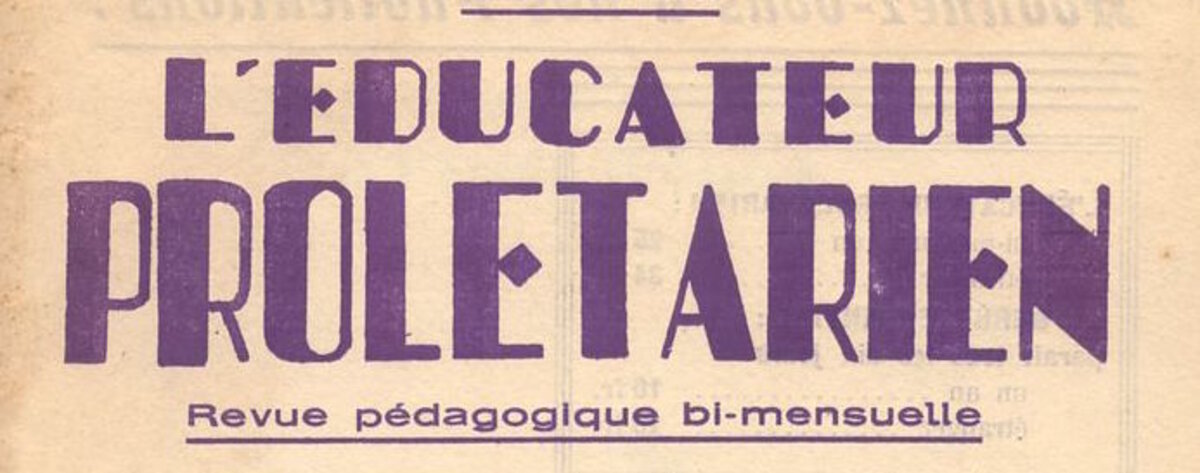
Agrandissement : Illustration 1