« La défaite a dépassé toutes nos espérances. »
La formule, cinglante, est du médecin Stéphane Barsony, communiste critique, ancien brigadiste en Espagne et résistant FTP-MOI. Assénée en mars 1978, elle est reprise par le dessinateur Wiaz comme titre au recueil de dessin qu’il publie la même année chez François Maspero.
Cette sentence résonne avec ce que nous traversons depuis un an. Même si « faire Front populaire » n’était pas réductible au cartel électoral du NFP, l’explosion en vol de ce dernier – avec chaque jour les retombées de nouveaux éclats – est une entaille profonde à la dynamique que nous avons connue.
Alors cette phrase nous invite sans doute à réfléchir à la part de « récidive » qu’elle peut contenir (pour reprendre l’expression du philosophe Michaël Fœssel). Avec bien sûr la mesure à prendre de toutes les différences, nombreuses et importantes, qui séparent hier et aujourd’hui. Mesurons donc, tout en réfléchissant quand même.
Lorsqu’elle est prononcée, nous sommes au lendemain des élections législatives des 12 et 19 mars 1978. Presque 35 000 000 d’inscrit·es, un taux de participation de 83% au premier tour, 85% au second. Et la gauche qui échoue à rassembler une majorité des suffrages (avec 46,74% des voix au premier tour et 49,54% au second).
La défaite est bien celle-là, celle des urnes et d’une gauche institutionnelle qui n’arrive plus à s’unir (l’union de la gauche actée depuis 1972 avait été rompue en 1977) et qui n’arrive pas à gagner. Des écueils que nous connaissons bien.
Listons aussi les différences : les urnes sont aujourd’hui désertées ; la gauche est à son étiage le plus bas ; l’enjeu n’est pas une victoire électorale dans la foulée d’un immense mouvement social, celui de Mai 68, mais d’empêcher le fascisme de s’installer au pouvoir.
Encore que sur ce point il ne faille pas oublier ce qui hantait la gauche de l’époque : la possibilité d’un putsch militaire comme ce fut le cas le 11 septembre 1973 au Chili contre le gouvernement d’Union populaire. Le cauchemar fasciste restait proche.
Mais électoralement parlant, l’extrême droite était cantonnée aux scores marginaux. Elle était disqualifiée et honnie par l’écrasante majorité de la population.
Sur le temps long – car la « victoire » suivante de 1981 apparaît à peine comme une parenthèse si ce n’est déjà un leurre – il faut mesurer à quel point la défaite de la gauche est indexée sur la montée de l’extrême droite. Disons-le sans détours : elle ne peut pas évacuer ses responsabilités en la matière. En tout cas, ses responsabilités sont celles qui nous intéressent et doivent urgemment être passées par notre camp au tamis de la critique.
Ne pas construire le désespoir à gauche
La défaillance du premier gouvernement de gauche depuis longtemps, dès 1982, attendue peut-être par celles et ceux qui se méfiaient des socialistes de gouvernement ne l’était pas par toutes et tous. En lieu et place de « nos espérances », elle construisit un désespoir à gauche – réactivé par le désastreux quinquennat Hollande, de déchéance de nationalité en Lois Travail – que nous payons lourdement aujourd’hui.
On pourrait être tenté d’en conclure que les états-majors de la gauche d’appareil et de gouvernement, de toute façon, « ont trahi, trahissent et trahiront ». Bref, que « l’espoir à gauche » ne sert à rien. Que des promesses on soit passé aux désillusions, au désarroi, soit.
Néanmoins, aux anti-électoralistes de principe ou de circonstance – et ce même si on peut entendre les critiques à l’égard d’un système représentatif qui n’arrive qu’à reconduire l’ordre des puissants – disons que les urnes nous ont habitué à ce que rien d’absolument révolutionnaire n’en sorte c’est vrai, mais que des mêmes urnes peuvent aujourd’hui sortir le pire.
C’est tout le problème : ces urnes-là, qui ne sont pas le lieu de nos espérances, sont les mêmes qui peuvent leur faire courir un risque mortel. Trop petites pour les contenir, leur influence néfaste peut être gigantesque à leur encontre. On ne peut pas faire l’impasse sur cela. Si l’on veut être pragmatique, une conclusion s’impose : empêcher l’extrême droite de parvenir dans moins de deux ans au pouvoir, c’est la faire reculer électoralement et cela veut dire faire progresser électoralement la gauche.
Le vote fasciste n’est pas une bulle électorale, il a désormais des racines profondes. Mais rien n’est gagné ou perdu d’avance. Quel que soit l’état du NFP aujourd’hui, la mobilisation de juin dernier a montré qu’il était possible de faire mentir les sondages. Rappelons-nous les énergies qui se sont déployées. Même si la mobilisation de juin dernier n’a pas eu l’ampleur de celle contre la ratification du Traité constitutionnel européen en 2005, les vestiges en sont toujours visibles sur les murs de nos rues.
Autonomie et force collective
Il va falloir aller plus loin. Débarrasser les promesses de gauche de leurs illusions, ce n’est pas abandonner l’espoir, mais bien plutôt chercher à le rendre palpable, concret.
Être lucide sur ce point, et agir en conséquence, conduit à poser les conditions d’un changement en profondeur la société – ce qu’un seul gouvernement de gauche ne garantira jamais.
Repassons très brièvement par 78.
D’abord, confiner nos espoirs de « changer la vie » à une seule victoire électorale est une erreur et une faute. Pensons au mea-culpa du secrétaire général de la CGT, Georges Séguy, à l’ouverture du 40ème congrès de son syndicat fin 1978. Le soutien inconditionnel au Programme commun de gouvernement comme seule alternative tenait d’« une vue idéaliste du changement et une certitude en la victoire électorale de la gauche à laquelle tout fut subordonné, y compris, dans une certaine mesure, la satisfaction des principales revendications ». Le bilan méritait d’aller au-delà, interrogeant la nature même des revendications et leur portée (pour ne pas l’avoir fait, la CGT manqua en partie les années 68).
Tirons-en toutefois deux leçons : 1) l’autonomie du mouvement social ne peut pas être une variable d’ajustement. Une erreur (la subordination au « politique ») qui a été commise trop souvent et trop longtemps ; 2) changer la société, si ce n’est la vie, ne tient pas du « raccourci électoral ». C’est une erreur à nouveau que de le croire, une faute que de le faire croire.
Sur le premier point, l’indépendance des organisations du mouvement social est aujourd’hui actée et constamment réaffirmée – même lorsqu’il a fallu appeler à voter pour le NFP en juin dernier. Mais l’indépendance doit malgré tout se conjuguer à la convergence avec les partis, a minima une convergence tactique, antifasciste et immédiate.
Cette approche a été insuffisante en juin/juillet dernier. Le NFP a été un cartel électoral parce qu’il est resté la propriété des partis – et des quatre plus gros – et parce que le mouvement social n’y a pas été/ne s’y est pas associé. Quelques comités locaux tentent encore d’inverser la tendance, mais sans dynamique nationale alliant grandes associations, syndicats et partis (autour par exemple d’un comité de liaison, de réunions régulières et publiques).
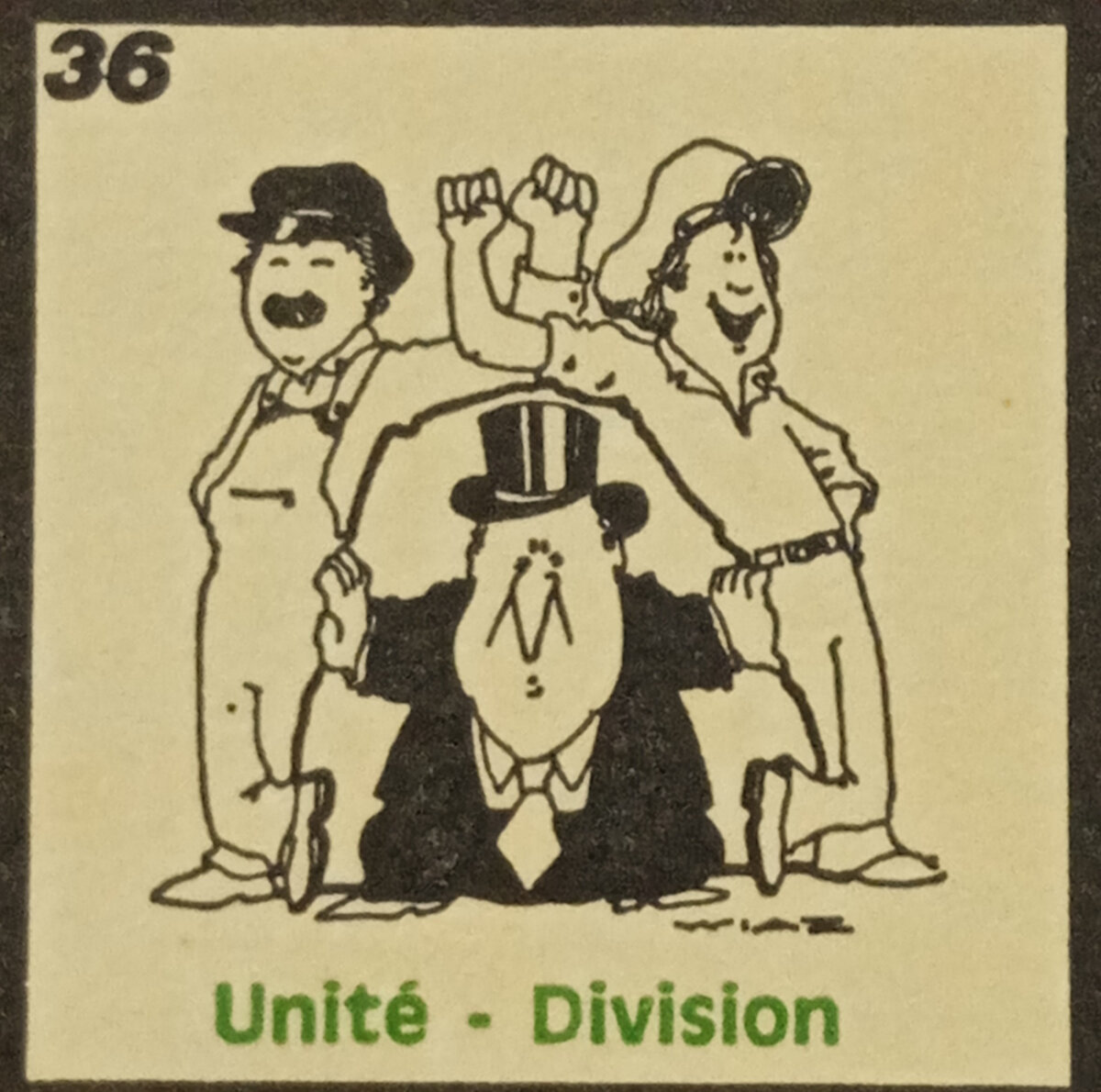
Agrandissement : Illustration 1

Il manque une démarche nationale et collective – assumant des désaccords – qui permettrait d’intervenir avec force dans les grandes batailles qui nécessitent un engagement de toutes et tous : contre le génocide à Gaza ; contre les crimes racistes et de haine ; contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre; en soutien aux salarié·es en lutte contre les licenciements ; pour la transition écologique. Des marches aux piquets de grève, personne ne doit manquer à l’appel. Les absences dans notre camp comptent aujourd’hui double, si ce n’est plus encore. L’indépendance, ça ne peut pas vouloir dire « chacun dans son couloir ».
L’indépendance n’est par ailleurs qu’un des aspects de l’autonomie : le syndicalisme, les mouvements sociaux peuvent élaborer et incarner bien plus ce qu’on entend par « transformation sociale », pour prouver qu’une alternative anticapitaliste, antiraciste et antipatriarcale existe et peut être portée largement dans la société. Rappelons que la CGT, la FSU, SUD-Solidaires se sont des centaines de milliers de membres affilié·es. Ce qui est au demeurant à la fois beaucoup et peu.
Refonder et renforcer
Le second point est peut-être plus décisif encore de ce point de vue. Imaginer que la progression de la gauche puisse se faire de scrutin en scrutin en enjambant le patient travail d’organisation c’est courir à l’échec encore et encore. L’ancrage populaire est une nécessité et il s’agit de s’en inquiéter (au moins) et de s’y atteler (vraiment). Ce qui veut dire donner plus de temps à l’organisation, et peut-être moins à la communication.
Dans un récent entretien donné à Mediapart, le journaliste franco-américain Cole Stangler, de retour d’États-Unis sous le joug trumpiste, livre cette analyse : « Ce qui me donne espoir, c’est le renouveau du syndicalisme aux États-Unis, même si la tendance est encore modeste. (…) Un pays davantage syndiqué est un pays dans lequel les classes populaires ont des valeurs plus ancrées à gauche ».
Le négliger coûte cher, très cher. Non seulement à la gauche mais à toute politique d’émancipation digne de ce nom.
Dire ça ne résout pas tout. Un travail d’organisation n’est pas pur volontarisme. Il faut à la fois identifier les zones grises de l’organisation, là où nous n’avons pas trouvé ce qui peut donner le déclic, l’envie. Pas trouver non plus les actrices et les acteurs pour le faire. Ce qui signifie bien identifier le tissu social réel du pays, et ne pas le fantasmer en étant à la recherche perpétuelle d’une nouvelle avant-garde qui apparaîtrait un coup ici, un coup là. Oui, ça n’est pas simple. Mais des expériences comme celles menées par le syndicat ELA au Pays basque sud dans des grèves féministes retentissantes (et gagnantes) montre que les efforts peuvent ne pas être vains.
Je me permettrai de reprendre ici ce qui a été dit ailleurs dans un texte collectif : « Ce qui s’appelle prolétariat, et qui n’est pas réductible à la classe ouvrière d’industrie, est loin d’avoir disparu. Que les grandes concentrations ouvrières, tous les « Billancourt », ne soient plus dans le paysage est une chose (au passage, c’est peut-être une réalité française, mais qui n’est pas européenne et encore moins mondiale). (…) Mais cette concentration n’est pas une constante de l’histoire du prolétariat : le syndicalisme, le mouvement ouvrier même, s’est ainsi inventé dans un entrelacs de fabriques et de métiers qui valent bien l’éclatement d’aujourd’hui. »
Attention, il ne s’agit pas non plus d’organiser pour « orienter les masses » comme à la manœuvre, le doigt sur la couture du pantalon. Car c’est dans les mobilisations des classes populaires elles-mêmes que s’affirme leur capacité politique. Redonner conscience pour reprendre confiance, tel est l’enjeu.
C’est en quelque sorte de la fabrique du peuple de gauche dont il est question. D’une majorité sociale qui se reconnaît, se vit et se bat comme telle, pour et par elle-même.
Et cela aucun tribun, aussi doué soit-il, n’y palliera. Aucune primaire à gauche résumée, si ce n’est résumable, à une compétition des égos ne s’y substituera.
Il y a bien des questions qui méritent des désaccords à gauche : celles et ceux qui s’inquiètent de la démocratie en son sein (de son absence ou de ses défaillances), qui voient dans le présidentialisme une gangrène ont raison. Mais si l’aspiration démocratique, qui existe, redevient une exigence populaire appuyée sur des luttes auto-organisées, donc concrètes, alors le point d’équilibre du débat à gauche en sera modifié. Et l’espace pour imaginer une remise en cause radicale de l’ordre du monde se dégagera d’autant. Où le pouvoir ne serait plus confisqué par quelques-un·es, où les hiérarchies traditionnelles seraient sérieusement remises en question. Refonder et renforcer nos espérances – pour en revenir au second terme du docteur Barsony. Parce que ce qui s’appelle « victoire » va bien au-delà d’un lendemain de second tour.
Il y a peut-être un chemin pour reconstruire une voie démocratique et socialiste au sens plein et entier du terme. Un projet de société sans domination ni oppressions. C’est aujourd’hui un chemin de crête, au bord du volcan. Si nous ne voulons pas que la défaite dépasse à nouveau – et durablement – ce qu’il reste de nos espérances, il nous faut l’emprunter collectivement.



