Dans un billet précédent (lien), Mickaël Bertrand présentait certains grands thèmes de son ouvrage L’Histoire racontée par les séries publié en 2022 aux éditions L’Étudiant. Cet article fait suite aux réflexions de l’article précédent, avec un focus sur la façon dont est (ou non) manipulée l’histoire dans les séries.
Les séries s’emploient également à raconter l’histoire, la rendre vivante en restituant ou inventant des personnages et des lieux. Certaines séries bénéficient d’une audience planétaire. Elles mobilisent les imaginaires et deviennent des références communes à plusieurs centaines de millions de personnes en l’espace de quelques semaines. Ce phénomène existe depuis la fin des années 70. Il a pris une ampleur considérable avec le développement des plateformes de streaming. Tous ces éléments poussent à développer l’émergence d’un nouvel imaginaire collectif. Les séries sont, à bien des égards, une nouvelle forme de mythologie.
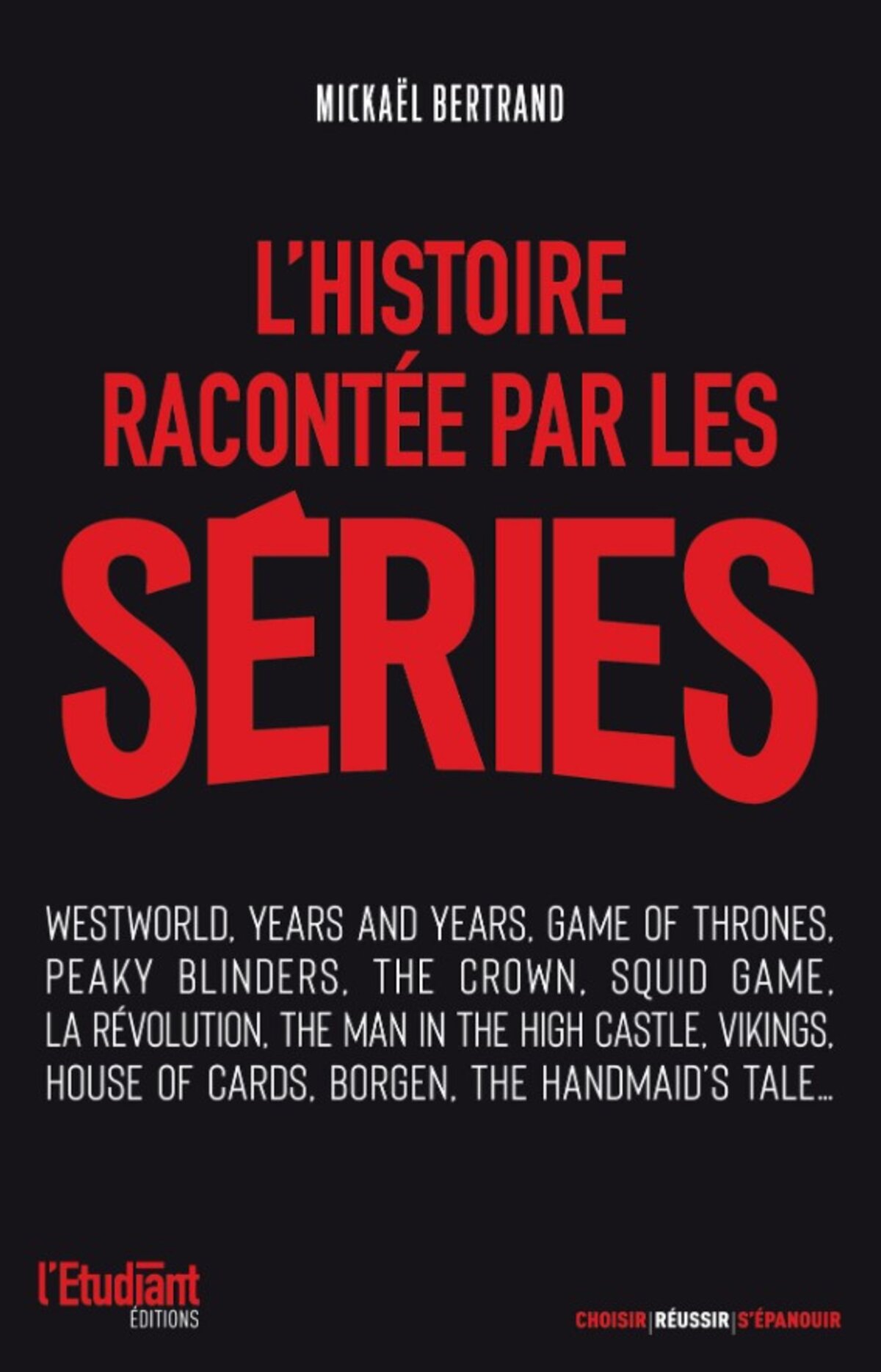
Agrandissement : Illustration 1
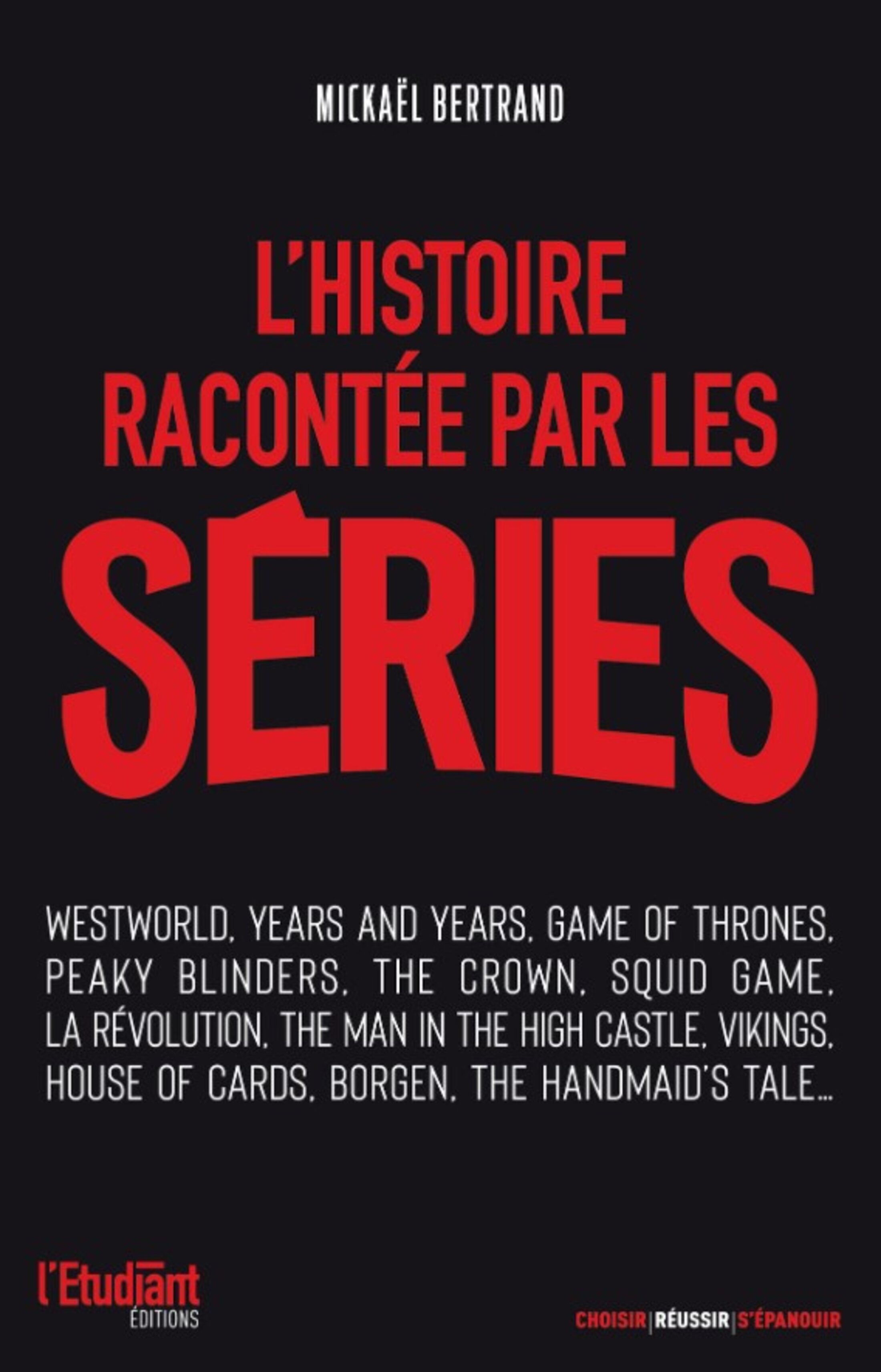
Vincent Mathiot. : Certaines séries se développent autour d’éléments historiques précis. Celles-ci peuvent également chercher à restituer une période de l’Histoire. L’Histoire serait-elle instrumentalisée dans les séries ?
Mickaël Bertrand. : Je serai assez prudent sur le terme « instrumentalisation ». Il me semble déraisonnable de considérer que les scénaristes auraient pour intention d’instrumentaliser l’histoire. Ils peuvent lui accorder une place plus ou moins importante selon leurs objectifs narratifs mais je ne suis pas certain que la plupart d’entre eux ait un agenda idéologique et politique bien défini. La série Mixte par exemple, qui raconte l’arrivée des jeunes filles dans une école de garçons en France dans les années 1960, est assez décevante de ce point de vue car le contexte historique, pourtant essentiel dans l’intrigue, est finalement réduit à la portion congrue.
A l’inverse, comme pour toute production culturelle, il me semble intéressant d’interroger le sens implicite du contexte historique proposé dans chacune de ces séries. George R. R. Martin développe notamment une réflexion intéressante sur l’altérité dans Game of Thrones. Lorsqu’il met en scène le Mur de glace qui sépare le royaume des Sept Couronnes des terres glacées et sauvages (largement inspiré du Mur d’Hadrien), il nous invite à considérer les murs physiques et mentaux que nos sociétés continuent à bâtir entre les pays, les hommes et leurs univers mentaux.
Quoiqu’il en soit, l’audience des séries nous oblige à considérer ces productions avec le plus grand sérieux car leur diffusion planétaire leur confère un pouvoir culturel sans précédent. Il y a quelques années, le Time désignait Tom Hanks comme « l’historien en chef des États-Unis » et ce n’est pas anodin. Son influence dans le domaine de la production audiovisuelle lui permet en effet aujourd’hui de mettre en lumière des acteurs ou des périodes de l’histoire avec un impact bien plus important que n’importe quel historien.
V.M. : Comment l’histoire se matérialise-t-elle dans les séries ?
M.B. : Les séries donnent à réfléchir sur le sens de l'histoire, la causalité, le rôle des acteurs… et c’est probablement l’un de leurs principaux intérêts. Elles permettent de comprendre la profondeur et la complexité du temps qui passe sans se limiter à une simple chronologie événementielle.
Les productions anglo-saxonnes sont particulièrement convaincantes sur ces questions car les équipes de production font largement appel à des équipes de consultants en histoire qui parviennent à insuffler des éléments qui donnent une profondeur scientifique aux récits. En France, à l’exception d’Un village français qui a bénéficié des conseils avisés de Jean-Pierre Azéma, les séries se passent généralement d’une véritable lecture historienne, au détriment souvent de la qualité de l’intrigue.
V.M. : L’Histoire se réécrit-elle dans les séries ?
M.B. : Malgré tout l’intérêt que je porte aux séries, j’essaie dans cet ouvrage de proposer un manuel de lecture critique de quelques productions parmi les plus populaires. Il convient en effet de rappeler que ce n’est pas parce qu’un scénario est bien ficelé que l’histoire qu’il raconte se rapproche de la vérité. Si la première saison de Vikings est par exemple très bien renseignée, les suivantes prennent de plus en plus de liberté avec l’histoire de ces peuples dont il reste encore de nombreuses facettes à dévoiler.
V.M. : Certaines séries comme The man in the high castle sont des uchronies qui laissent entendre que notre présent pourrait être pire. Par ce procédé, cherchons-nous à anticiper nos craintes sur l’avenir ?
M.B. : Je me suis longuement interrogé sur la légitimité d’un chapitre consacré aux uchronies mais la multiplication de ce genre dans la production sérielle et la lecture de l’excellente Histoire des possibles de Quentin Deluermozet Pierre Singaravélou a fini par me convaincre.
Ces uchronies interrogent selon moi le rapport de nos sociétés à l’avenir. Au début des années 2000, François Hartog avait proposé la notion de « présentisme » pour expliquer une espèce de nostalgie généralisée face à un avenir considéré comme incertain et angoissant. A mon sens, les uchronies témoignent d’un niveau supérieur d’anxiété qui conduit nos sociétés à ne pas seulement se réfugier dans un passé fantasmé, mais à réécrire l’histoire pour nous rassurer. Le point commun des uchronies récentes dans les séries consiste en effet à montrer que la situation pourrait être bien pire que celle dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 2

V.M. : Les séries deviennent-elles une marche pour atteindre le pouvoir ?
M.B. : C’est une excellente question. Le cas le plus évident auquel tout le monde pense est celui de Volodymyr Zelensky avec la série Serviteur du peuple. Mais il ne faudrait pas non plus négliger The Crown qui a joué un rôle important dans la préparation de la succession à la tête de la monarchie en Angleterre.
Dans ces deux cas, il est intéressant de s’interroger sur la place que le storytelling occupe désormais dans nos sociétés et dans nos systèmes politiques. Aujourd’hui, toutes les femmes et tous les hommes politiques se mettent plus ou moins en scène et tentent de raconter une histoire pour s’emparer du pouvoir car, comme le rappelle la conclusion de la série Game of Thrones, celui qui accède au pouvoir est toujours celui qui détient la meilleure histoire.
Contrairement à ce que pourraient laisser croire certains conseillers en communication, cette stratégie est millénaire. Elle était déjà présente dans les récits mythologiques et elle est simplement actualisée aujourd’hui par des storytellers dans un contexte médiatique moderne. Dans le chapitre que je consacre à l’histoire politique dans les séries, j’évoque notamment le cas de Fanny Herrero (la talentueuse showrunneuse de Dix pour cent) qui a raconté dans une interview qu’elle a été approchée par les équipes d’Emmanuel Macron pour scénariser la campagne pour l’élection présidentielle de 2022.
Si cela peut nous sembler relativement nouveau en France, c’est une pratique déjà ancienne aux États-Unis avec des conseillers qui traversent régulièrement le pont entre le monde de la communication politique et celui de la production scénaristique. C’est par exemple le cas de Mark McKinnon qui a expliqué dans un remarquable documentaire réalisé en 2016 par le New York Times comment il est parvenu à faire gagner de nombreux candidats aux élections. Sa recette est finalement simple : il faut à chaque fois trouver une menace ou une opportunité susceptible de susciter de la peur ou de l’espoir chez les électeurs. Dès lors, on identifie une victime de cette situation, un méchant, une solution et un héros (de préférence, le candidat que l’on essaie de faire élire). Cette architecture narrative a notamment été mobilisée lors des élections de George W. Bush. En 2000, la menace était la dérive culturelle à l’issue des mandats de Bill Clinton éreinté par le scandale Monica Lewinsky. Le candidat républicain a alors été présenté comme un bon père de famille, surjouant le rôle du « born again ». En 2004, c’est la menace terroriste qui était désormais sur le devant de la scène et George W. Bush s’est alors transformé en chef de guerre.
V.M. : Les séries permettent-elle la construction d’un nouvel imaginaire collectif ?
M.B. : Si les histoires sont utiles pour prendre le pouvoir, elles sont aussi indispensables pour s’emparer des savoirs. Pourquoi Homère a-t-il écrit L’Iliade et L’Odyssée ? Parce que ses histoires permettaient de faire passer de nombreux messages sur l’amour, le pouvoir, la guerre, la fidélité, etc. Quelques siècles plus tard, les religions du livre l’ont bien compris et se sont emparé de cette stratégie sous la forme de paraboles. Aujourd’hui, il existe tout un champ de recherche en storytelling dans le domaine de l’éducation qui réfléchit à la fois aux méthodes permettant de mieux faire comprendre certains concepts aux élèves, mais aussi à former les élèves pour qu’ils puissent exercer leur esprit critique sans se faire manipuler par des raconteurs d’histoires.
« Si notre époque contemporaine a tendance à placer la science censée dire vrai (qu’elle soit expérimentale ou historique) au-dessus de la fiction dans l’échelle de valeurs, cela n’a donc pas toujours été le cas. Pendant longtemps, croire aux mythes et légendes relevait de la piété, voire du civisme, et permettait de faire communauté. On peut dès lors se demander si les scénaristes, lorsqu’ils parviennent à rassembler des millions de téléspectateurs à travers le monde autour des séries populaires, ne sont pas tout simplement les héritiers des poètes antiques et des troubadours médiévaux. Ils continuent à fabriquer des histoires, aussi variées que significatives, dans lesquelles chacun est libre de se laisser perdre, avec raison ou passion. »
- Mickaël Bertrand dans L’Histoire racontée par les séries



