« Tant que les revenus des classes de la société contemporaine demeureront hors de portée de l'enquête scientifique, il sera vain de vouloir entreprendre une histoire économique et sociale valable.» C'est par cette belle phrase que s'ouvre le livre consacré en 1965 par Jean Bouvier, François Furet et Marcel Gillet au Mouvement du profit en France au XIXe siècle. Ce livre mérite d'être relu, d'une part parce qu'il s'agit d'un des ouvrages caractéristiques de l'histoire "sérielle" qui prospère en France au XXe siècle (essentiellement des années 1930 aux années 1970), avec ses qualités et ses défauts, et d'autre part et surtout du fait du parcours intellectuel de François Furet, qui illustre à merveille les bonnes et les mauvaises raisons expliquant la mort de ce programme de recherche.
Quand Furet débute sa carrière, jeune historien prometteur, il se dirige vers ce qui lui semble être le sujet de recherche central : "les revenus des classes de la société contemporaine". Le livre est rigoureux, sans préjugé, et cherche avant tout à rassembler des matériaux et à établir des faits. Pourtant, il s'agit de son premier et dernier ouvrage dans ce domaine. on retrouve dans Lire et écrire, magnifique ouvrage publié en 1977 avec Jacques Ozouf et consacré à "L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry", la même volonté d'établir des séries, non plus sur les profits industriels, mais sur les taux d'alphabétisation, les nombres d'instituteurs et les dépenses d'éducation. Mais pour l'essentiel, Furet s'est rendu célèbre pour ses travaux sur l'histoire politique et culturelle de la Révolution française, dans lesquels on peine à trouver trace des "revenus des classes de la classe contemporaine", et où le grand historien, tout préoccupé qu'il est par le combat qu'il mène dans les années 1970 contre les historiens marxistes de la Révolution française (alors particulièrement dogmatiques et nettement dominants, notamment à la Sorbonne), paraît même refuser toute forme d'histoire économique et sociale. Cela me semble dommage, dans la mesure où il est possible - je crois - de concilier les différentes approches. La vie politique, la vie des idées ont évidemment leur autonomie par rapport aux évolutions économiques et sociales. Les institutions parlementaires, l’État de droit, ne sont pas les institutions bourgeoises décrites par les intellectuels marxistes d'avant la chute du Mur. Mais en même temps, il est bien évident que les soubresauts des prix et des salaires, des revenus et des patrimoines, contribuent à forger les perceptions et les attitudes politiques, et qu'en retour ces représentations engendrent des institutions, des règles et des politiques qui finissent par modeler les évolutions économiques et sociales. Il est possible, et même indispensable, d'avoir une approche qui soit à la fois économique et politique, salariale et sociale, patrimoniale et culturelle. Les combats bipolaires des années 19174-1989 sot maintenant nettement derrière nous. Loin de stimuler les recherches sur le capital et les inégalités, les affrontements autour du capitalisme et du communisme ont plutôt contribué à les stériliser, aussi bien d'ailleurs parmi les historiens que parmi les philosophes*. Il est plus que temps de les dépasser, y compris dans les formes que prend la recherche historique, qui demeure me semble-t-il profondément marquée par ces affrontements passés.
Comme je l'ai noté dans l'introduction, il existe sans doute également des arisons purement techniques expliquant la mort prématurée de l'histoire sérielle. Les difficultés matérielles liées à la saisie et au traitement des données expliquent sans doute pourquoi ces travaux (y compris Le mouvement du profit en France au XIXe siècle) consacrent finalement très peu de place à l'interprétation historique, ce qui rend parfois la lecture de ces ouvrages relativement aride. En particulier, l'analyse des liens entre les évolutions économiques mises à jour et l'histoire politique et sociale de la période étudiée est souvent minimale, et passe derrière une description méticuleuse des sources et des données brutes, qui de nos jours trouvent naturellement leur place dans des tableurs Excel et des bases de données disponibles en ligne.
Il me semble aussi que la fin de l'histoire sérielle est liée au fait que ce programme de recherche est mort avant d'avoir atteint le XXe siècle. Quand on étudie le XVIIIe ou le XIXe siècle, on peut plus ou moins s'imaginer que les évolutions des prix et des salaires, des revenus et des fortunes, suivent une logique économique autonome et n'interagissent pas ou peu avec les logiques proprement politiques et culturelles. Quand on étudie le XXe siècle, une telle illusion vole e éclats immédiatement. Il suffit de jeter un rapide coup d’œil aux courbes suivies par l'inégalité des revenus et des patrimoines ou le rapport capital/revenu pour voir que la politique est partout, et que les évolutions économiques et politiques sont indissociables, et doivent être étudiées de concert. Cela oblige également à étudier l’État, l'impôt et la dette dans ses dimensions concrètes, et à sortir des schémas simplistes et abstraits sur l’infrastructure économique et la superstructure politique.
Certes, un sain principe de spécialisation peut parfaitement justifier que tout le monde ne se mette pas à établir des séries statistiques. Il existe mille et une façons de faire de la recherche en sciences sociales, et celle-ci n'est pas toujours indispensable, loin de là, ni particulièrement imaginative (j'en conviens). Mais il me semble que les chercheurs en sciences sociales de toutes les disciplines, les journalistes et les médiateurs de tous supports, les militants syndicaux et politiques de toutes tendances, et surtout tous les citoyens, devraient s’intéresser sérieusement à l'argent, à sa mesure, aux faits et aux évolutions qui l'entourent. Ceux qui en détiennent beaucoup n'oublient jamais de défendre leurs intérêts. Le refus de compter fait rarement le jeu des plus pauvres.
* Quand on lit les textes consacré à Sartre, Althusser ou Badiou à leurs engagements marxistes ou communistes, on a parfois l'impression que la question du capital et des inégalités entre classes sociales ne les intéresse que modérément, et qu'il s'agit d'un prétexte à des joutes d'une autre nature.
Source : Le capital au 21e siècle Thomas Piketty Editions du Seuil -Septembre 2013 pages 948-950
Aux risques de masquer sa richesse et sa subtilité : enfin un économiste qui s’exprime dans un bon français et fait un usage raisonné et raisonnable des chiffres.
Mais aussi pour éviter la récupération par la médiocrité si courante chez les « experts » de l’économie, comme dans ce billet désolant, publié il y a quelques jours, prônant l’imposition sur le loyer « fictif » des propriétaires de leur logement au nom de l’imposition du capital. Billet entretenant, par imbécilité, idéologie, ou les deux, la confusion entre ceux qui vivent des revenus de leur seul travail et ceux qui s’enrichissent, et c’est la seule voie efficace actuellement, du « travail » de leur capital, résultant pour une part croissante, comme à l’époque de Balzac et Jane Austen, de l’héritage.
La différence observée historiquement entre le taux de rendement du capital et la croissance, en faveur du premier, conduit inéluctablement, en l’absence de mécanismes de régulation, à une concentration extrême des patrimoines et à la transformation des entrepreneurs, tant célébrés, en rentiers. Selon la belle expression de Piketty, le « passé » dévore « l’avenir ».
Au XXe siècle ce sont les deux guerres mondiales qui ont fortement réduit les patrimoines (réduction visible dans celle du rapport capital/revenu) et redonné ainsi sa place à l’avenir, mais à quel prix.
Une classe moyenne a émergé et là où le patrimoine était concentré, en 1910, dans les mains des 10% et surtout des 1% les plus riches, ne laissant rien aux 50% les plus pauvres, et pratiquement rien aux 40% en situation intermédiaire, le patrimoine s’est reconstitué, mais de façon moins inégalitaire avec une classe moyenne de 40% des personnes possédant 25 à 30% du patrimoine total, les 10% les plus riches en possédant 65 à 70% et les 50% les plus pauvres 0 à 5%.
Cet effet des deux guerres mondiales est aujourd’hui quasiment effacé, suite à la révolution conservatrice des années 1980, et la concentration du patrimoine se rapproche dangereusement de ce qu’elle était en 1910. La quasi-totalité des richesses est par ailleurs privée, le patrimoine public étant proche de zéro si on tient compte de la dette.
La question est alors, au moins, double. Un tel système peut-il survivre sans conduire à la misère généralisée et à la fin de la démocratie ? Ou faut-il en sortir ?
Piketty propose, ce qu’il qualifie lui-même d’utopie, de réguler ce système par un impôt mondial sur le capital, dont la mise en place pourrait d’abord se faire sur des espaces régionaux, comme, par exemple, celui de l’Europe. Cela permettrait de contrer ce qu’il a identifié, avec beaucoup de données, comme la contradiction inhérente du capitalisme : un taux de rendement du capital toujours supérieur au taux de croissance. J’avoue avoir du mal à croire à cette hypothèse qui suppose un sens de l’intérêt général et même une intelligence des faits qui semblent manquer aux oligarchies qui nous dirigent et à celles qui y aspirent.
La voie de la sortie me parait plus réaliste. Voie explorée par de plus en plus de monde et qui ne peut qu’être facilitée par l’apport des travaux de Thomas Piketty.
La lecture et le travail collectifs de ce livre sont indispensables et doivent permettre de renouveler des approches, trop basées sur des préjugés et insuffisamment étayées factuellement, qu’elles soient portées par des partis défendant des alternatives politiques ou des associations et groupes de citoyens en recherche.
Lisez et faites lire ce livre !
Fichier attachéTaille 1540-1.jpg9.95 Ko
Source :
Un livre d'économie comme outil politique : Le capital au XXIe siècle
03 octobre 2013 | Par Thierry T. d'Ouville
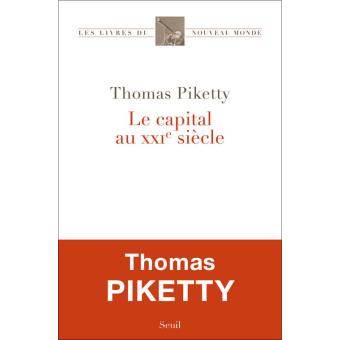
© Thomas Piketty
http://blogs.mediapart.fr/blog/thierry-t-douville/031013/un-livre-deconomie-comme-outil-politique-le-capital-au-xxie-siecle



