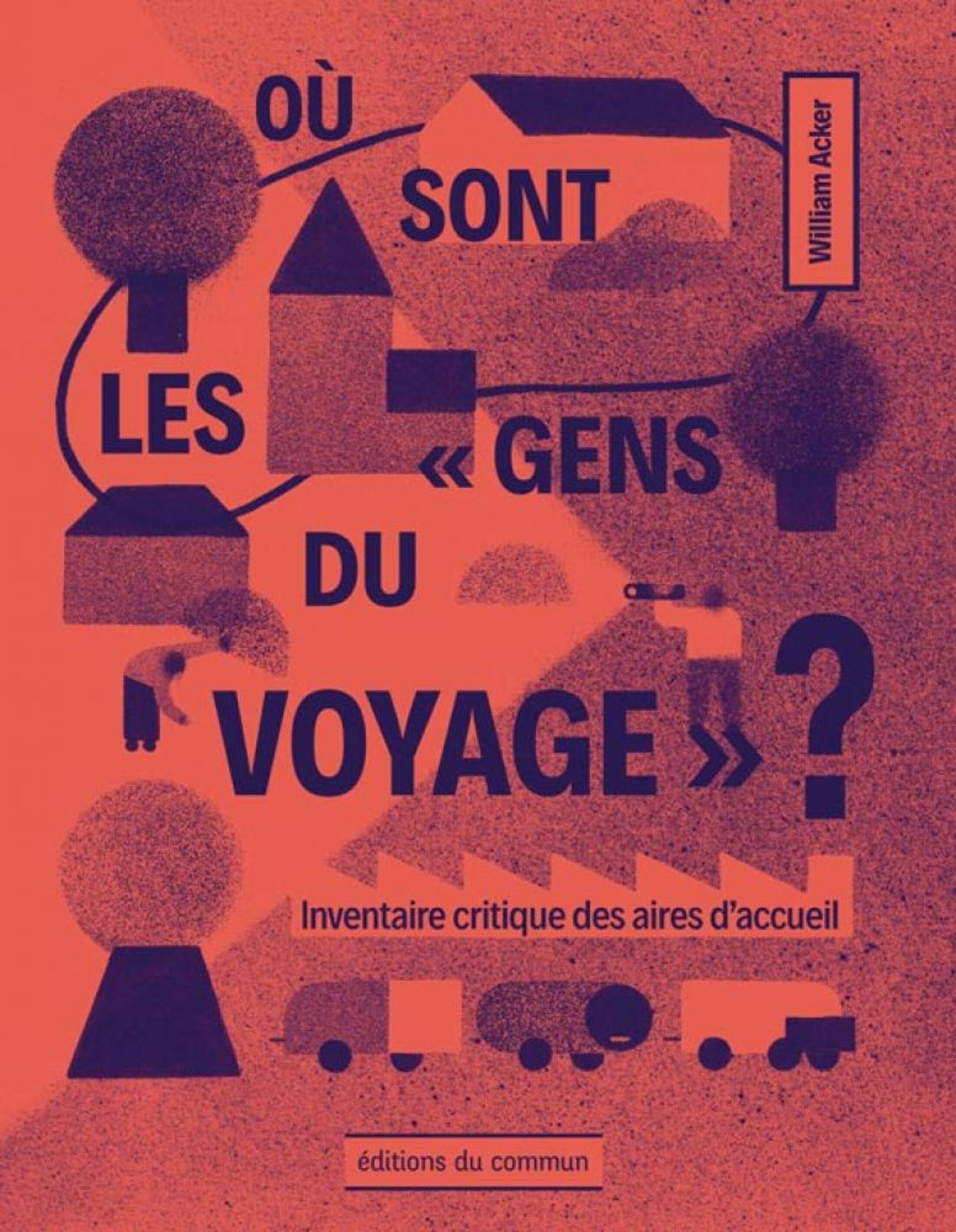Aujourd’hui, quand j’arrive au milieu de l’après-midi dans un de ces terrains, quelle que soit la saison, je suis sûr de rencontrer des hommes désœuvrés. Ils lèvent la tête en direction de l’auto sans manifester aucune surprise. Ce sont les “hommes du temps des chevaux”. Ils sont seuls à cette heure-là avec les plus jeunes enfants, tous les autres à l’école ou partis chiner. Comme du “temps des chevaux”, accroupis au bord du feu ou assis à l’ombre sur le “V” d’une caravane, ils m’invitent à partager le vin – un même verre pour tous (“On a tous la même maladie, mon frère !”). Quand les écoliers rentreront, nous les enverrons acheter d’autres litres. Comme au “temps des chevaux aussi”, nous ne parlons pas beaucoup en buvant.
Patrick Williams (1)

Agrandissement : Illustration 1

En quête de quoi ?
Qu’est-ce qui a merdé ? La question revient tout le temps, qu’est-ce qui a merdé ?
Dans le mobile-home de Papou trônaient des photographies en noir et blanc. Quelques portraits de famille, récents et plus anciens, beaucoup plus anciens même. Trois de ces photographies retenaient toujours mon attention, elles dataient visiblement du début du siècle avec des robes et des costumes d’époque. 1925 pour être précis. Sur l’une d’elles est présente Micheline, la mère de Papou. Encore bébé, elle pose dans les bras de ses parents, entourée des membres de sa famille, des Destouches, des Siegler, des Théodore ou des Demeulemester. Tous posent fièrement devant deux roulottes en bois avec leurs ânes. Ils sont bien habillés, bien peignés, et exposent leurs accordéons et cymbales. On sent qu’ils ont mis du temps et du soin pour cette photo de famille, un moment pour la postérité. Sur une autre, figure la famille Duville dont les membres voyageaient souvent avec la mienne. Eux posent avec leurs instruments de musique, violons et guitares, devant leurs roulottes en bois.
Elles sont touchantes ces deux photos, une époque (partiellement) révolue, où l’esthétique tout entière illustre une idée, un idéal même du Voyage. Aussi parce que ces personnes qui fixent joyeusement ou sérieusement l’objectif ont toutes été internées ensemble. Ainsi sur une liste du camp pour « nomades » de Mulsanne (72) figure des noms familiers, une dizaine de Duville, dix-huit Duvil, treize Destouches, onze Demeulemester, etc. Cette liste intitulée « liste nominative, par famille et par camp de provenance, des internés du Camp de Mulsanne (Sarthe) » m’est envoyée en 2019 par Théophile Leroy, doctorant en histoire, qui mène ses recherches sur les camps d’internement. Pas moins de 18 pages noircies des noms des familles internées : Reinhard le nom de mon beau-père, Winterstein, Debarre, Delage, Sauzaire le nom de mon amie d’enfance, Demestre, Vogt, Laurot ou Lorot, Théodore, Auffray, Demeter, etc. À chaque fois, un ou plusieurs visages me reviennent derrière chaque patronyme. Les noms historiques des familles manouches, rroms et sinti françaises sont connus de la plupart des Voyageurs. Le premier réflexe quand on se présente est toujours de dire de quelle famille on vient, moi je dis Robin et Destouches, parce que Acker ça vient du côté de mon père et lui n’est pas Voyageur. Alors je dis les noms et après je parle des régions et ensuite avec mon interlocuteur on égraine un à un les personnes de mon entourage jusqu’à trouver une connaissance commune, parfois un cousin, une tante, un oncle, ou juste l’ami d’un ami, on finit toujours par s’entendre. Ces arbres généalogiques qui se croisent et se côtoient sur une histoire qui nous dépasse largement nous rappellent qu’il existe bel et bien un lien, enfin une multitude de liens entre les Voyageurs : celui du Voyage c’est certain et un peu plus encore.
Un de ces points communs est l’internement, qui a marqué un grand nombre de familles, surtout celles du nord de la France et qui continue encore à revenir régulièrement dans les discussions, particulièrement celles où on se réfléchit, on se pense, on s’objective diraient certains. Comme plein d’autres enfants de ma génération et de celles qui m’ont précédé, j’ai longuement entendu et conceptualisé la trahison originelle. Ce sont des gendarmes français qui ont retenu dans les camps nos arrière-grands-parents, français eux aussi. Comme un héritage, on m’a transmis la méfiance et l’impérieuse nécessité de toujours rester le plus indépendant possible des Gadjé. Ils nous ont mis dans les camps, ont cherché à nous marav et prétendent maintenant vouloir notre bien, mais si on les laisse faire ils nous placent dans des gadoues, nous empêchent de voyager et nous demandent de devenir à notre tour des Gadjé. Souvent j’entends des constats amers, sur le déclin du Voyage et de ses libertés. Les plus vieux disent « c’est fini ce temps-là » et nous on les regarde sans les contredire parce que les vieux ça se respecte, mais au fond le monde a changé et sûrement qu’un jour ça sera à notre tour de sortir ces vieilles phrases toutes faites sur la belle époque. Sur l’île de la Réunion, j’ai entendu une expression superbe pour ça, lorsqu’on parle d’un évènement passé et révolu, de l’esclavage, de pratiques anciennes ou d’époques passées, on dit dan’n tan Lontan. L’expression marque une temporalité, mais aussi un commun, un héritage comme pour les savoir-faire, ou d’autres marqueurs de la culture créole. Nous aussi on a notre tan Lontan, et c’est souvent un constat de perte qui l’accompagne.
Chaque Voyageur a son petit mot, son explication, pour parler de cette histoire tumultueuse, ces changements aussi dans les pratiques, notamment celles liées au Voyage. Pour beaucoup, il y a une concomitance entre la fin des roulottes en bois et le début des caravanes, l’éloignement de la nature, et l’assignation aux lieux. Certains y voient une évolution du temps, une forme de sédentarisation comme un moyen de correspondre à son époque. Il y a un avant et un après qui n’a pas toujours la même nature. Pour l’un ce sont les spoliations administratives de la guerre, pour l’autre c’est l’internement, pour celle-là il s’agit de la sédentarisation et celui-ci l’abandon de la vannerie au profit de cette nouvelle matière qu’est le plastique. Pour lui encore on ne peut plus voyager, le temps où on s’arrêtait un peu au gré des envies, dans une gravière, dans un pré ou sur le bord d’un chemin c’est révolu, aujourd’hui on nous chasse systématiquement, en 15 minutes les clisté arrivent et il faut dégager. Ils vous traîneront parfois jusque dans leurs misérables terrains désignés. Les politiques disent « prendre en compte le mode de vie des gens du voyage » pour expliquer tout ça. Mais est-ce que cette liberté, celle qu’on regrette, a réellement existé ? On sait que la chasse aux Tsiganes et les expulsions sont virulentes en France depuis au moins le XVIe siècle et qu’une partie de la mobilité par laquelle la force publique appréhende est due aux expulsions à répétition. Encore aujourd’hui.
De l’époque des roulottes à chevaux que reste-t-il ? Que reste-t-il des films d’anthropologues ? Que sont devenues les familles en roulottes suivies par Yasuhiro et Kimie Omori en 1976 (2) ? Dans le Calvados le réalisateur Mahammed Siad suivait encore en 2005 les dernières familles manouches en roulotte (3). Aujourd’hui ce mode d’habitat est devenu ultra-minoritaire, quelques collectifs continuent, mais pour combien de temps encore ?
Que disent les évolutions du Voyage ? Je sais qu’une partie de ma famille ne voyageait que de quelques kilomètres par jour, toujours entre la Sarthe, le Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire et ce depuis au moins la Révolution française. Je sais qu’au XXe siècle et en partie après la guerre il y a eu de longues périodes de sédentarisation, que le Voyage s’est étendu à d’autres parties de la France, voire de l’Europe et qu’enfin, depuis les années 1980, il a eu tendance à se regrouper dans les missions évangéliques ou les grands passages associatifs, qui permettent de contrer le contrôle social des déplacements familiaux par le rapport de force du groupe. Ces évolutions des pratiques du Voyage sont accompagnées d’un changement dans les pratiques professionnelles : la vannerie des familles manouches, la chaudronnerie des rroms hongrois ont décliné pour laisser une part plus large aux métiers du commerce ou du recyclage des métaux. L’école qui est un facteur de sédentarisation a aussi permis l’émergence d’autres parcours, ceux qui font quitter le Voyage pour la vie de gadjo (4). Des évolutions qui marquent aussi des changements dans la spatialisation du Voyage, que ce soient les parcours, substituant une variété riche de paysages et de lieux au parcours uniforme et standardisé des aires d’accueil. Mais aussi dans la répartition entre zones urbaines et rurales, ces dernières étant de moins en moins accessibles en raison du plancher de 5 000 habitants des lois Besson.
Quels écarts ou égarements ? Quels points communs entre ma famille « semi-sédentaire », qui vend des matelas, nettoie des toitures et d’autres qui travaillent dans la vannerie, dans la dorure d’art, le cirque, la fête ou rempaillent des chaises ? Comment continuons-nous de cohabiter sur les missions ou les places, dans les lieux assignés ? Qu’est-ce qui nous rapproche ? L’altérité aux Gadjé ou le « nous » ?
Et puis qu’est-ce qui a merdé ? En voilà une question insoluble, chacun sa réponse et pourtant le défi est toujours là, expliquer ce qui a merdé revient à expliquer ce qui a changé. Ce qui a changé en bien et en mal, où parfois le mal est un moindre bien ou l’inverse, on ne sait plus trop à force. Un coup, untel vous dira que ce qui a merdé c’est le truc qui la veille était présenté comme bénéfique. La sédentarisation ça a du bon et du mauvais, j’ai perdu et j’ai gagné, et au moment de faire le bilan je ne sais plus si c’était mieux avant ou si c’est mieux maintenant. Ils disent quoi autour de moi ?
Pour Laura qui vit sur les aires, les places ce n’est pas l’objectif, c’est « en attendant », elle veut un petit terrain et continuer à Voyager, enfin à « tourner en rond » entre Saint-Brieuc (22), Rennes (35), Vannes (56) et Quimper (29). Pour Tony, le terrain familial est insupportable, imposé et solution unique pour éviter de perpétuelles expulsions. Il est construit sur une ancienne décharge et les immondices vieilles de plusieurs décennies remontent maintenant à la surface dans ce quartier délaissé et pollué appelé par un nom poétique « la prairie des mauves » où les élus de Nantes (44) ont décidé il y a quelques années de parquer et reléguer tout ce qui s’apparente de près ou de loin à un Tsigane. Tony continue de voyager une partie de l’année, pour ne pas élever ses petits dans ce merdier et parce que « c’est en lui » le Voyage. Et l’autre Tony d’Esbly (77) il s’est fait son chalet sur son terrain à lui, il est fier à 27 ans d’être propriétaire, c’est un bon début, le Voyage c’est l’été et le reste de l’année il a sa maison. Mais le Voyage c’est parfois aussi l’hiver, dans les îles caribéennes, il profite des dépôts de matelas ouverts sur place par son cousin pour s’y rendre et chiner. Pour Marcel, le Voyage c’est fini depuis au moins 30 ans, pas le choix, plus les sous et les petits sont scolarisés dans la ville, les vieux sont malades et il a fallu 25 ans pour acquérir ce terrain sans eau ni électricité alors pas question de lâcher ça, il attaque même le maire de cette commune d’Eure-et-Loire contre ses traitements discriminatoires : « le maire c’est un raciste, il déteste les Voyageurs, il nous a dit que si un chenil s’installait à côté de chez nous, sûrement qu’il ferait installer l’eau, on est moins que des chiens ».
« Qu’ils me traitent comme un chien et je deviens un chien », m’a dit un habitant d’aire dans l’Ain. Même chose pour Marie et sa famille aux Arcs-sur-Argens (83), privés d’eau pendant le confinement, relégués dans la partie pourrie de la ville, oubliés, mais combatifs. Et pour Édouard Guerdener à Gex (01), le Voyage c’est le « bon vieux temps » celui qu’il regrette, là coincé sur son aire, un endroit qu’il déteste, là où il se sent mis à l’écart. Il n’aspire qu’à une chose maintenant, vivre sur le terrain qu’il a acheté sur les conseils des élus, qui lui refusent aujourd’hui les raccordements et une boite aux lettres. Comme Vanessa Moreira Fernandes qui vit sur l’aire d’accueil de Petit-Quevilly (76) et qui au moment de transmettre ses photos de l’incendie Lubrizol aux médias a souhaité les créditer par « mise à l’écart ». Mise à l’écart ou maltraitée, comme l’est Sue Ellen Demestre membre du Collectif des femmes de l’aire d’accueil d’Hellemmes Ronchin (59) qui vit sur une aire située au pied d’une usine de béton, ou Helena à Ajaccio (20) qui vit à côté d’une décharge à ciel ouvert, où les déchets ressortent, où on ne respire plus et où on ne s’entend pas parler à cause des mouches. Il y a aussi Émile Scheitz qui respire les fumées pestilentielles du crématorium voisin et reçoit des pluies d’hydrocarbures des avions qui atterrissent et décollent de la piste de l’aéroport Charles-de-Gaulle à 100 mètres de « chez lui », l’aire d’accueil provisoire de Tremblay-en-France (93), l’infâme. Il attend un terrain promis depuis 7 ans, rien ne vient (5). Des promesses pour tenir tranquille, ça dure des années, comme pour les familles de la Butte-Pinson à Montmagny (95), installées depuis des décennies, délogées pour être placées dans une aire d’accueil aux allures de camps, plusieurs années d’attente pour accéder au relogement promis, la requalification urbaine de la Butte-Pinson n’inclut pas les familles manouches qui y vivent (6).

Agrandissement : Illustration 2

Des terrains ? Tous les perdants de la sédentarisation de masse en attendent. D’autres n’osent pas encore y penser, Dino sur l’aire d’accueil de Saint-Menet (13) espère juste une aire vivable. Et puis il y a ceux qui ont lâché, parce qu’il n’y avait plus le choix, ceux qui ont fini dans un logement social, qui se sentent dépossédés, certains les traitent méchamment de « machins d’HLM », c’est humiliant surtout lorsque persiste le sentiment de s’être fait avoir. « J’aurais peut-être pu éviter ça » m’a dit cette Voyageuse reclassée dans un logement social de Mulhouse (68). Même sentiment pour certains à qui on a construit des petites maisons entre Voyageurs, ceux qui ont accepté puis ont quitté ces logements parce qu’ils ne supportaient plus de vivre enfermés. Passer du Voyage à la vie sédentaire en maison n’est pas simple pour tout le monde. Il y en a bien qui aiment, il y en a même qui souhaitent vraiment se sédentariser ou qui le sont de longue date et aspirent désormais à plus de confort matériel et de sécurité dans le logement. Et il y a tous les autres, tous ceux qui n’ont pas su, pas pu, pas voulu prendre le mode de vie des Gadjé. Ceux-là pour qui la sédentarisation est un drame, ceux-là qui se rappellent (ou idéalisent) du Voyage, du beau Voyage, celui d’avant, ceux-là qui sont déracinés et perdus, ceux-là mêmes qui attendent sur les aires d’accueil ou qui attendent des aires d’accueil. Il y a aussi ceux qui sont pleinement intégrés dans ces processus de normalisation par la sédentarisation. Certains regardent avec envie ces Voyageurs qui ont « réussi », ceux qu’on voit parfois à la télévision, les grands forains, les propriétaires de cirques, ceux qui sont devenus des stars, des chanteurs, ceux qui ont réussi dans les affaires, possèdent des sociétés internationales et ont fait fortune ou ceux qui privatisent Le Pré-Catelan dans le bois de Boulogne pour y organiser le mariage de leurs enfants. Cette sédentarisation qui donne envie, celle qui permet encore de pratiquer le Voyage, un Voyageur hybride, sédentaire et suffisamment riche pour continuer à aller sur le Voyage quelques semaines dans l’année.
Liberté, égalité, propriété.
Du temps des chevaux au bidonville

Agrandissement : Illustration 3

La Rochelle dans l’après-guerre est une ville qui sort de quelques années d’occupation allemande. En 1945 les habitants sont autorisés à revenir dans la ville et, à la hâte, les Américains construisent des baraquements en bois pour y loger ce nouvel afflux de population. Ces baraques, construites dans le quartier du Prieuré à Laffont, sont le premier lieu de vie de ma grand-mère. Les baraques sont détruites dans les années 1950 et les habitants relogés dans le quartier portuaire et populaire de la Pallice, avenue Denfert-Rochereau, dans des ensembles de logements sociaux qui serviront aux familles ouvrières, nombreuses dans la zone du port.
La Pallice est aussi un port semi-militaire, une partie abrite une ancienne base allemande convertie en base pour sous-marins de l’OTAN. Au début du siècle, l’armée française y avait déjà installé des industries et même des camps pour ouvriers chinois qui servaient de main-d’œuvre bon marché dans les chantiers du port (7). C’est aussi un port de commerce où sont importées par centaines de tonnes des bittes de bois. Comme toutes les zones portuaires, la Pallice a sa rue de la soif, une succession de bars et maisons closes le long du boulevard Émile Delmas. Un coin à marin, pas toujours bien fréquenté, ça boit, ça fait la fête et ça se bagarre. Mais le quartier de la Pallice est vivant et populaire, il y a des cinémas, des bals, « c’était très animé, surtout le dimanche » dit ma grand-mère.
Une grande partie des habitants du quartier travaillent dans le port, notamment comme docker. Il y a ceux qui « ont de la chance » qui sont dockers professionnels et syndiqués, ceux-là gagnent leur sou même les jours de repos. Et puis il y a les autres, ceux qui sont embauchés à la corvée, qui descendent dans les cales pour décharger les bittes de bois. Le quartier de la Pallice a aussi son bidonville, le Plateau de la Marine. C’est là dans les années 1960, que ma grand-mère rencontre Papou. Sur quelques rues en partant de la rue Jacques Cartier, une succession de maisons en tôle, d’autres bâties, le tout entrecoupé de caravanes. Les Voyageurs sont là, présents sur le Plateau, la famille Froumeau, les Robin et les autres. Titi, Luigi, Kikine, Roland, ils travaillent à la corvée, tantôt comme docker, tantôt à autre chose, c’est la débrouille. Avant ils voyageaient et puis un jour ils se sont arrêtés, la guerre et d’autres événements les ont arrêtés. Ils ont construit des cabanes, des petites maisons en dur parfois, directement sur le Plateau. Les Voyageurs vivaient au milieu des autres, des ouvriers, des immigrés et des naufragés. Ma mère qui est née dans ce bidonville se souvient de jours heureux, ma grand-mère elle n’appréciait pas tellement l’endroit et ne rêvait que d’une chose : partir.
Déjà dans les années 1970 les pouvoirs locaux essayaient de sédentariser les quelques Voyageurs du Plateau, la tante poupée par exemple, on l’a placée dans un appartement à Aytré (17), elle est restée un peu, mais elle n’a pas supporté d’y « vivre enfermée » et elle est revenue quelque temps après. Papou, lui est arrivé jeune au Plateau, dans les années 1950, recueilli par l’oncle Auguste. Le Plateau c’était au moins 200 ou peut-être 300 petites cabanes ou maisons construites là. On pouvait accéder aux quais et jouer dans les bittes de bois, mais en 2006 tout ça s’est terminé, il a fallu se conformer aux lois européennes et on a érigé un grand mur pour fermer l’accès. Alors ça ne gêne pas le quartier du Plateau puisque lui ça fait belle lurette qu’il a été rasé. Vidé peu à peu de ses habitants dans les années 1970 et 1980, qui ont été relogés dans un quartier de petites maisons non loin de là.
La Pallice et le Plateau de la Marine c’était aussi et surtout un environnement industriel dangereux. Déjà en 1916 lorsque l’usine d’explosifs Vandier et Despret a explosé, 177 personnes ont péri. La zone est entourée de sites dangereux, des dépôts chimiques et pétroliers, et aujourd’hui ce ne sont pas moins de 5 sites Seveso qui parsèment le quartier. Dans l’après-guerre, il n’y avait pas vraiment de précautions, les enfants passaient dans les sites dangereux en faisant des trous dans les grillages pour rejoindre la plage, qui a maintenant disparu au profit du pont de l’île de Ré. On allait aussi à la plage du radar, enfin plage c’est un grand mot, c’était plutôt une décharge, une gadoue qui servait de lieu de détente pour les habitants du Plateau.
C’est ici au Plateau de la Marine, dans un environnement sur-pollué que ma mère a vu le jour. Des fois la famille partait sur le Voyage, dans l’est de la France par exemple vers Sarreguemines (57). Elle s’arrêtait dans les places désignées le temps d’une halte et de travailler un peu puis repartait. La Pallice comme beaucoup d’autres quartiers en France est le théâtre de parcours croisés chez les Voyageurs qui y vivent, là où certains ont réussi à reprendre le Voyage et où d’autres se sont définitivement sédentarisés. Le Voyage comme moyen d’échapper au lieu, d’échapper à un environnement indigent. Pour ma famille, un parcours du bidonville aux places désignées, rattrapé par une forme de sédentarisation à la fin des années 1970, dans un terrain privé de Seine-Saint-Denis.
Tous n’ont pas eu cette possibilité. Dans les années 1970, les premiers plans de sédentarisation voient le jour. C’est l’époque des « hameaux tsiganes » ou des « cités gitanes » comme à Berriac (11). La « cité de l’espérance », c’est son petit nom, construite à la hâte dans les années 1960 pour « loger » une communauté gitane qui jusque-là se retrouvait reléguée dans une décharge. La localisation de la cité en dit long, à l’écart, au pied d’un poste électrique EDF, une catastrophe sanitaire qui se mesure des années plus tard où les problèmes de fertilité, les cancers et les morts prématurées s’enchaînent (8).

Agrandissement : Illustration 4

Ou la cité des Violettes à Tarbes, deux rangées de maisons basses construites elles aussi à la hâte en 1974 juste à côté d’une station d’épuration. On y a parqué tous les Gitans et Manouches de la ville. Un abattoir jouxtait le site, source de puanteurs et d’immondices diverses, de nombreux rats et tout ça sous des lignes haute tension. Il a fallu attendre les années 1990 pour proposer enfin des solutions de relogement à ces différentes familles (9). En fait, c’est un ensemble de ghettos qui ont été construits dans les années 1970, de grandes zones de relégation ethnique dans les lieux les moins hospitaliers des villes. Relégation et pollution, le schéma classique.
Voyager c’est perdre la nature
La seconde moitié du XXe siècle est le terrain d’un paradoxe, le Voyage qui jusqu’alors répartissait la « présence voyageuse » (10) dans les territoires ruraux s’est trouvé dépossédé de ce rôle. Pire encore, le Voyage longtemps associé à une pratique proche de la nature, est au contraire devenu un facteur d’éloignement des espaces naturels. Sites industriels, zones routières et zones de déchets sont souvent les seuls choix possibles pour les Voyageurs.
Voyager c’est perdre la nature. Le constat est terrible, mais 94 % des communes (celles de moins de 5 000 habitants) ne sont plus accessibles au stationnement des « gens du voyage ». Outre l’exclusion majeure qui en résulte, l’accès aux espaces ruraux s’est trouvé fortement contraint. Combien de fois ai-je entendu ces histoires de Voyage près des rivières, avec vue sur les montagnes ou dans les prairies, racontées aujourd’hui comme un fait du tan Lontan ?
Et le paradoxe se poursuit quand la nature devient un argument de plus contre la présence des Voyageurs. Les exemples sont légion, à Herblay (95) dans la zone du bois du Trou-Poulet, près de 100 personnes qui y vivaient (pour certaines légalement) depuis plus de 30 ans ont été expulsées. Patrick Barbe, maire de la ville en 2004, a fait classer les terrains en zone naturelle et demandé l’expulsion des familles. Après une première procédure, en 2005 les juges d’appel ont condamné les familles à quitter les lieux, décision assortie de mesures d’astreinte de près de 70 € par jour. L’aide juridictionnelle leur a été refusée. Ce problème d’accès aux droits est récurrent et dénoncé par des avocats depuis plusieurs années. La pression et la brutalité des procédures utilisées par le maire ont eu des effets que l’on connaît bien : une partie des familles s’est retrouvée en errance dans des parkings autour de la zone, d’autres ont accepté d’aller vivre en logements sociaux et enfin certaines ont fait le choix de partir. En 2013, à l’unanimité des sept juges, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour ce traitement dans l’affaire Winterstein contre France (11). Mais bientôt 8 ans plus tard, une grande partie des familles n’a toujours pas obtenu de solution de relogement et continue à vivre une forme d’errance institutionnalisée.
L’écologie devient une variable d’ajustement dans l’exclusion des « gens du voyage ». On ne compte plus les pétitions en nombre qui s’opposent à la réalisation de ce type d’infrastructures pour des raisons écologiques liées aux localisations des aires. Cas de figure particulier à Claye-Souilly (77) où depuis des années l’intercommunalité est dans l’obligation de réaliser un terrain de grand passage. Le problème est la localisation retenue. Le site des Monts Gardés est situé aux limites communales, au cœur d’un nœud ferroviaire de huit voies de TGV, en bordure de nationale, adossé à une déchèterie énorme qui est le premier émetteur francilien de méthane et sous des lignes haute tension. Autant le dire tout de suite, aucun être humain ne devrait avoir à y vivre ou y séjourner. C’était pourtant le projet de la municipalité et ce qui est intéressant ici c’est que l’argument écologique si souvent invoqué pour éviter la construction d’aire n’a pas fait le poids. En effet, les Monts Gardés sont aussi une zone d’intérêt écologique, avec un projet de régénération de milieu dégradé porté par une association locale depuis des années. Mais cette zone pourtant des plus inhospitalières pour l’être humain a été jugée parfaite par l’ancienne équipe municipale. Le besoin pour l’EPCI de se mettre aux normes vis-à-vis de l’accueil est urgent dans une ville qui connaît des installations illégales régulières, et elle est avancée comme un argument. En construisant l’aire de grand passage, l’EPCI se met en conformité avec les prescriptions d’accueil et peut bénéficier de conditions d’expulsion plus large pour tout « gens du voyage » s’installant en dehors de l’aire. L’intérêt écologique peut donc s’effacer lorsqu’il s’agit d’encamper. Mais revirement, en décembre 2020, la nouvelle équipe municipale annule le projet, pour un motif… écologique : « Cette aire de grand passage remet en cause les objectifs de l’État pour freiner l’artificialisation des sols, des espaces naturels, forestiers et agricoles » (12). À ce jour aucune alternative n’a été proposée et l’agglomération de Claye-Souilly retarde d’encore quelques années les échéances, laissant sans solutions d’accueil les Voyageurs.
Vivre dans les pollutions
Sur le terrain, des habitants d’aires d’accueil entrent en lutte contre les gestionnaires. Souvent seuls face à la machine administrative, il faut dire qu’ils ne pèsent pas lourd. Déjà comme sédentaire, dans un espace pensé pour soi, défendre sa position face aux abus est parfois difficile, autant dire que pour les « gens du voyage » l’affaire est sensiblement compliquée. Pendant près d’un an, j’ai échangé avec un nombre significatif d’habitants des aires et de terrains familiaux. Ceux qui y vivent toute l’année. Je suis étonné à chaque fois de voir la quantité de recours, de lettres, de documents, de photographies, de classeurs, de coupures de presse et de photocopies que gardent mes interlocuteurs. Dans une caravane, il y a assez peu d’espace et chaque placard compte, enfin on ne garde pas les choses inutiles, on ne va pas installer une bibliothèque par exemple. T’achète un livre, tu le lis, puis tu passes à l’autre. Et c’est pareil pour tout, faut compter et garder le nécessaire. Alors quand je monte dans la caravane de Sonia et qu’elle me montre trois placards entiers remplis de papiers, je me dis qu’elle est acharnée. Elle bataille depuis des années pour obtenir son terrain, mais rien n’y fait. Des dizaines de lettres, de documents pour réclamer, prouver et se protéger. On se bat contre les conditions environnementales, qui ne vont jamais sans des difficultés sociales. Absence de logement, conditions sanitaires déplorables, harcèlement administratif ou policier, difficultés à payer l’eau, l’électricité ou la place. Des luttes, des heures de démarches et de papiers, des heures à se faire balader, parfois, souvent, en vain. La récurrence est celle de l’épuisement, épuisé par les recours administratifs, épuisé par la succession des interlocuteurs, par les menaces d’expulsion, les remarques déplacées, les leçons de morale et, il faut aussi le dire, épuisé d’être seul.
Les atteintes environnementales diffèrent d’une aire à l’autre, selon qu’on est situé au pied d’une usine Seveso, d’une carrière, d’une déchèterie, d’une société d’équarrissage, d’une autoroute, sous les voies de TGV ou derrière une usine de béton, mais ces atteintes ont pourtant un point commun. Une charge symbolique forte. Lorsque depuis l’enfance les seuls lieux de vie croisés sont les déchèteries et les arrières d’usines, ça laisse une arrièrepensée, une petite musique. Souvent on ne l’entend pas ou plus, mais elle est là : les poubelles c’est pour moi, c’est ici dans ces lieux que la société choisit de m’installer, souhaite me voir et surtout que je reste. Édouard me cite Georges Brassens pour illustrer ce sentiment : « Que je me démène ou que je reste coi, je passe pour un je-ne-sais-quoi, je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme ; mais les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux ». On ne s’interroge pas sur la charge symbolique et encore moins sur les effets psychologiques qui accompagnent ces expériences. Ceux qui conçoivent les schémas d’accueil, ceux qui travaillent dans les administrations, dans les ministères, ceux qui au niveau des métropoles, ou de l’État sont en charge des « gens du voyage », tous ceux-là n’auront jamais à tenter l’expérience de l’aire d’accueil et comprendre les effets de la relégation sur les personnes.
Aussi il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour au moins entendre que vivre au milieu de nuisances n’est pas viable. La poussière, le bruit ou l’odeur insupportable ne se dissimulent pas, même pour l’élu ou le responsable public (ils se rendent parfois sur les aires, souvent pour l’inauguration de l’équipement). Évidemment il paraît difficile d’appréhender les conséquences concrètes sur la santé, il faut entendre les toux régulières, voir les plaques d’eczéma ou ressentir les migraines. Il faut faire l’expérience de l’impossibilité de se concentrer ou celle du bruit permanent. Trouvez un pont qui passe au-dessus d’une autoroute et fermez les yeux, vous aurez l’exacte ambiance sonore de l’aire d’accueil de Saint-Menet (13). Mais sans chiffres pour prouver ces atteintes, rien ne bouge. Détourner le regard, pointer les installations illégales, c’est plus simple.
À Saint-Menet, je m’y rends en juillet 2020, sous la chaleur écrasante de l’été, cet immense parking de goudron et de béton, jonché de déchets présents depuis des années, pullule de rats en raison du manque d’entretien de la métropole d’Aix-Marseille. L’aire est située à 10 mètres d’une autoroute, elle jouxte un transformateur électrique, une déchèterie pour BTP, un site Seveso seuil haut, les voies de TGV et un terrain de motocross dont le bruit continu est invivable. Le vent soulève des nuages de déchets et de poussières qui s’infiltrent partout. Une journée sur l’aire a suffi pour que mes cheveux soient pleins de poussière, pour que ma peau soit crasseuse, que mes yeux brûlent et que ma gorge soit en feu.
Une journée alors que certains habitants y sont parqués depuis des décennies. Rien n’est aux normes, la moitié des installations d’eau est défectueuse, les branchements électriques sont plus que douteux. Les douches comme les toilettes sont inutilisables, les fils à linge sont cassés, certains habitants se voient refuser l’accès à l’eau et l’électricité. D’autres n’ont pas accès à la climatisation si précieuse dans les caravanes par ces chaleurs. On promet aux habitants une rénovation qui n’arrive pas, depuis des années (13).
Il y a aussi des nuisances qu’on n’envisage pas sans les vivre, c’est le cas des vibrations. Sur l’aire d’accueil de Gex (01) située entre deux carrières, des dizaines de camions circulent à proximité, des concasseurs brisent des pierres du matin au soir. Edouard Guerdener me dira « ça nous rend fous, des fois on ne parvient même plus à se parler avec ma femme, j’ai du mal à me concentrer ». À Gex deux industriels de la carrière encerclent l’espace. L’aire est une honte, « j’ai rarement vu ça », me dira la journaliste Sophie Rosensweig, grand reporter pour Arte, qui se rend sur l’aire en septembre 2020. Reléguée dans cette zone de travaux permanente, l’aire d’accueil est aussi le terrain de résidence de plusieurs familles qui y vivent à l’année et n’ont d’autres choix que d’y rester. L’exploitation d’une des deux carrières est manifestement illégale et des déchets toxiques y sont brûlés en journée. Il est difficile de faire entendre la voix d’Édouard Guerdener dans l’espace médiatique local, peu de gens de sa ville se préoccupent de l’aire d’accueil, la plupart ne doivent même pas la connaître. Pourtant Édouard est aussi le témoin des pollutions au lixiviat des cours d’eau avoisinants qui servent à alimenter la ville entière.
Et puis il y a ce sentiment d’être traité comme un moins que rien. En mars 2020 mon frère séjourne trois jours sur l’aire de Quincy-Voisins (77). À son arrivée, il informe la gestionnaire de son souhait de ne rester que 3 jours. Mais le lundi au moment de son départ le portail reste fermé, la gardienne a pris un congé sans en prévenir les habitants qui se retrouvent enfermés sur l’aire. Après quelques appels sans réponse, des renvois de service en service, on lui dit qu’il faut attendre le retour de congés de la gardienne s’il souhaite sortir de l’aire, deux ou trois jours supplémentaires (son interlocuteur ne sait pas exactement). Il a fallu plusieurs menaces, dont celle de détruire le portail, pour que la société gestionnaire décide d’envoyer quelqu’un ouvrir la barrière qui empêchait toute sortie. La facture finale de ces trois jours sur l’aire s’élève à 45 euros, eau comprise (pour 6 douches au total). Un prix prohibitif, particulièrement au regard de la localisation de l’aire, une de plus située hors de la ville, entourée d’une déchèterie et d’une autoroute.
Alors qu’est-ce qui a merdé ? Comment nous regarderaient les « hommes du temps des chevaux », toujours sans surprise ? Que dirait Papou ? Où sont passés ses niglé braisés et ses petits coins de campagne ?
Je n’ai pas eu le temps de lui demander.
Livre disponible ici
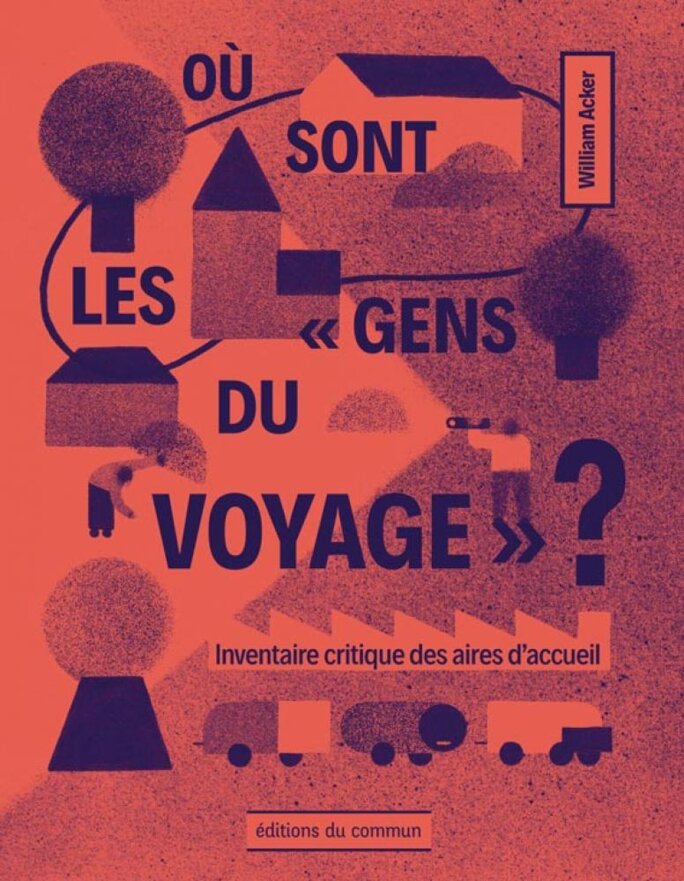
Agrandissement : Illustration 5