Personne ne voit rien. Alors que t’es en train d'étouffer. Tu déposes ton fils devant la cour du collège. C’est sa rentrée en sixième. Voyage dans le temps. Tu es là, toi, le terrorisé des terrains de foot, le survivant de l’adolescence. Tu te retrouves au seuil de tes peurs, de tes hontes, de tes échecs, à l’entrée de la cour sans miracle.
Le bruit des enfants te ramène violemment des années en arrière.
Ton fils aura-t’il la force de ne pas fléchir sous les invectives ? Saura-t-il faire face à l’humiliation si elle se présente ? Saura-t-il se confier ?
Tu sais que la cour d’un collège est une arène où les enfants se lavent de leurs bonnes manières et mènent des combats sans alternative et sans espoir de trêve. Que les enfants sont sans scrupules parce qu’ils ne mesurent jamais la portée de leurs actes. Qu'ils expérimentent le pouvoir et se grisent, souvent, de la douleur des autres. Qu'ils déterminent leur position, leur rang, le glaive à la main. Qu'ils forgent leurs aptitudes à diriger le monde.
Tu sais qu' à ce jeu, les fragiles comme toi ne gagnent jamais.
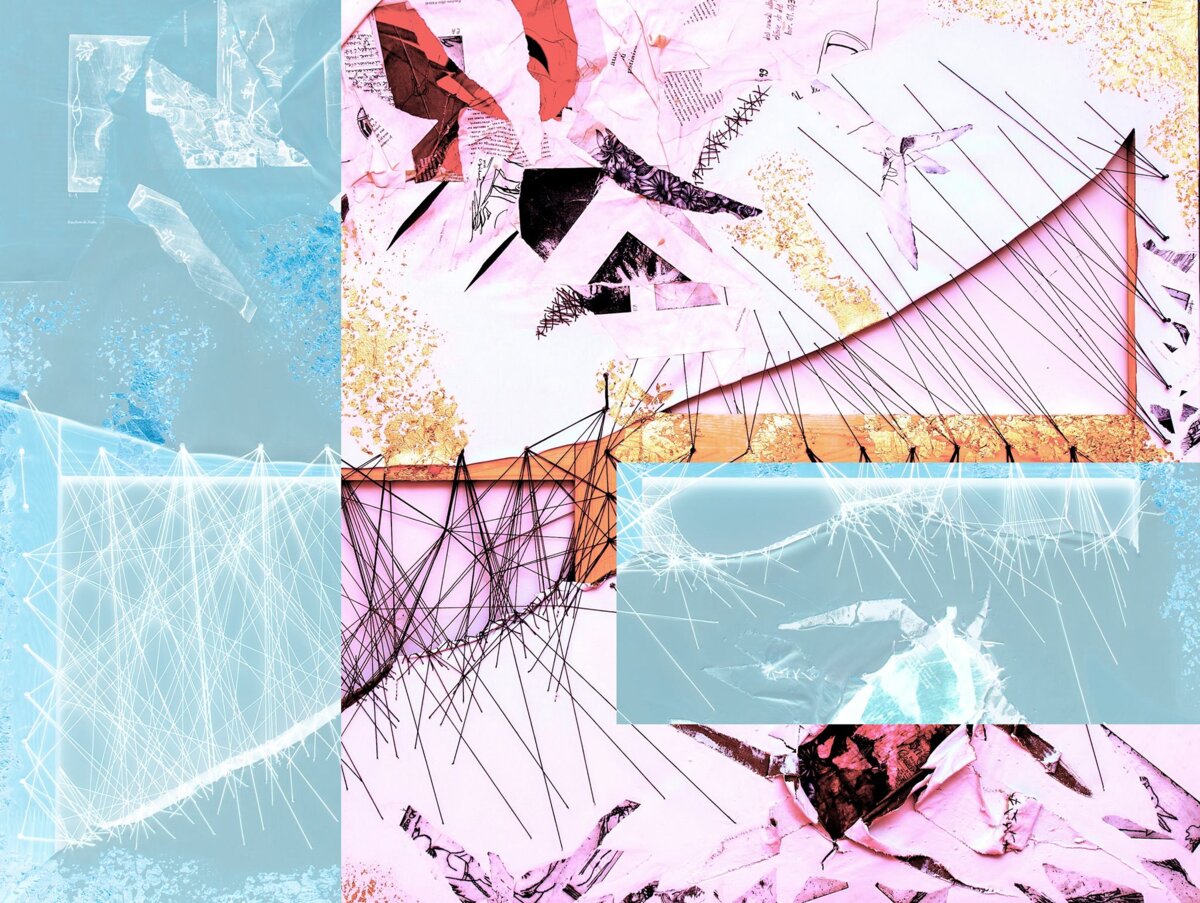
Agrandissement : Illustration 1
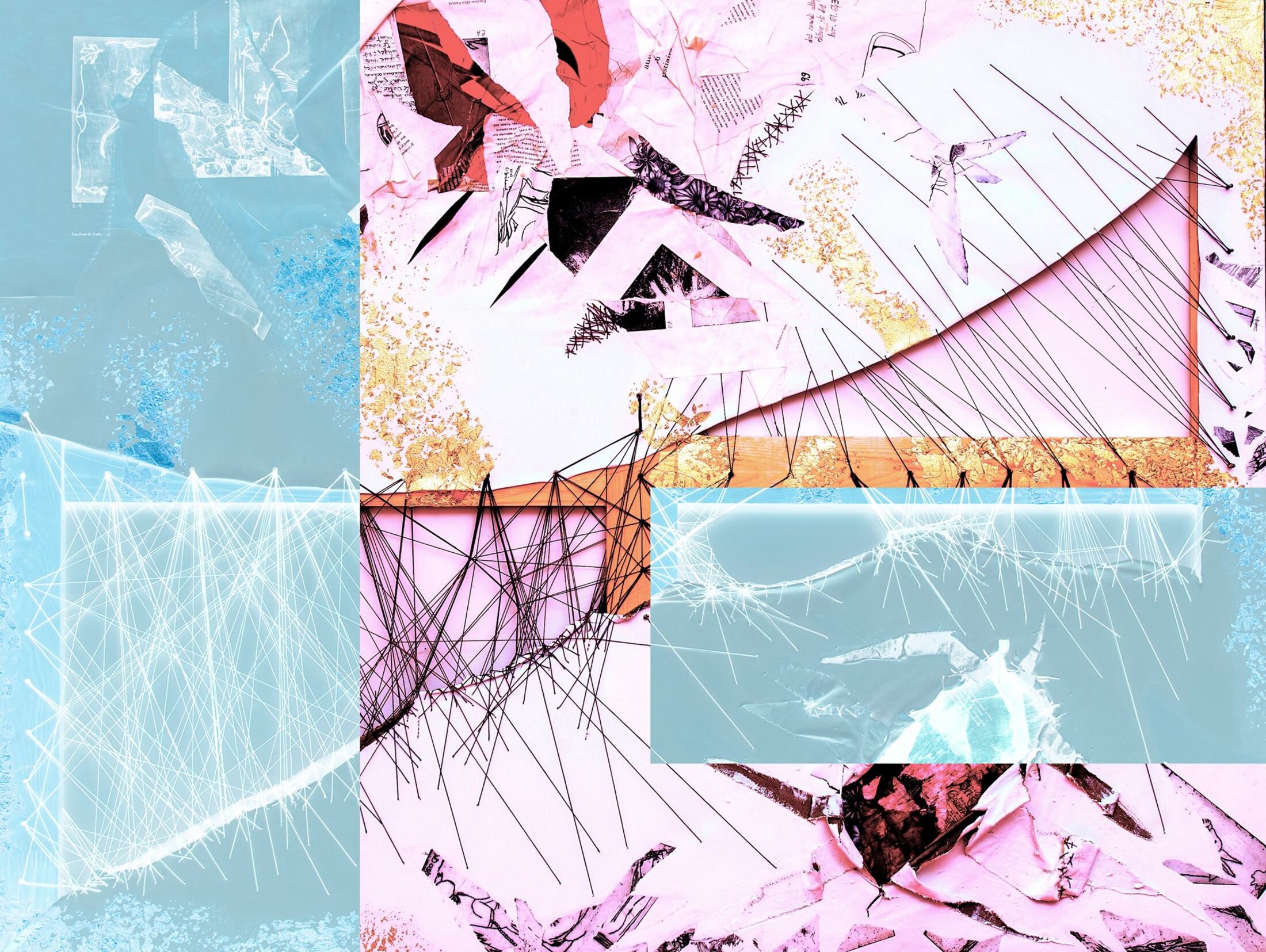
Tu ne sais pas comment lui dire de passer une bonne journée. Il ne peut pas comprendre pourquoi tu es dur comme un chien mort, assis, accroché au volant. II faut qu’il sorte de la voiture sans te dire au revoir, comme le font les gens qui ne s’aiment pas ou qui ne s’aiment plus.
Non, il veut t’embrasser, il veut s’infliger les moqueries de ses camarades. Pourquoi as-tu tenu à l’emmener ? Il a beaucoup insisté.
Et puis tous ces mioches désinvoltes, le sourire bas, la mèche collée aux sourcils. Tous ces tortionnaires en puissance qui regardent dans votre direction. Pourquoi l’as tu habitué à la tendresse et à la douceur ?
Tu dois le sevrer en quelques minutes. Il t’agrippe le bras pour que tu l’encourages à courir vers les autres, vers le champ de bataille. Il ne comprend pas que ça ne sert à rien d’encourager les autres. Nous sommes seuls au monde. Putain mais cours avec tes chaussures toutes blanches et ton jean rose trop cher. Les lions sont plus forts sans leurs parents. Il a les cheveux longs, il est bien trop maigre avec ses gommettes sur les oreilles. Tu sais qu’il est foutu.
Tu redeviendras papa ce soir, tu dois t’effacer, n’être qu’un véhicule. Mais tu l’as habitué à plus. La pitié va le rendre plus tendre. Ils le boufferont en premier.
Tu démarres la voiture en pensant qu’il va disparaître mais il est toujours là quelques kilomètres plus loin. Il y a de plus en plus d’oxygène. Il n’a même pas posé de questions. Tu l’as habitué à tes lunes grises. Il faut que tu trouves des mitraillettes et des boucliers. Il vous faut des sacs de sable.
Tu ressens ce que l’instinct a imposé à ton corps, les soubresauts de tes douleurs passées, les moqueries viles et incessantes, les coups bas que tu as reçus. Tu peux encore ressentir la brûlure des larmes sur tes joues. Tu penses que la pire des violences est d’aller mal quand tout va bien, d’attendre que le ballon arrive pour glisser dessus, de quitter le bahut pour revenir le lendemain, d’imaginer les insultes qui ne sont pas encore prononcées, de ressentir des coups que tu n’as pas encore reçu. Tu penses que l’on ne peut pas parler de ce qui n’arrive pas. Il faudrait déjà pouvoir dire ce que tu prends dans la gueule. Tu te demandes si ton propre silence n’a pas fait plus de ravage que les poings que tu as pris dans le ventre.

Agrandissement : Illustration 2

Tu as bien réfléchi à tout cela toutes ces années. T’avais pas 200 solutions. Tu aurais pu l’habituer à la dureté et en faire un petit soldat, costaud et normé. Mouler son poing dans ton ventre meurtri. Réveiller la haine que tu as ressenti. L’utiliser pour te venger des prochains hommes. Le conditionner aux derniers siècles, en faire un petit mâle, un modèle qui répéterait les mêmes violences et cognerait à son tour. Tu aurais pu facilement céder aux injonctions qui datent des grottes et des mammouths et lui refiler les codes de la domination qui trainent un peu partout, sous les semelles des doc martens, entre les jambes des adolescents, sur les fronts des footballeurs, dans les cerveaux des puissants.
Tu ne dis rien. T’es toujours accroché au volant. C’est bien lourd à porter tout ça mais tu es toujours là et ton fils a l’esprit subtil. Tu t’es si souvent juré d’avoir le verbe facile avec tes propres enfants que tu appuies de plus en plus fort sur l’accélérateur dans le sens que tu viens de quitter. Tu t’entends dire : j’ai pété un câble, vas vite mon grand, rien de grave.
Il court vers la grille vide du collège quand tu refermes la porte, le torse compressé par la ceinture et le battement de tes veines.
La suite dans la revue Polymorphes : REVUE POLYMORPHES numéro JEUNESSES



