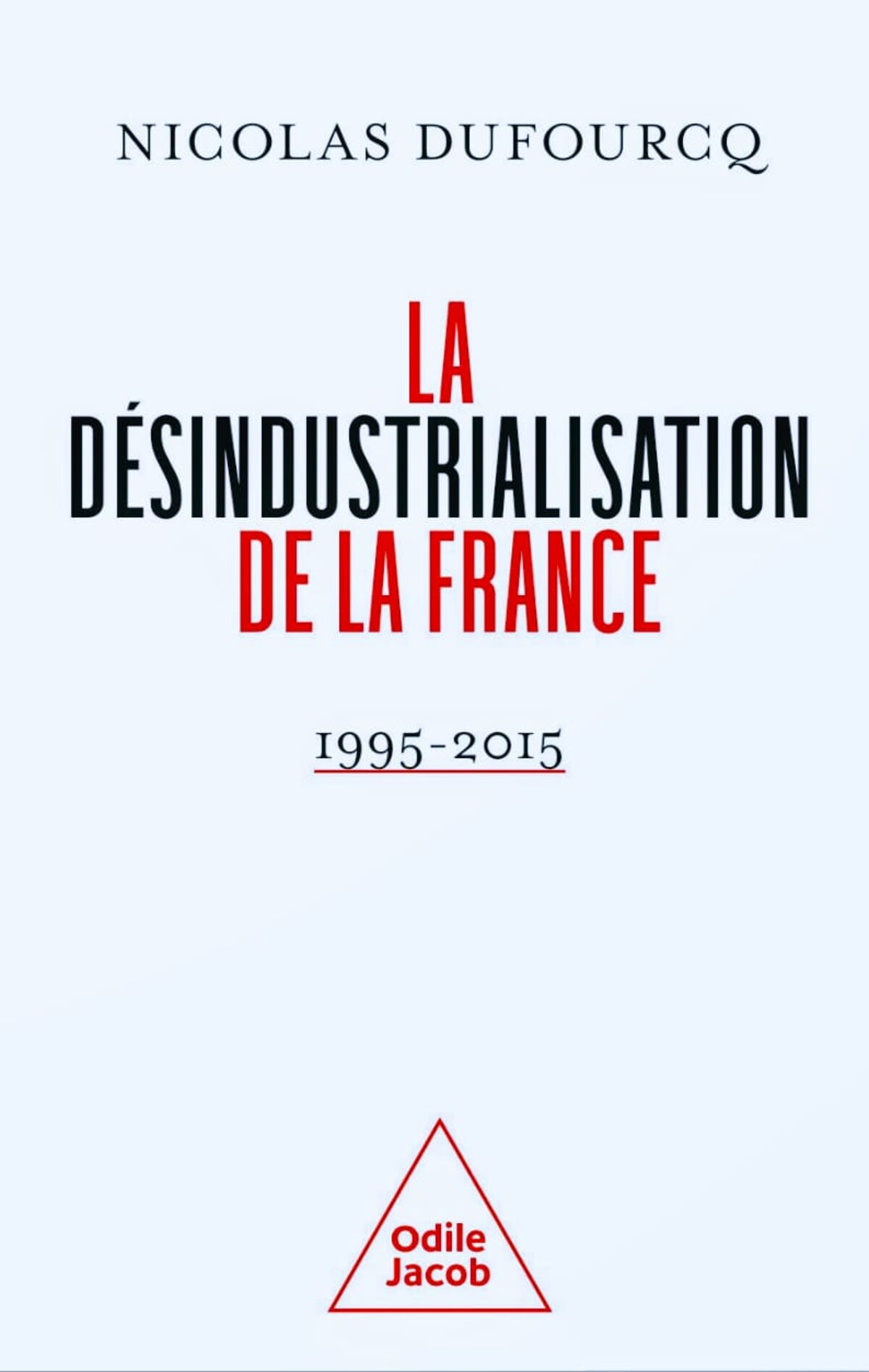
Agrandissement : Illustration 1
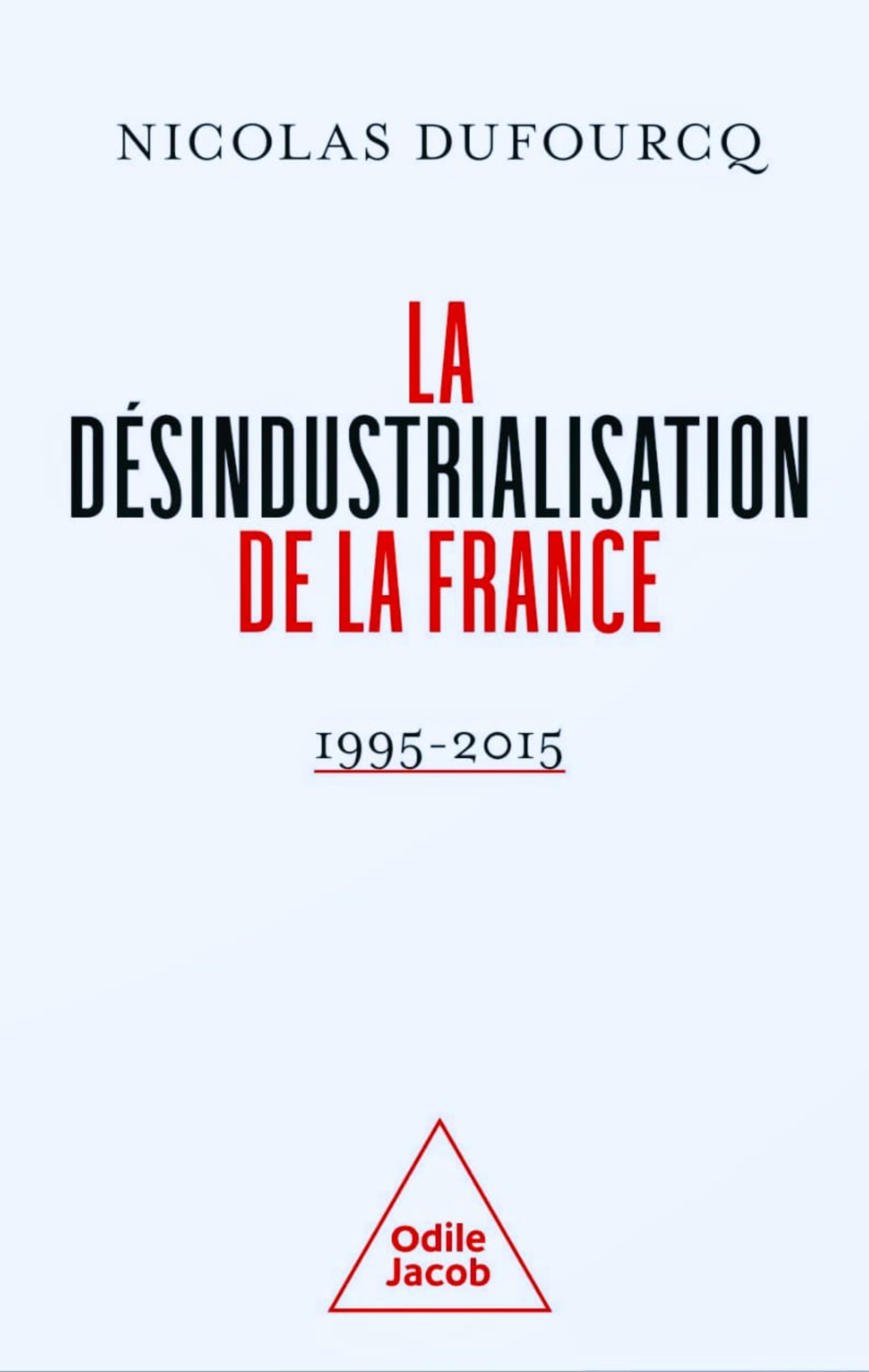
Un héritage à redécouvrir
L'industrie française connaît de profondes mutations. Le pessimisme ambiant est contre-productif. Il est temps de regarder les transformations avec lucidité et confiance. Des opportunités s'offrent à nous. Repenser notre modernisation industrielle est crucial pour l’avenir.
Le modèle classique de modernisation industrielle identifiait la croissance avec la taille des usines et l'essor des industries lourdes. Ce point de vue liait le développement industriel à la puissance militaire. Il supposait un chemin unique, calqué sur le modèle britannique.
Cette vision est aujourd'hui remise en question. Les critiques soulignent la diversité des parcours historiques. L'industrialisation française, par exemple, n'était pas en retard. C'était un "modèle de développement original", avec ses propres forces.
Un modèle historique unique
Dès le XVIIIe siècle, la France a développé un modèle d'industrialisation unique…et souvent méconnu. L’historien britannique Patrick O'Brien et l'économiste et sociologue turc Çağlar Keyder l'ont analysé. La croissance industrielle française par habitant était quasi identique à celle de la Grande-Bretagne (1,2% contre 1,3% entre 1815 et 1913). Cette performance s'appuyait sur des caractéristiques distinctives. Elles sont riches d'enseignements pour aujourd’hui.
Le modèle français différait du britannique. Sa croissance fut précoce et continue. Elle commença au XVIIIe siècle et fut stable au XIXe. Pas de "décollage" soudain comme ailleurs.
La démographie française joua un rôle. La croissance démographique y était plus lente. L'urbanisation moins intense qu'en Grande-Bretagne. Une population rurale plus importante subsistait. Cette base agricole fournissait une main-d'œuvre expérimentée aux industries rurales. Elle façonnait aussi la demande. La France privilégiait les biens de consommation de qualité. Le Royaume-Uni visait la production de masse pour une population urbaine croissante.
La productivité française était notable. Sa productivité du travail industriel surpassa celle du Royaume-Uni jusqu'à la fin du XIXe siècle. Elle excellait dans les procédés de fabrication moins intensifs en capital. C'était le cas pour l'agroalimentaire, la mécanique et le textile non-cotonnier. La France se spécialisait dans les produits finis et élaborés, souvent pour l'export. Le Royaume-Uni se concentrait sur les produits de base (charbon, fer).
Le rôle de l'État et des banques était différent. En France, leur rôle était moins direct. Ils intervenaient moins dans la croissance des secteurs capital-intensifs. La France s'appuyait surtout sur son grand marché intérieur. Elle était l'un des pays les plus peuplés d'Europe jusqu'au milieu du XIXe siècle.
Ces différences montrent que la voie française fut distincte et efficace. Elle n'était pas un simple “retard".
Le "grand débat" autour de la croissance industrielle française illustre cela.
La vision classique, des professeurs américains Rondo Cameron ou David Landes, soulignait la lenteur française. Ils la liaient à un ralentissement démographique précoce. Ils considéraient l'industrialisation française comme en retard. Ils se basaient sur la croissance du produit global comparée à celle du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des États-Unis.
Le modèle britannique servait de référence idéale.
La nouvelle vision, celle de l’américain Richard Roehl, et des français Maurice Lévy-Leboyer, François Caron et Jean Bouvier, réfute ce "retard français". Ils affirment qu'il n'existe pas de modèle idéal unique.
La France a suivi un "schéma de développement original" avec ses propres forces.
Sa croissance industrielle par habitant était comparable à celle du Royaume-Uni. Son industrialisation était précoce et continue. Sa structure économique était dualiste. Son développement impliquait une progression simultanée d'anciennes et de nouvelles industries, d'industries lourdes et légères, à la fois dans les industries rurales et urbaines. L'industrie française a connu un développement vigoureux des branches à forte intensité capitalistique (industries lourdes, équipement, filature de coton) et des branches à faible intensité capitalistique (tissage de la soie et de la laine, habillement, bâtiment, alimentation, cuir, bois). Cette croissance dualiste a persisté pendant longtemps, au moins jusqu'aux années 1880, et même jusqu'à l'entre-deux-guerres.
Comprendre la désindustrialisation
La désindustrialisation française, notable depuis les années 1970 et accentuée après 2007-2008, se caractérise par une forte réduction de l'emploi industriel. Selon les géographes François Bost et Dalila Messaoudi,
- L'emploi industriel est passé de 5,6 millions en 1970 à 3,3 millions en 2014.
- La contribution manufacturière au PIB a chuté à 10% en 2016 (20,3% en Allemagne).
- Un déficit commercial structurel de -48,1 milliards d'euros fut enregistré en 2016.
- La France ne représentait plus que 3,1 % des exportations mondiales en 2014
Évitons cependant tout catastrophisme. Cette érosion s'explique par des phénomènes complexes. Il faut les distinguer.
D'abord, les causes mécaniques :
- La "tertiairisation" de l'emploi. Il s'agit d'un transfert d'emplois industriels vers le secteur des services. Cela est dû aux gains de productivité. Les activités de maintenance, informatique, logistique, conseil, sont externalisées. Elles étaient auparavant internes aux entreprises industrielles. Elles sont désormais confiées à des prestataires. Cela crée un transfert statistique majeur vers les services.
Ensuite, les causes structurelles :
- La concurrence par les coûts. Elle explique 30% des pertes d'emplois depuis 2000. Elle vient des pays à bas salaires et émergents, mais aussi de pays européens. Les coûts salariaux élevés et la fiscalité des entreprises en France aggravent ce phénomène.
- Les gains de productivité liés à l'automatisation jouent aussi. La perte de compétitivité structurelle entraîne des faillites. Des usines ferment, des lignes de production s'arrêtent. Cela détruit des emplois nets.
- La part de la France dans les exportations mondiales diminue. Notre déficit commercial s'aggrave. Nos produits perdent des parts de marché.
Le retard technologique
L'analyse des indicateurs de modernisation alerte.
La France consacrait 2,21% de son PIB à la R&D en 2016. Loin de l'objectif européen de 3% et des 2,87% de l'Allemagne. Cette faiblesse handicape notre capacité à créer des produits à forte valeur ajoutée. Elle freine notre "montée en gamme”.
Le vieillissement de notre outil industriel est un autre défi. L'âge moyen des équipements français atteignait 19 ans en 2013 (17,5 ans en 1998).
Notre retard en robotisation est plus révélateur. Selon le consultant allemand Roland Berger, estimé en 2014, le différentiel entre la France et l’Allemagne (respectivement 34 000 robots contre 162 000) était abyssal. Même si, ramené en nombre d'actifs dans l'industrie, la situation pouvait paraître moins catastrophique ( avec 84 robots pour 10 000 salariés contre 125 en Allemagne).
De plus, notre industrie est trop concentrée dans les secteurs à faible et moyenne technologie; des secteurs plus exposés à l'automatisation et à la concurrence. L'Allemagne, elle, vise le haut de gamme et la haute technologie.
Enfin, les entreprises industrielles sont passées de structures verticales à horizontales. Elles externalisent les activités non stratégiques. Cela est jugé crucial pour la compétitivité.
Le nombre de fermetures d'usines a longtemps dépassé les ouvertures. La tendance semble se stabiliser. Les nouvelles usines sont souvent plus petites et automatisées.
La désindustrialisation affecte inégalement le territoire.
Sur 304 zones d'emploi métropolitaines, 252 ont perdu des emplois industriels entre 1998 et 2014. Les anciennes régions industrielles ont subi les plus fortes pertes absolues. Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Lyon et Saint-Étienne en sont des exemples. C'est l'héritage des restructurations des années 1970.
Cependant, des territoires résistent et prospèrent. Toulouse en est l'exemple emblématique. Elle a gagné 12 575 emplois industriels. Son secteur aéronautique et spatial l'a portée. D'autres zones comme La Roche-sur-Yon, Figeac ou Saint-Nazaire montrent la voie.
Une adaptation réussie est possible. C'est vrai même dans des secteurs traditionnels.
L'innovation technologique et organisationnelle est la clé.
L'émergence de l'Industrie 4.0 est une chance
Elle permet à la France de renouer avec l'excellence industrielle. Robotisation massive, impression 3D, réalité augmentée, Internet des objets, ces technologies révolutionnent la production. Elles créent des "usines intelligentes et connectées". Elles redéfinissent les avantages concurrentiels. Les coûts salariaux élevés deviennent moins pénalisants. Nos compétences en ingénierie et en recherche sont de vrais atouts.
La montée en gamme est une stratégie prometteuse. Elle s'inspire du modèle nord-européen. En se concentrant sur des productions à forte valeur ajoutée, la France peut retrouver sa place. Il faut développer nos capacités d'innovation. Cette stratégie demande des efforts soutenus. Il faut investir en R&D, moderniser les équipements, simplifier notre réglementation.
La relocalisation offre aussi des perspectives. Elle crée des emplois, même modérés. Les investissements massifs en robotisation et automatisation la rendent viable. Ils réduisent l'importance des écarts de coûts salariaux.
Ces stratégies visent à inverser le déclin. Elles renforcent la compétitivité. Elles favorisent l'innovation. Elles s'adaptent aux exigences d'une économie mondialisée et technologiquement avancée.
Agriculture et industrialisation
La comparaison des agricultures française et britannique au XIXe siècle est éclairante. Elle met en lumière leurs parcours industriels distincts. L'agriculture britannique avait un rapport terre/travail plus élevé. Elle avait plus de terres par travailleur. Ses rendements par hectare étaient supérieurs. Sa productivité du travail agricole était donc meilleure qu'en France.
Le Royaume-Uni concentrait la culture sur les meilleurs sols. Plus de 50% de ses terres étaient dédiées aux pâturages contre 27% en France. Cela favorisait l'élevage. Plus de fumier et d'énergie animale pour l'agriculture, donc de meilleurs rendements.
L'agriculture française, à l'inverse, cultivait des sols médiocres. Elle sacrifiait souvent l'élevage. Sa densité démographique était élevée. Les parcelles étaient petites.Les paysans, quand ils disposaient d'économies, choisissaient d'agrandir leur domaine plutôt que d'investir dans de meilleurs outils ou des techniques agricoles plus performantes. Cette stratégie, bien que sécurisante, freinait l'innovation et la productivité agricole.
La France, très rurale, dépendait des céréales comme aliment de base. Elle utilisait moins de cultures fourragères et d'animaux. Le travail était souvent manuel. Le Royaume-Uni, plus productif et axé sur l'élevage, importait de plus en plus de nourriture. Le droit de propriété jouait un rôle clé.
En Grande-Bretagne, les enclosures consolidaient les terres. La population rurale était poussée vers les villes. Cela fournissait de la main-d'œuvre à l'industrie.
En France, la propriété paysanne était plus égalitaire. La Révolution la consolida. Une population plus importante restait en zone rurale. Cette différence influença profondément la mobilité du travail et la demande de biens industriels.
Ces disparités s'expliquent par des phénomènes structurels objectifs. Conditions naturelles, démographie, structures sociales étaient en jeu. Ce n'était pas la qualité entrepreneuriale. Cela prouve que l'industrialisation française fut distinctement façonnée par ses réalités agricoles.
Le sens du progrès
Les implications sociales et humaines de ces chemins d'industrialisation invitent à réévaluer le "progrès". La "qualité de vie" est centrale. La croissance économique et les changements structurels ne sont pas des fins en soi. Ce sont des instruments pour le bien-être social. Ils doivent élever les niveaux de consommation et la qualité de vie.
Au Royaume-Uni, l'urbanisation rapide et la migration interne furent massives. Enclosures et changements agricoles poussèrent des millions de personnes vers les villes et les usines.
Pour de nombreux petits paysans qui n'avaient pas les moyens de clôturer leurs parcelles ou qui dépendaient des terres communales pour leur subsistance, les enclosures signifiaient la perte de leurs moyens de vie traditionnels. Ils étaient souvent contraints de vendre leurs terres ou de devenir des ouvriers agricoles salariés, ou de migrer vers les villes pour chercher du travail dans les industries naissantes.
Les salaires réels augmentèrent après le milieu du XIXe siècle. Mais l'expérience humaine directe de cette transition est mal documentée. Perte de communauté, d'identité, pollution urbaine… Les avantages de la vie industrielle justifiaient-ils une telle perturbation ? Surtout pour la classe ouvrière.
En France, la croissance démographique fut plus lente. Le secteur agricole plus stable. Une part bien plus grande de la population resta en zone rurale. Le système agraire français était moins hostile au maintien de la main-d'œuvre. La distribution plus égalitaire des droits de propriété favorisait les petites exploitations familiales.
Cette trajectoire fut "différente", pas "en retard". Elle permit un changement rural-urbain moins dramatique. Ce fut peut-être une transition plus humaine. Les avantages perçus de la vie urbaine n'étaient pas toujours assez évidents pour un exode rural massif. Cette perspective remet en question la supériorité intrinsèque du modèle britannique en termes de bien-être humain.
Un nouveau modèle industriel français
La transformation de notre industrie exige une mobilisation collective. Montée en gamme, relocalisation, nouvelles activités numériques, ces dynamiques dessinent un nouveau contrat industriel français
Pour atteindre le niveau de ses partenaires européens, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, la France doit accélérer.
Elle peut s'inspirer du Mittelstand allemand : Un réseau de PME innovantes, hautement qualifiées, et très exportatrices.
La formation professionnelle et l'intégration de la R&D dans l'entreprise sont des piliers. La France doit aussi valoriser son savoir-faire unique, à l'image des niches de luxe et de design italiennes ou des pôles d'excellence technologique britanniques.
Cela passe par des investissements massifs en capital. Il faut un écosystème d'innovation renforcé. La simplification réglementaire continue est nécessaire.
Développer l'attractivité du territoire pour les investissements directs étrangers est également clé.
L'histoire l'a montré, la France a toujours tracé sa propre voie industrielle. Notre modèle historique est basé sur la qualité, la diversité, l'équilibre territorial.
Il résonne particulièrement avec les défis actuels.
Innovation, créativité, excellence technique restent nos forces historiques.
L'Industrie 4.0. peut écrire un nouveau chapitre.
Il ne s'agit pas d'imiter les autres. Il s'agit d'inventer, encore une fois, notre propre modèle d’excellence. Il s’agit alors de concilier performance économique et qualité de vie, innovation et tradition, compétitivité et cohésion territoriale. Voilà tout le génie national français.
L'industrie française n'est pas vouée au déclin. Elle doit juste se réinventer.



