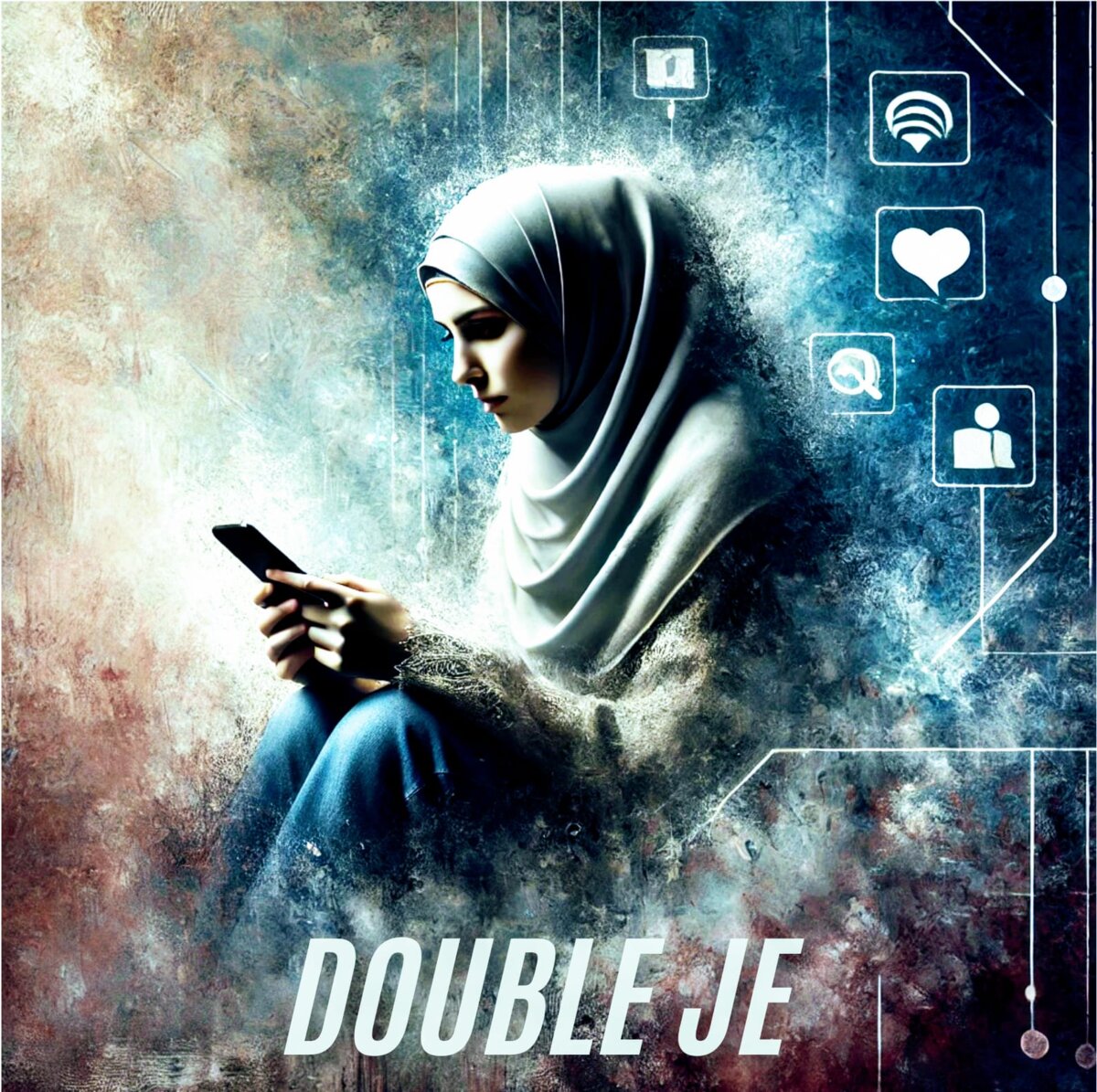
Agrandissement : Illustration 1
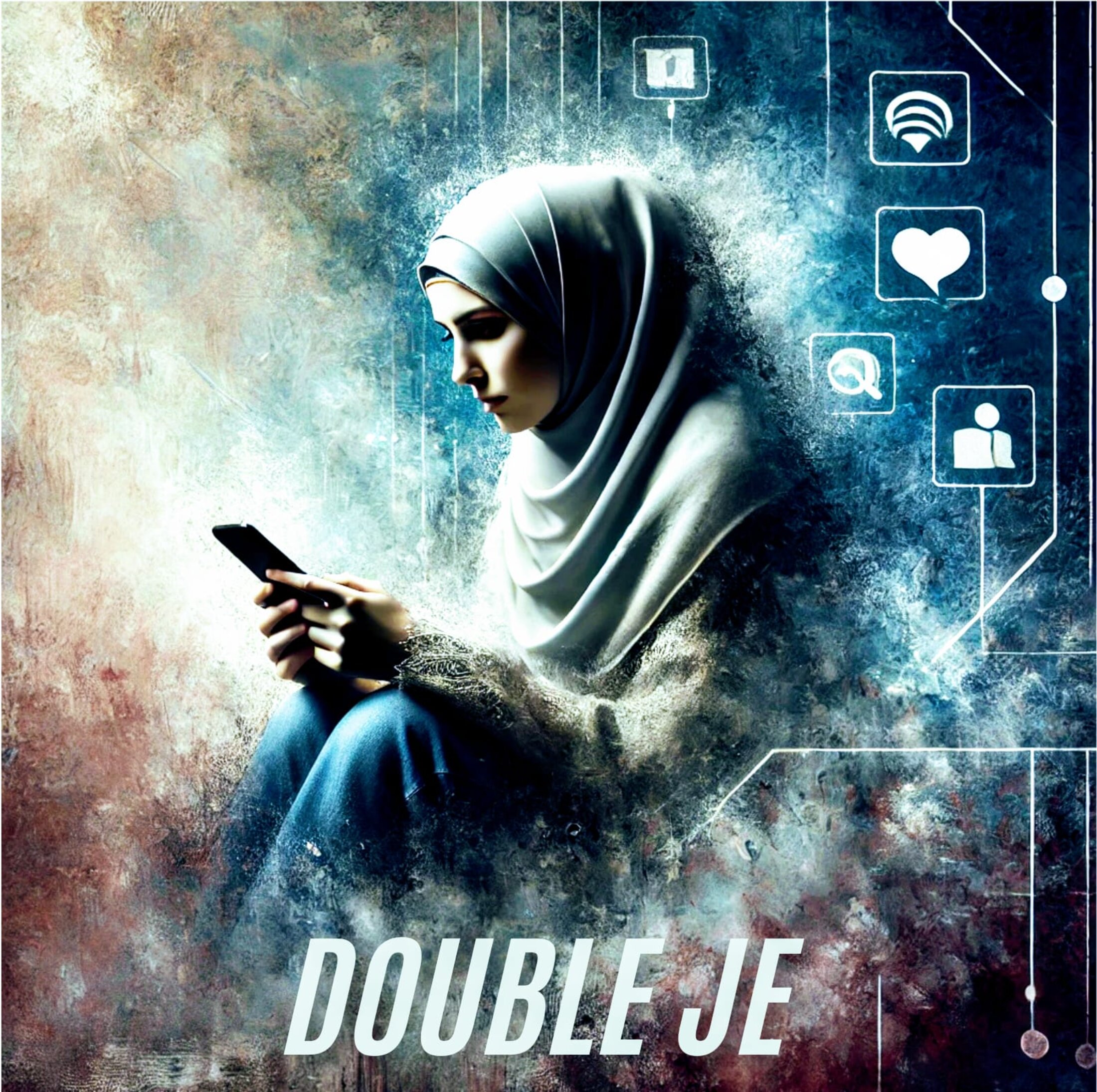
La France : Ses cités populaires, ses mosaïques culturelles, ses associations vibrantes. Et pourtant, ce sont ces quartiers qui se retrouvent, une fois de plus, au cœur d’un jeu trouble.
Des vies ordinaires, des missions extraordinaires
Imaginez Fadila, 23 ans, habitante de la banlieue parisienne. Elle a grandi entre les jeux dans les cours d’immeubles et les soirées couscous en famille.
Un jour, un "recruteur" l’approche. Officiellement, il travaille pour une organisation préoccupée par la radicalisation. Officieusement, il lui propose un rôle dans la “protection” de sa communauté. Ce qu’on lui demande ? Porter le foulard, se rapprocher des associations culturelles locales — celles qui prônent la gastronomie maghrébine ou traditions vestimentaires — et transmettre des informations.
Pour Fadila, c’est une chance de changer de vie, peut-être d’échapper à un avenir fait de petits boulots.
Mais elle ignore que derrière les promesses se cache un engrenage dangereux, où sa vie deviendra une pièce d’un puzzle politique qui la dépasse.
Les conséquences ?
Stigmatisation, risques psychologiques, et le poison d’une confiance brisée au sein de sa communauté.
La face cachée du renseignement amateur
L’idée d’utiliser des civils non formés pour des missions de surveillance est loin d’être nouvelle. Mais les exemples récents montrent à quel point cela peut tourner au fiasco.
En 2023, en Grande-Bretagne, une étudiante en échange universitaire avait été enrôlée pour surveiller une mosquée sous prétexte de prévenir des activités extrémistes. Mal encadrée, elle a fini par se faire démasquer, mettant sa vie en danger et provoquant une vague de colère parmi les fidèles.
En France, l’affaire des "infiltrés agricoles" dans les années 2010 avait déjà soulevé un tollé. Des saisonniers étrangers étaient recrutés pour espionner des syndicats agricoles jugés trop "radicaux". L’opération s’était soldée par un scandale après la fuite de documents internes.
Ces épisodes illustrent les limites éthiques et pratiques de l’utilisation de civils dans des rôles d’espionnage.
Un mal insidieux : stigmatisation et divisions
Cibler une communauté particulière, ici les maghrébins de France, ne fait qu’accentuer les fractures sociales.
Ces pratiques alimentent un climat de suspicion généralisée. La moindre association culturelle devient suspecte. Les femmes portant le foulard, souvent déjà confrontées à des discriminations, sont encore plus pointées du doigt.
Et pour les informatrices elles-mêmes ? C’est un poids psychologique écrasant. Coupées de leurs proches, elles vivent dans la peur d’être démasquées ou abandonnées par les agences qui les emploient.
Ce ne sont pas des James Bond, mais des jeunes femmes ordinaires, piégées dans un système qui les dépasse.
Les "officines parallèles" : des fantômes dangereux
Les officines "parallèles", ces structures agissant en dehors du cadre officiel de l’État, sont un cancer pour les démocraties.
Leur manque de transparence pose des questions graves :
- Qui les dirige ?
- Avec quels budgets ?
- Pour quels objectifs ?
L’exemple du "Rainbow Warrior" est emblématique. En 1985, des agents français, sous couvert d’une mission secrète, avaient saboté le navire de Greenpeace. Résultat : une opération dévoilée, des conséquences diplomatiques catastrophiques, et une France humiliée sur la scène internationale.
Aujourd’hui encore, ces méthodes dénoncées continuent d’inspirer des pratiques similaires.
Résister à la dérive
Face à ces dérives, les solutions existent.
Des solutions juridiques
Le Parlement français doit jouer un rôle central en enquêtant sur ces pratiques et en imposant un contrôle strict des services de renseignement.
L’article 706-84 du Code de Procédure Pénale protège les officiers ou agents de police judiciaire et punit jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende la révélation de l’infiltrée.
Mais ce statut ne s’applique pas à la femme recrutée pour surveiller sa communauté.
Certes, la loi Perben II du 9 mars 2004 a ouvert la voie à la rétribution en espèces pour ces informatrices, mais elle n’a rien prévu pour leur protection.
Si l’utilisation d’un citoyen ordinaire s’avère nécessaire dans le cadre d’une enquête, il est impératif que cette infiltration soit autorisée par un juge d’instruction.
La durée de ces opérations doit être strictement limitée, et la rémunération devrait couvrir non seulement la période d’infiltration mais aussi celle de réinsertion dans la vie sociale.
Un suivi psychologique devrait également être instauré après chaque mission pour garantir le bien-être de ces informatrices.
Enfin, en dehors du cadre d’enquête, l’utilisation de citoyens ordinaires ne devrait concerner que ceux dont l’activité professionnelle les amène à côtoyer des individus suspects.
Il est temps d’établir un cadre légal clair et protecteur pour éviter que ces pratiques ne deviennent une normalité inquiétante.
Des solutions sociétales
Les populations ciblées doivent être associées à un dialogue réel, et non vues comme des menaces potentielles.
La lutte contre le terrorisme est essentielle, mais ne doit jamais se faire au détriment des droits fondamentaux ni au prix d’une société divisée.
Carl Jung ajouterait : "Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes." Cette introspection collective est nécessaire, car le véritable danger ne réside pas seulement dans l'ennemi extérieur, mais aussi dans les failles de notre propre système.
À force de "chasser des ombres", comme dirait Lamia Berrada-Berca, nous oublions souvent que ces ombres naissent de nos propres choix, de notre propre lumière.
Ainsi, plus que d’infiltration, nous avons besoin d’intelligence, non pas au sens d’espionnage, mais d’une compréhension profonde et humaine.
Christian Bobin nous rappelle avec justesse : "Plus on s'approche de la lumière, plus on se connaît plein d'ombres."
Le terrorisme est le fruit d’un déséquilibre, souvent nourri par l’absence de droit et d’équité. C’est donc une réponse juridique et un dialogue inclusif qui seront les outils les plus performants pour contrer cette ombre.



