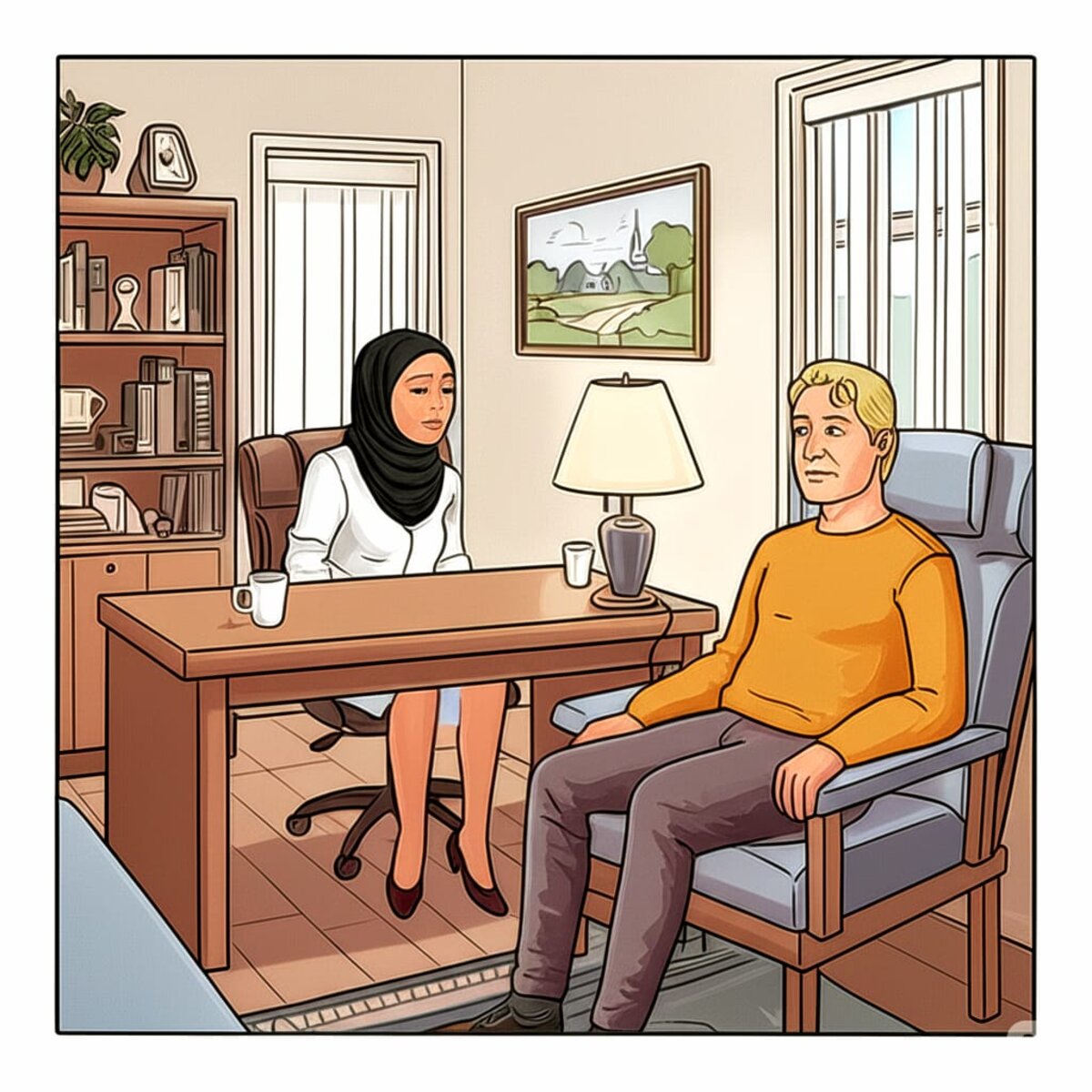
Agrandissement : Illustration 1
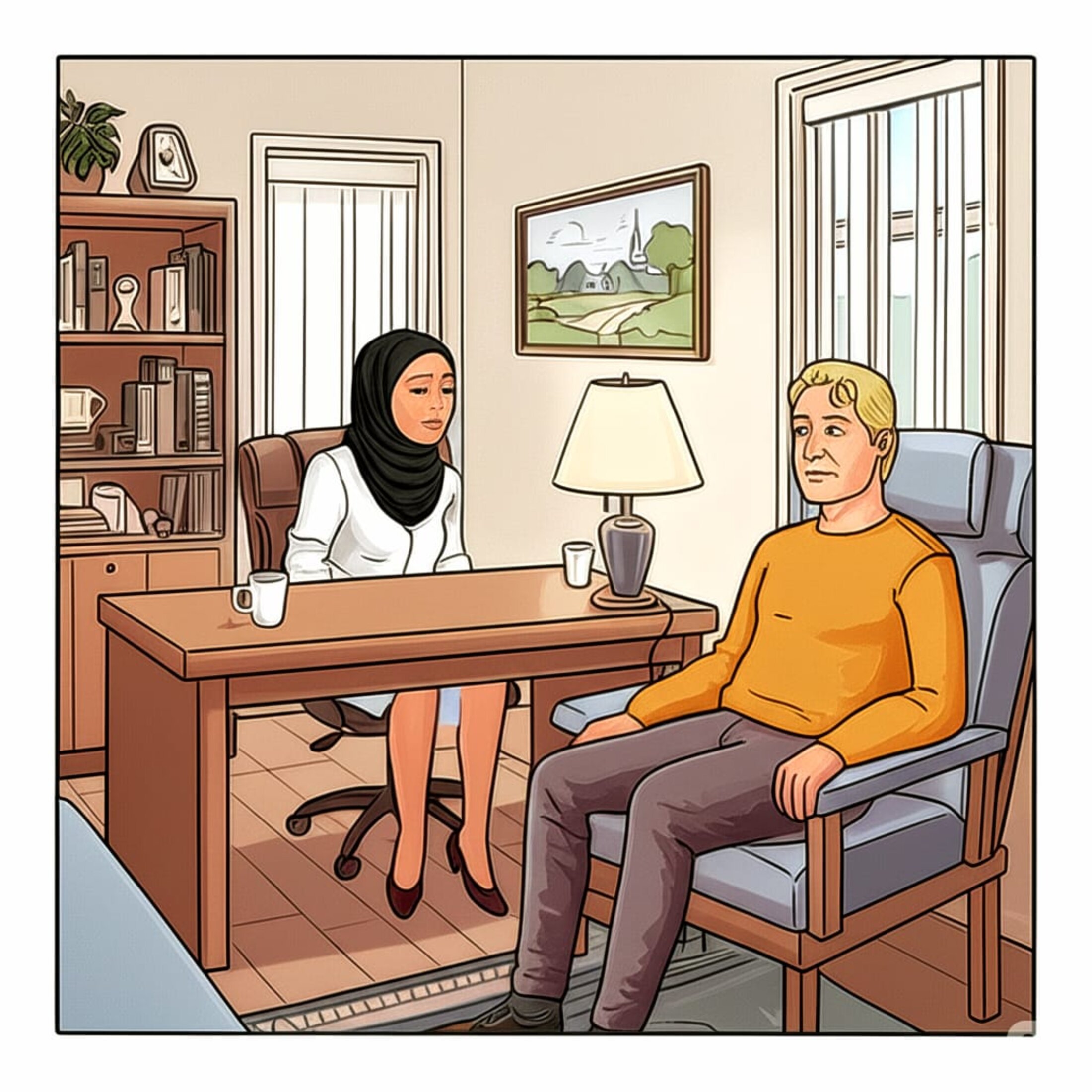
Comme toujours, dans toutes les expressions créées à partir du préfixe "islamo-", l'essentiel est contenu dans le second terme.
Dans “islamo-gauchisme”, c’est bien “gauchisme” qui souffre d’une définition ambigüe.
De même, dans “islamo-phobie”, c'est le mot phobie qu'il faut comprendre.
Ce matin, le président de la République et son "conseil de défense" examinent un nouveau rapport sur l’entrisme supposé des Frères musulmans dans la société française. Une commande politique aussi anxieuse qu’infondée. Derrière le vernis sécuritaire, se dessine une réalité bien plus inquiétante : une islamophobie d’État, devenue réflexe conditionné de nos institutions.
Mais appelons un malaise par son nom. Et prenons au sérieux le mot que tout le monde prononce sans jamais le considérer pleinement : phobie.
Une peur irrationnelle, mais bien entretenue
Les phobies, au sens clinique, sont des peurs intenses et irrationnelles déclenchées par des objets ou des situations qui ne présentent pas de danger réel. Araignées, avions, foule, clowns : tout peut devenir source de terreur — si on y associe assez d’angoisse collective et de récits anxiogènes.
Et l’islam, aujourd’hui, en France, est devenu l’un de ces objets phobiques. Non pas dans l’esprit de quelques individus marginalisés, mais au cœur de l’appareil d’État, de ses lois, de ses décrets, de ses commissions.
Un voile porté sur un quai de gare. Une prière murmurée à la pause déjeuner. Un prénom qui déclenche une suspicion. Tout est surinterprété, surexposé, surexploité.
Le rapport examiné aujourd’hui n’analyse rien, il fantasme. Il projette sur des citoyens français une peur façonnée dans les bureaux ministériels, bien plus que dans les rues du pays.
Peut-on traiter une phobie collective ?
Et si l’on appliquait, au problème politique qu’est l’islamophobie, les traitements que l’on recommande pour une phobie classique ?
Exposition progressive : Accepter de voir, d’entendre, de croiser ce qui nous fait peur, dans un cadre apaisé. Bref, reconnaître les musulmans comme des citoyens ordinaires, dans toute leur diversité.
Restructuration cognitive : Travailler sur nos croyances erronées. Par exemple : non, la foi musulmane n’est pas incompatible avec la République. Non, le voile n’est pas une arme politique.
Soutien social : Sortir du repli, dialoguer, créer des espaces de compréhension au lieu de légiférer dans l’urgence.
Hygiène démocratique : Éteindre les médias qui hurlent au danger chaque semaine. Refuser que des partis construisent leur audience sur la peur de l’autre.
Il ne s’agit pas de nier les risques sécuritaires, mais de refuser leur instrumentalisation au détriment d’un groupe entier. À force de désigner l’islam comme un danger potentiel, l’État fabrique lui-même la panique, et se condamne à vivre dans un état d’alerte constant — au prix de sa propre cohésion.
Ce n’est pas une dérive, c’est une politique
Soyons lucides : cette peur-là est entretenue, alimentée, organisée. Ce n’est plus une réaction de défense, c’est une méthode de gouvernement. L’islamophobie d’État n’est pas une crise passagère. C’est un système.
Mais si une phobie peut se soigner, alors un système peut se transformer.
Encore faut-il le reconnaître comme malade.



