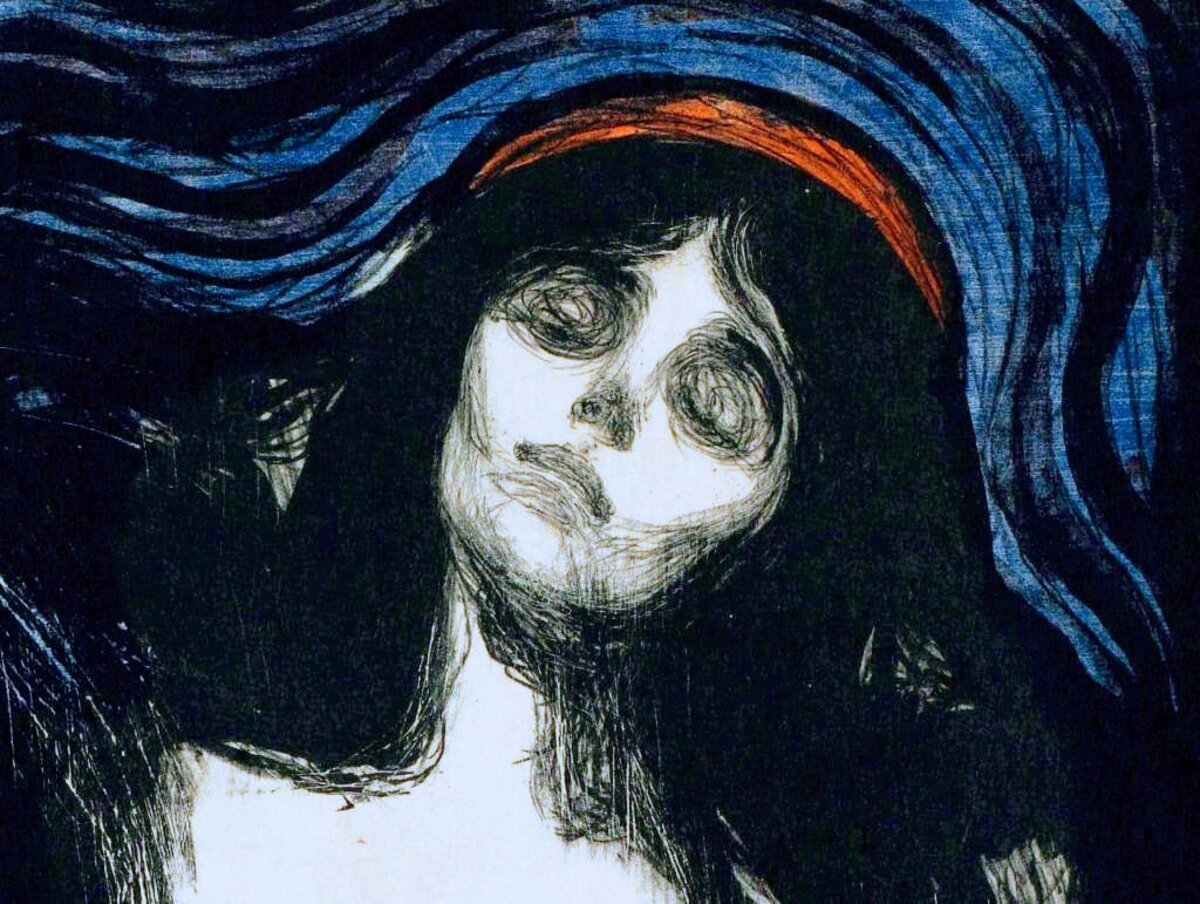
Agrandissement : Illustration 1
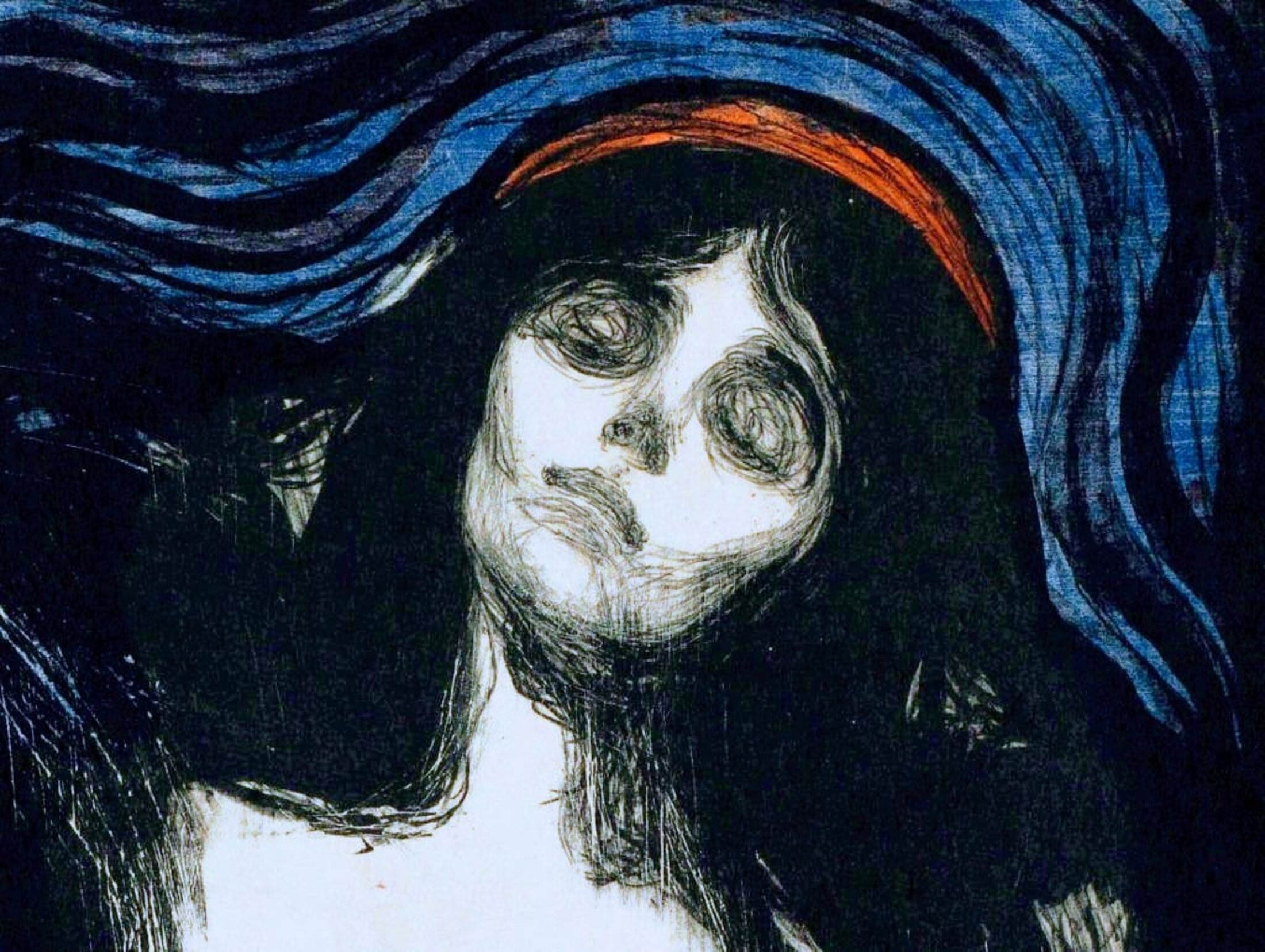
Octobre 2025 restera gravé dans l'histoire de notre droit pénal comme un mois de contrastes vertigineux.
Le 9 octobre, la nation rendait un hommage solennel à Robert Badinter en l'accueillant au Panthéon, consacrant ainsi l'abolition de la peine de mort comme pierre angulaire de notre justice républicaine.
Quarante-quatre ans après avoir arraché la France à la peine capitale, cette figure tutélaire recevait la reconnaissance ultime d'un pays qui a choisi de placer la dignité humaine au cœur de son système pénal.
En même temps, ce même mois, la cour d’assises de Paris prononçait la sanction la plus sévère de notre arsenal judiciaire, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, et pour la première fois depuis 1949, à l'encontre d'une femme, une jeune femme âgée de 27 ans, reconnue coupable du viol, torture et meurtre de la petite Lola Daviet, âgée de douze ans.
La justice a fait preuve, dans cette affaire, d'une efficacité remarquable en condamnant la meurtrière trois ans après les faits, presque jour pour jour.
Un contraste saisissant avec une autre actualité judiciaire du même jour; quarante-un ans, presque jour pour jour après le crime, la justice mettait en examen une vielle femme âgée de 81 ans, la grande-tante du petit Grégory Villemin, âgé de 4 ans et assassiné le 16 octobre 1984.
Une affaire gravée comme le symbole absolu d'un fiasco judiciaire qui a marqué toute une génération.
Entre célérité moderne et lenteur historique, la justice française révèle ses deux visages.
Cette peine de perpétuité incompressible, qui rend la période de sûreté théoriquement illimitée, exprime une volonté d'exclusion définitive qui interroge nos principes les plus fondamentaux.
Une peine infinie
Le paradoxe est troublant.
Nous célébrons l'homme qui refusa à l'État le droit de vie ou de mort, tout en confirmant une sanction qui, par sa durée et son intransigeance, coupe l'individu de tout avenir possible.
La perpétuité incompressible constitue la réponse du législateur face aux crimes jugés irrécupérables, signalant une rupture avec l'idée que l'amendement demeure l'objectif premier du système pénitentiaire.
Lorsque la France abolit la peine capitale en 1981, nombreux furent ceux qui crurent à un tournant définitif.
Pourtant, la réclusion criminelle à perpétuité s'est imposée comme le substitut silencieux de la guillotine. Elle ne tue plus, certes, mais elle efface progressivement. Elle enferme jusqu'à l'oubli, parfois jusqu'à la mort biologique.
Les chiffres le rappellent avec brutalité; plusieurs dizaines de personnes purgent aujourd'hui en France une "perpétuité réelle", une peine sans horizon.
Le condamné n'a plus de date en vue, plus de perspective, plus d'existence au-delà des murs de sa cellule.
Robert Badinter, artisan de l'abolition, l'avait pressenti, en supprimant l'exécution, on risquait de créer "des peines infinies". Cette prédiction s'est malheureusement réalisée.
L'exigence européenne
La Cour européenne des droits de l'homme a pourtant posé un principe cardinal.
Dans son arrêt Vinter contre Royaume-Uni de 2013, elle a reconnu le "droit à l'espoir" comme corollaire indissociable de la dignité humaine.
Toute peine doit offrir une possibilité réelle de réexamen, même pour les crimes les plus atroces. Priver un individu de cette espérance reviendrait à infliger un traitement inhumain, contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pour se conformer à cette exigence, le droit français prévoit un mécanisme de révision.
Même en cas de perpétuité incompressible, le détenu peut, après trente ans de réclusion, parfois avant, solliciter le relèvement de sa période de sûreté. Ce processus demeure exceptionnel, soumis à l'évaluation rigoureuse de la dangerosité par une commission spécialisée.
C'est le mince fil qui relie notre système pénal à l'idéal humaniste, une porte de sortie légale aussi étroite soit-elle.
En pratique, toutefois, cette révision reste presque théorique. Le condamné survit, mais sans horizon véritable; une forme de mort sociale, étalée sur des décennies de silence.
Cette absence totale de perspective pose également un problème de sécurité pénitentiaire rarement évoqué.
Un détenu qui n'a plus rien à perdre, qui sait qu'aucune aggravation de sa peine n'est possible, risque de se transformer en ce que certains juristes appellent un "fauve carcéral".
Sans espoir de libération, la récidive en détention ne représente plus aucun risque supplémentaire.
Cette situation met directement en danger la vie des personnels pénitentiaires, confrontés à des individus pour qui toute violence additionnelle reste sans conséquence juridique.
Le droit à l'espoir n'est donc pas qu'une question philosophique; c'est aussi un outil de régulation indispensable à la sécurité même du système carcéral.
La France a peur
Cette formule, lancée par Roger Gicquel résonnait dans les foyers français en janvier 1976, au lendemain de l'enlèvement et plus tard le meurtre du petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans.
Ce climat d'effroi collectif avait fourni à Robert Badinter l'occasion de son plaidoyer le plus célèbre, transformant le procès d'un meurtrier d'enfant en procès de la peine de mort elle-même.
Près de cinquante ans plus tard, cette peur demeure le moteur de notre politique pénale.
Depuis vingt ans, la politique pénale française s'est considérablement durcie.
Les périodes de sûreté se sont allongées, les aménagements de peine sont devenus exceptionnels, et la logique du risque a supplanté celle de la faute. On ne punit plus uniquement un crime, on neutralise un danger potentiel.
Ce glissement vers un "droit de la peur" traduit une mutation profonde. La justice se veut protectrice, mais elle devient gestionnaire de risques. En cherchant à garantir la sécurité absolue, elle crée l'irréversible.
Or l'irréversible, en droit comme en philosophie, constitue toujours un échec.
Reconstruire plutôt qu'effacer
D'autres voies existent.
Certains pays européens, comme le Danemark, ont fait des choix différents. Même les détenus condamnés à perpétuité participent à la vie commune de la prison; ils cuisinent, votent, travaillent, décident collectivement.
L'objectif n'est pas d'effacer, mais de reconstruire. La réinsertion n'y est pas un vœu pieux, mais une politique concrète.
Penser un droit "post-éliminatoire", comme le proposent certains juristes français, suppose de repenser la finalité même de la peine.
Si l'État reconnaît la possibilité du changement humain, il ne peut logiquement maintenir une sanction qui nie tout devenir.
Punir n'a de sens que si l'on admet que l'être humain peut évoluer, même après l'irréparable.
La noblesse du droit
Octobre 2025 nous confronte brutalement à la vérité de notre justice; elle doit simultanément écouter le cri des victimes qui exigent la fermeté la plus absolue, et se soumettre à l'impératif de dignité, hérité de Robert Badinter et imposé par le droit européen.
C'est précisément dans cette tension que réside la véritable noblesse du droit, celle qui l'empêche de succomber à la tentation vengeresse.
La perpétuité incompressible met en lumière la contradiction d'un système qui se veut humaniste tout en organisant la disparition progressive de certains de ses membres.
L'abolition de la peine de mort a supprimé le geste, pas la logique.
Garantir un droit à l'espoir, même pour ceux qui ont commis l'irréparable, ne relève pas du laxisme mais de la cohérence morale.
Une société qui refuse toute possibilité de rédemption finit par se condamner elle-même à ne plus croire en l'humain.
C'est peut-être là l'enseignement ultime que nous laisse Robert Badinter; la justice n'est grande que lorsqu'elle demeure capable d'espérer, même face à l'horreur.



