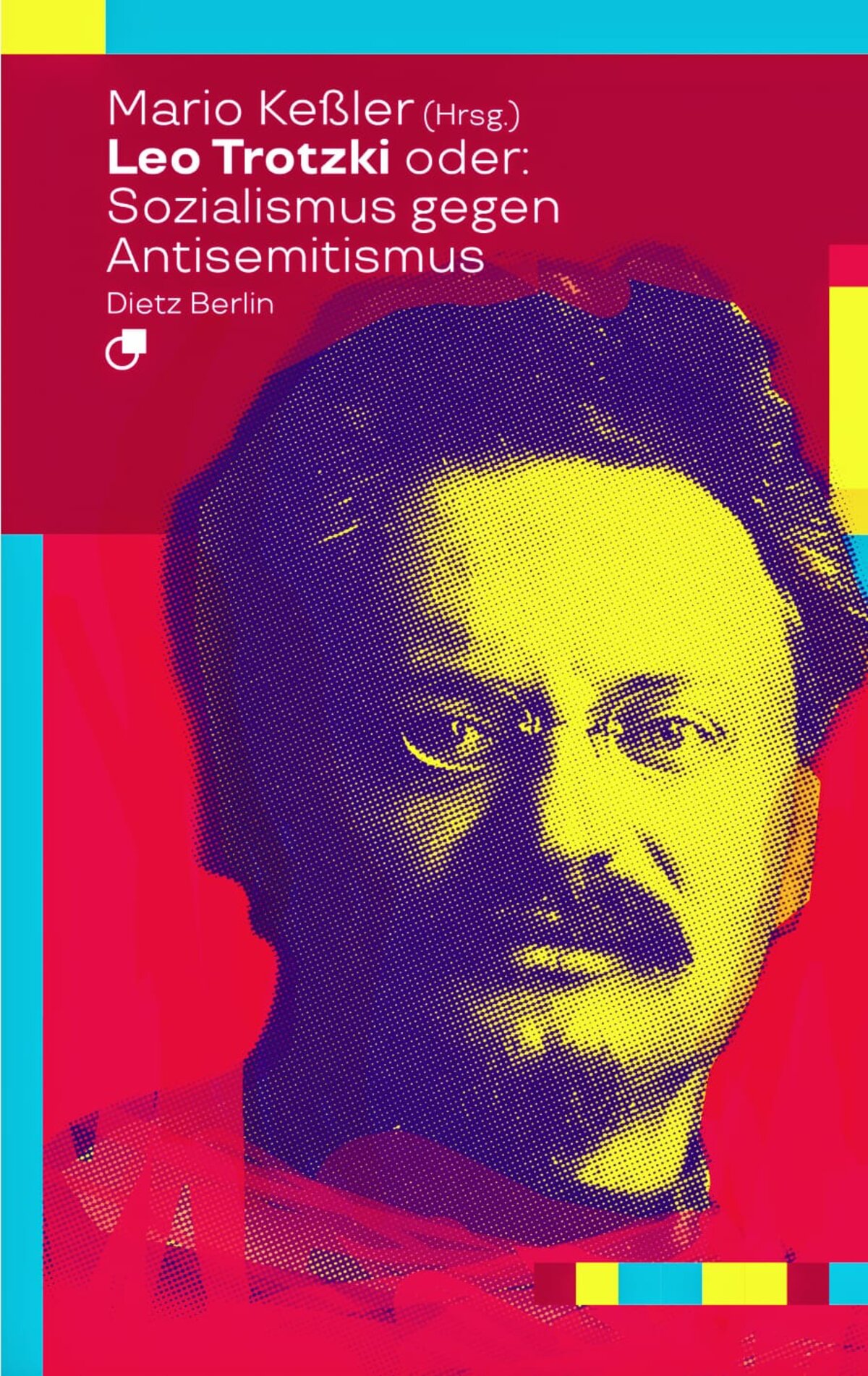
Agrandissement : Illustration 1
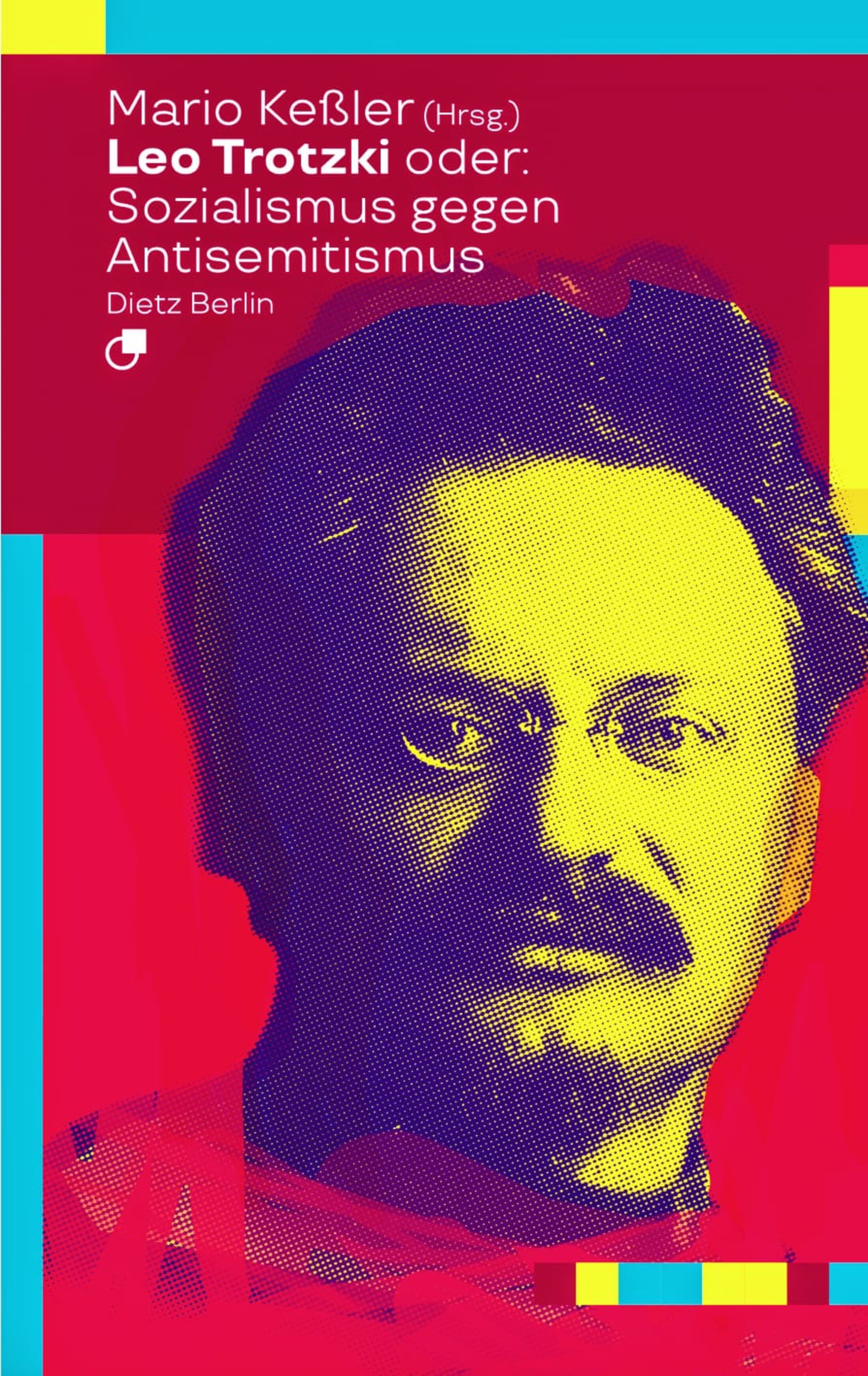
Les racines d'une contradiction
Dès les balbutiements du mouvement socialiste, cette ambivalence est palpable.
Karl Marx lui-même, dans son essai "Sur la question juive" de 1844, proposait une émancipation des Juifs par "l'émancipation de la société du judaïsme”; cette formule, malgré ses intentions révolutionnaires, suggérait une forme d'assimilation où l'identité juive devait disparaître. Bien qu'animée par un idéal d'égalité, cette approche portait en germe une incompréhension profonde de la légitimité des particularismes culturels.

Agrandissement : Illustration 2
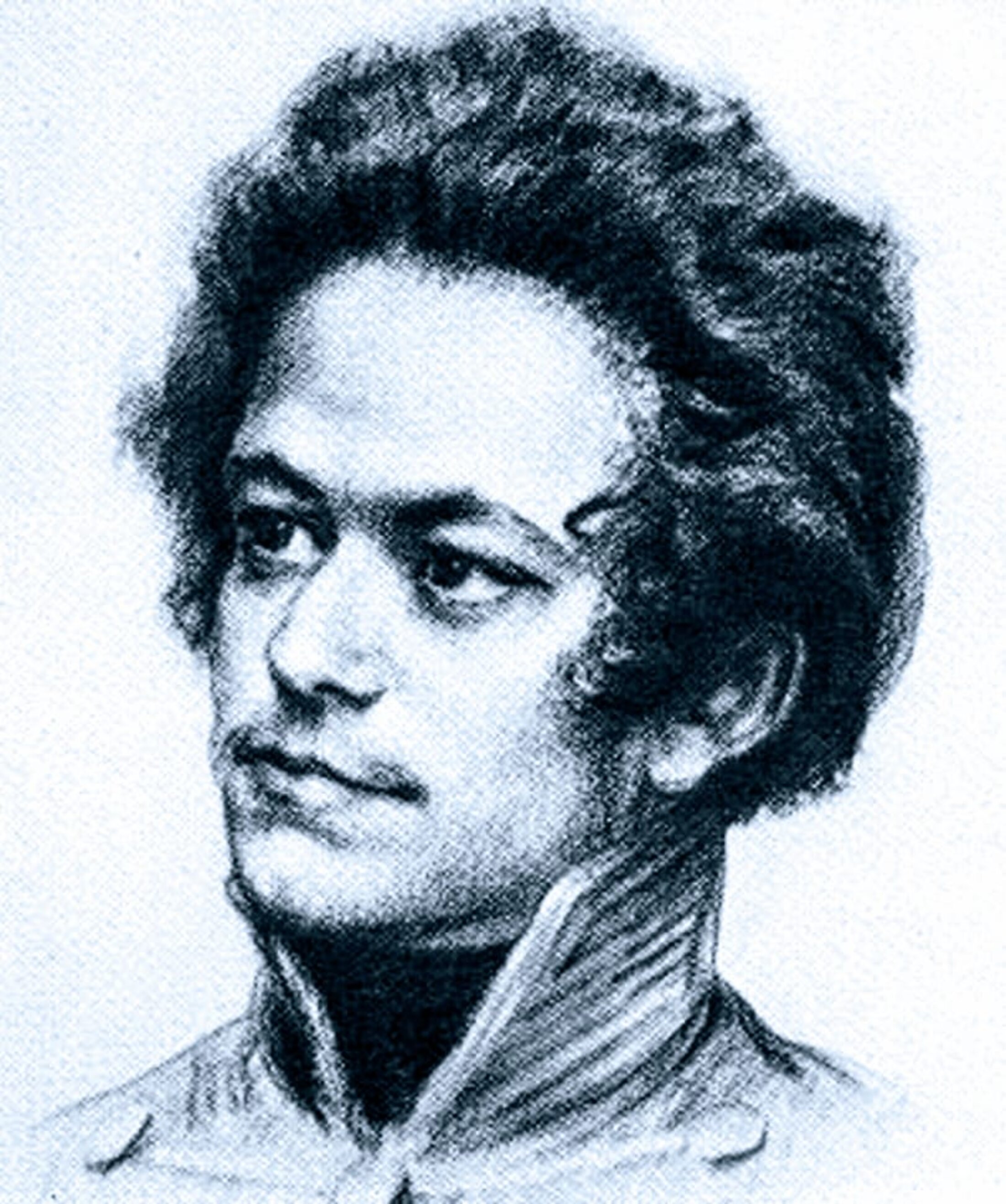
Ironiquement, Marx lui-même fut la cible d'attaques anti-juives, certains de ses détracteurs le dénonçant comme un "juif enflé".
Les anarchistes, notamment Mikhail Bakounine qui qualifiait les marxistes de "bande de petits juifs", ou encore Pierre-Joseph Proudhon qui, en décembre 1847, appelait dans ses carnets à "l'expulsion ou l'extermination" des Juifs, témoignent de la persistance de ces préjugés, notamment dans les premiers mouvements socialistes français.
Paradoxalement, ces mouvements, qui visaient à briser les chaînes de l’oppression, ont parfois reproduit les oppressions qu’ils condamnaient ailleurs.
À l’inverse, Friedrich Engels sut dépasser ces préjugés initiaux pour devenir un fervent défenseur de la lutte contre la judéophobie. Ce virage n’était pas général, mais il montrait que la gauche était capable d’autocritique.
La lutte contre l’anti-judaïsme
Heureusement, une prise de conscience progressive s'opéra. Les militants juifs, dès les années 1840, comprirent que la libération ouvrière et l'émancipation juive étaient "les deux faces d'une même médaille". Cette convergence se nourrissait d'une réalité sociologique : Prolétaires et Juifs appartenaient tous deux aux franges marginalisées de la société.
En Allemagne, les sociaux-démocrates, sous l’influence d’Engels, firent front contre les discours anti-juifs, perturbant les meetings judéophobes et présentant des candidats juifs. Cette évolution témoignait d'une maturation politique remarquable. En Europe de l’Est, la situation était différente, plus violente.
Sous la poigne du tsarisme, les pogroms étaient monnaie courante. C’est dans ce climat que naît le Bund (1897), un mouvement ouvrier juif réclamant l’autonomie culturelle et l’organisation d'une vie juive indépendante dans la diaspora. Contrairement aux sionistes qui rêvaient d'un État, et aux bolcheviks qui espéraient résoudre la "question juive" par la seule révolution, les bundistes proposaient une troisième voie.
L’URSS post-révolutionnaire, un temps, porta cette vision. La révolution d’Octobre garantissait enfin des droits civiques pleins aux Juifs.
Pendant les années tourmentées de la guerre civile russe, une fracture morale traversait les lignes de front; alors que les armées blanches et certains groupes nationalistes ukrainiens se rendaient complices de pogroms, les bolcheviks, eux, adoptèrent une position radicalement opposée. Ils firent front.
Ce choix, car c’en était un, pleinement assumé, ne relevait pas simplement d’un calcul politique. Il puisait dans une vision profondément émancipatrice, presque utopique, où l’éradication des préjugés raciaux devenait une condition sine qua non du monde nouveau à bâtir. Pour ces révolutionnaires, s’attaquer à la judéophobie, c’était défendre rien de moins que l’humanité dans ce qu’elle a de plus digne.
Parmi eux, une figure émerge avec une acuité particulière, celle de Léon Trotsky.
Né Lev Davidovitch Bronstein en 1879 dans une famille juive en Ukraine, Trotsky a grandi dans un environnement culturellement juif mais non religieux. Très tôt, il rejette la religion dans son ensemble, y compris le judaïsme, au profit du marxisme et d'une vision résolument matérialiste et internationaliste du monde. Il se distancie explicitement de toute appartenance religieuse et ne manifeste aucune pratique ou croyance religieuse au cours de sa vie politique.
Cela dit, son origine juive n’a jamais cessé d’être un facteur dans la façon dont ses ennemis, en Russie comme ailleurs, le désignaient. C’est, entre autres, la raison pour laquelle il a pris la défense des Juifs persécutés, non pas en tant que représentant d’une communauté religieuse, mais en tant que révolutionnaire opposé à toutes formes d’oppression.
Il incarna cette conscience lucide et inquiète. Dès 1938, il perçut, avec une précision troublante, l’approche d’un désastre sans précédent. Ses mises en garde, quasi prophétiques, prouvent qu’en plein tumulte, une conscience morale peut non seulement survivre, mais éclairer l’avenir.
L’électrochoc Dreyfus
L'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe siècle, constitua un tournant décisif dans cette évolution des mouvements progressistes. Malgré des hésitations initiales, les socialistes français, menés par Jean Jaurès, comprirent que la judéophobie n'était pas une question secondaire mais bien un pilier de l'ordre réactionnaire. Ils réalisèrent que "l'autoritarisme militaire s'attaquerait d'abord à la classe ouvrière" et que la lutte pour Dreyfus était indissociable de la défense des institutions républicaines.
Cette mobilisation permit non seulement la réhabilitation du capitaine, mais aussi une alliance historique avec les libéraux et une clarification du positionnement antiraciste du socialisme français.
Le drame stalinien
L’expérience soviétique est un cas d’école de dévoiement. Après avoir initialement combattu la judéophobie, reconnu la culture yiddish et considéré les Juifs comme une nationalité à part entière, le stalinisme bascula dans une politique judéophobe déguisée sous couvert de "réaction chauvine russe violente”.
Paradoxalement, Staline adopta d'abord une politique pro-sioniste en 1947, soutenant le partage de la Palestine aux Nations Unies et fournissant des armes à Israël en 1948, faisant de l'URSS le premier État à reconnaître de jure l'État hébreu. Cette stratégie visait à gagner un nouvel allié au Moyen-Orient.
Lorsque Staline comprit que l'existence d'Israël ne servirait pas les intérêts stratégiques soviétiques et que le soutien des Juifs soviétiques à l'État hébreu posait problème, Staline "pivota rapidement vers une politique anti-israélienne" accompagnée de purges internes.
L'affaire des médecins du Kremlin
Entre 1952 et 1953, plusieurs médecins, majoritairement juifs, furent accusés d'avoir prévu d'assassiner des dirigeants soviétiques. Ce prétendu complot, relayé par la presse officielle, servit à déclencher une nouvelle vague de purges anti-juives.
La purge judéophobe prit des formes codées; "cosmopolitisme" en était le mot-clé.
Cette campagne, sous couvert d’anticolonialisme ou d’anti-impérialisme, fut en réalité une chasse aux Juifs. Le Parti communiste palestinien lui-même en fit les frais. Ces purges saignèrent le socialisme de ses penseurs juifs les plus brillants.
L'affaire fut abandonnée peu après la mort de Staline, et les accusés réhabilités.
Le malentendu sioniste
La relation complexe entre la gauche et le sionisme mérite une attention particulière.
Le mouvement sioniste, théorisé par Theodor Herzl dans "L'État juif" (1896), rencontra initialement un "rejet généralisé parmi les socialistes" qui privilégiaient l'intégration juive par l’assimilation. La gauche y voyait une fuite identitaire, une abdication de la lutte de classes.
Les marxistes comme Max Zetterbaum, dans son essai de 1901, «Probleme der jüdisch-proletarischen Bewegung» (Problèmes du mouvement prolétarien juif), percevaient le sionisme comme une réaction de la bourgeoisie juive face à la judéophobie moderne et à la montée du mouvement ouvrier. Plus problématique encore, ils observaient que les sionistes s'alliaient paradoxalement avec des gouvernements judéophobes (Kaiser allemand, Tsar russe) car les pogroms favorisaient l'émigration vers la Palestine, servant ainsi leur projet colonial. Là où les sionistes voyaient un avenir, la gauche y lisait une trahison.
Lénine et Trotsky s'opposèrent sans équivoque au sionisme, convaincus que la "question juive" serait résolue par la révolution socialiste garantissant l'autonomie nationale-culturelle sans État séparé.
À l'inverse, les socialistes réformistes comme Eduard Bernstein devinrent des défenseurs du sionisme, l'alignant sur leur soutien plus large au nationalisme et à l’impérialisme.
Cette division préfigurait les tensions contemporaines autour de la critique d'Israël au sein des mouvements progressistes.
Cette fracture annonçait déjà les débats actuels qui traversent les mouvements progressistes lorsqu’il s’agit de critiquer l'entité sioniste en Palestine occupée. Dans ce climat complexe, il est intéressant, et sans doute nécessaire, de rappeler que la question des alliances passées, qu'elles soient réelles ou simplement perçues, entre le sionisme et des forces conservatrices ou réactionnaires, continue de façonner certaines grilles de lecture politiques.
L’un des exemples les plus controversés demeure la thèse de doctorat de Mahmoud Abbas, aujourd’hui président de l’Autorité palestinienne. Intitulé La relation secrète entre les nazis allemands et les sionistes, ce travail a été soutenu en 1982 à l’Institut d’études orientales de Moscou.
Bien que largement discréditée, tant pour ses conclusions que pour sa rigueur méthodologique, cette thèse illustre une idée persistante dans certains courants antisionistes, celle d’un pacte stratégique entre le sionisme et des idéologies aux antipodes des intérêts juifs, voire ouvertement hostiles, dans le but de servir des desseins politiques particuliers.
Pour Abbas et d’autres penseurs partageant cette vision, il ne s’agissait pas tant de réécrire l’histoire que de déconstruire le mythe du sionisme comme mouvement exclusivement libérateur. Ils voulaient montrer, parfois de manière provocante, que ce dernier aurait pu, à certains moments, exploiter cyniquement des circonstances tragiques, comme l’ascension du nazisme, pour avancer ses projets de colonisation en Palestine.
La gauche face à elle-même
La tragédie nazie a donné une "terrible justification" au sionisme en rendant l'établissement d'un foyer juif une "nécessité indispensable”. L’"extermination organisée industriellement des Juifs" a rendu politiquement intenable tant le concept d'une vie juive organisée selon le modèle du Bund que l'assimilation traditionnelle.
Initialement, la gauche allemande et internationale soutint Israël après 1948. Mais la guerre des Six Jours de 1967 "brisa cette image idéalisée”.
Le SDS ouest-allemand, Union Socialiste des Étudiants Allemands, percevait Israël comme une "puissance impérialiste”.
L’Union soviétique, et notamment la RDA qui se disait débarrassée de tout héritage fasciste, adopta une posture anti-israélienne tranchée, allant jusqu'à refuser la restitution des biens juifs confisqués.
Dans l’imaginaire post-colonial, Israël en est venu à incarner un prolongement de l’Occident dominateur. De là, certaines critiques ont glissé vers une forme d’anti-judaïsme à peine voilée. La dénonciation de la finance mondiale, du "lobby", ou encore d’un prétendu monopole des médias recycle, sous des habits neufs, d’anciens tropes bien connus.
Pour mieux saisir cette dérive, la pensée de Moishe Postone, historien et sociologue canadien, s’avère particulièrement éclairante. Postone avance que l’antisémitisme moderne ne relève pas simplement d’une haine raciale ou religieuse. Il le définit plutôt comme une forme de "fétichisme anticapitaliste".
Selon lui, la judéo-phobie moderne projette sur les Juifs certains traits perçus du capitalisme ( le pouvoir de l’argent, l’abstraction des flux financiers, l’absence d’ancrage territorial ).
En somme, le Juif devient le réceptacle fantasmatique des angoisses générées par le capitalisme, une sorte de figure spectrale sur laquelle on décharge ses frustrations. C’est là, dit-il, une forme de "fausse conscience", qui détourne la critique sociale en la dirigeant vers une cible visible et identifiée, plutôt que vers les rouages systémiques du capital.
De nos jours, on observe une dynamique similaire à travers l’islamophobie. Dans ce cas, l’islamophobie devient, non plus la lutte contre le capitalisme mais celle contre le cléricalisme, autre marqueur du socialisme. Sans reprendre mot pour mot le concept de "fétichisme" dans ce contexte, on pourrait emprunter à August Bebel, figure marquante de la social-démocratie allemande, sa célèbre formule :
« L’islamophobie est le socialisme des imbéciles ».
Cet aphorisme, toujours percutant, rappelle que toute xénophobie, y compris lorsqu’elle se cache derrière des discours se voulant critiques ou “émancipateurs", trahit le combat véritablement progressiste, celui qui s’attaque aux structures d’oppression, non aux minorités.
Construire l’avenir
Face à cette histoire complexe, notre responsabilité est claire.
Nous devons développer une vigilance bienveillante, capable de distinguer la critique légitime des politiques d'un État de la stigmatisation d'un peuple, qu’il soit juif ou musulman.
Cette vigilance suppose une éducation permanente, une capacité d'autocritique et un refus de la facilité.
Il nous faut aussi reconnaître le "dilemme insoluble" que représente l'établissement d'Israël comme État défini ethniquement et basé sur "l'expropriation violente et l'expulsion des Palestiniens", créant une contradiction tragique pour les sionistes socialistes aspirant à une société juste et égalitaire.
L'Internationale trotskyste de 1948 avait prophétiquement averti qu'Israël serait un "piège sanglant" pour les Juifs.
Le modèle du Bund, ce mouvement ouvrier juif d'Europe orientale, offre encore des enseignements; un universalisme qui ne nie pas les identités, mais les intègre dans un projet d’émancipation partagée. Une voie médiane entre l’asservissement identitaire et le repli communautaire.`
Cette approche pourrait inspirer une voie médiane entre l'assimilation forcée et le séparatisme ethnique.
La judéophobie n'est pas une fatalité. Elle peut être combattue, comme l'ont montré les socialistes français de l'époque dreyfusarde ou les bolcheviks dans leur lutte contre les pogroms. Mais cela exige de nous une vigilance constante, une capacité à reconnaître nos propres aveuglements et un engagement sans faille pour la dignité de tous.
Car au final, c'est bien cela l’enjeu; construire un monde où l'émancipation ne se fait pas contre les identités mais avec elles, où la justice sociale ne se nourrit pas de boucs émissaires mais de solidarité véritable. Un monde où l’antisémitisme, sous toutes ses formes, judéophobe et islamophobe, n’a plus sa place.
Ne pas construire l’avenir sur l’oubli ou l’exclusion, mais sur la mémoire et la solidarité.
Cette vigilance nous concerne tous. Elle est le prix de notre humanité commune.



