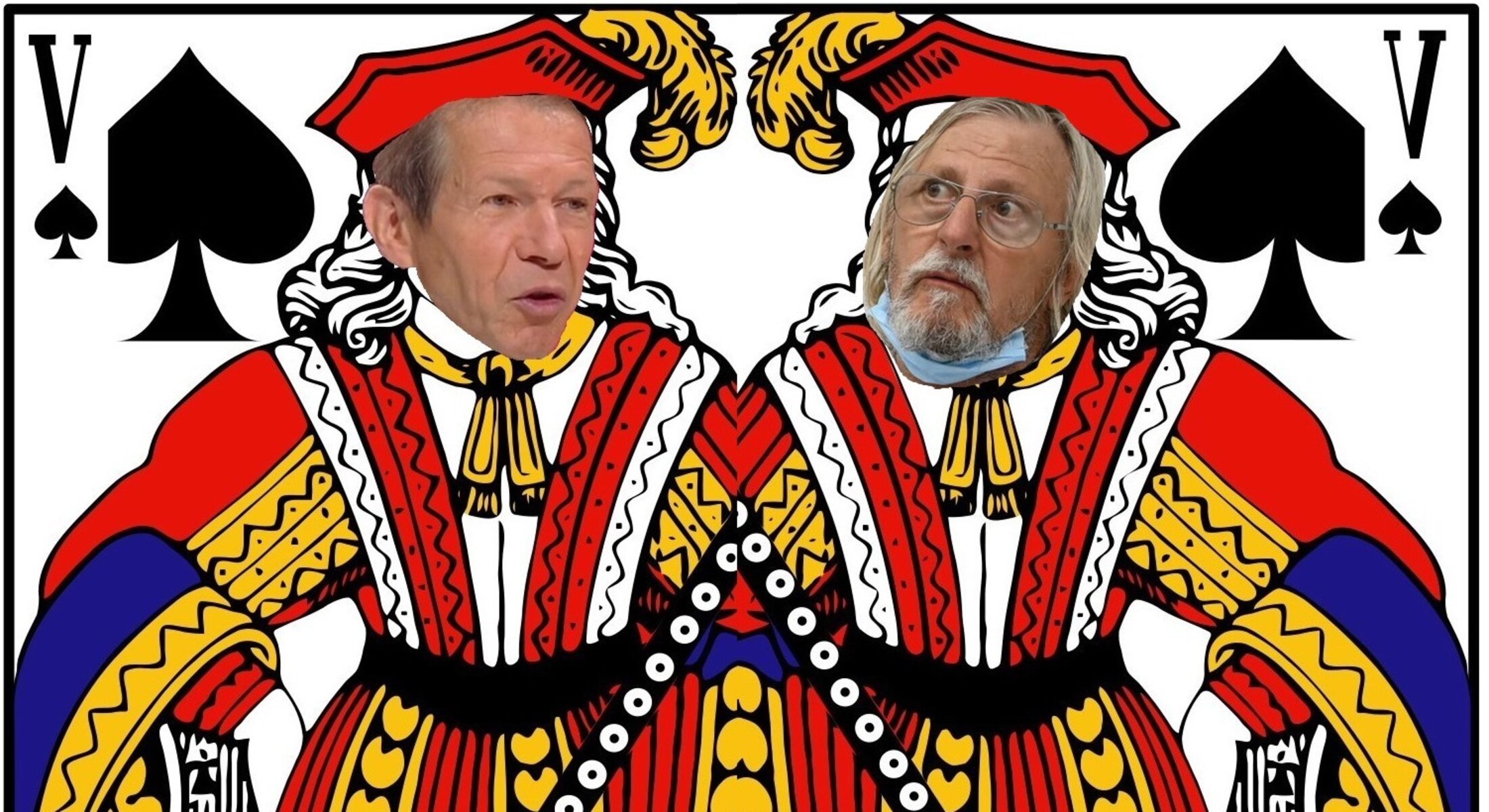Même s’ils travaillent dans deux domaines différents : l’énergie pour l’un, les virus pour l’autre, Jean-Marc Jancovici et Didier Raoult ont plus d’un point en commun et ce n’est pas forcément dans le bon sens.
Le premier serait un côté « gaulois » au parler franc et simple, de nature à convaincre le Français moyen lassé des discours politiques ou technocratiques.
Le deuxième point commun, même s’ils s’en défendent, serait une certaine égocentricité. Ils veulent (ou sont persuadés ?) d’avoir toujours raison, en écartant systématiquement tout ce qui va à l’encontre de leurs certitudes. Des résultats d’expériences ou des constats concrets sur le terrain ne confortent pas leurs affirmations. Ils les contestent, en minimisent l’importance, ou les passent sous silence.
Ainsi, Didier Raoult a commencé par affirmer que la pandémie de Covid-19 provoquerait moins de morts que les accidents de trottinettes.
De son côté, Jean-Marc Jancovici continue de prétendre que Tchernobyl n’aurait fait que 30 victimes, alors que plus de 600.000 liquidateurs ont sacrifié leur vie ou leur avenir pour éviter que la catastrophe ne soit encore plus grave et ne contamine la moitié de l’Europe. Parallèlement, il attaque systématique les vraies énergies renouvelables, en occultant les nombreuses limites ou défaillances du nucléaire.
Le troisième grand point commun des deux hommes est de s’être fait les représentants de commerce d’une solution « miracle » présentée comme indispensable, quitte à travestir les faits et les données pour mieux promouvoir leur produit.
Pour Didier Raoult, cela a été l’hydroxychloroquine, qui était supposée sauver l’humanité du fléau de la pandémie (qu’il avait pourtant initialement déclaré invraisemblable). Cela n’a servi à rien, et même, au contraire, l’hydroxychloroquine a induit des intoxications et des complications de santé chez des personnes ayant suivi les conseils du professeur.
D’après Jean-Marc Jancovici, c’est le nucléaire, qui serait nécessaire pour « sauver le climat ». Pourtant, les données factuelles montrent que le nucléaire n’est pas à la hauteur des enjeux (à peine plus 2% de l’énergie mondiale actuellement), que son potentiel de croissance est très limité (réserves très réduites d’uranium, lenteur de construction, retards récurrents...), sans parler de la gestion des déchets toxiques, des pollutions, des intermittences (vieillissement des centrales, manque d’eau pour le refroidissement...) et des risques de nouveaux accidents graves. Voir notamment le lien ci-dessous :
https://www.terrestres.org/2022/02/16/nucleaire-une-fausse-solution-pour-le-climat/
Quelles différences maintenant entre les deux hommes et leurs activités ? Au moins deux.
D’abord, Didier Raoult se revendiquait comme un « grand chercheur », ce qui a fini par montrer ses limites, mais cela a quand même duré des mois. Jean-Marc Jancovici a de son côté l’astuce de se présenter, avec feinte modestie comme un ingénieur et pas un « scientifique ». Cela le rend plus accessible et lui permet de mieux faire passer son message, notamment au niveau des médias et du public, y compris de jeunes légitimement inquiets face à l’inaction climatique.
Ensuite, l’hydroxychloroquine ne disposait pas d’un puissant lobby derrière elle, de sorte que sa présentation comme « remède miracle » n’a pas duré bien longtemps. A contrario, le nucléaire est adossé à de puissants groupes de pressions et dispose de moyens financiers considérables, qui lui permettent de continuer à faire croire qu’il pourrait « sauver le climat », même s’il n’est au mieux capable d’y contribuer que de manière extrêmement marginale, au prix de coûts et de risques considérables, qui le disqualifient.
Que sortira-t-il de tout ça ?
Comme l’hydroxychloroquine, les gens finiront par se rendre compte que le nucléaire n’est pas une source d’énergie sur laquelle on peut compter. Cependant, la puissance de frappe de son lobby fera sans doute que cela tardera et que des dizaines de milliards d’euros et de dollars seront engloutis avant que les dirigeants mondiaux (dont les Français) n’acceptent de le reconnaître, alors que cet argent aurait pu être utilisé à l’essor de vraies énergies renouvelables.
Alternativement, la prise de conscience de l’aberration d’investir dans le nucléaire sera peut-être accélérée par de nouveaux accidents majeurs, à la Tchernobyl ou à la Fukushima. Si le prochain accident se produit en France, un seul suffira probablement. S’il survient ailleurs dans le monde, il en faudra sans doute deux, car à l’instar des promoteurs du tabac ou de l’amiante, le lobby français du nucléaire ne lâchera pas si facilement.
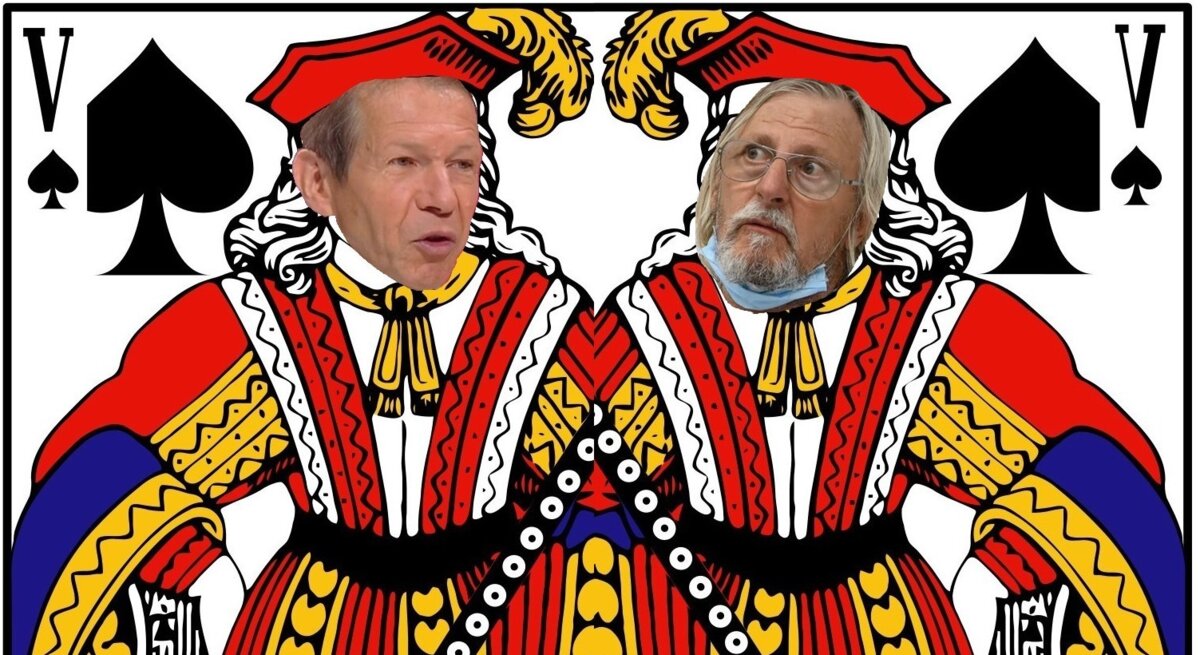
Agrandissement : Illustration 1