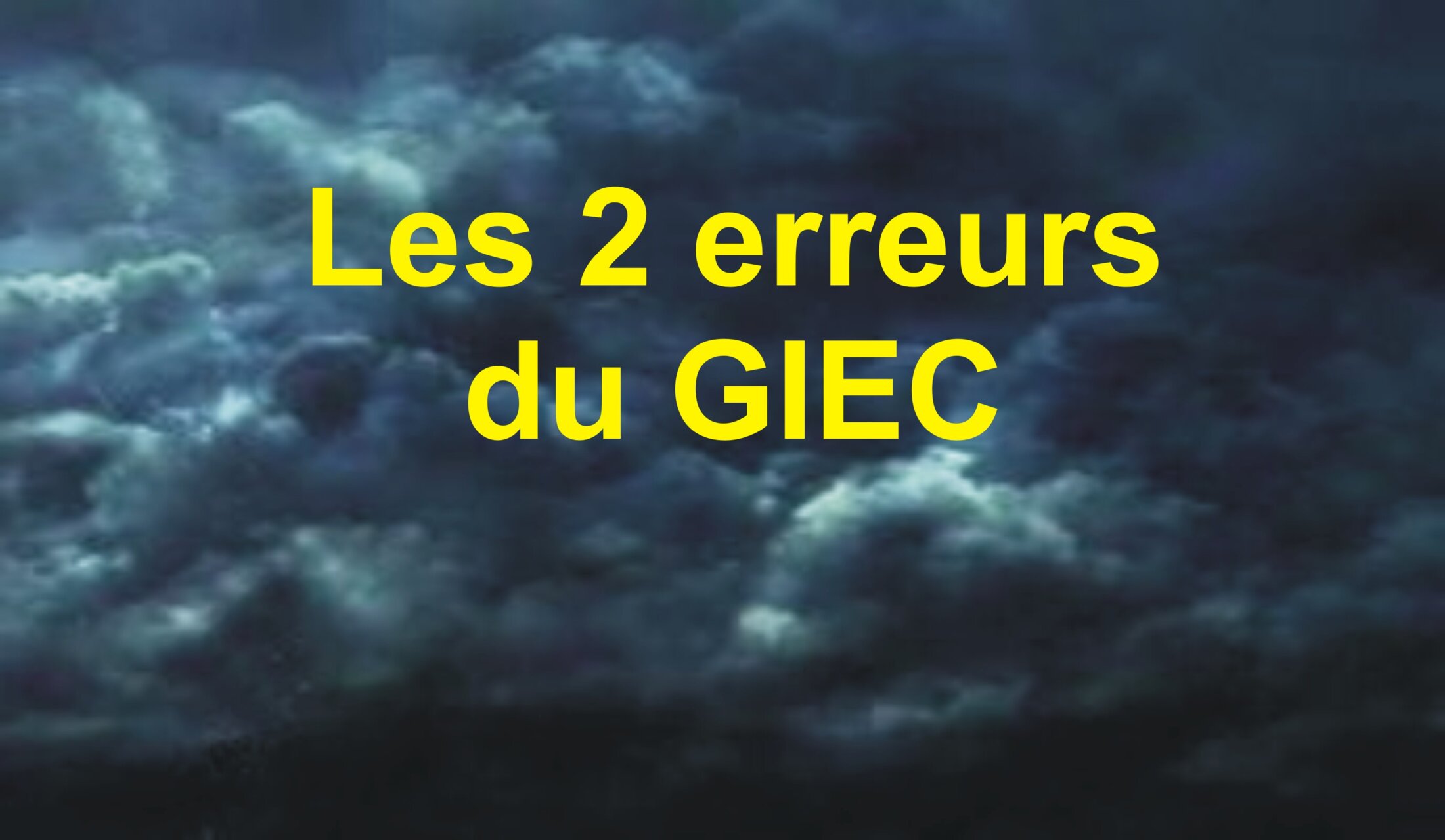En mars 2023, le GIEC vient de produire un document fournissant une vision synthétique d’un avenir climatique particulièrement menacé, avec la perspective qu’il est désormais très improbable que l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris soit respecté, à savoir : ne pas dépasser les +1,5°C par rapport à la température planétaire moyenne à l’ère préindustrielle.
Certains qualifient encore le GIEC de « catastrophiste », mais c’est un double faux sens.
Ce n’est pas être « catastrophiste » que d’annoncer des catastrophes de moins en moins évitables. Par ailleurs, les faits montrent que depuis sa création il y a 35 ans, le GIEC a plutôt eu tendance à sous-estimer les problèmes. Plus exactement, les problèmes se révèlent plus graves que ce qui avait été envisagé initialement, que ce soit la fonte des glaciers, la montée du niveau des mers, l’impact sur la biodiversité… Et il est probable que le GIEC sous-estime encore ce qui va advenir.
Cette sous-estimation n’est pas de la faute des chercheurs et chercheuses travaillant dans le cadre du GIEC, dont l’éthique scientifique a toujours été confirmée, y compris face à de nombreuses tentatives de dénigrement ou de déstabilisation. Cette sous-estimation est liée au fonctionnement même du GIEC, qui doit soumettre ses rapports au crible de tous les États de la planète. Et nombre d’entre eux s’efforcent au maximum de faire disparaître ou de minimiser ce qui pourrait nuire à leur économie.
Cette sous-estimation n’est donc pas vraiment une « erreur ».
En revanche, on trouve deux erreurs fondamentales dans les rapports du GIEC : sur le « développement » et sur la supposée plus grande vulnérabilité des pays du Sud au changement climatique.
La première erreur est liée à la constitution même du GIEC, puisque ce groupe est placé sous la tutelle de deux structures de l’ONU : l’OMM (Organisation météorologique mondiale) et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement). Même si l’on sait depuis longtemps que seul un fou ou un économiste peut croire à une croissance infinie dans un monde fini, l’ONU continue de s’accrocher à l’obsession du « développement », et donc d'une croissance infinie (en les qualifiant faussement de « durables »). Tant que le GIEC se contentera de très modestes appels à « un peu de sobriété » et ne sera pas capable de remettre fondamentalement en cause les injections à la croissance économique et au « développement », il alimentera la machine qui emballe le climat.
Plus subtile et plus ambiguë est la deuxième erreur.
Le GIEC, à la suite de beaucoup de supposés « experts », déclare régulièrement que les pays du Sud (qui ont moins contribué que ceux du Nord au réchauffement), en seront les principales victimes. Or c’est faux.
Certes, les pays du Sud vont subir de plein fouet les effets du réchauffement, mais pas forcément moins que ceux du Nord. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à voir par exemple, les incendies, les inondations ou les sécheresses des dernières années en Europe, en Amérique, ou en Australie. Et cela va s’aggraver. Certains prétendent que la technologie aidera les pays du Nord à mieux s’adapter, mais vu l’ampleur des phénomènes, c’est illusoire. Paradoxalement, dans bien des cas, la technodépendance pourrait même rendre les populations du Nord plus vulnérables que celles du Sud, ces dernières étant habituées à des modes de vie plus sobres et plus rustiques.
Mais d’où vient cette deuxième erreur du GIEC ?
En fait, le GIEC (qui se contente de compiler les publications scientifiques) ne fait que reprendre des travaux d’économistes du Nord, qui prennent pour « postulat » que plus le PIB est important, moins les pays seraient vulnérables. Et ces économistes tirent des cartes fondées sur ce postulat, qui ne font que reproduire l’idée initiale erronée.
Cette deuxième erreur est doublement grave.
D’abord, elle véhicule une idée fausse, ce qui est scientifiquement critiquable.
Mais elle est de surcroît paradoxalement contre-productive. En effet, par-delà les discours politiquement corrects ou se présentant comme altruistes, si les populations du Nord ne se sentent pas directement concernées par les menaces (et elles devraient), elles ne feront pas d’efforts, et ne demanderont pas à leurs gouvernements d’agir avec l’énergie et la détermination nécessaires. Ce ne sera que quand les populations du Nord comprendront qu’elles et leurs enfants sont directement menacés au plus haut point, qu’elles exigeront vraiment des actions pour respecter au plus vite l’Accord de Paris.
Tant que le GIEC n’aura pas corrigé ces deux erreurs, il ne sera pas possible de freiner les crises climatiques et plus largement environnementales.
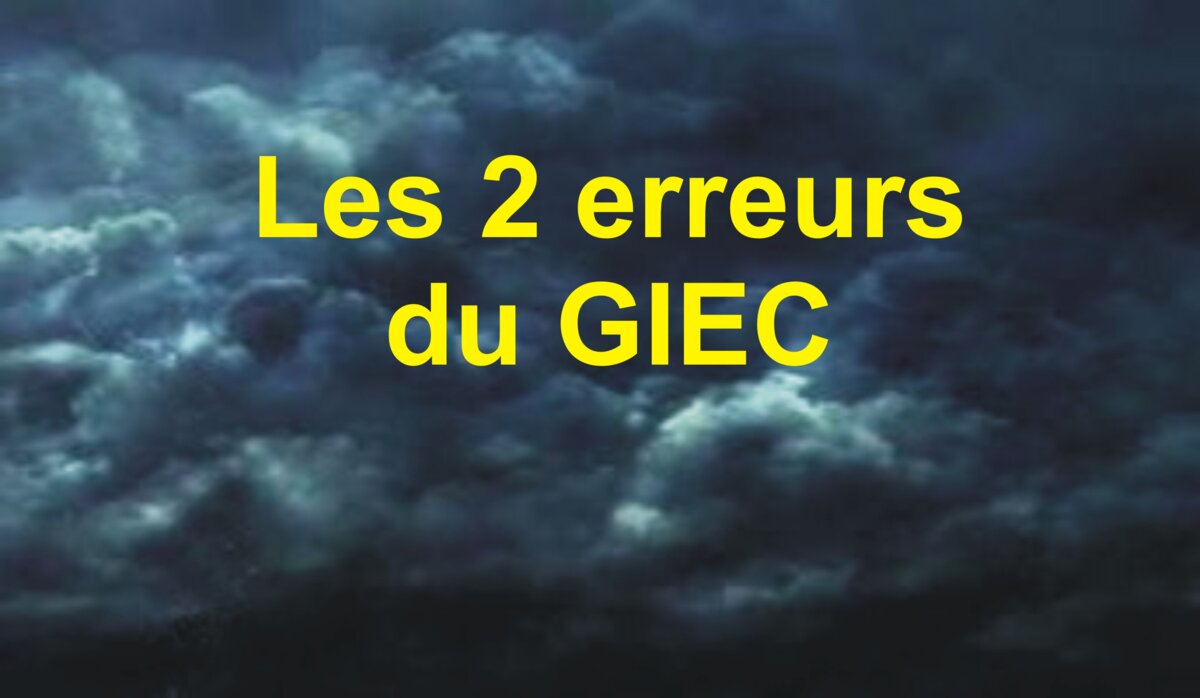
Agrandissement : Illustration 1