Aurélien Berlan constate que nous sommes pris dans une multitude de crises, économique, sociale, écologique : "la crise est devenue notre quotidien". Est-ce dû au fait que l'époque bourgeoise est caractérisée par son instabilité (Marx) ? Parce que l'État moderne, bureaucrate, édicte sans cesse des normes ? En tout cas, alors que le progrès technologique gagne régulièrement du terrain, la foi dans le progrès, chez les citoyens confrontés à ces crises, s'effrite.
L'appel aux "pères fondateurs de la sociologie allemande", qui écrivent au moment de l'apparition de la Révolution industrielle, "acte de naissance de notre monde", a pour but de nous éclairer sur notre réalité présente : Ferdinand Tönnies, Georg Simmel et Max Weber tordent le cou à bien des idées reçues.
La première est celle de la "perte du lien social" : ainsi on s'épanche sur les SDF qui seraient en état de "désaffiliation" (perte de tous les liens : travail, amis, famille). A cela, l'injonction politique est qu'il faut réagir : "produisez du lien social" afin d'aider les individus à recouvrer leur nature d'êtres sociables. On s'est, à une époque, complu dans le diagnostic d'une "crise du lien social". A contrario, Berlan rappelle que "la sociologie nous dit que le lien social ne se perd pas". En fait, il prend des formes nouvelles : affaiblissement, certes, des liens familiaux, locaux et de voisinage, mais développement d'autres liens, plus larges. Tout en créant de nouvelles interdépendances.

Tönnies, mort en 1936, homme de gauche, dit que ce que l'on appelle "perte de lien social" c'est en réalité "le renforcement de la société". Il constatait bien sûr, il y a presqu'un siècle, que les liens communautaires se désagrégeaient, que les formes de solidarité s'effondraient. Berlan nous dit que le philosophe allemand voyait bien dans le développement de la misère prolétarienne la preuve que la solidarité était mise à mal "sous la pression du capital et de l'État". L'homme moderne est un "homme abstrait", "coupé de toute communauté" et "condamné à maximiser ses intérêts privés parce qu'il n'a plus de monde communà défendre". Il récusait, et Berlan avec lui, l'idée d'une "montée de l'individualisme" : ce sont les rapports sociaux (la propriété privée et les échanges marchands) qui déterminent le rapport de l'individu à la société.
Simmel, dont l'ouvrage majeur est Philosophie de l'argent, constate lui que la monnaie a instillé le calcul dans tous les pores de nos sociétés modernes. Et si l'argent a "libéré" l'individu, il l'a coupé de tout (des choses dont il n'en perçoit plus les qualités intrinsèques, de ses semblables qui ne sont plus que des prestataires de services). La sacralisation de la marchandise, en réifiant les relations humaines, a paradoxalement apporté à l'homme la liberté pour la lui retirer aussitôt : car la déshumanisation des relations sociales ne peut garantir la liberté. Il expliquait ainsi (déjà) que notre époque "possède certainement plus de liberté qu'aucune autre" tout en étant "si peu heureuse de cette liberté-là".
Enfin, Max Weber décrit un nouveau type d'enfermement (il parle d'une "cage d'acier"). Berlan écrit, pour illustrer dans nos temps actuels ce que nous enseigne Weber : "le flux ininterrompu des informations (…) laisse de moins en moins de temps pour penser par soi-même, laisser vagabonder ses idées, imaginer d'autres manières de vivre. Un bruit de fond permanent nous martèle qu'il n'y a pas d'autres mondes possibles, que c'est folie d'en rêver". Et de rappeler le TINA de Margaret Thatcher (acronyme en anglais de "il n'y a pas d'alternatives", tellement en vogue dans le discours des "experts").
Ce que se propose de faire Weber c'est un "diagnostic", une science sociale de la réalité, actuelle, objective et empirique. Il tient à distance tout à la fois le militant qui déforme la réalité et le savant qui masque ses choix en prétendant "laisser parler les faits". Ce qui nous parle, là encore, car cela fait écho au discours dominant qui assène son idéologie cachée par l'invocation d'un pragmatisme de bon aloi. Berlan écrit que cette "science de la réalité" n'a pas "grand-chose à voir avec le positivisme larvé de la sociologie actuelle, qui se fait fort de ne pas porter de jugement alors qu'elle ne fait que camoufler ses jugements conformistes dans une analyse qui ne semble neutre que parce que les jugements impliqués y sont conformistes".
Bien d'autres sujets mériteraient d'être développé comme la défense par Weber de l'"homme cultivé", ou ses propos sur le "savoir spécialisé" ou le "spécialiste sans esprit". Et aussi ce qu'il dit de la bureaucratie dont le capitalisme sait si bien se servir (1) et sa prémonition sur le "socialisme d'État" qui ne ferait que "parachever l'œuvre du capital".
Après cette plongée dans la pensée de ces grands penseurs, Aurélien Berlan propose "à ceux qui sont convaincus que la dynamique capitaliste mène l'humanité au bord du gouffre (sur tous les plans : social, politique, écologique, etc.)" "de se débarrasser des vielles lunes socialistes estimant qu'il serait possible de se réapproprier, dans un sens égalitaire et fraternel, les moyens de production industriels". Car "ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité ne sont compatibles avec un monde qui suppose gestion centralisée, hiérarchie et impersonnalité". Et de livrer un véritable programme : "Tenter de nous libérer, à chaque fois qu'on peut de ces liens impersonnels passant par l'argent et le salariat, multiplier et enrichir les autres en faisant des choses nous-mêmes au lieu de les déléguer aux organisations : la voie est semée d'embûches, mais elle a le mérite de ne pas nourrir le capital".
Lors de sa venue à Auch, Aurélien Berlan apporte de nombreux éclaircissements sur son ouvrage. Il développe des idées autour de la notion de liberté : qui ne repose pas sur l'absence de liens, mais sur la nature de ces liens. Et les pouvoirs jouent sur cette ambigüité. Laisser croire qu'on est libre parce qu'on est seul : "only and free". En effet, comme le précise Yanis Lebrun, professeur de philosophie, chargé de présenter l'ouvrage de Berlan à cette journée auscitaine, pour que l'"organisation" obtienne de lui ce qu'elle veut, "il faut que l'individu se pense libre".
Et Aurélien Berlan poursuit que si, jadis, les gens avaient "intérêt" à être solidaires, aujourd'hui, dans un monde hyper-organisé et hyper-surveillé, le lien social se perd, il n'y a plus vraiment besoin d'entrer en relation avec les autres. Pourtant, un nouveau "lien", artificiel, se crée, avec connexion avec des millions d'individus. D'où son appel évoqué plus haut à retrouver une liberté dégagée de ces relations deshumanisées et à produire du "commun". C'est bien à cela que l'on assiste, partout en France, à des actions de terrain, concrètes, qui répondent à cette aspiration, dans des coins les plus éloignés, les plus reculés, loin de l'agitation générale qui les ignore.
_____
(1) Ce qui fait penser à ce que dit Sylvain Laurens dans Les courtiers du capitalisme, ces lobbys libéraux à Bruxelles qui prolifèrent en phagocytant la bureaucratie de la commission européenne. Voir mon billet sur cet ouvrage : ici.
_____
Aurélien Berlan va un peu vite en besogne quand il écrit que la question du lien social n'intéresserait pas les sociologues d'aujourd'hui. Par ailleurs, sur la question du lien social qui, finalement, jamais ne disparaît réellement dans une société, mais se recompose autrement, lire Ce qui nous relie, coordonné par André Micoud et Michel Pironi, éd. de l'Aube, 2000.
. La fabrique des derniers hommes, Retour sur le présent avec Tönnies, Simmel et Weber, La Découverte, 2012. Aurélien Berlan est agrégé et docteur en philosophie, chargé de cours à l'Université Jean-Jaurès de Toulouse.
Débat entre Miguel Abensour et Aurélien Berlan :
Miguel Abensour rappelle tout d'abord que l'utopie n'a rien à voir avec le totalitarisme. "C'est une société sans utopie qui est totalitaire". Il en veut pour preuve la dictature stalinienne qui avait dans le collimateur toutes les idées utopistes de la Révolution de 1917 : conseils ouvriers, égalité homme-femme. Et de citer les grands utopistes : Ernst Bloch, Martin Buber, Levinas, Walter Benjamin…

Agrandissement : Illustration 2

À ce rêve d'utopie qu'exprime Abensour, Berlan oppose le monde contemporain, de non-lieu (" utopie"), tout à la fois manquant d'ancrage dans la terre, et de sens des réalités. Occasion pour Berlan de faire ce rappel : Dieu a puni les hommes en leur imposant la malédiction du travail, de la souffrance, de la mort et, last but not least, de devoir s'organiser avec les autres. Auparavant, le Paradis c'était tout le contraire, et il n'y avait aucune obligation à devoir s'entendre avec les autres. Autre façon, me semble-t-il, de convoquer Sartre et de nous dire que "la fin du Paradis, c'est les autres" !
Le monde moderne cherche à retrouver cet Eden-là : le transhumanisme c'est se débarrasser du travail, de la souffrance, de la mort, "la mort de la mort". Il voit dans le Net, cette "mauvaise utopie" : on n'a plus de corps, la réalité devient abstraite. Le "vertige des possibles".
Abensour, quant à lui, insiste sur son utopie, celle qu'envisageait Marx et qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le capitalisme d'État. Il cite le mot d'Adorno constatant que Marx était opposé à l'utopie… justement dans le but de sa réalisation. Le grand philosophe rend hommage au travail du jeune thésard, et en profite pour ironiser sur la bureaucratie universitaire qui classifie arbitrairement : sociologie, sciences politiques, philosophie… Les penseurs qu'étudie Berlan sont, tout à la fois, capables d'allier plusieurs savoirs, pour tenter de répondre à la question : "dans quel monde vivons-nous ?".
Miguel Abensour :
Né en 1939, il est un philosophe subversif, comme l'écrit Mickaël Löwy dans la revue Raisons politiques : "un des penseurs les plus importants" en France aujourd'hui. Dans L'Utopie , de Thomas More à Walter Benjamin (2000), il prend la défense de cette mal-aimée qu'est l'utopie, indispensable dans les sociétés modernes. Dans La communauté politique des "tous uns" (Les Belles lettres, 2014), entretiens avec Michel Enaudeau, il tente de dire son espoir dans une société meilleure et juste (utopique) qui éviterait la catastrophe, lui qui fut, enfant, juif réfugié dans le Sud de la France.
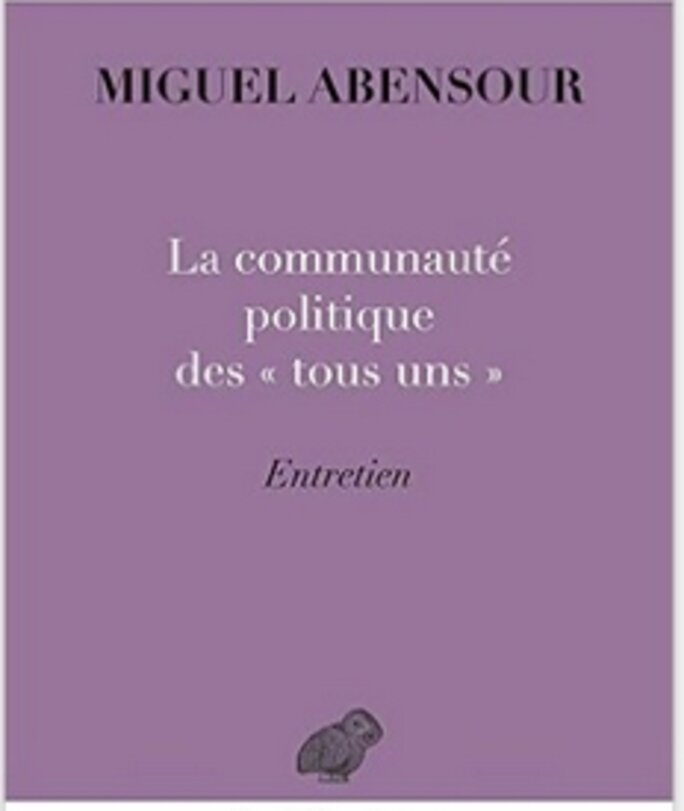
Lors de sa venue à Auch, Miguel Abensour s'explique sur ce "tous uns" : une pluralité constituée de tous les individus, dont la personnalité n'est pas écrasée. L'envers du "tous un", où l'un, le monarque, règne au nom de tous. Et de lister les oppositions : contre ou pour l'État ; l'amitié et non pas l'amour (qui est fusionnel et renvoie au "tous un"). La Boétie a montré que les dominés contribuent à leur domination ("ils se coupent eux-mêmes la gorge", écrit-il dans La servitude volontaire). Lefort a parlé de la "démocratie sauvage", Abensour de la "démocratie insurgente". Et de nous lâcher tout de go, lui le philosophe politique : "La Vème République n'a absolument rien d'une démocratie, c'est une oligarchie". René Capitant, quand il co-élabore la Constitution, s'inspire… de Carl Schmitt, juriste allemand, défenseur non pas de la démocratie, mais d'un régime autoritaire.
. La communauté politique des "tous uns", Miguel Abensour, avec la contribution de Michel Enaudeau, Les belles lettres, 2014.
______
. Montaigne voulait intégrer dans Les Essais le texte de La Boétie sur la servitude volontaire mais il ne put le faire de crainte d'être assimilé aux Huguenots puisque ces derniers avaient publié la démonstration de son meilleur ami sous le titre Le Contr'Un.
. Hannah Arendt considère que nous sommes pluriels ontologiquement : ce sont les êtres humains qui ont le pouvoir, la puissance, entre eux (sans domination) et non les uns sur les autres. Elle considérait, ce qui peut être contesté estime Abensour, que l'on est toujours dans le temps du "social" et non celui de la "politique", qui serait le pouvoir de tous.

Agrandissement : Illustration 4

Les Petits Papiers :
La librairie Les Petits Papiers, à Auch (Gers), avec Pascal Pradon et Marielle Dy, le samedi 23 janvier, ont organisé une demi-journée de réflexion et d'échanges avec Miguel Abensour et Aurélien Berlan : 60 à 70 personnes y ont assisté, non-stop, de 14 h à 19 h.
Billet n° 251
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr
Tweeter : @YvesFaucoup
[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]



