
Agrandissement : Illustration 1

L’organisation patronale de la FNSEA et la Coordination rurale, adoubée par l’extrême droite, ont gagné une bataille leur permettant de mettre sous perfusion (de pesticides) leur modèle agro-industriel tourné vers l’exportation, cheval de bataille gouvernemental, tout en criant au loup concernant la « souveraineté alimentaire ». On est bien loin d’un plan désintéressé au secours des petits agriculteurs en détresse ou d’un nouveau Resto du cœur avec alimentation saine destiné aux populations défavorisées. Si leur modèle est voué à sombrer, après sans doute d’autres convulsions, cet effondrement progressif ne sera pas sans continuer à provoquer d’énormes dégâts, dont certains irréversibles.
Face à ce désastre, partout en France et ailleurs, existent des îlots, voire des îles de résistance, des paysans qui vivent de leur métier en harmonie avec leur environnement, des chercheurs qui expérimentent de nouvelles pratiques en rupture avec l’agrochimie, des Géo Trouvetou qui inventent les nouveaux outils de l’agroécologie, des militants qui renouent les liens sociaux et locaux entre ceux qui produisent sain et les populations à portée d’une poignée de main. Ils sont le ferment révolutionnaire d’une nouvelle agriculture qu’il nous faut étendre, sans doute au prix de combats âpres comme ceux des Soulèvements de la terre.
Mais rappelons en préambule quelques réalités : le métier de paysan nourricier n’a rien à voir avec l’idéal de la petite maison dans la prairie, le rêve d’une arche de Noé revue par Disney ou un camp de vacances de scouts. Confrontés à la volonté de trouver des repreneurs pour notre ferme (élevage, transformation et vente directe), nous avons été consternés de voir passer de nombreux candidats ayant une idée fantasmée du travail et de la vie à la ferme et même de la vie rurale en général, et qui sont retombés sur le plancher des vaches après avoir mis les mains dans le fumier ou courbé le dos sur des terres ingrates. Le fantasme venait de se crasher sur la réalité.
La vocation, car c’en est une, vous promet de la sueur, des angoisses face aux échéances, des doutes, des périodes de déprime et de découragement face aux formulaires abscons, des grosses fatigues, des accidents de météo et de la vie. Entre tous ces obstacles, il y aura des moments de grâce : des naissances toujours miraculeuses, un lait qui se mue en caillé onctueux, des céréales généreuses ondulant sous la brise, un·e gourmand·e qui vous revient avec un large sourire sur le marché, un instant de flânerie dans une prairie fleurie, les bêtes paissant paisiblement à côté de vous, etc. C’est une vocation car cela n’a rien d’une besogne d’exécution, 35 heures par semaine, voire d’une tâche artisanale, aussi intense soit la passion pour une matière ou une œuvre parfaitement exécutée. Le paysan, enraciné dans son terroir, ne peut que vivre son métier, c’est-à-dire en acceptant de n’être qu’un élément facilitateur mais créatif, coopérateur dans un ensemble d’éléments vivants et/ou naturels, de liens et d’interactions complexes qui peuvent s’enrichir mutuellement, tout comme se perturber, du cheptel aux plantations et au biotope et éléments climatiques. Un ouvrier, un ingénieur, un artisan pourra toujours éteindre la machine ou l’ordinateur après sa journée de travail. Un paysan reste paysan 24 heures sur 24. Un exploitant de ferme industrielle ne peut accéder à une telle connexion. Posséderdes centaines de bêtes, d’autant plus si elles sont hors-sol, se reposer sur des robots et des ordinateurs ne peut remplacer le contact direct avec les animaux, la terre, contact permettant de former tous ses sens et de repérerune anomalie autantqu’une opportunité.
Le terme de paysan inscrit sur les pancartes revendicatives des membres de la FNSEA ou des Jeunes agriculteurs, est majoritairement usurpé. Durant les décennies de colonisation du paysage agricole français par l’agro-industrie, cette même FNSEA a préféré lui substituer l’étiquette d’exploitant agricole, rétrogradant le paysan au rang d’arriérés refusant la modernité du machinisme, des pesticides et… des dettes. Et que n’ont pas entendu ceux qui s’étaient convertis au bio dès les années 1960-1970. S’arroger aujourd’hui le terme de « paysan » relève du ripolinage marketing visant à enfumer des Français demandeurs d’une nourriture plus saine et locale.
La grande distribution use des mêmes ficelles en affichant la trombine de quelques producteurs locaux dont les produits ne font pas le poids dans les kilomètres de linéaires dédiés à l’industrie agro-alimentaire. Lorsqu’elle crée des gammes en lien direct avec des fermes de leur territoire, les mauvaises habitudes reprennent vite le dessus, comme l’a montré la récente grogne des 230 éleveurs laitiers de la gamme « Merci » d’Intermarché : « À l'origine, c’était un produit co-construit, mais là, ils étaient en complète déconnexion avec le terrain et nous imposaient un prix, raconte leur représentante, Elodie Ricordel qui ne dit pas « Merci » à la centrale d’achat. Ce n’est pas toujours simple avec la grande distribution.[…] [Ils] s’associent dans des centrales d’achats, les industriels essayent de nous diviser… Il faut que les producteurs se regroupent aussi pour être plus forts. Il faut que l’on reprenne notre destin en main ! »1
L’exploiteur n’est pas celui qu’on croit

Agrandissement : Illustration 2

Les agricultures en crise sont celles qui ont mis les doigts dans l’engrenage industrie agroalimentaire-grande distribution-subventions publiques, qui se sont laissé broyer par cette machine à aspirer la valeur ajoutée sur le dos des agriculteurs, tout en régurgitant pour les consommateurs des produits ultra-transformés, véritable catastrophe sanitaire et écologique. Ils dictent leurs prix et leurs standards, tandis que le pouvoir administratif impose ses règles hors-sol, kafkaïennes et exige son tribut de formulaires, dématérialisés ou pas. L’alimentation ultra-transformée (AUT) et son rouleau compresseur publicitaire conditionnent aujourd’hui, avec la complicité active de la FNSEA, le modèle agricole, comme le notent deux chercheurs de l’Inrae.2 Ce segment de milieu de chaîne alimentaire joue un rôle primordial, expliquent-ils, puisqu’il est donneur d’ordre pour la production, notamment à travers ses chaînes intégrées, et prescripteur omniprésent de modes et de goûts chez les consommateurs, avec dans les deux cas des forces de frappes, publicitaires, financières et de lobbying, très importantes. « Ce sont bien eux qui jouent un rôle majeur sur la durabilité des systèmes alimentaires et la plupart des agriculteurs comme des consommateurs ne font que s’adapter à ces acteurs du milieu de la chaîne qui ont coopté une grande partie de la valeur », expliquent les chercheurs. Et de rappeler que « près de 200 études épidémiologiques (dont près de 80 études de cohorte longitudinale) convergent dans le même sens : une consommation excessive d’AUT est associée à des risques significativement accrus de dérégulations métaboliques, maladies chroniques et/ou mortalité précoce toutes causes confondues. »
Le résultat de cette domination de l’agro-alimentaire est une perte totale d’indépendance des agriculteurs, une ubérisation du métier au service d’intérêts supérieurs et trop souvent une plongée dans l’endettement, la misère et le désespoir. Une ubérisation qui atteint son paroxysme lorsqu’on parle de « filière intégrée », où l’industriel fournit animaux, aliments standardisés et produits vétérinaires ou phytosanitaires au prix fort, tout en imposant son tarif d’achat du produit fini, le plus bas possible, « intégrant » ainsi des profits maximums, alors que l’éleveur doit supporter les investissements et les risque inhérents. L’exploiteur n’est plus celui qu’on croit.
L’exploitant agricole a abandonné les liens du paysan à la terre et au vivant dans un processus mécanisé dans la lignée du fordisme. Il a également perdu le rapport social entre l’agriculteur qui nourrit et ceux qu’il nourrit. Cet effacement s’est fait aux dépens de ces deux groupes sociaux et au profit d’un écheveau d’intermédiaires, d’actionnaires, de financiers qui s’octroient d’autorité la valeur ajoutée, telles des sangsues. Le paysan ou la paysanne doit donc reconquérir cette indépendance tout en tissant des chaînes de solidarité et des liens sociaux de la fourche à l’assiette, pour paraphraser un slogan européen par ailleursvidé de son contenu.
Une réforme agraire indispensable

Agrandissement : Illustration 3

Cela doit d’abord passer par une réforme agraire, ce qui, ne nous le cachons pas, serait révolutionnaire. La Safer et les commissions départementales d’orientation agricoles (CDOA)3 doivent se remettre au service public d’installations utiles au territoire dans lequel elles sont implantées, non pas au service privé de propriétaires terriens de la FNSEA qui, par tous les moyens de contournement des règles, cherchent à s’agrandir. Elles sont censées contrôler ces agrandissements, mais restent sous influence du syndicat ultra majoritaire dans toutes les instances agricoles puisqu’elles se réfèrent à une politique agricole décidée en co-gestion entre le syndicat et les préfectures, entre les présidents de FNSEA et les ministres de l’Agriculture. Les quelques règles législatives mises en place sont contournées par les sociétés d’exploitation agricole et des systèmes de cessions de parts sociales ou d’action permettant à ces sociétés et des fonds financiers de s’agrandir au détriment de l’installation de jeunes. La propriété reste l’arme la plus redoutable d’emprise du capitalisme au détriment de l’intérêt général.
Des solutions alternatives apparaissent comme des coopérations citoyennes et locales pour racheter collectivement des terres et y installer des paysans avec un droit d’usage et l’assurance de débouchés. L’association Terre de liens, qui a été pionnière dans le domaine de la propriété collective au service de l’installation de nouveaux paysans, a fait des petits comme Passeurs de terres dans la région des Pays de la Loire. Sous forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)4 réunissant paysans, habitants, associations paysannes ou naturalistes, collectivités locales… la structure « vise à protéger les fermes sur le long terme grâce à la propriété collective, à y installer des paysans nombreux, respectueux de l’homme et de leur environnement, porteurs de dynamiques sociales dans les campagnes ».5 Presque six ans après sa création, le pari est gagné et une dizaine de projets sont financés ou en voie de l’être pour des productions très diversifiées en maraîchage, viande, laitages, céréales, volailles, etc. Le lien entre la fourche et l’assiette est renoué et est d’autant plus fort qu’il s’est établi sur la « confiance pour gérer et préserver ensemble le foncier acquis. » Autre configuration, la coopérative paysanne de Belêtre, en Indre-et-Loire, regroupe six paysans·nes depuis 2014, des paysans·nes boulangers·ères et des maraîchers·ères sur 64 hectares de terres appartenant à Terre de liens. Dans le sud des Pays-Bas, où domine l’agriculture industrielle, il existe une ferme collective et écologique nourrissant 200 familles copropriétaires. Au menu, œufs, viande, fruits, légumes frais. « Je pense qu’il faut revenir à des pratiques d’un temps où l’on comprenait encore ce que l’on faisait » expliquait en 2019 Geert van der Vee, le fondateur.6 En France, la Fadear, fédération des associations pour le développement de l'emploi agricole et rural (Adear), si elle ne détient pas de foncier, accompagne les porteurs de projets en liens avec ce portage citoyen du foncier agricole, et d’une manière générale aide à maintenir et installer des paysans et faire vivre les valeurs de l'agriculture paysanne.
La souveraineté alimentaire n’est pas celle de Macron

Agrandissement : Illustration 4

La réadaptation du foncier agricole doit permettre de retrouver sur tout le territoire des fermes adaptées au terroir, de taille humaine, familiales, en association, en projets collectifs sur des productions complémentaires et diversifiées. En point de mire, la fameuse souveraineté alimentaire, qui n’est pas celle détournée par Macron et son gouvernement qui est avant tout un différentiel exportations/importations, mais celle des véritables initiateurs du concept, l’organisation internationale de paysans Via Campesina (voir mon précédent billet). Cette réforme agraire serait un remembrement7, non pour revenir à la parcellisation pré-industrielle, mais pour un nouveau modèle agricole qui privilégierait véritablement la souveraineté alimentaire des Français, l’agriculture vivrière, tout en restaurant paysages, biodiversité et identité des régions. La politique agricole doit donc s’orienter vers une déspécialisation des régions et un retour à la polyculture/polyélevage, une « polyagriculture » moderne, le meilleur outil qui permettra de nourrir la population avec des déplacements réduits et un tissu de PME transformatrices locales. Associer cultures et élevages plus ou moins extensifs, toujours diversifiés, permet de fonctionner en production circulaire tout en couvrant la plus grande partie des besoins alimentaires tout en diminuant globalement le cheptel qui retrouvera son utilité loin des usines à viande. Les pâturages nourrissent les troupeaux qui eux-mêmes défrichent, fertilisent les terres, entretiennent les paysages. Par exemple, un élevage laitier avec transformation fromagère sera complété utilement par un élevage extérieur de porcs pour absorber le petit lait, polluant naturel, auquel on pourra ajouter le son des céréales transformées pour l’alimentation humaine. Cela peut se faire sur la même ferme ou en en associant plusieurs.
L’agriculture intensive a fait table rase des paysages bocagers et de la diversité écologique pour y implanter des monocultures industrielles et des élevages concentrationnaires dont les populations locales ne verront les produits qu’après d’invraisemblables voyages, parfois planétaires, et au prix d’une ultra-transformation dans des méga-usines, système onéreux tant au niveau des prix que des conséquences sur la santé et l’environnement. La « polyagriculture » à taille humaine peut nourrir sainement, par le plus court chemin, tout en cultivant paysages et biodiversité. Elle permet d’implanter de nouveaux bocages adaptés à une mécanisation douce, certes moins denses que par le passé, mais riches de biodiversité. Ou encore la mise en place plus étendue de l’agroforesterie, de jachères et des rotations plus rapides et diversifiées. C’est la seule voie d’adaptation aux changements climatiques en ménageant les ressources, contrairement à l’agriculture intensive qui ne pourra survivre (provisoirement) qu’au prix d’une pression intenable sur ces mêmes ressources, notamment en eau (mégabassines).
Souveraineté alimentaire et écologie vont de pair

Agrandissement : Illustration 5

Cela exclut bien sûr de consacrer les terres nourricières à des productions visant à remplir les réservoirs de nos bagnoles ou des avions à tourisme de masse, à les couvrir de panneaux photovoltaïques, véritable hold-up du capitalisme sur le monde agricole, à assouvir l’insatiable appétit des méthaniseurs géants ou à produire un hydrogène qui n’aura rien de vert. L’expérimentation de nouvelles techniques, de nouvelles variétés, de nouveaux outils, surtout dans l’adaptation au changement climatique, est plus aisée sur des fermes de taille humaine, à condition de travailler sur des technologies simples et moins coûteuses que des outils high-tech 2, 3 ou 4.0. C’est la même problématique que l’aide occidentale trop souvent sophistiquée apportée à des agriculteurs du Sud qui ne peuvent assumer financièrement et technologiquement la pérennité des dispositifs. À ce titre, l’Atelier paysan, coopérative d’autoconstruction, est un modèle de créativité et d’adaptation : « Nous accompagnons les agriculteurs et agricultrices dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne. En remobilisant les producteurs et productrices sur les choix techniques autour de l’outil de travail des fermes, nous retrouvons collectivement une souveraineté technique, une autonomie par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire », explique leur site web.8
Dans le même sens, il faut réhabiliter les ceintures vertes (maraîchage, petits élevages) autour des villes, limitant ainsi l’artificialisation des sols, rétablissant les circuits courts et raffermissant les liens entre les producteurs et les consommateurs citadins. L’agriculture urbaine, les jardins ouvriers ou familiaux peuvent la compléter à condition de ne pas sacrifier ces enclaves vertes et niches écologiques aux programmes immobiliers de promoteurs peu scrupuleux.
L’élevage industriel et concentrationnaire doit bien entendu disparaître au profit d’un élevage diffus, utile aux processus en place sur la ferme (circulaires) et à l’entretien des paysages. Cela doit s’accompagner d’une diminution drastique de la consommation de produits animaux (viande, laitages…) en rééquilibrant les régimes alimentaires au profit des protéines végétales. La production animale doit aussi s’appuyer sur des coopératives dédiées à des productions locales pour des consommateurs locaux, à l’opposé des coopératives géantes exportatrices qui jouent dans la cour du commerce mondialisé. Cette agriculture restauratrice d’un métier et des milieux écologiques n’est en aucune manière une régression mais une renaissance. « La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources », a écrit Edgar Morin. Cette agriculture nouvelle est plus technique et réclame des programmes de recherche ainsi que des formations adaptées.
Zapper les intermédiaires parasites
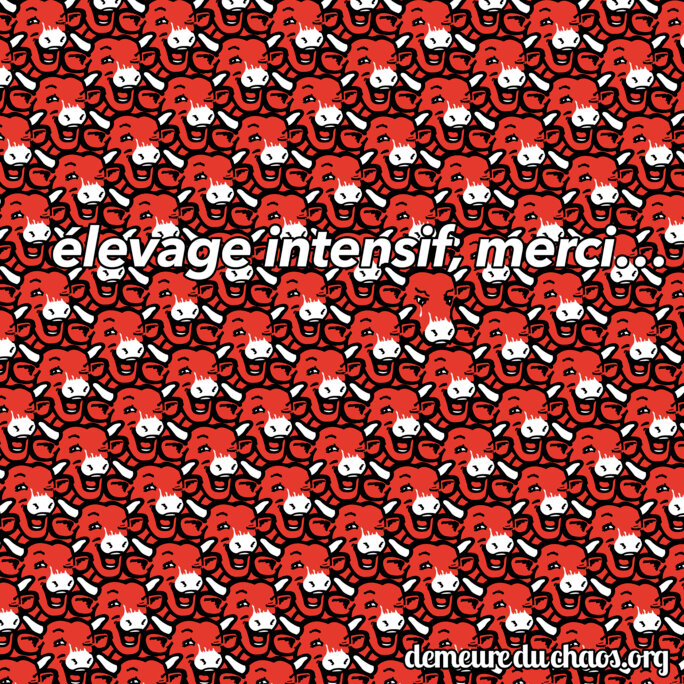
Agrandissement : Illustration 6
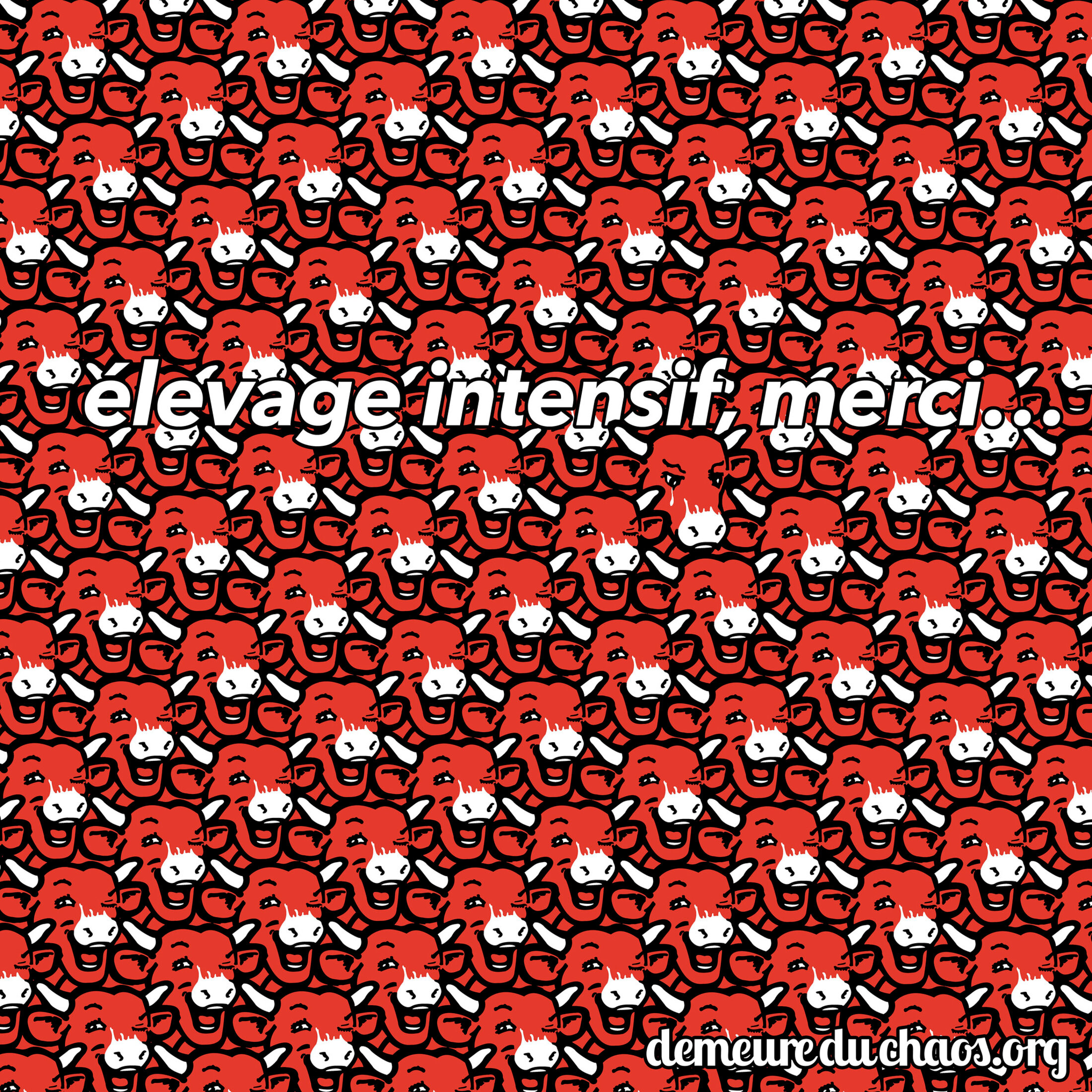
À l’autre bout de la chaîne, il est donc nécessaire que le consommateur réadapte sa demande et s’adapte à une offre refondue, parce que locale et non plus mondiale, zappant autant qu’il est possible les intermédiaires parasites. Avec des objectifs environnementaux, mais aussi de santé préservée et de plaisirs nouveaux. La diversité des productions est donc primordiale. Tout autant que l’est le rétablissement des liens entre producteurs et consommateurs pour une meilleure compréhension des contraintes et demandes réciproques. On a vu que c’était possible pour le foncier agricole. La coopération dans le domaine de la consommation est aussi expérimentée partout sur le territoire sous forme de coopératives d’achat, d’épiceries solidaires, de supérettes coopératives, d’associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), etc. Le plus grand défi est celui de l’éducation à l’alimentation face aux moyens marketings de l’industrie agro-alimentaire et de la grande distribution. Un jeune sur cinq confond un concombre avec une courgette.9 Autre exemple : la viande de veau « blanche » fait partie des images marketing imposées dès les années 1960 pour pouvoir industrialiser l’élevage. Or, une viande de veau « rosé », plus ferme et goûteuse, garantit une bête élevée sous la mère au pâturage (il se nourrit de lait ET d’herbe), contrairement à une viande de veau « blanche », c’est-à-dire anémiée, le veau étant gardé en cage et libéré seulement pour aller téter, quand il n’est pas élevé au lait en poudre, même si les hormones de croissance ont, en principe, disparu des élevages français (mais pas ailleurs).
Bien entendu, les prix, surtout dans un contexte difficile pour le pouvoir d’achat, sont un enjeu primordial. L’agriculture agroécologique, donc sans dopage chimique, peut atteindre une productivité et des prix compétitifs par rapport à l’agriculture productiviste. La main-d’œuvre et le travail supplémentaires en agroécologie ont un coût compensé par des offres d’emploi supérieures à l’agriculture industrielle ultra mécanisée tandis que matériel sophistiqué, pesticides, engrais chimiques et emprunts coûtent encore plus cher à l’agriculteur, écrasé par les charges d’emprunts, mais aussi à la société. L’agriculture intensive ne prend l’avantage (celui des dopés !) dans les rayons du supermarché que parce que les coûts environnementaux et sanitaires ne sont pas intégrés dans ses prix de vente, puisque supportés par l’ensemble de la communauté : dépollution des terres et des eaux, intoxications et maladies induites par les pesticides, réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, arasement des paysages ruraux…
Décoloniser les habitudes alimentaires

Agrandissement : Illustration 7

Le consommateur devra faire de nouveaux arbitrages, se déprendre de réflexes façonnés par le marketing, imaginer une alimentation plus végétale agrémentée ponctuellement d’une viande de qualité. Pour la population qui ne peut qu’arbitrer entre malbouffe et ne pas manger à sa faim, des étudiants aux retraités pauvres, il faut mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation, 10 véritable contrat social. Une éducation populaire à l’alimentation, à la cuisine, à l’utilisation de produits bruts, est indispensable, de même qu’un contre-feu au marketing de l’industrie agroalimentaire. Le service public est sur ce point indigent dans la formation et la communication, préférant souvent culpabiliser le consommateur.
Le politique a donc aussi une large part de responsabilité puisqu’il se rend complice de la FNSEA en acceptant toutes ses revendications pour faciliter l’agriculture intensive de ses membres, tandis qu’il reste très timoré dans la réglementation de cette filière industrielle et pour la protection sanitaire des Français. Enfin, si le tandem Macron-Fesneau veut nous vendre une réelle souveraineté alimentaire, qu’il oriente d’abord la commande publique vers les productions locales et respectueuses des valeurs sociales et écologiques.
Ces dernières années, contrairement au discours mensonger de la FNSEA, de nombreuses études11 ont démontré qu’il est possible de nourrir l’humanité avec une agriculture agroécologique, à certaines conditions. La réduction des protéines animales (divisée par trois) est l’une d’elles. Il faudra y ajouter une diminution drastique du gaspillage alimentaire et de la surconsommation lorsqu’on sait que 30 % de la production agricole se perd entre la fourche et la fourchette. Un objectif atteignable notamment en raccourcissant les circuits de commercialisation, ce qui est le cas dans une production locale. Certes, il serait nécessaire de libérer de nouvelles terres cultivables pour compenser des rendements moins élevés. Mais la diminution du cheptel animal libérerait des terres aujourd’hui utilisées pour produire l’aliment du bétail sachant qu’un tiers des terres cultivables de la planète sont dédiés à ce dernier. Dans une étude12 parue en 2017 dans Nature, Stratégies visant à nourrir le monde de manière plus durable avec l'agriculture biologique, une équipe internationale a étudié différents scénarios avec des proportions plus ou moins grandes d’agriculture biologique. « Nous montrons à travers 162 scénarios ce qui est possible et à quelles conditions. La direction à prendre est ensuite un choix politique et de société », explique l’un de ses auteurs. Pour que paysans et consommateurs puissent effectuer leur mue vers ce nouveau modèle court-circuitant celui de l’industrie, il faut donc que l’Europe politique réoriente les 53,7 milliards13 d’euros du budget agricole vers ce nouveau modèle. Ce n’est pas gagné, sachant qu’en France, 20 % des plus gros agriculteurs, émargeant en majorité à la FNSEA, possèdent 52 % des terres agricoles et touchent ainsi 51 % des aides européennes, la PAC étant versée à l’hectare. Au niveau européen, les pourcentages respectifs sont de 20 %, 83 % et 81 %, les exploitations des pays de l’est étant plus étendues. Priorité est donnée aux marchés internationaux, aux industries agro-alimentaires, dont la France et l’Europe hébergent quelques « champions » mondiaux. Comme dit plus haut, c’est « un choix politique et de société ». Le problème est que ces choix sont en grande partie décidés dans les bureaux parisiens ou bruxellois, par une haute fonction publique hors-sol et par une commission européenne non élue. L’enjeu est d’abattre, non pas les haies, mais le quasi-monopole de la FNSEA et des ministres affidés ou soumis ou tout simplement impuissants. La politique agricole doit se décider localement, démocratiquement, collectivement en lien avec les politiques sociales. L’Europe peut peser de son poids sur l’orientation générale de transition, agir sur la régulation et les restrictions à la circulation mondiale des denrées et matières premières agricoles et à la spéculation, destructrice des agricultures vivrières et de la paysannerie, en Europe comme dans le Sud. Ce n’est pas en signant à tours de bras des accords de libre échange que l’on améliorera le problème de la faim dans le monde ni les choix des communautés pour leur souveraineté alimentaire. Enfin, l’État parisien doit décentraliser massivement aux collectivités locales, en attendant une liberté anarchiste et intégralement démocrate favorable à l’autodétermination alimentaire dans tous recoins de France, dans des biorégions cohérentes.
Si les nouveaux paysans sont les germes d’une révolution agricole, cette dernière ne pourra s’épanouir qu’avec la faillite de la grande industrie à malbouffe. Et il faut faire vite face à la dégradation accélérée des terres, des biotopes et des réserves en eau, aux menaces d’invasion des nouveaux OGM, à l’accaparement et l’artificialisation des terres. Sur le tracé de l’A69 comme autour des megabassines privées, des paysans se battent pour garder leurs terres ou avoir un accès équitable à l’eau. Il nous faut collectivement rejoindre tous les lieux de résistance, ils sont légion sur le territoire. « Si nous laissons la destruction du vivant aller plus vite que l'essaimage d'alternatives, nous perdons. Il nous semble donc tout aussi important de lutter contre les projets destructeurs que de construire des alternatives collectives », avertit la Confédération paysanne qui invite à un dimanche convivial chez l'un de leurs adhérents près de l'A69.14
2. https://theconversation.com/aliments-ultra-transformes-comment-ils-modelent-notre-agriculture-223881.
3. La Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture ou CDOA, créée en 1995, délivre les autorisations préalables d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, autrement dit sensée limiter leur agrandissement par rachat de terres adjacentes pour ne pas hypothéquer les installations nouvelles.
4. SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif.
5. https://passeursdeterres.org/.
7. Le remembrement est un outil de réorganisation du foncier agricole utilisé depuis l’Antiquité. Plus récemment, un vaste remembrement a accompagné la modernisation de l’agriculture, de 1955 à 1975, bouleversant profondément les paysages, les écosystèmes, la gestion de l’eau et le métier. Le paysan a laissé place à l’exploitant agricole.
8. https://www.latelierpaysan.org/.
10. https://securite-sociale-alimentation.org/, https://reporterre.net/Creons-une-securite-sociale-de-l-alimentation-pour-enrayer-la-faim, https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=967.
11. Voir ici, ici, ici et ici, etc.
12. https://www.nature.com/articles/s41467-017-01410-w, en anglais.
13. La France se mange la plus grande part du gâteau avec 9,3 milliards, voir https://agriculture.gouv.fr/infographie-la-politique-agricole-commune-2021-2027-montant-annuel-par-pays.
14. Au Hangar Vert, chemin de Senales. Coordonnées GPS : 43.59543 - 2.16461



