Les résultats des législatives étaient à peine connus que les calculettes chauffaient : 1,61€ par voix obtenue, de quoi constituer des magots pour des partis, véritables machines de guerre dévolues à la conquête de la magistrature suprême. Les guerres d’égos se jouaient sur l’addition et pouvaient reprendre de plus belle, d’un bout à l’autre d’un échiquier politique finalement très prévisible, à condition de ne pas s’être laissé emporter par l’euphorie d’un tirage électoral foutraque. Prévisible ? peut-être parce qu’on y retrouve les mêmes professionnels, barbotant dans un modèle de gouvernance modelé par leur appartenance majoritairement bourgeoise, épuisé par les compromissions, les manigances, les bas arrangements, la corruption. Les quelques petits nouveaux qui plongent, avec naïveté, dans cette marmite et qui pourraient relever le débat, sont de fait vite noyés dans cette cuisine infâme.
De son côté, l’attelage hétéroclite de la Gauche de partis n’aura pas résisté longtemps, après un accord passé sur un coin de table, une arrivée en tête inattendue et, finalement, l’opportunité de conquérir des sièges de pouvoir, dont celui de Matignon. L’occasion de relancer une sempiternelle guerre de chefs à plumes, dans un scénario éculé d’un ixième épisode de Fast and furious. Ça lasse, ça polarise, ça efface les débats d’idées, ça démontre que le système représentatif n’est qu’une lutte de pouvoir sous-tendue par l’intérêt d’un État au service du capitalisme. On est loin d’une gestion démocratique par le peuple, pour le peuple. On est très loin des slogans de rupture appelant à une société d’équilibres, juste, paritaire, protectrice des minorités, ouverte… et surtout non verticale. Leur propension à vouloir parler au nom des Français dans leur ensemble très pluriel, dès qu’une caméra ou un micro se pointe, tout en gardant leur ligne de conquête idéologique, relève d’une falsification intellectuelle : ils privatisent les résultats du suffrage universel pour des intérêts personnels. La reconduite gaguesque de Yaël Braun-Pivet au perchoir prouve que tout est fait pour que rien ne change dans l’entre-soi de la caste des professionnels de la politique.
Les partis personnels à l’assaut du pouvoir suprême
Les électeurs, du NFP au RN, n’ont plus qu’à aller se rhabiller pour aller trimer ou pointer au chômage. Attachés à cette verticalité du pouvoir typique de la Ve République, les « partis personnels », comme les qualifie Ludovic Grave, doctorant en sciences politiques à l’Université de Lille, 1 c’est-à-dire centrés autour de leur fondateur et leader (tiens ! Que des hommes…), forcément incontestable, happent les électeurs à coups de slogans réducteurs, de phrases assassines, de coups médiatiques. La personnalisation du pouvoir compte plus que l’animation d’un projet politique collectif. Ces partis se caractérisent par l’horizontalité des recrutements mais par la verticalité décisionnelle, le plus souvent dans l’opacité d’un cercle restreint de lieutenants fidèles. « Un parti personnel se caractérise par le contrôle total de son leader-fondateur sur le parti, fusionnant ses ambitions personnelles avec le programme politique du parti », précise Ludovic Grave, citant les exemples de Renaissance et de LFI voire du RN, véritable « entreprise familiale ». La démocratie représentative et son pendant, les partis de conquête du pouvoir, sont en déliquescence dans un contexte de cataclysme climatique et écologique, de capitalisme débridé et d’inégalités profondes.
Ruffin a une idée, à nous de nous en emparer
Au milieu de ce maelstrom « où tout se perd », disait Victor Hugo de la capitale, centre du pouvoir, une voix singulière a suggéré la création à gauche d’une coopérative politique. « Hier soir en me couchant, je me disais […] pourquoi on n’aurait pas une coopérative politique qui permettrait, un homme, une voix, qu’on avance ensemble et qu’on fasse cause commune ? » s’est demandé François Ruffin, le lendemain du scrutin sur France 2. Tout le contraire de la verticalité du pouvoir des partis. François Ruffin n’est pas l’Homme providentiel et ses ambitions ne sont pas clairement annoncées. S’il veut se libérer de la tutelle mélenchonesque, on ose espérer que ce n’est pas pour prendre sa place sur l’estrade dominante. Par contre, lorsqu’il lance cette idée, à la manière d’un logiciel libre déposé sur internet, nous devons nous en emparer pour l’enrichir, la débattre dans des assemblées populaires, dans les villages et les quartiers. Sa proposition n’a pas reçu l’écho qu’elle méritait, à droite, ce n’est pas une surprise, mais pas plus au sein de la gauche « plurielle » du Nouveau front populaire, encore moins dans les médias. Ironie, le « Figaro »2 est l’un des rares à faire écho à cette dernière, appelant la mémoire de la Commune de Paris, son organisation libertaire et ses coopératives.
Une coopérative est la base d’une économie sociale et solidaire, antinomique, opposée au capitalisme de spoliations (pillage des ressources, non partage des revenus…) et à une gouvernance autoritaire. Mais, prolongation d’une volonté libertaire et autogestionnaire, la coopérative est aussi une organisation politique qui institue, en théorie, un rapport d’égalité entre ses membres : un homme ou une femme égale une voix. En théorie, parce que les volontés de domination ou les intentions vénales du capitalisme sont toujours en embuscade. La preuve par les coopératives agricoles transmutées en multinationales tournées vers l’industrie agrochimique et agroalimentaire et l’exportation qui appauvrit les petits paysans du Sud, pressurant ses membres agriculteurs/éleveurs les plus faibles comme n’importe quelle entreprise ultra-capitaliste. Ces entités inhumaines sont tenues fermement par des affairistes acoquinés avec le pouvoir politique (FNSEA). À noter aussi que parmi les dix plus grosses de ces « coopératives » capitalistes, on trouve six groupes bancaires, deux acteurs majeurs de la grande distribution, quatre géantes de l’agroalimentaire et une représentante de la distribution pharmaceutique (classement 2020). Elles sont très loin de l’idéal communaliste et ne sont heureusement pas représentatives des 23 000 entreprises coopératives de France, dont la plupart sont à taille humaine, tout en étant vues avec condescendance par le patronat et ses factotums gouvernementaux.
Une coopérative intégrale ?
L’organisation d’une coopérative peut-elle dès lors être transposée dans le champ politique du débat d’idées et dans celui d’administration autogestionnaire en démocratie directe de la société ? Les expériences jalonnent l’Histoire depuis plus de deux siècles, toujours liées à des mouvements libertaires et le plus souvent réprimées dans le sang par les pouvoirs aristocratiques étroitement liés à l’hypertrophie capitaliste et colonialiste. La Commune s’acheva par la Semaine sanglante. Plus proche de nous, la Révolution espagnole (1936-1939) a sans doute été l’une des plus abouties avant d’être écrasée sous les bombes fascistes. Pour l’historien Antoni Castells Duran (1943-2021), l’expérience des collectivisations développée en Catalogne durant la période 1936-1939 « constitue l’unique tentative de mise en pratique des principes de socialisme libertaire et autogestionnaire qui a existé dans une société industrielle. C’est, ce qui lui confère une importance exceptionnelle au niveau mondial, tant du point de vue historique qu’économique et social ».3
La Coopérative intégrale catalane, née en 2009, est une timide héritière de cette histoire tout de même forte de plusieurs milliers de sociétaires, et avec l’ambition d’un « système hors du système capitaliste » et incluant « toutes les entreprisés sociales et tous types de secteurs d'activité (productifs ou non) ».4 François Ruffin se limite sans doute à la gestion du Nouveau front populaire sous forme de coopérative, lissant les égos surdimensionnés, une sorte de coop délibérative produisant des idées, un programme et des modes d’action selon un processus de démocratie directe. Avec des obstacles de taille. D’abord les leaders du NFP qui sont programmés pour la conquête du pouvoir, pas pour son abolition. Ensuite, une coopérative politique ne peut vivre sans l’expérience de terrain, la connexion avec la vie économique et les enjeux de société. L’expérience espagnole montre que le chaudron politique, qui a vu s’y affronter anarchistes, marxistes et républicains, était intimement lié au mouvement spontané d’autogestion ouvrière, bien que ce dernier a finalement pris son autonomie en renonçant au pouvoir.5 Car cette aventure démontre aussi que l’autogestion peut, doit s’affranchir des appareils politiques, on appelle ça l’émancipation. C’est ce qui fait dire à Victor Alba (1916-2003), journaliste catalan, écrivain, historien, professeur d'université et militant communiste anti stalinien, que la Révolution espagnole fut « la seule authentiquement ouvrière ».
Le citant, Richard Neuville, syndicaliste et animateur de l’Association pour l’autogestion, estime qu’elle a été « conduite spontanément par les travailleurs sans initiative initiale de leurs organisations. Ce fut une révolution de la base ouvrière de la société. Les décisions furent adoptées par les travailleurs eux-mêmes au service de leurs propres intérêts. Le prolétariat espagnol, sans oublier les collectivités rurales, ouvrit un chemin qui conduisit vers une société sans classe, dans laquelle les différences sociales, économiques, culturelles dues à la division du travail et aux différentes fonctions dans le processus de production s’estompèrent. Il entreprit bel et bien la construction d’une société socialiste autogestionnaire même s’il renonça au pouvoir politique. »
Est-ce à cela que pense François Ruffin ? Pense-t-il pouvoir lancer une telle initiative de l’intérieur d’une gauche modelée par la République des professionnels ? À nous de nous emparer de ce logiciel à peine esquissé, en analysant les expériences passées, en innovant, en relocalisant la politique alors que les territoires ont été dépossédés d’une démocratie en prise directe avec leur quotidien, de la gestion de leurs productions, de leurs écosystèmes, de leur conception d’un bien vivre adapté. Hors du cirque politique actuel et de ses numéros qui dérapent de plus en plus, le salut viendra de la base populaire qui aura le courage de l’émancipation, de l’autogestion et du respect d’elle-même.
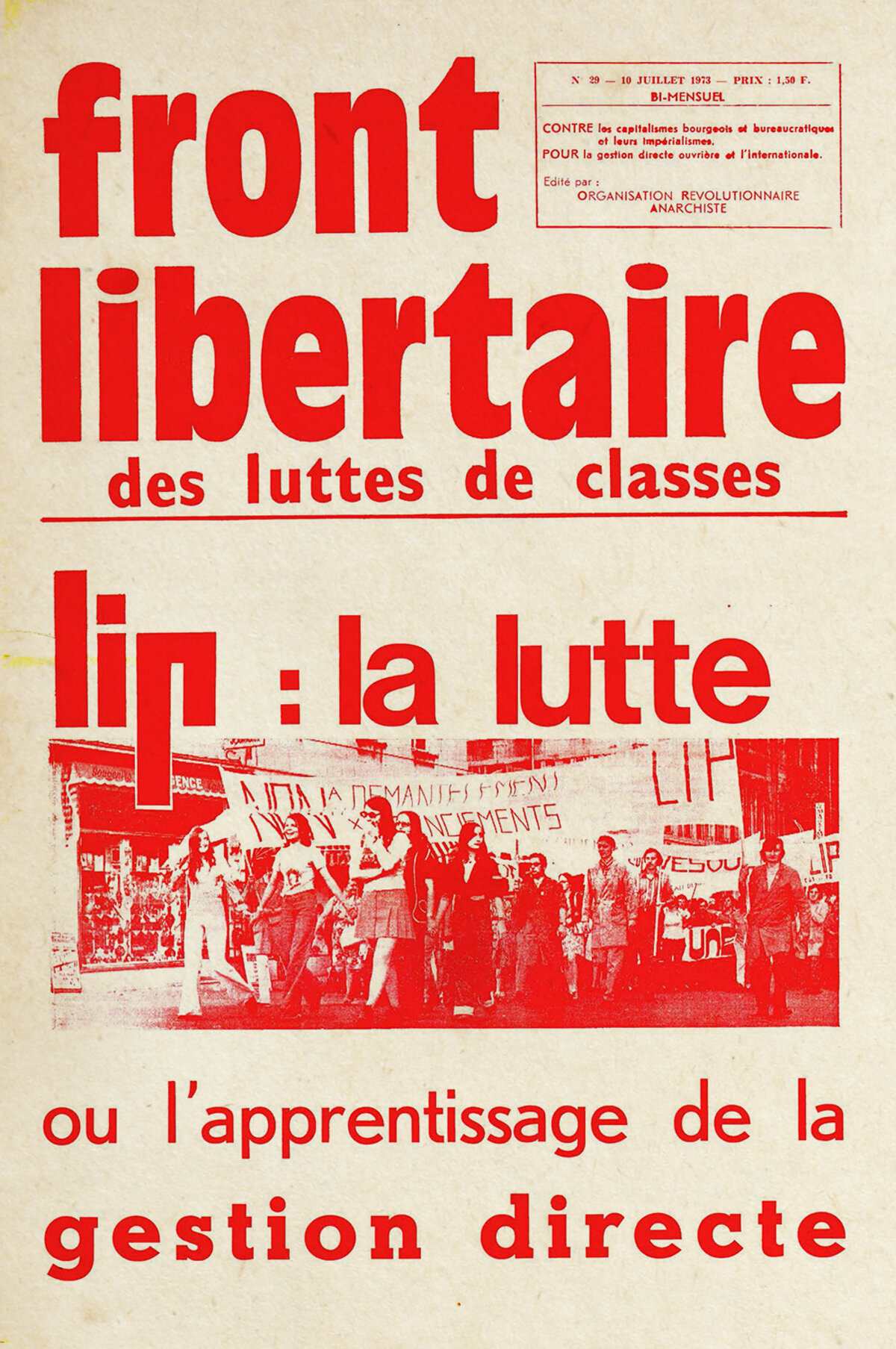
Agrandissement : Illustration 1
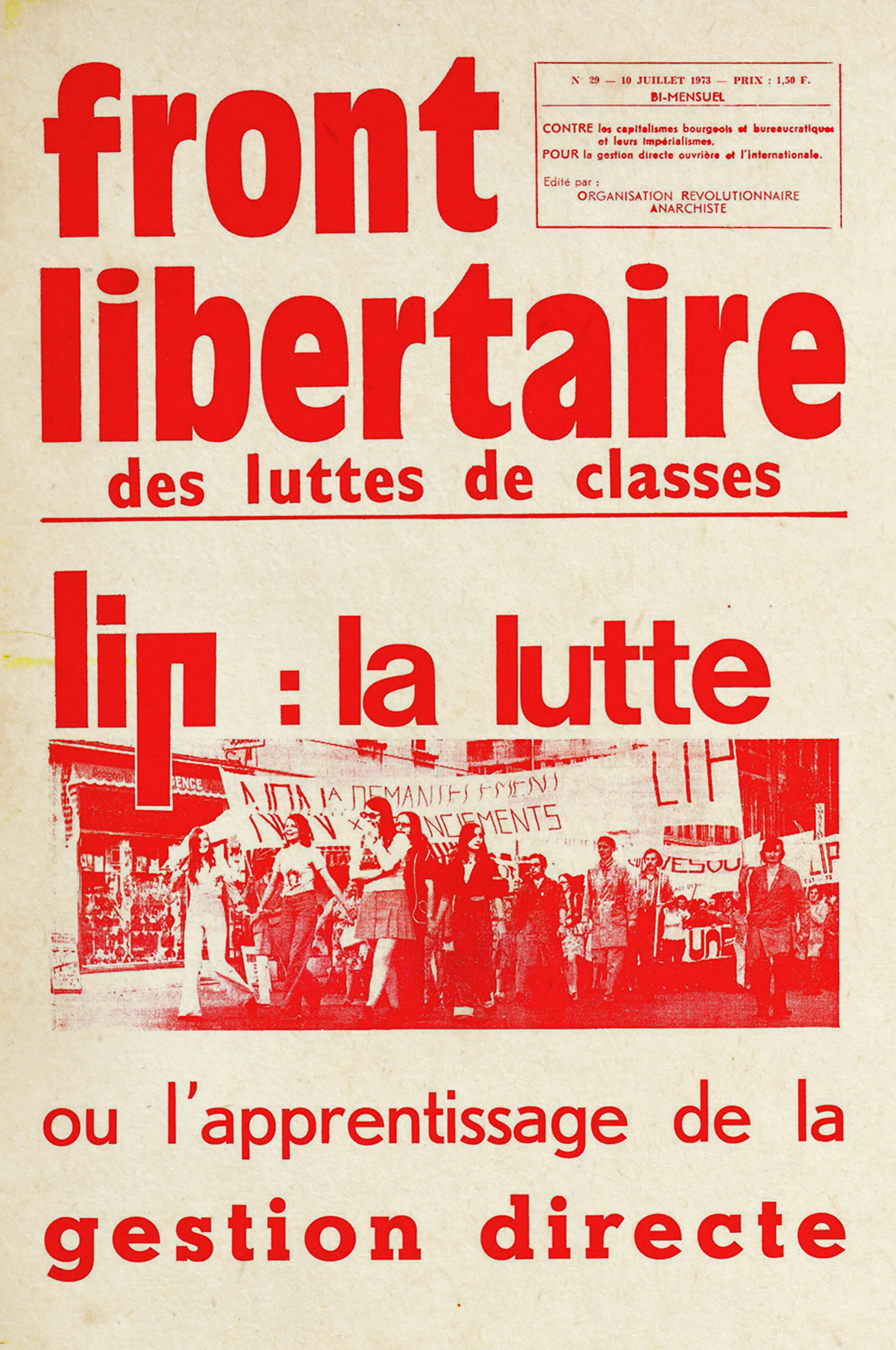
3. Antoni Astells Duran, Les col-lectivitzacions à Barcelona 1936-1939, Hacer, Barcelona, 1993, p.258.
4. https://cooperativa.cat/benvenuti-nel-sito-della-cooperativa-integral-catalana/.



