Partir en reportage pour Mediapart en Europe centrale et orientale, c’est parfois renouer avec un passé lointain, mais toujours si présent que les retrouvailles vont de soi, comme si l’on s’était quitté la veille.
En 2014, à l’occasion d’une virée à Budapest pour enquêter sur la Hongrie régressive de Viktor Orbán, j’avais repris contact avec une vieille connaissance rencontrée en 1980, trente-quatre ans plus tôt : Tibor Fabian, né en 1930 à Paris où il avait été éduqué jusqu’en 1947, avant que son père, idéaliste communiste, ne rapatriât sa famille pour bâtir le socialisme hongrois.
J’avais filmé Tibor Fabian, alors âgé de 84 ans. Ancien diplomate au service de la démocratie populaire, il était conscient d’avoir travaillé pour un régime odieux, mais il demeurait fidèle à une gauche anti-autoritaire à construire et fulminait contre le système Orbán aux accents nationalistes et post-fascistes.
Tibor est mort l’an dernier, à 92 ans, vaincu par le Covid : il venait d’obtenir – je l’avais aidé dans cette démarche – une pension versée par l’Allemagne aux victimes des persécutions à l’encontre des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Tibor, sous son nom de Grosz, avait dû se cacher à Paris sous l’Occupation et en partie escamoter sa scolarité au lycée Chaptal.
Nous étions devenus très amis. Nous étions passés au tutoiement. J’étais retourné un week-end le voir à Budapest, je l’avais accueilli à Paris, nous correspondions ou nous parlions chaque semaine. Il me manque. Voici la vidéo tournée voilà neuf ans, dans un appartement qu’il avait été obligé de vendre quelques années plus tard, pour survivre dans un pays devenu brutalement capitaliste (pléonasme…).
Tbilissi
En février 2023, à Tbilissi, me voici de nouveau dans ce chaudron géorgien si empoignant, que j’avais connu à l’automne 1995, voilà bientôt 28 ans, du temps que je travaillais à Télérama. J’avais accompagné Bernard Pivot, qui devait animer de là-bas un numéro de son magazine ayant succédé à Apostrophes : Bouillon de culture.
Ce fut un moment de franche rigolade. L’ambassadeur de France en Géorgie, qui ouvrait ce poste (c’était auparavant notre représentant à Moscou qui consentait parfois à se déplacer à Tbilissi), était un saint-cyrien. Regardé de haut par les énarques tout à leur molle courtoisie, ce soldat-diplomate, Bernard Fassier (1944-2018), était un fonceur chaleureux.
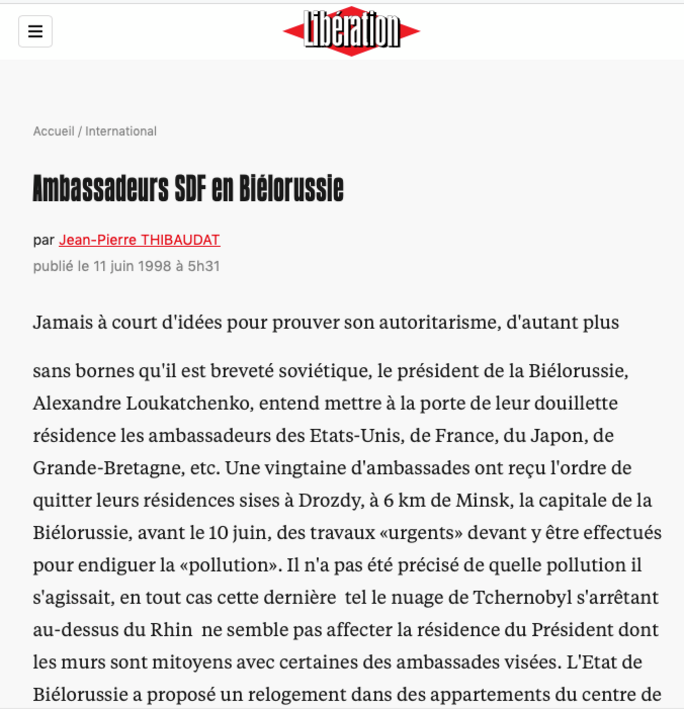
Agrandissement : Illustration 2
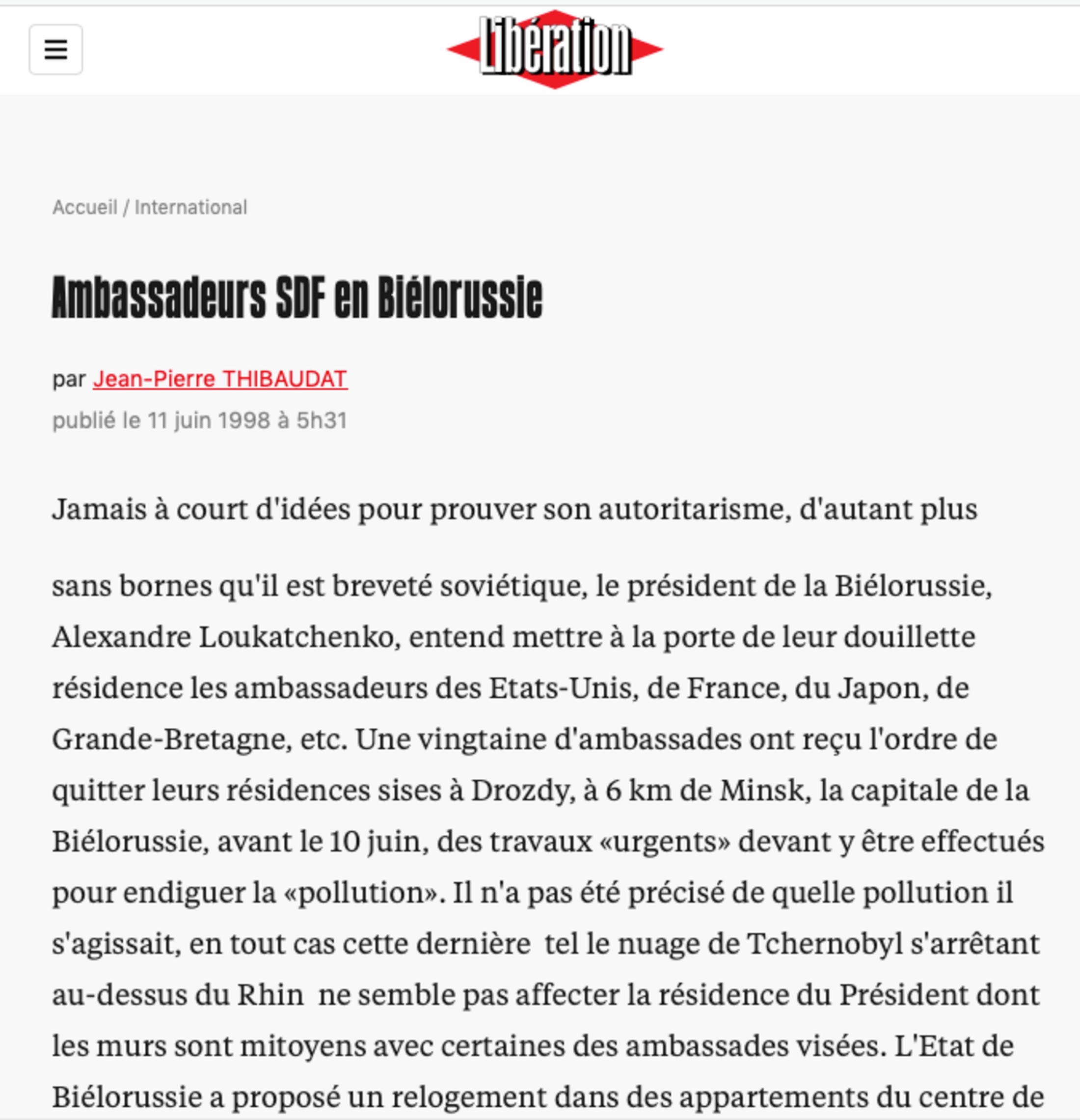
Dans son poste suivant, à Minsk, il allait se heurter au dictateur Loukachenko. Celui-ci réquisitionnerait pour son profit le quartier des ambassades et Bernard Fassier continuerait à rallier à bicyclette la légation française, en dépit des interdictions de circuler faites aux voitures automobiles, même diplomatiques.
En attendant, sur le sol Géorgien, Bernard Fassier était au mieux avec les autorités – il m’obtint en cette année 1995 une interview avec ce vieux renard de président d’alors : Édouard Chévardnadzé.
Bernard Fassier nous traîna dans les bains de soufre de Tbilissi, privatisés pour l’occasion, où nous nous retrouvâmes nus comme des vers. Bernard Pivot et Claude Sérillon – venu pour préparer un numéro de son émission Géopolis – sifflaient à qui mieux mieux « Tea for Two and Two for Tea » en barbotant, rejouant la scène fameuse de Bourvil et Louis de Funès dans La Grande Vadrouille.
En sortant de l’établissement de bain, nous vîmes entrer un sacré bandit géorgien de l’époque, Djaba Iosseliani. Il avait, à la tête de ses vingt mille Mekhedrioni (« Cavaliers »), porté Chévardnadzé au pouvoir, avant que de tenter de le faire assassiner. Fixant cette inquiétante silhouette, Bernard Pivot bougonna : « Il est préférable que ce soit lui qui trempe dans notre eau plutôt que nous dans la sienne. »
L’enregistrement public de Bouillon de culture fut légendaire. Un studio immense et déglingué : fellinien. Des projecteurs préhistoriques y déversaient, entre deux coupures de courant, l'équivalent lumineux du liquide rouillé qui s'échappait alors des robinets de la ville, entre deux suppressions de la distribution d'eau.
Il y avait de vieilles caméras abracadabrantes et fourbues, jadis refourguées par Moscou au nom de l'amitié entre les peuples. Derrière les appareils, s'activaient machinalement des hommes âgés au corps meurtri, au regard absent, habillés à la décrochez-moi-ça. Ils traînaient à la télévision, une fois par semaine, histoire de bénéficier de la cantine et d'une raison sociale. Le reste de la semaine, ils exerçaient une activité plus lucrative, au noir. Nous étions, au moindre cliché près, au cœur de la mouise postsoviétique...

Agrandissement : Illustration 3

Soudain, les échines se redressèrent, les regards s'allumèrent, une atmosphère électrique vint ressouder cette communauté de techniciens, de cameramen, de chefs opérateurs qui semblait sécher sur pieds. Une voix houspilla ce monde, dans un russe qui n'ignore point les bonnes manières. C'était le réalisateur français Alexandre Tarta.
Alexandre Tarta aura 95 ans le 1er juin 2023. Depuis la mort de Marcel Bluwal (1925-2021), il est le dernier grand pionnier encore en vie des heures chaudes de la télévision française. Alexandre Tarta n’est pas très à gauche. Au printemps 1995, il avait conseillé, lors du débat d’entre deux tours de la présidentielle, le candidat Jacques Chirac – tandis que le déjà éternel Serge Moati veillait sur le candidat Lionel Jospin.

Agrandissement : Illustration 4

Je m’étais acheté un chapeau de berger géorgien, hirsute de poils blancs de brebis, je l’avais coiffé et m’étais placé à côté de Tarta en réclamant une photographie prouvant un lien secret entre lui et Jospin, auquel me faisait ressembler ma coiffure. Le réalisateur ne m’en voulut pas.
L’heure était aux blagues potaches. Nous avions repéré un tic de langage de l’ambassadeur Fassier : toutes ses phrases commençaient par « s’agissant de ». Nous nous étions promis de placer cette expression dans nos émissions et articles respectifs. Quand Bernard Pivot, matois, glissa en plein enregistrement de Bouillon de culture un petit « s’agissant de » de derrière les fagots, Claude Sérillon, dans le public, partit de son rire proverbial, une sorte de hennissement homérique inassouvissable : il en fallut presque interrompre l’émission.
Lia Loria
Entre deux joyeux banquets, où nous élisions à tour de rôle un « tamada » chargé de porter des toasts à mesure que le repas progressait, nous étions guidés vers des occupations plus culturelles par une fée souriante et enthousiaste, professeure de français à l’université de Tbilissi, capable de vous réciter au débotté La Complainte du roi Renaud, cette ballade aux accents merveilleusement médiévaux : « Divin Renaud, mon réconfort,/ Te voilà donc au rang des morts ! »
C’était Lia Loria, venue quelque temps plus tard à Paris et que nous avions chacun traitée comme il se dût – Bernard Pivot l’avait invitée chez Maxim’s…
Le 18 février 2023, j’ai revu Lia Loria. In extremis, à la toute fin de mon séjour à Tbilissi. Elle n’avait pu me recevoir avant, frappée par le virus que nous savons. Elle a maintenant 80 ans. Elle a résisté, grâce à l’aide du voisinage, au dernier étage de son immeuble – où vit sa cousine, la cinéaste Nana Djordjadze, autrice, entre autres, du film Les Mille et une recettes du cuisinier amoureux (1996), avec un Pierre Richard devenu fou de la Géorgie sur le tournage.
Intarissable, pleine de vie et de souvenirs, amoureuse jamais contrariée de la France et de sa langue, voici Lia Loria, filmée dans le petit bureau de son appartement.
Mamuka Didebashvili
Il m’a été donné de vivre un autre rendez-vous à Tbilissi. Inespéré. À l’automne 1995, dans la froidure d’un parc de la ville, j’avais acheté un tableau à un peintre à l’air triste et famélique. Une toile à la fois emplie de douleurs et d’ironie.
Comme une caricature en pointillé de la Sainte Famille. On y sent une névrose palpable et tenace, sans doute induite par le père, militaire et donc encombrant, qui semble déverser, en cascade, tout son trouble retenu sur le fils qui n’en peut mais, empoté, inhibé, refoulé, complexé…
Je gardais le souvenir, en regardant chaque jour ce tableau à Paris, des yeux désolés du peintre géorgien me cédant à vil prix son œuvre – 20 dollars dans mon souvenir, mais j’espère que ce fut davantage.

Agrandissement : Illustration 6

J’avais photographié la peinture avant de quitter Paris le 13 février. Quatre jours plus tard, vendredi 17 février en fin d’après-midi, je suis allé au Pont Sec, le parc devenu très touristique, où les Géorgiens cédaient leurs biens pour avoir de quoi vivoter voilà vingt-huit ans.
J’ai montré le cliché du tableau à quelques peintres qui exposaient leurs croutes d’un style montmartrois insoutenable, dans l’attente d’un gogo de rencontre. Un vieux rapin – peut-être de mon âge – reconnut aussitôt Mamuka Didebashvili : « Vous le trouverez sur Facebook. »
Je prends contact par les voies électroniques avec l’artiste retrouvé, en joignant la photographie de sa toile de 1995. Il me répond aussitôt qu’il est heureux d’avoir une trace de sa production de l’époque, qu’il a été obligé de vendre à tout va pour faire face aux difficultés de ces temps révolus.
Il m’invite à lui rendre visite, sur les hauteurs de la ville, non loin du lac Lissi. Je découvre sur la Toile qu’il est désormais lancé, coté, exposé dans des galeries, dont une londonienne qui le qualifie de « Brueghel géorgien ».
Je file le voir après ma visite chez Lia Loria. Il me reçoit dans sa maison toute neuve, où m’accueille son fils qui nous servira d’interprète et sa femme, Maia Ramishvilli, également peintre, avec laquelle il partage un atelier, dans lequel il me fait entrer. Il a préparé de quoi boire et manger – en particulier un vin géorgien d’une grande pureté.
Mamuka est né en 1968. Il me dit d’emblée, avec un pli douloureux sur le visage, qu’il a été enrôlé dans la guerre d’Afghanistan à 19 ans, en 1987, et qu’il en ressent de la honte.
Nous trinquons à la paix. Pas à n’importe quel prix, lui glissé-je. Alors il précise son toast : « À la paix, après la victoire. » L’émotion de telles retrouvailles impromptues relève d’une expérience unique, à peine descriptible. J’abrège donc en vous proposant une minute de silence, en forme de rapide tour de son atelier filmé à la bonne franquette.



