Si nous avons dit précédemment (voir les billets 2 et 3) qu’il nous paraissait très audacieux – et daté – de soutenir que l’art et la morale formaient des domaines « a priori parfaitement autonomes »[1], il faut donc assumer que certaines personnes puissent trouver Madame Bovary immoral, en particulier dans la société où le roman est paru.
En effet, la dé-moralisation du roman semble à la fois trahir la réception initiale du roman et l’intention de Flaubert.
Plus encore, en faisant de Madame Bovary « un livre sur rien »[2] on sape, comme le remarque Fabienne Dupray elle-même avec Yvan Leclerc, une dimension essentielle du roman[3]. Son immoralité, c’est-à-dire sa révolte contre les normes morales de son époque, conservatrices et hypocrites, me semblent en être une clé importante de lecture de l’ouvrage, et même fonder en partie son intérêt.
Plutôt que de faire de Flaubert un modèle de moralité bonapartiste réactionnaire comme s’y essaie l’avocat Senard ou de nier que le roman aborde des questions morales comme le fait la modernité, il me semble bien plus intéressant de « redonner à [ce] texte sa la force de scandale qu’[il a] perdue en passant par une plaidoirie moralisante et par plus d’un siècle de blanchiment pédagogique »[4].
En l’occurrence, dé-moraliser c’est dépolitiser le travail de Flaubert, qui s’oppose pourtant frontalement, à son époque comme aujourd’hui, aux réactionnaires moralistes qui font du foyer le seul lieu d’existence de la femme, et du mariage son seul horizon. Pourquoi refuser que l’auteur, tout bourgeois qu’il était, s’opposait à l’ordre moral terrible mis en place par Napoléon III et que le roman s’oppose encore aujourd’hui aux tenants d’extrême-droite d’un retour à l’ordre moral ?

Agrandissement : Illustration 1

Il est intéressant de constater que Fabienne Dupray termine son article sur cette idée, qui vient contredire la position globalement moderniste et dé-moralisatrice qu’elle soutient dans le reste de son texte, comme on l’a déjà mentionné.
En particulier, elle vient contredire un des arguments selon lesquels on ne peut pas attribuer de morale ou de sens exact aux œuvres d’art puisqu’elles sont « nécessairement susceptible[s] de plusieurs lectures », l’auteur ne devant « pas être tenu pour responsable de celles que son livre autorise sans pour autant les imposer »[5].
Si la plupart des œuvres d’art (et, en fait, la plupart des démarches symboliques et des représentations) sont évidemment susceptibles de plusieurs lectures, cela ne signifie pas qu’elles puissent recevoir toutes les interprétations (comme le suggère Fabienne Dupray en imaginant qu’il y aurait autant de sens différents qu’il y aurait de lecteurs[6]), ni que, dans la variété des interprétations effectivement possibles, il n’y en ait pas certaines qui soient dominantes.
Cette individuation des interprétations, qui nie notamment toute sociologie de la réception, ressemble en fait (et une fois de plus, serait-on tenté de dire) à un argument ad hoc : lorsque c’est pour soutenir le roman, Fabienne Dupray admet, comme on le disait, sa force subversive, ou peut encore faire appel aux « lecteurs contemporains » comme à un « lecteur “idéal” »[7].

Agrandissement : Illustration 2

D’autre part, il me faut signaler que, si je m’inscris en phase avec Fabienne Dupray et Yvan Leclerc sur le caractère subversif du roman, ce n’est sans doute pas en adoptant le même arrière-plan théorique, qui me semble chez eux irrémédiablement lié aux théories modernistes.
On retrouve en effet répété comme un mantra la croyance selon laquelle l’art vit du dépassement, a pour fonction de dépasser ou veut toujours « dépasser les limites qui lui sont imposées »[8].
Plus encore, dans cette conception où l’on devine la figure du génie solitaire et illuminé, on affirme le caractère indissociable de la transgression et de l’art : « Ainsi la possibilité de la transgression, et donc la nécessaire détermination de limites par la censure, serait indispensable au statut même de l’artiste. »[9]
On pourrait discuter pendant longtemps de ce que signifie cette transgression artistique, et de l’habile glissement de la transgression des habitudes d’écriture (qui peut effectivement participer à une définition de la littérature en tant qu’écart) à la transgression des normes morales, dont on ne sait pas bien ce qu’elle a à faire avec l’art.
Transgresser est-il toujours positif ?
Les tristement célèbres écarts de Picasso de la morale, rappelés récemment de manière salutaire par Manon Bril[10], et les excuses qu’on lui a longtemps trouvées, montrent sans aucun doute le caractère profondément nocif de cette conception de l’art et la morale.

Agrandissement : Illustration 3

Il faut accepter le caractère politique de la transgression, plutôt que d’essentialiser celle-ci comme un élément artistique toujours positif, voire indispensable à l’art, ou plutôt il faut assumer le caractère politique de nos jugements sur ces transgressions. Mon jugement moral ne peut être le même selon que l’artiste transgresse le droit à la vie des animaux ou les normes sociales réactionnaires. Je ne peux donc pas m’accorder avec la position qui consiste à garantir toute liberté d’expression aux artistes et regretter avec Fabienne Dupray que la loi condamne « la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, et la négation des crimes contre l’humanité »[11].
Quoi qu’en dise l’autrice, les artistes sont des justiciables comme les autres, et ils sont responsables de leurs actes selon des règles et des normes acquises politiquement[12]. Il ne me semble pas que la censure d’un roman (qui encouragerait, par exemple, l’épuration ethnique des étrangers en France) compromettrait irrémédiablement la production artistique en France.
Une fois de plus la position de Flaubert, si elle est une ligne de défense habile et efficace, ne semble pas pouvoir être intégralement maintenue : « Ma cause [est] celle de la littérature contemporaine tout entière. Ce n’est pas mon roman qu’on attaque, mais tous les romans, et avec eux le droit d’en faire. »[13]
Ce n’est donc pas l’ensemble des romans qu’on défend ici, mais les romans qui viennent subvertir les valeurs morales réactionnaires. On doit à cet égard affirmer notre immoralité, même s’il faut toujours se méfier des mécanismes ethnocentristes et coloniaux qui consistent à projeter nos valeurs contemporaines sur des lieux où des époques éloignés.
Enfin, je crois qu’on doit plus largement se méfier du réflexe de la censure, moyen politique particulièrement radical et violent qu’on ne peut instituer en norme, sous peine de voir un tel pouvoir politique nous échapper et se retourner contre nous. On s’oppose donc alors à la censure non plus pour des raisons morales mais pour des raisons politiques.
Donc il ne faut pas censurer Madame Bovary.

Agrandissement : Illustration 4
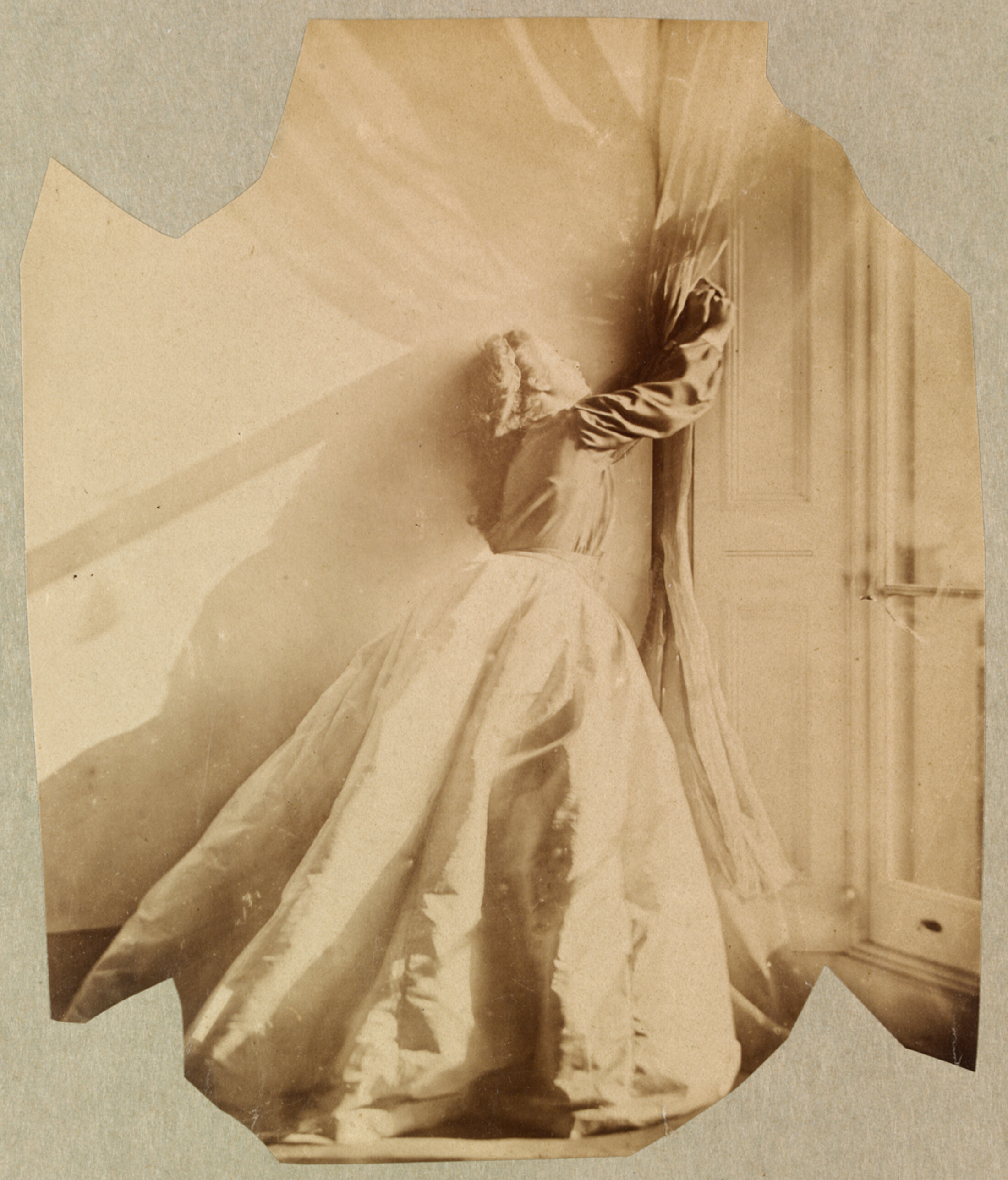
[1] Fabienne Dupray, « Madame Bovary et les juges. Enjeux d’un procès littéraire », Histoire de la justice, no 17, 2007, p. 240, https://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2007-1-page-227.htm (consulté le 17/07/21) (souligné par l’autrice).
[2] Voir billet précédent. Gustave Flaubert, « Lettre à Louise Colet du 16 janvier 1852 », Université de Rouen, 16 janvier 1852, https://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/correspondance/trans.php?corpus=correspondance&id=9900 (consulté le 09/10/21). Cité par Fabienne Dupray, « Madame Bovary et les juges », op. cit., p. 227.
[3] Fabienne Dupray, « Madame Bovary et les juges », op. cit., p. 245.
[4] Yvan Leclerc, Crimes écrits. La littérature en procès au XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, p. 11. Cité par Fabienne Dupray, « Madame Bovary et les juges », op. cit., p. 245.
[5] Fabienne Dupray, « Madame Bovary et les juges », op. cit., p. 242.
[6] « Or, c’est aux lecteurs de se faire leur propre opinion, en individus responsables », Ibid.
[7] Ibid., p. 245 et 242. On détourne cette deuxième citation, dans laquelle l’autrice estimait que le « lecteur ‘idéal’ déterminé par la justice […] ne représente pas l’ensemble des lecteurs véritables. »
[8] Ibid., p. 243, 244 et 245.
[9] Ibid., p. 245.
[10] Manon Bril, « PICASSO = GROSSE MERDE », Youtube, 6 octobre 2021, https://www.youtube.com/watch?v=gsuLpUTs50c (consulté le 06/10/21).
[11] Fabienne Dupray, « Madame Bovary et les juges », op. cit., p. 243.
[12] Fabienne Dupray propose de conserver à l’artiste un statut de « justiciable particulier, en ce qu’il comparaît pour des faits imaginaires » (Ibid., p. 242.). Bien entendu, Madame Bovary n’est pas un objet imaginaire, pas plus que les mots qui le composent. Il y a là une confusion (habile ? maladroite ?) entre « symbolique » ou « fictionnel » et « imaginaire » ou « fictif ».
[13] Gustave Flaubert, « Lettre à Champfleury », Université de Rouen, 4 février 1857, https://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/correspondance/trans.php?corpus=correspondance&id=10207&mot=&action=M (consulté le 09/10/21). Cité par Fabienne Dupray, « Madame Bovary et les juges », op. cit., p. 230.



