Lorsque nous avons constitué avec Bernard Stiegler, fin 2020, l’Association des Amis de la Génération Thunberg (AAGT), il s’agissait avant tout pour nous de percer la toile du réel, y faire de l’air. Sonner l’alarme ne suffisait plus, pour nous autres activistes. Nous devions convertir, avec nos amis du collectif Internation, le devenir suffocant de l’extinction en un champ de possibles – en prenant le temps, dans l’urgence, de les penser et de les panser. Entre générations.
L’AAGT est ainsi devenu un espace-temps privilégié, pour ses membres et ses amis, de suspension de ses propres jugements, postures, opinions ; de ses empressements collectifs. Lieu d’épreuve et de remise en question, visant à accueillir le conflit inévitable qui surgit de cet écart entre monde de l’activisme et celui de la recherche, entre celui des baby-boomers et de la génération Z … entre l’impératif de passer à l’acte, et sa précondition d’une dés-automatisation de nos modes de pensée. Il nous fallait apprendre à convertir, ensemble, nos préconceptions en re-conceptions.
Si Bernard Stiegler nous n’est plus qu’un souvenir, aussi revenant qu’il soit et aussi réactivées que soient ses mémoires, et si Greta Thunberg n’est plus qu’un phénomène médiatique du passé, aussi engagée qu’elle reste pour sa cause, l’étouffement perdure. Les tendances analysées dans le livre Bifurquer se font de plus en plus lourdes et le sentiment général grandit qu’elles sont comme inamovibles. « Nous manquons de résistance au présent » disaient Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans le livre Qu’est-ce que la philosophie. Trente ans plus tard, nous pouvons dresser le même bilan et avec, en prime, une certaine fatalité, une impuissance frustrée. Une résistance qui se manifeste, trop souvent, sous une certaine forme de « survivalisme » … sauve qui peut !
Dans ce contexte, il nous faut retourner à ce que les Grecs appelaient, dans l’antiquité, l’épokhè, soit ce mouvement, cet espace, ce temps – cette danse ? – où le je, avec le nous, peut quelque peu se suspendre du cours ordinaire des choses. Loin de fuir ce dernier, la suspension, comme stratégie politique et philosophique, est une manière de le comprendre et de le saisir, dans toute sa complexité ; une manière de se donner les chances d’une transformation de celui-ci ; de faire un pas de côté[1] ; de ne pas foncer vers les mêmes murs, encore et encore.
Pour témoigner de la nécessité d’expérimenter et d’encourager une épokhè, je vais faire dialoguer Anne Dufourmantelle et Bernard Stiegler, au travers de leurs livres L’éloge du risque et Passer à l’acte ; tous deux étant philosophes de la suspension, ayant pratiqué le saut dans l’intimité du cabinet psychanalytique pour l’une, et de la cellule de prison pour l’autre. Jusqu’à leurs morts.[2]
Pas de côté
Pour Stiegler, « La vocation philosophique ne saurait être une détermination de tel ou tel individu en particulier. Nous tous, et précisément en tant que nous formons un nous, nous serions en puissance voués à la philosophie ».[3] La philosophie ne peut se réduire à une profession, ni même à quelques ‘talents’ : c’est un art à pratiquer collectivement. Nous pourrions le voir comme l’« outil de lutte » qu’invoque Hubert Guillaud, dans son article sur le livre Stuck on the platform, ce « pas de côté qui nous permet de regarder le monde autrement ».
De son côté, Dufourmantelle soutient que la philosophie est par essence « le premier espace de questionnement ». La philosophe et psychanalyste nous encourage ainsi à « ne se fier à aucun concept préfabriqué, prédigéré. Être aussi loin que possible de la pensée figée en postures, en réponses, en certitudes, mais néanmoins penser. » C’est cela, « l’art du suspens » qu’il nous faut développer : « être en suspens dans une balance conceptuelle sans vraiment toucher terre, et choisir de ne pas… Juger, décider, agir. Pas encore, pas tout de suite. »
Une non-action, une non-décision, où pourtant, tant de choses sont rendues capables de se mouvoir et de se déployer, selon la philosophe. « La suspension n’est pas un temps arrêté avant qu’il se passe quelque chose, c’est l’événement même ». Comment effectivement dégager du vide dans « ce qui est saturé de plein », comme le formule Vincent Puig dans sa thèse ? Ce dégagement est aussi nécessaire que l’espace blanc qui séparent ces paragraphes : cet espace en apparence vide, ce silence rempli de tensions et de potentiels, indispensable pour changer de ligne. Une absence de signal, où il se joue quelque chose qui ne peut être récupéré, calculé, traité par un ordinateur (le capitalisme des données peut bien passer, et avec lui, la société du spectacle !).
Cellule de conversion de l’ordinaire
Pour Anne Dufourmantelle, « le ‘en suspens’ est contigu à l’espace de la lettre d’amour, au retrait intérieur, nécessairement spirituel, quoi que l’on désigne par ces mots. » Et c’est en prison que Bernard Stiegler a pu trouver en lui-même « la ressource » de ce retrait, qui fut son passage à l’acte philosophique. « Un passage à l'acte m'a fait plonger accidentellement dans une situation profondément philosophique, qui fut à son tour un passage de la puissance à l'acte - une réminiscence par interruption de l'action et suspension des conditions de la vie ordinaire. Ce fut le début d'une expérience de l'extraordinaire » ; le début d’une certaine lettre d’amour.
Dans cette « épokhè qui était une conversion de ma vie », nous dit Stiegler,[4] « j’avais appris à aimer le silence pour écouter ce qui y survenait toujours si je savais patienter : une autre voix, un soliloque où ce n’était plus moi-même qui parlais, mais l’autre moi, que j’appelais moi-l’autre : l’autre de moi, l’autre que je portais en moi, que je devenais ». Pour ne pas devenir fou – ou en le devenant, c’est selon – Stiegler a fait du défaut du monde extérieur, de son enfermement, « une extraordinaire cellule de conversion de l’ordinaire ».[5] Monde extérieur qui lui était toutefois présent au travers de livres et de traces de mémoire, dont il a fait l’objet premier de sa thèse.
Nous ne pouvons abstraire la philosophie de Bernard Stiegler de cette expérience, constitutive, par laquelle il était « comme un poisson sorti de l’eau », pouvant apercevoir comme « par accident » tout ce milieu de traces et de mémoires extériorisées, qui sont le support du monde et de nos manières de penser. « L'eau est ce que voit toujours le poisson, ce qu'il ne voit jamais » : c’est ainsi que le philosophe se voulait être poisson volant. Et c’est cela, pour Stiegler, le rôle de l’épokhè, « telle qu’elle est à l’origine d’une conversion du regard, d’un changement de façon de penser ». Elle nous convoque à sortir du milieu dans lequel on baigne, à suspendre par intermittence nos automatismes de pensée, d’action, comme condition indispensable à toute transformation et/ou adoption de ce milieu.
Herméneutique de la bifurcation
Vu ainsi, ce n’est ni Épiméthée, qui oublia de donner une qualité unique aux humains comme il le fit pour les autres créatures, ni son frère Prométhée, qui pour compenser ce défaut vola le feu et les arts des dieux, mais Hermès, le messager, qui figure comme le dieu grec de l’épokhè. C’est bien lui qui, dans les mots de James Bridle, « se tient debout et indique d’autres directions, et qui doit être le guide pour un nouvel âge des ténèbres. »[6]. Si « Hermès, révélateur du langage et des paroles, insiste sur l’ambiguïté et l’incertitude de toute chose », alors nous pourrions le désigner comme le messager de l’épokhè : ce qui émerge de sa suspension et de sa remise en question.
« Une compréhension hermétique » souligne comment « la réalité n'est jamais aussi simple, qu'il y a toujours un sens au-delà du sens, que les réponses peuvent être multiples, contestées et potentiellement infinies. » C’est par cette compréhension que nous pouvons dépasser les penchants techno-solutionnistes de l’époque numérique, comme le raconte très bien Bridle :
« Lorsque nos algorithmes ne parviennent pas à converger vers des situations idéales, lorsque, malgré toutes les informations dont ils disposent, les systèmes intelligents ne parviennent pas à appréhender le monde de manière adéquate, lorsque la nature fluide et changeante des identités personnelles ne parvient pas à s'intégrer dans les rangées ordonnées des bases de données, il s'agit là de moments de communication herméneutique. »[7]
Funambules, bras ouverts au vide
Hermès nous effraie ; tout comme le vide, l’espace blanc, le silence. Ces formes in-quantifiables, incontrôlables, pour lesquelles on se risque. Être en suspension, c’est être suspendu au-dessus du vide, se lancer dans tout le vertige de cette situation. « Le funambule risque la chute, surtout lorsqu’il s’immobilise, qu’il s’exerce à se tenir là, presque sans bouger. C’est son propre élan qu’il retient et qui pourtant lui rendrait la stabilité », comme le dit Dufourmantelle. Le risque aussi que, « venant du bord non familier, non apprivoisé du réel », nous rencontrions quelque chose de « non soluble » dans notre identité ; celui de « tenir en soi des contradictions insupportables ».
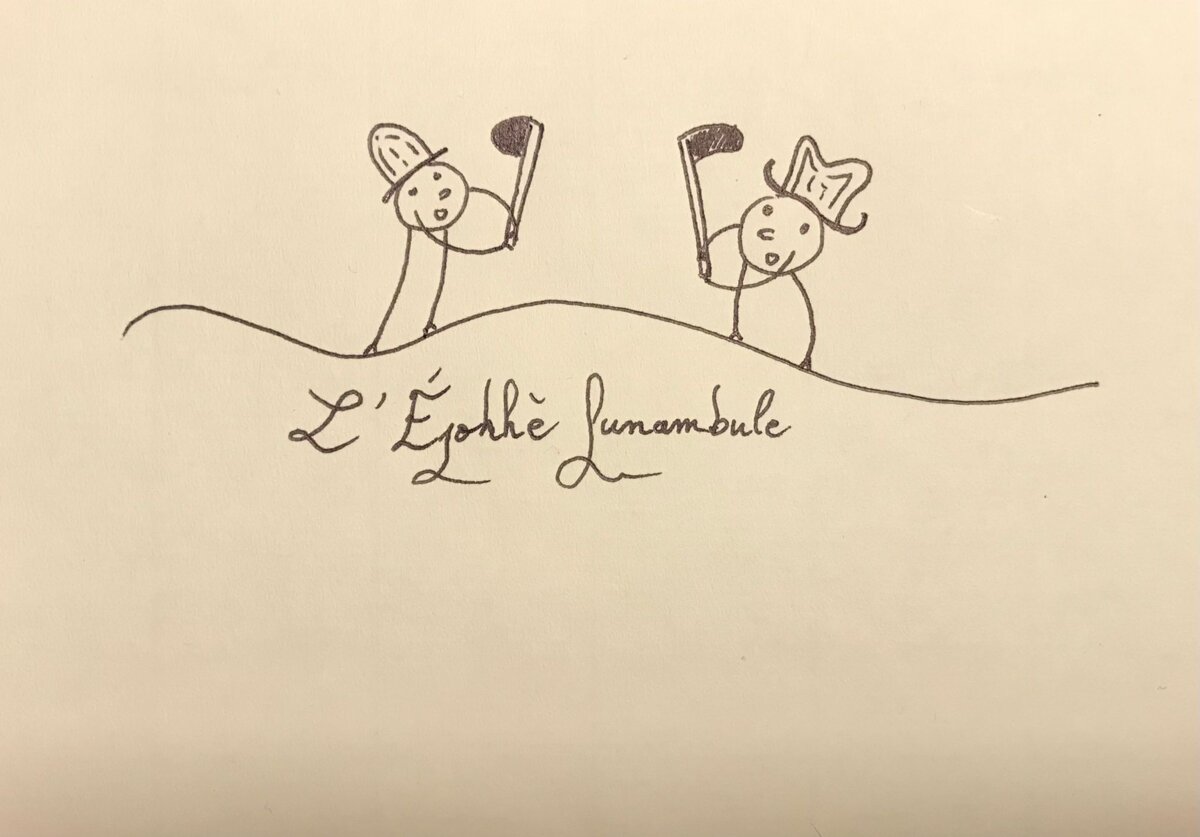
Agrandissement : Illustration 1
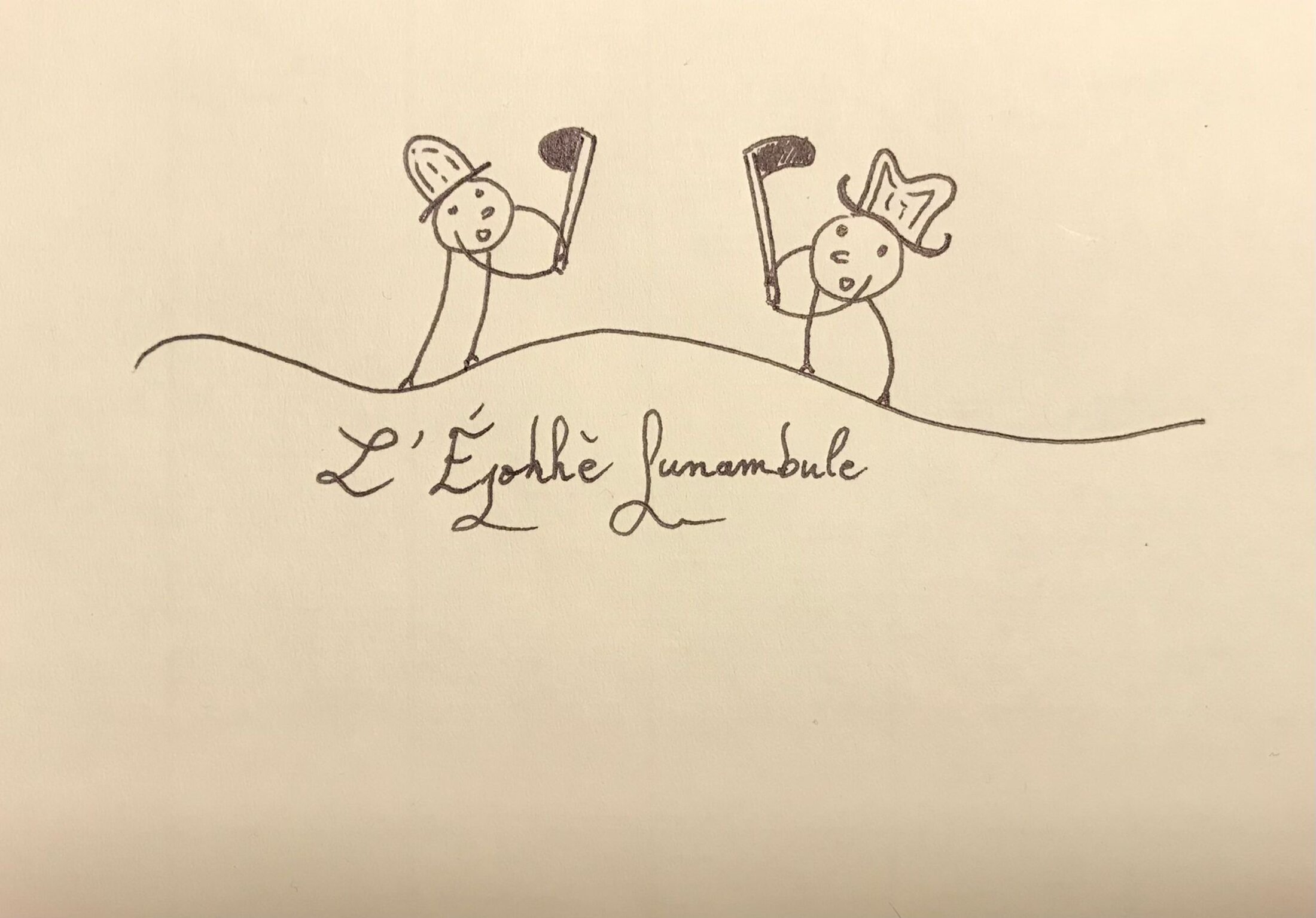
Si je parlais dans cet article de comment les bords « nous tiennent dans un mouvement d’oscillation » et de comment le « parcours du funambule », entre ces bords, est celui d’un « décodage et recodage sans garantie de notre régime techno-social », je dois ajouter aujourd’hui que nous nous devons d’ouvrir nos bras au vide, comme exercice de souplesse. Dans l’épreuve solitaire, et partagée, de la vulnérabilité. Qu’est-ce qui nous en empêche, à l’heure de la 6ème extinction de masse, et face à l’horizon probable de la guerre, de nouvelles formes de fascismes ?
Quand bien même tout serait déjà acté, il n’est jamais trop tard pour faire passer nos puissances à l’acte, en prenant le risque de quelques suspensions. C’est même parce qu’il est déjà « trop tard », qu’il est enfin temps de prendre notre temps.[9] Il nous est encore possible, sur le chemin – qu’importe où il nous mène ? – de nous « attarder là où se meut la pensée, c’est-à-dire aussi l’émotion. Ne rien détruire, observer, pacifier. Laisser la pensée se déployer, s’étendre, se débarrasser de ses scories. Alors le monde s’allège.[10] »
Victor Chaix
Avec les généreuses relectures et apports de Marie Chollat-Namy, Somhack Limphakdy, Maël Montévil, Esther Haberland, Giuseppe Longo et Anne Perrier.
Merci Amélie de m’avoir offert ce super livre d’Anne Dufourmantelle, et merci Emma pour m’avoir encouragé à travailler sur cette figure du funambule, il y a presque un an !
[1] Formule que Giuseppe Longo utilise souvent en pensant à ce que doit être propre à toute activité scientifique, par rapport à ses principes théoriques – le « pas de côté » étant au cœur d'une démarche critique. Voire G. Longo, Le cauchemar de Prométhée. Les sciences et leurs limites (PUF, Paris, 2023).
[2] Notons avec Stiegler que « la philosophie d’un philosophe n’aurait de sens qu’à s’illustrer dans sa manière de vivre – c’est-à-dire de mourir » (Passer à l’acte, page 20), et que tous deux sont partis de par leurs dévouements pour le nous – aussi tragiques que soient leurs derniers gestes.
[3] Passer à l’acte, p. 11.
[4] Dans la disruption, p. 90.
[5] Dans la disruption, p. 92.
[6] James Bridle, New Dark Age, p. 116 (traduit de l’anglais).
[7] Ibid.
[8] Comme l’explique Laurette Colmard, graphiste et typographe avec qui l’Association travaille, le pilcrow « a cela de fascinant qu’il condense, métaphorise l’évolution des supports d’écriture : autrefois utilisé pour marquer un changement d’idée (sans sauter de ligne ! – pour économiser du papier), aujourd’hui absent des livres mais intégré dans les logiciels de traitement de texte comme un caractère masqué, matérialisant un retour à la ligne. »
[9] Comme le formule Somhack Limphakdy, en retour de ces lignes.
[10] Anne Dufourmentelle, L’éloge du risque, chapitre « En suspens », pp. 29-34.



