Blog Labyrinthe des sciences et des arts
C. K. Raju, L'Occident a-t-il inventé la science ? Paris : Hic Sunt Dragones, 2022. Trad. B. Bel
https://hicsuntdracones.fr/loccident-a-t-il-invente-la-science/
https://www.amazon.fr/LOccident-inventé-Science-C-K-Raju/dp/249005063X
Source: C.K. Raju, Is Science Western in Origin? Penang: Multiversity & Citizens International, 2009.
Selon la vision occidentale, la science serait née chez les Grecs pour se développer en Europe après la Renaissance. En s'appuyant sur de nombreuses sources historiques, le mathématicien et physicien C. K. Raju montre que ce récit a été construit en trois phases.
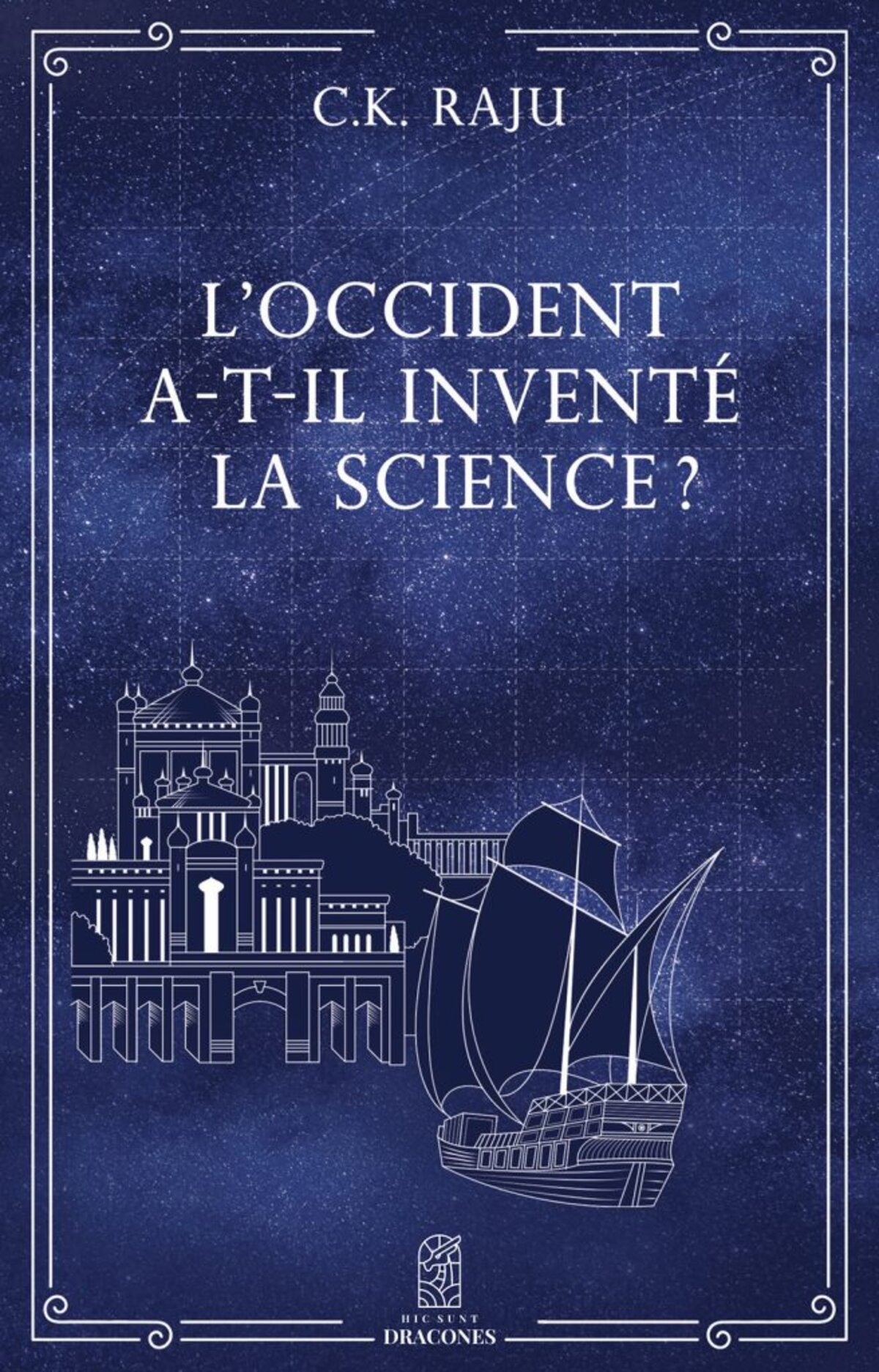
Agrandissement : Illustration 1
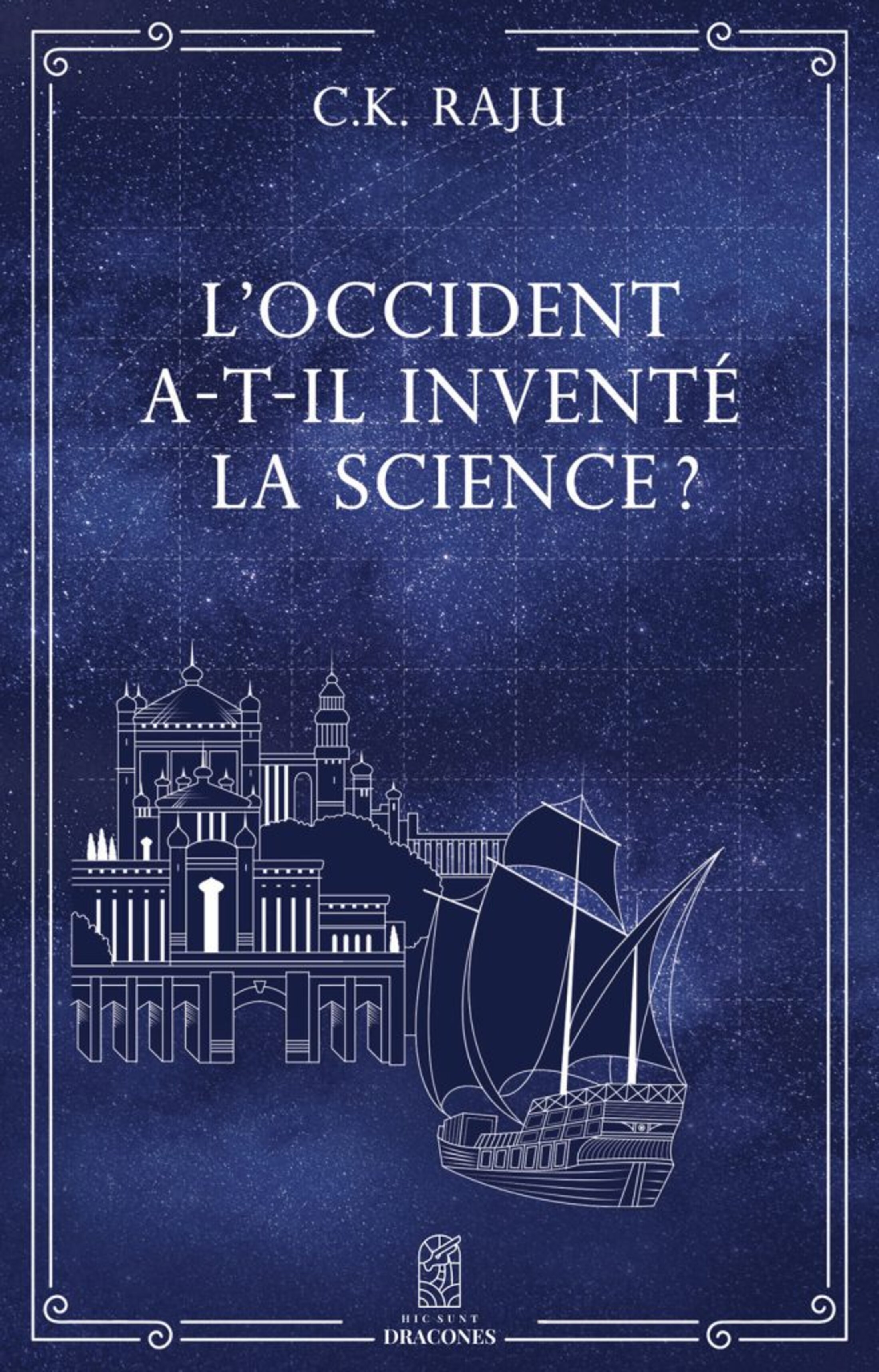
Tout d'abord, pendant les croisades, les connaissances scientifiques du monde entier (Égypte, Perse, Inde…) traduites et inscrites dans des livres arabes, ont été dotées par l'Église d'une origine théologiquement acceptable en les proclamant originaires de la Grèce antique. Les scénarios d'Euclide (géométrie) et de Claude Ptolémée (astronomie), tous deux des personnages fictionnels, sont emblématiques de cette fabrication chrétienne de l'Histoire. L'ouvrage emblématique des mathématiques (Les Éléments) attribué à « Euclide » serait-il l'œuvre de Hypathie, une femme égyptienne noire?
Deuxièmement, pendant l'Inquisition, on a de nouveau assigné aux connaissances scientifiques une identité théologiquement acceptable en alléguant qu'elles n'avaient pas été transmises par d'autres, mais « redécouvertes indépendamment » par les Européens. Les cas de Copernic et de Newton (calcul), dont les sources islamiques et indiennes ont été identifiées, illustrent ce processus de révolution par redécouverte.
Troisièmement, les connaissances ainsi appropriées ont été réinterprétées et alignées sur la théologie chrétienne postérieure aux croisades. Les historiens colonialistes ont exploité cette situation, arguant que la version (théologiquement) « correcte » des connaissances scientifiques (géométrie, calcul, etc.) n'existait qu'en Europe. Cette affirmation de supériorité occidentale est le terreau d'un racisme qui ne se limite pas à la couleur de peau.
Ces processus d'appropriation se poursuivent aujourd'hui encore. Par exemple, l'invention par Russel et Hilbert des mathématiques formelles a institué avec autorité le mélange des mathématiques avec la métaphysique. Cette approche prétendument supérieure (car universelle) est en rupture avec les procédures de validation des sciences expérimentales. La preuve d'une hypothèse scientifique résidant dans sa compatibilité avec des faits réels, elle ne peut être remplacée par un raisonnement axiomatique – excluant toute donnée factuelle.
Concrètement, à quoi nous mène ce constat ? L'auteur se fait l'avocat d'une sécularisation des mathématiques qui passe par l'abandon des mathématiques formelles au bénéfice de mathématiques « normales ». Ces dernières sont faciles pour les étudiants, et ce sont les mathématiques utilisées à la fois dans la vie quotidienne et dans les algorithmes informatiques. Cette sécularisation est vitale pour la « décolonisation des esprits » de peuples autrefois asservis à l'autorité et convertis au système d'éducation des nations impériales.
Présentation de l’auteur
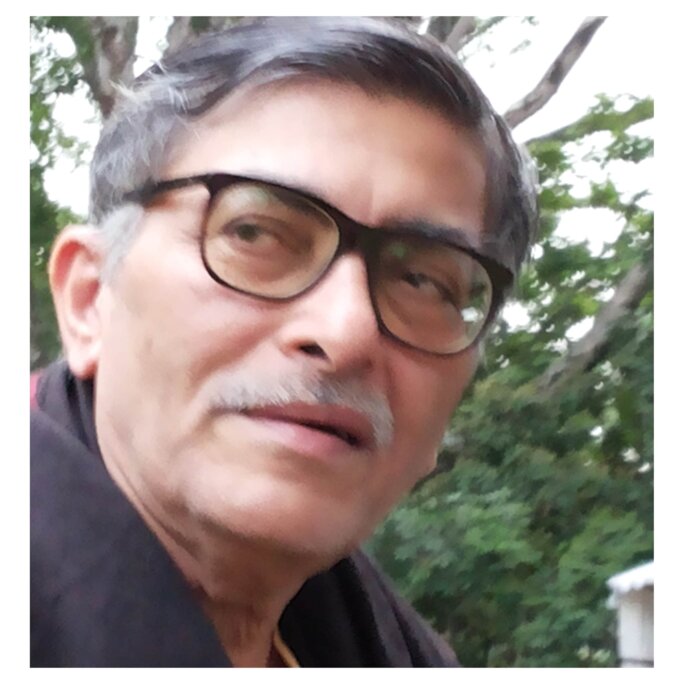
Agrandissement : Illustration 2
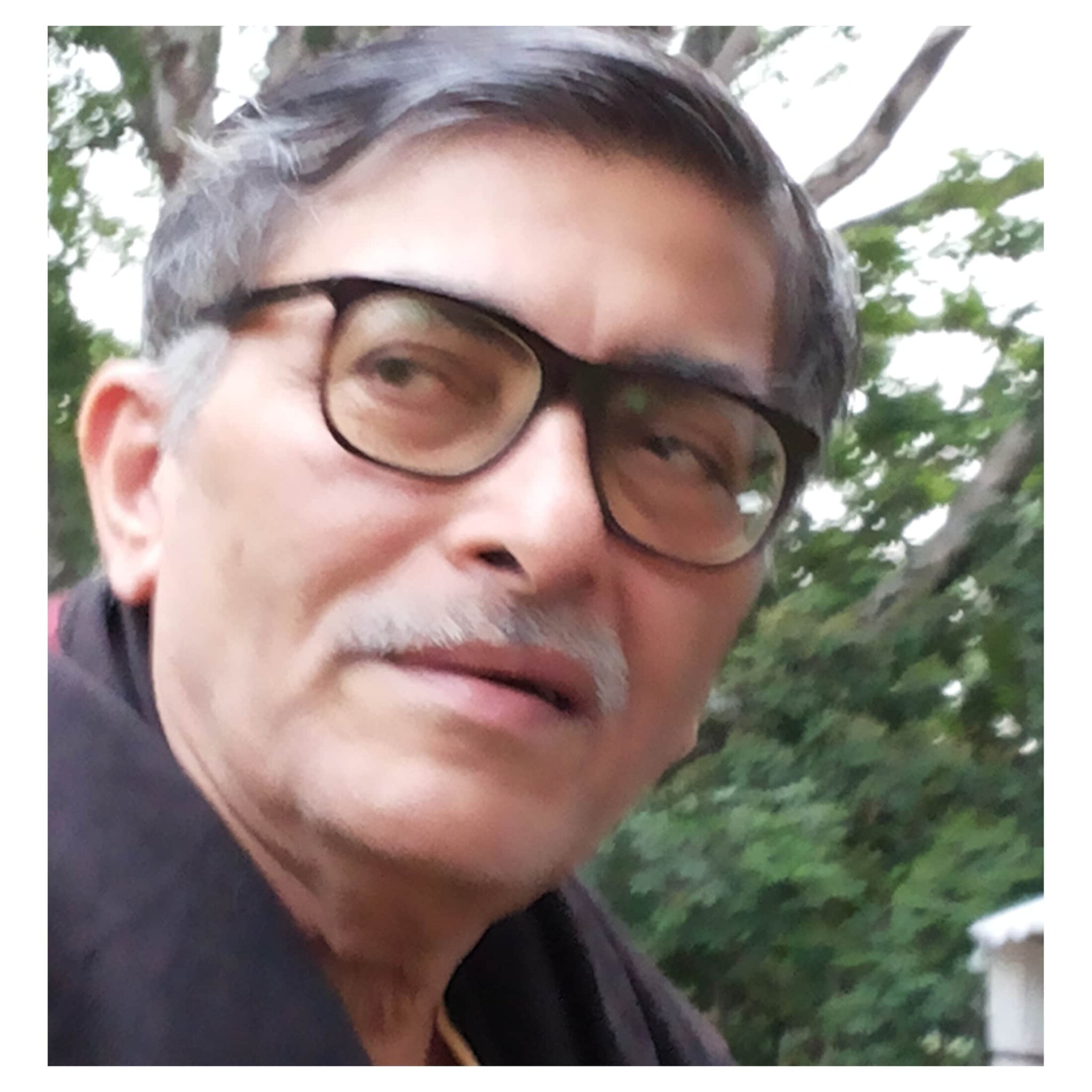
C. K. Raju est titulaire d'une licence de physique, d'une maîtrise de mathématiques et d'un doctorat de l'Indian Statistical Institute. Il a d'abord enseigné à l'Université de Pune, où il a mené des recherches pendant plusieurs années en mathématiques formelles (analyse fonctionnelle). Il a été responsable du portage d'applications sur le premier superordinateur indien PARAM (1988-1991) et a longtemps travaillé comme professeur de mathématiques et d'informatique dans plusieurs universités en Inde et à l'étranger. Il a conçu et maintenu des logiciels à usage éducatif et industriel.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, salués par la critique, mettant en avant des thèses inédites. Dans Time: Towards a Consistent Theory (Kluwer, 1994), il plaide en faveur d'une physique fondamentalement nouvelle utilisant les équations différentielles fonctionnelles, négligées par Einstein. Dans Cultural Foundations of Mathematics: the Nature of Mathematical Proof and the Transmission of the Calculus from India to Europe in the 16 c. CE (Pearson Longman, 2007), il propose une nouvelle philosophie des mathématiques, intitulée le « zéro-isme », liée au développement du calcul en Inde dont il a rassemblé les preuves de la transmission à l'Europe du 16e siècle. Il a par la suite montré comment la correction de l'erreur de Newton au sujet du calcul conduit également à une meilleure théorie de la gravitation, utilisant des équations différentielles fonctionnelles(*).
Dans The Eleven Pictures of Time (Sage, 2003), il a mis en relation la science et diverses religions sous la perspective commune du temps. Dans Euclid and Jesus (Multiversity, 2013), il explique au profane comment des croyances religieuses se sont immiscées dans les mathématiques occidentales.
Raju a démontré, en faisant l'expérience d'enseigner dans cinq universités de trois pays, que l'apprentissage du calcul, tel que conçu en Inde avec le zéro-isme et l'arithmétique « non archimédienne », est suffisamment facile pour être divulgué en cinq jours, permettant aux élèves de résoudre des problèmes difficiles qui ne sont pas abordés dans leur cursus habituel. Il a également créé et enseigné d'autres cours « décolonisés » en mathématiques, physique, statistiques, informatique, histoire et philosophie des sciences.
Dans le domaine des sciences sociales et humaines, il a fait partie du comité de rédaction du Journal of Indian Council of Philosophical Researchet a contribué au Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture. Il a été chercheur associé, puis chercheur Tagore, à l'Indian Institute of Advanced Study et chercheur associé au Nehru Memorial Museum and Library.
Publications et documents partagés : <ckraju.net/cv/>
(*) C. K. Raju, « Functional Differential Equations 1: A New Paradigm in Physics » <physedu.in/uploads/publication/11/200/29.3.1FDEs-in-physics-part-1.pdf> ; « Functional Differential Equations 2: The Classical Hydrogen Atom » <physedu.in/uploads/publication/11/201/29.3.2FDEs-in-physics-part-2.pdf>, Physics Education (India) 29, 3, 2013.
Voir aussi C. K. Raju, « The Electrodynamic 2-Body Problem and the Origin of Quantum Mechanics », Foundations of Physics, 34, 6, 2004, p. 937-962 <arxiv.org/pdf/quant-ph/0511235v1>



