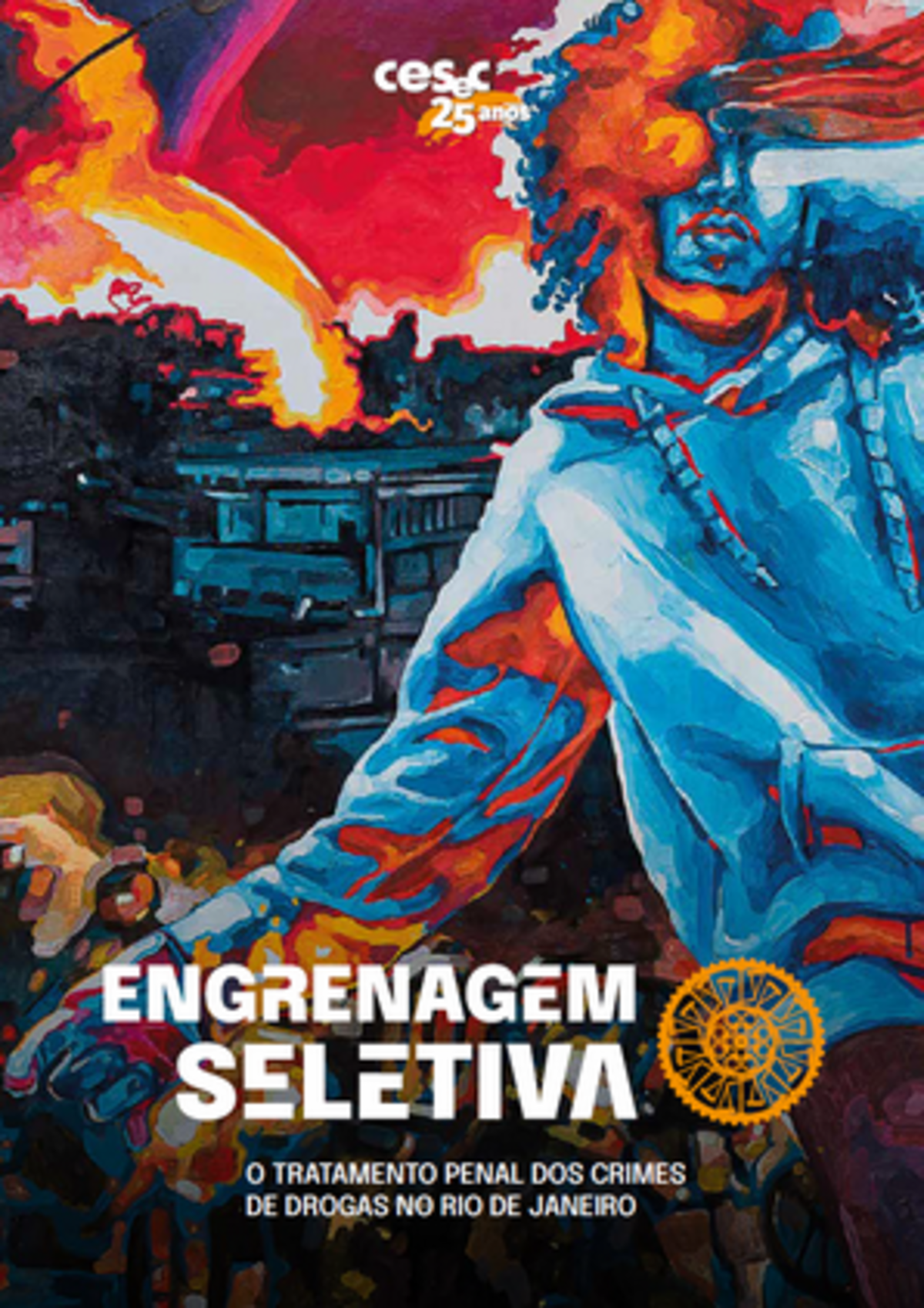
Une étude* publiée lundi 24/11 a montré que le profil racial des personnes poursuivies pour des crimes liés à la drogue devant la justice de Rio de Janeiro devient de plus en plus "noir" à mesure que la procédure judiciaire avance.
Le professeur de droit pénal Salo de Carvalho, coordinateur du Groupe de recherche en sciences criminelles/GCRIM de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) qui a participé à l'analyse des procédures judiciaires, a déclaré que l'idée des chercheurs était de dresser un diagnostic de l'évolution des procédures judiciaires liées aux crimes liés à la drogue dans l'État de Rio de Janeiro.
L'analyse a été réalisée sur la base de toutes les affaires jugées en première instance par la Cour de justice de Rio de Janeiro en 2022 et 2023, dont l'objet principal était les crimes de trafic et d'usage illicite de stupéfiants.
Sur l'ensemble des personnes poursuivies dans l'Etat de Rio de Janeiro, en vertu de la loi sur les stupéfiants, 69 % sont noires. Mais au fur et à mesure que l'affaire progresse, les Blancs bénéficient de plus d'avantages et la proportion devient encore plus inégale : les Noirs représentent 75 % des personnes mises en examen et 77 % des personnes condamnées.
Les Noirs et les métis représentent 56 % des personnes qui se voient proposer un accord par le ministère public (MP-RJ) pour mettre fin à la procédure. En outre, ils reçoivent en moyenne 300 jours de peine supplémentaires par rapport aux Blancs.
Au total, 3.392 cas ont été recensés, dont 911 pour possession à des fins personnelles, 2.169 pour trafic et 1.212 pour association de malfaiteurs en vue du trafic. L'analyse des cas de possession à des fins personnelles a été effectuée sur l'ensemble des procédures. Dans les autres cas, les auteurs ont utilisé des échantillons.
L'analyse par type de crime montre une proportion plus élevée de Noirs dans toutes les classifications observées, la surreprésentation la plus importante étant dans l'association pour le trafic (87,5 %). Le profil est, comme l'ont déjà montré d'autres études, masculin et jeune.
La durée moyenne de la peine pour les Blancs est de 810 jours, tandis que les Noirs ont reçu, dans l'intervalle observé, une moyenne de 1.172 jours.
Les interpellations pour comportement suspect sur la voie publique apparaissent également comme les faits les plus fréquents à l'origine des procédures, représentant 41,9 % du total des cas étudiés, bien qu'une proportion similaire, 41,2 %, ne soit assortie d'aucune motivation.
L'étude estime que les personnes noires et pauvres ont moins de chances de se voir proposer un accord pénal par le ministère public. Cet accord est proposé aux personnes considérées comme des consommateurs de drogue et peut mettre fin à la procédure si elles respectent certaines mesures alternatives.
« Si vous êtes blanc ou si vous avez un statut socio-économique plus élevé, vous aurez beaucoup plus de chances de bénéficier d'un accord. C'est encore plus grave : nous avons constaté que souvent, les personnes blanches n'arrivent même pas à l'accord, car la procédure est classée avant », affirme la sociologue Julita Lemgruber, directrice du CESeC.
« Si vous vivez dans une favela et que vous êtes en possession de drogue, vous devez être un trafiquant », dit-elle à propos de l'interprétation des informations contenues dans le dossier par les juges. « Et cela peut être avec les mêmes quantités que celles qui, dans la zone sud de Rio de Janeiro ou dans le quartier richissime de Jardins, à São Paulo, vous auraient permis d'être acquitté », affirme-t-elle. Et rajoute : « Maintenant que nous avons analysé les procès de bout en bout, nous savons que ce qui fait tourner cette machine, c'est le racisme structurel dans la société. »
La professeure critique également les effets de la Súmula 70, une règle qui permet de condamner un accusé sur la seule base des témoignages de policiers. Le document a été modifié à la fin de 2024 afin d'exiger la cohérence avec d'autres preuves. Les procès inclus dans l'étude sont antérieurs à cette révision. « Cela n'existe nulle part ailleurs au Brésil, dans aucun des autres 26 autres Etats, c'est une création du TJRJ. Si le témoignage de la police incrimine quelqu'un, cela suffit comme preuve. Il n'y a pas de contradiction. »
Dans les procès où cette règle est mentionnée, 89,1 % des accusés sont condamnés, contre 28,3 % dans ceux où elle ne l'est pas. Il y a également plus de condamnations lorsqu'il est fait mention des favelas et de la domination des factions criminelles.
Pour Julita Lemgruber, la manière d'aborder le problème de la drogue dans le pays reste la même depuis l'époque où elle était responsable du système pénitentiaire de l'État, dans les années 1990. « Il faut accepter le fait que vous ne résoudrez pas le problème du trafic de drogue dans les favelas par la violence. La police militaire a tué [29 octobre 2025] 117 personnes, aujourd'hui il y en a 117 autres pour prendre leur place », a-t-elle déclaré, en référence à l'opération policière Contenção, qui a fait cinq morts parmi les policiers militaires, en plus des 117 civils.
Contacté par de nombreuses rédactions, le ministère public de Rio de Janeiro a déclaré qu'il ne commentait pas les recherches ou les analyses externes, mais uniquement les cas concrets, selon le contenu des dossiers. La Cour de justice de l'État de Rio de Janeiro n'avait pas répondu au moment de la publication de cet article.
------
(*) “Engrenagem Seletiva – O tratamento penal dos crimes de drogas no Rio de Janeiro” (PDF, 72 pages).
Une réalisation du Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), en partenariat avec le Grupo de Pesquisa em Ciências Criminais (GCrim) de l'université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) et le Laboratório de Análise de Violência (LAV) de l'université de l'Etat de Rio de Janeiro (UERJ).



