Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM
----------------------------------------------------
“ La Palestine n'est pas notre terre natale ”
----------------------------------------------------
Le projet de Theodor Herzl fera un flop dans la communauté juive de France. La formation d'un Etat juif en Palestine n'est pas du tout un projet populaire dans les pays où ces derniers sont très minoritaires, comme la France, où depuis la Révolution Française il s'agit, pour certains représentants, de "tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus" (Stanislas de Clermont-Tonnerre, député de l'Assemblée Nationale, discours du 23 décembre 1789), et du côté de certaines organisations hébraïques, de "travailler partout à l’émancipation et aux progrès moraux des Israélites" (statuts de l'Association Israélite universelle, in Weill, 2010). Le dépit de Herzl est donc à la hauteur de la résistance du bastion antisioniste français, au sein duquel on trouvait en particulier l'Alliance israélite universelle, les Consistoires ou encore le Rabbinat (Benbassa, 1989). Aux Etats-Unis, par exemple, les convictions du rabbin réformé américain Isaac Mayer Wise (1819-1900) sont on ne peut plus claires : "Nous dénonçons toute cette affaire d’un Etat juif comme étrangère à l’esprit du Juif moderne de ce pays, qui considère l’Amérique comme sa Palestine, où se placent tous ses intérêts" (Laqueur, 1972).
Beaucoup de juifs séfarades étaient sur la même longueur d'onde : "Dans l’ensemble...les Juifs séfarades palestiniens étaient soit opposés, soit indifférents au sionisme et étaient souvent accusés par les dirigeants sionistes d’être des « assimilationnistes », indiquant leur désir de faire partie de la société arabe et affirmant leur citoyenneté ottomane." (Salim Tamari, Issa al Issa's Unorthodox Orthodoxy : Banned in Jerusalem, Permitted in Jaffa / "L'orthodoxie peu orthodoxe d'Issa : interdite à Jérusalem, autorisée à Jaffa", article paru dans Institute for Palestine Studies, N°59, été 2014).
En Allemagne aussi, les Juifs veulent croire à l'intégration : "À partir de 1880, et malgré l’antisémitisme, le nombre de mariages mixtes chez les juifs allemands ne cesse d’augmenter : entre 1901 et 1929, la proportion passe de 16,9 à 59 %" (Alain Gresh, op. cité). Ceux qu'on appellera assimilationnistes sont la grande majorité en Allemagne et s'opposeront vigoureusement aux sionistes, conflits qu'a bien explorés l'historien Avraham Barkai (1921-2020) :
"En général.. les relations entre les membres du CV (1) et le mouvement sioniste sont faites d'affrontements : les sionistes s'opposent à la collusion entre le CV et le Hilfsverein der deutschen Juden [Association d'Entraide des Juifs allemands, NDA] (issu de l'AIU) au moment de la «guerre des langues «(1912-1913), et les partisans de Herzl semblent «trahir «l'Allemagne en favorisant une solution britannique pour l'accomplissement de leurs visées à partir de 1917. Au-delà d'options stratégiques opposées, c'est sur le fond que s'opposent les deux camps ; car pour le CV rien ne peut détacher les Juifs allemands de leur patrie (comme l'écrit l'un des fondateurs, Eugen Fuchs: «Nous ne parlons pas l'hébreu, la Palestine n'est pas notre terre natale... ce n'est même pas le pays de nostalgie, la patrie à laquelle j'aspire... je parle l'allemand, ressens en tant qu'Allemand; la culture allemande et l'esprit allemand me remplissent plus que la poésie hébraïque et la culture juive. Lorsque je suis à l'étranger, c'est vers l'Allemagne, la nature allemande et mes compatriotes allemands que se tourne ma nostalgie»" (Trimbur, 2002, citations d'A. Barkai : voir bibliographie).
(1) CV : Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens : Association centrale des citoyens allemands de confession juive, créée en 1893.
Ni colonialiste, ni assimilationniste, le mouvement sioniste socialiste du Bund (2) est quant à lui "partisan d’une autonomie juive au sein des États d’Europe centrale et orientale" (Vidal, 2001).
"[...] le but final du sionisme politique ‑ la création d'un territoire pour le peuple juif ‑, pour autant que ce territoire n'en pourrait accueillir qu'un segment réduit, est une question de portée limitée et ne peut pas résoudre la “question juive”. Dans la mesure où le sionisme prétend concentrer en [Palestine] le peuple juif tout entier ou du moins sa majorité, ce congrès le considère comme une utopie irréalisable."
Extrait de la résolution adoptée par le 4 e congrès du Bund, tenu en 1901.
(2) Bund : Désigne l'Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, Pologne et Russie. L'organisation nationaliste et socialiste "prône le yiddish comme langue nationale et une autonomie politico-culturelle conforme aux thèses de ceux que l’on appelle les « austro-marxistes" (Alain Gresh,, op. cité).
Réagissant aux ratiocinations des intellectuels du Bund sur la question sioniste, Lénine émettra plus tard un avis beaucoup plus tranché, à l'encontre de la pensée sioniste, contrairement à l'austro-marxiste Otto Bauer, par exemple, qui pensait le peuple juif comme une nation :
"Notre tâche n'est pas de prêcher ou de tolérer le mot d'ordre de la culture nationale, mais de lutter au nom de l'internationalisme contre nos propriétaires fonciers et nos grands bourgeois russes, contre leur « culture », en « s'adaptant » aux particularités des Pourichkévitch et des Strouvé. On doit en dire autant de la nation la plus opprimée et la plus traquée, la nation juive. La culture nationale juive, c'est le mot d'ordre des rabbins et des bourgeois, le mot d'ordre de nos ennemis. Mais il est d'autres éléments dans la culture juive et dans toute l'histoire juive. Sur les 10 millions et demi de Juifs existant dans le monde entier, un peu plus de la moitié habitent la Galicie et la Russie, pays arriérés, à demi sauvages, qui maintiennent les Juifs par la contrainte dans la situation d'une caste. L'autre moitié vit dans un monde civilisé, où il n'y a pas de particularisme de caste pour les Juifs et où se sont clairement manifestés les nobles traits universellement progressistes de la culture juive : son internationalisme, son adhésion aux mouvements progressifs de l'époque (la proportion des Juifs dans les mouvements démocratiques et prolétariens est partout supérieure à celle des Juifs dans la population en général). Quiconque proclame directement ou indirectement le mot d'ordre de la « culture nationale » juive est (si excellentes que puissent être ses intentions) un ennemi du prolétariat, un partisan des éléments anciens et frappés d'un caractère de caste de la société juive, un complice des rabbins et des bourgeois. Au contraire, les Juifs marxistes qui se fondent dans des organisations marxistes internationales avec les ouvriers russes, lituaniens, ukrainiens, etc., en apportant leur obole (en russe et en juif) à la création de la culture internationale du mouvement ouvrier, ces Juifs-là, qui prennent le contre-pied du séparatisme du Bund, perpétuent les meilleures traditions juives en combattant le mot d'ordre de la « culture nationale »."
Lénine, Notes critiques sur la question nationale, ch. 2, La «culture nationale », 1913
--------------------------
Un “ peuple parasite”
--------------------------
Herzl est loin d'être le seul à rejeter plus ou moins violemment ses coreligionnaires juifs opposés au projet sioniste, tout en sachant qu'une très large majorité d'Israélites dans le monde ne s'y intéressent pas du tout ou y sont carrément opposés : "les juifs français sont hostiles au projet. Je ne m'attendais pas à autre chose. Leur situation ici est trop bonne pour qu'ils envisagent un changement (...) Je dirai pour conclure que, pour nous, les Français israélites — si cela existe vraiment — ne sont pas des juifs et que notre cause ne les concerne pas." (T. Herzl, Lettre à Zadoc Kahn du 18 mars 1898, citée par C. Nicault, La France et le sionisme, 1897-1948. Une rencontre manquée, Paris, Calmann-Lévy, 1992, p. 39-40).
C'est avec la même volonté farouche et intolérante que les maskilim (sing. maskil : "Philosophes des Lumières" de haskala, haskalah : "raison", "intellect", et par extension : Lumières juives), puis les premiers sionistes, "souvent d'anciens maskilims déçus" (Nicault, 2001), vont concevoir une idéologie essentialiste de la judéité, recherchant comme Klatzkin, un jüdischer Volltypus, "type juif complet" (Baisez, 2009), ou encore un "Juif régénéré", cet "être nouveau" recherché par le médecin et romancier Max Nordau (1849-1923), d'abord au sein même des sociétés européennes puis, au sein d'un nouvel Israël, débarrassé de toutes les tares dont ces penseurs juifs accablent leur propre communauté, qualifiée même de "peuple parasite" par le penseur Aharon David Gordon, 1856-1922 (Charbit, 1998). Alors, pour recouvrer une prétendue plénitude antique, ces sionistes réclament pour les Juifs une langue et un territoire communs, prêts à renier tous les Juifs, assimilationnistes en tête, qui se mettront en travers de leur route, comme le rabbin de Lublin, Jacob Klatzkin (1882-1948) :
"Le judaïsme sera à son tour déterminé et certifié par le critère national séculier. Le terme de Juif obtiendra une signification nationale égale à celle des termes d’Allemand, de Français, d’Anglais. Juif, c’est-à-dire véritable Hébreu, désignera dès lors celui dont la patrie est la Terre d’Israël et dont la langue est l’hébreu. Tous ceux qui appartiennent prétendument à notre groupe ethnique (Stamm) et autres soi-disant coreligionnaires, qui ont une autre patrie, qui sont enracinés dans une autre langue et une autre littérature et qui vivent et meurent pour une autre communauté, ceux-là ne pourront plus abuser du nom de Juif ; il ne leur sera pas non plus imposé contre leur gré. […] La création d’un centre national pour le judaïsme ne signifie rien d’autre que la transplantation du judaïsme dans un pays, son enracinement dans une patrie, dans une seule et unique forme, avec toute la précision et la prégnance nationales. "
Jakob Klatzkin, Probleme des modernen Judentums : "Problèmes du judaïsme moderne", 1918, Berlin, Jüdischer Verlag, p. 70-71 et 76.
Ben Gourion eut sur le sujet, comme sur d'autres, un avis radical, pensant que les "Juifs d'Orient ont perdu l'esprit ancestral et le rôle qu'ils jouaient autrefois dans la nation juive a décliné ou totalement disparu. Au cours des derniers siècles, la nation a été portée par les Juifs d'Europe, que ce soit en termes de qualité ou de quantité." (B. Gourion, cité par Segev, 1984). Ainsi, tout en proclamant que le sionisme va libérer tous les Juifs, les dirigeants sionistes européens feront venir les Juifs séfarades en Palestine pour des besoins spécifiques, où ils seront "systématiquement discriminés par un sionisme qui déploiera de manière différenciée son énergie et ses ressources pour avantager constamment les Juifs européens et desservir tout aussi constamment les Juifs orientaux." (Shohat, 1988).
"L'émigration portera exclusivement sur l'Europe où se concentre le «matériel humain » juif de qualité. Les autres, les séfarades, ne sont pas conviés au départ quand bien même ils sont en butte à l'antisémitisme, comme en Algérie où les «prédicateurs ambulants » les vouent aux gémonies." (Courbage, 2008).
Ben Gourion, toujours, "peu sensible plus tard à la Shoah" (op. cité, ci-dessous), selon Tom Segev, ira même jusqu'à envisager sacrifier un grand nombre de Juifs pour la cause sioniste si la nécessité se faisait sentir, selon une ligne de conduite constante chez lui que le "nouvel historien" israélien décrit patiemment dans une somme inégalée à ce jour, intitulée מדינה בכל מחיר : Un État à tout prix , sous-titrée : La vie de David Ben Gourion, Crown, 2018 (voir aussi sur le sujet le très bon article de Catherine Nicault : La Shoah et la création de l'État d'Israël : où en est l'historiographie ?, dans Cahiers de la Shoah, 2002/1 n°6, pp. 161 à 204).
"Si je savais qu'on pouvait sauver tous les enfants [juifs] d'Allemagne en les envoyant en Angleterre mais seulement la moitié d'entre eux en les envoyant en Palestine, je choisirais cette dernière option parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre en compte le nombre d'enfants mais de tenir également compte de l'histoire du peuple juif." (B. Gourion, discours devant le comité central du parti Mapai (3), décembre 1938) : "sa volonté de payer le prix d'un sacrifice humain aussi terrible pour atteindre les buts du sionisme correspondait à une position qui a toujours été la sienne depuis qu'il a mis les pieds en Palestine." (T. Segev, Un Etat... op. cité).
En 1936, c'est en tant que président de l'Agence juive (créée en 1929) que Ben Gourion, toujours, renvoie vers l'Europe des groupes de Juifs européens installés en Palestine, parce qu'il les voyait comme un fardeau et qu'il se préoccupait comme d'une guigne de leur sort (op. cité).
(3) Mapai : acronyme de Mifleget Poalei Eretz Israël : "parti des Ouvriers d'Eretz Israël", issu de la réunion des deux mouvements HaPoël HaTsair et Ahdout Haavoda.
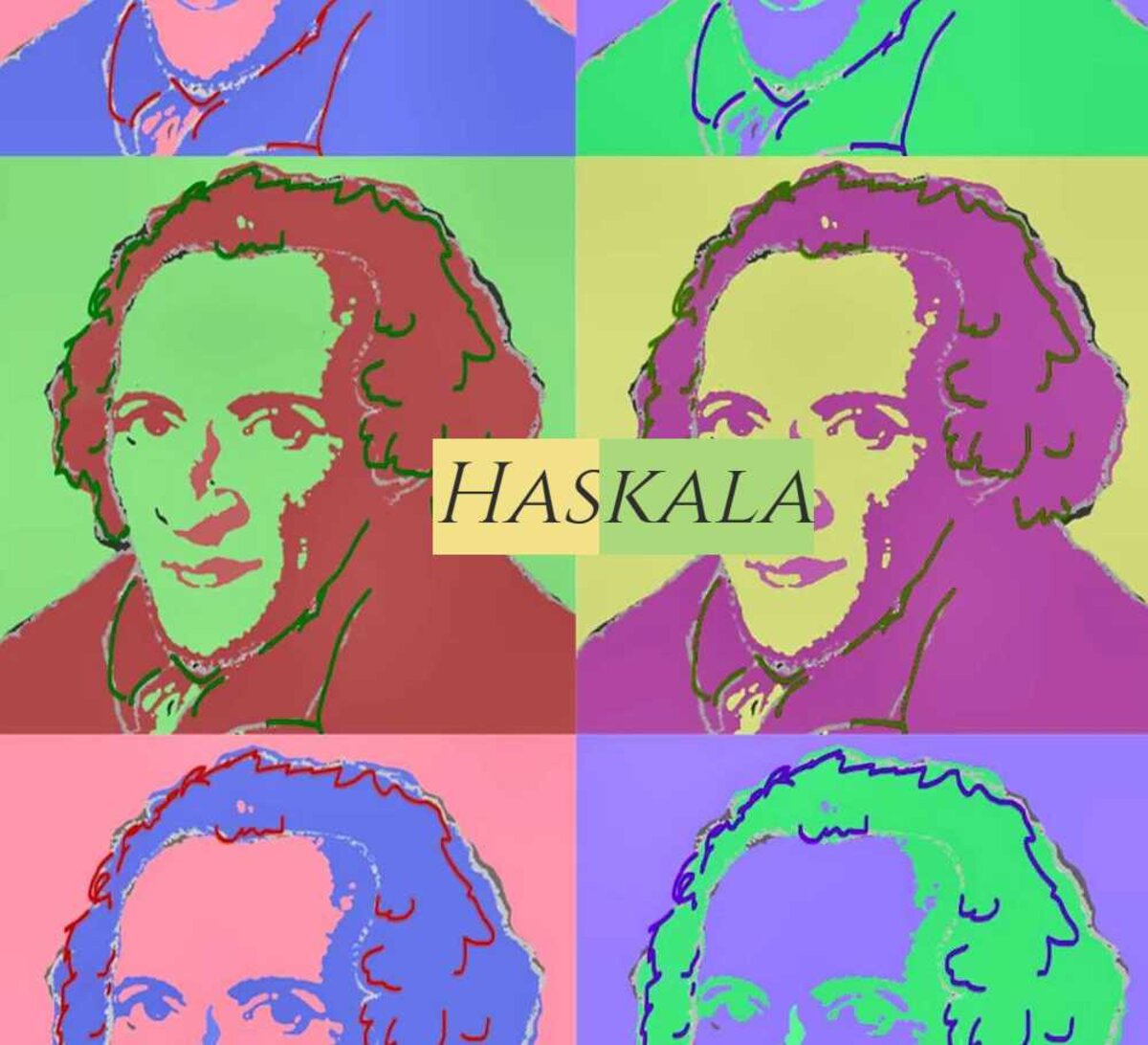
Agrandissement : Illustration 1
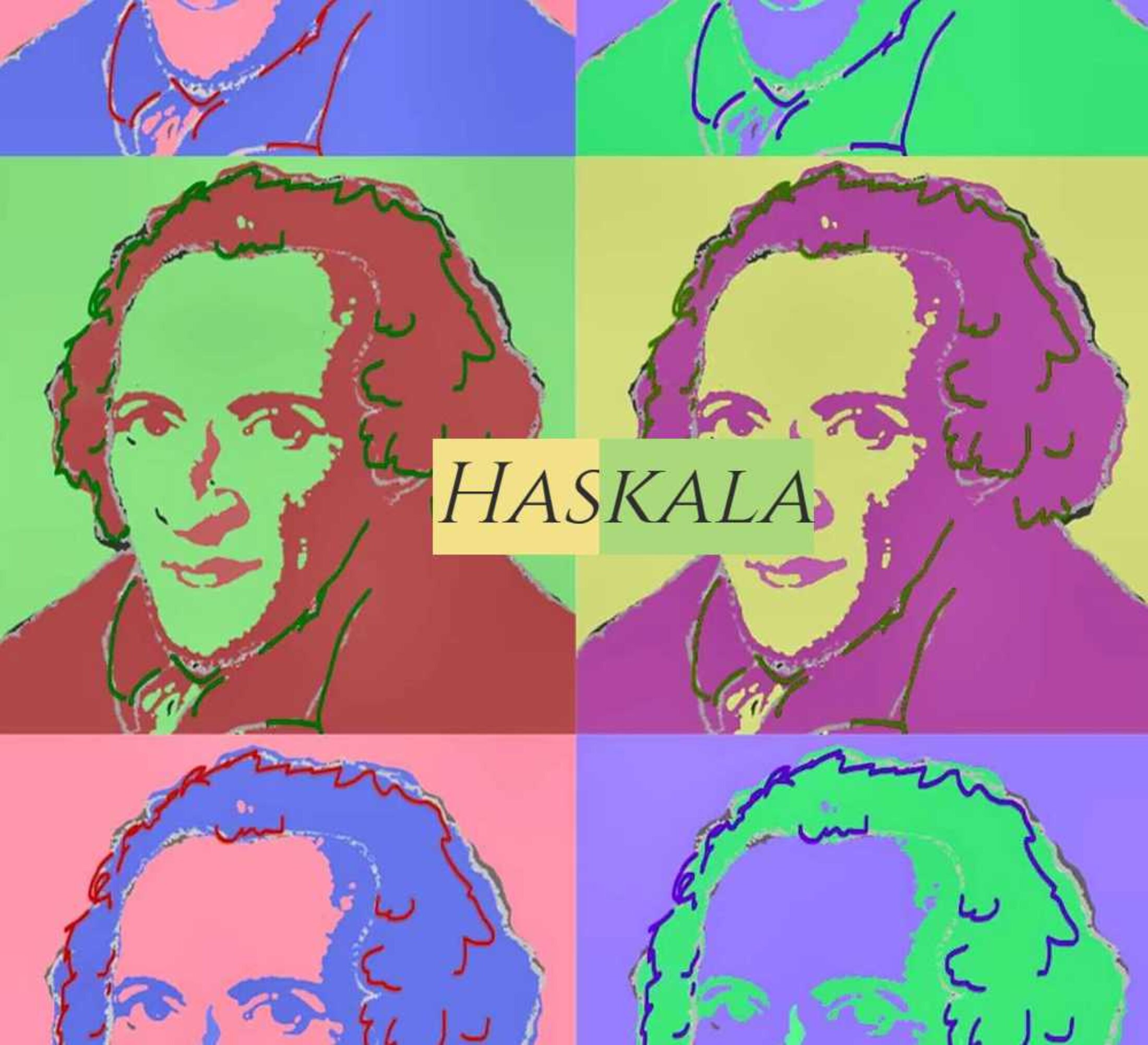
Dans ce mouvement de renaissance judaïque qu'est l'Haskala les maskilim œuvrent à la promotion et à la diffusion de la culture, en particulier la littérature et la langue, l'hébreu n'étant plus depuis la lointaine occupation romaine qu'une langue écrite, à usage religieux. Le plus connu des rénovateurs de l'hébreu se nomme Eliezer Ben Yehuda (Yehouda, 1858-1922), d'origine lithuanienne, qui émigre en Palestine en 1881 et travaille à moderniser, à codifier un hébreu moderne, afin qu'il soit parlé quotidiennement, au travail ou chez soi, en particulier dans son Thesaurus de la langue hébraïque (1889) ou dans son journal Ha-Zvi (ha-Tsevi, qui devait s'appeler Ha Hor : "Lumière", nom dont il n'a pas reçu de licence ottomane). En 1882, Ben-Yehuda écrivait :
"L’objectif est de faire revivre notre nation sur son territoire… si seulement nous parvenons à accroître ici notre nombre jusqu'à ce que nous représentions la majorité…. A ce jour, on compte cinq cents mille Arabes, qui ne sont pas très forts, et à qui nous arracherons facilement le pays, si seulement nous le faisons au travers de stratagèmes et sans attirer sur nous leur hostilité avant de devenir les plus forts et les plus nombreux." (E. Ben Yehuda et Yehiel Michael Pines, octobre 1882, cité par Morris, 1999)
Là, encore, nous retrouvons la stratégie de dissimulation, de ruse, invoquées par les sionistes pour parvenir à leurs fins en évitant aussi longtemps que possible les hostilités frontales : nous examinerons en détail leurs applications concrètes. Nous verrons au fur et à mesure que ces quelques lignes résument parfaitement la stratégie longtemps adoptée par les sionistes pour atteindre leurs objectifs de domination. Cependant, un autre courant de l'haskala évoque davantage ce "sionisme spirituel" ou "sionisme culturel" des Lumières juives, au sein duquel œuvrait un tout petit nombre d'humanistes juifs qui avaient un regard autrement plus clairvoyant sur la situation. Citons un des plus connus d'entre eux, Ahad Haam (A’had, Achad Ha’am, pseudonyme d'Asher Ginsberg, 1856-1927), chef de file de ce mouvement culturel et qui sera très opposé à Herzl, quant à lui chef de file historique du sionisme politique et directeur de Ha-Shiloah ("Le Messager"). Cette première revue moderne en langue hébraïque a vu le jour grâce au soutien financier du magnat juif du thé, d'origine russe, Kalman Zeev Wissotsky (1824-1904), qui contribua comme d'autres riches philanthropes juifs, au développement de la colonisation en Palestine. Dès 1891, pourtant, au sein même du mouvement sioniste, Haam mettait en garde sur les dangers de la colonisation juive en Palestine :
"Nous avons l’habitude de croire, à l’étranger, que la Palestine est une terre presque entièrement désolée, un désert non cultivé, un champ en friche, où quiconque désireux d’y acheter des terrains pourrait se rendre et en acquérir à sa guise. En réalité elle ne l’est pas : sur toute cette terre, il est difficile de trouver un champ de terre arable non semée ; il n’y a plus que des champs de sable et des collines pierreuses... Nous avons l’habitude, à l’étranger, de croire que les Arabes sont tous des sauvages du désert, un peuple pareil à l’âne, incapables de voir et de comprendre ce qui se passe autour d’eux. C’est là une grande erreur... Les Arabes, notamment ceux des villes, voient et comprennent le sens de nos actions et de nos aspirations en Palestine, mais ils se taisent. Ils affectent de ne rien savoir car, pour le moment, ils ne voient dans notre action aucun danger pour leur avenir. Ils s’efforcent de nous exploiter au mieux, de tirer parti de ces nouveaux hôtes... (...) Mais le jour où la présence de notre peuple prendra une dimension telle qu’elle empiète, de peu ou de beaucoup, sur les positions des autochtones, ce n’est pas de bon gré qu’ils nous céderont la place (...) Nous devons traiter les autochtones avec affection, conformément au droit et à la justice. Or, que font nos frères en Palestine ? Exactement le contraire. Ils ont été serfs dans la diaspora, et maintenant qu’ils peuvent jouir d’une liberté sans limite, ils deviennent à leur tour des tyrans. Ils traitent les Arabes avec animosité et cruauté, les privent de leurs droits... et personne parmi nous ne s’oppose à cette attitude méprisable et dangereuse"
Ahad Haam, Emet me-Ertz Israel : "La vérité sur Eretz-Israël", article de 1891 paru dans la revue pétersbourgeoise HaMelitz
En amont de cette critique contre le nationalisme sioniste, il invoquait un danger spirituel encore plus important à ses yeux, dont le principe moteur est la paix :
"...le judaïsme avait toujours donné la préséance à l'idéal abstrait ; il avait toujours relégué la force physique au second plan. « L'Ecriture » était au-dessus du « Sabre ». En faisant cela, il voulait empêcher les individualités de se mettre trop en avant aux dépens de la masse. Le judaïsme d'est toujours efforcé à faire perdre à l'homme le « sens de la terre » ; et le Juif réel, le Juif en chair et en os n'était qu'un pendant du Juif moral, du Juif réduit à une entité abstraite. Dans ces conditions, il est impossible que le Juif continue à vivre parmi les autres peuples, ou qu'il songe même à se créer une existence nationale sur un terrain à lui. Or, à l'heure actuelle, voici que se réveille chez nous le désir d'une renaissance nationale ; il faut donc pour mettre d'accord nos conceptions morales avec ce désir matériel, transformer les valeurs morales qui prédominent chez nous. Il nous faut donc jeter à bas tout l'édifice historique élevé par nos ancêtres. Car il est construit sur la base d'une dangereuse erreur, à savoir : la prédominance de l'esprit sur la matière et la subordination de la vie individuelle à la loi générale et abstraite."
A. Haam, "Les idées de Nietzsche et le judaïsme", dans L'Écho sioniste, n°4 du 15 avril 1902, p. 91-94
Haam propose donc une solution au problème posé par une patrie juive fondée, croit-il, sur la raison et la sagesse, dont le projet doit être nécessairement accepté au préalable par les autochtones arabes. Haam n'est pas antisioniste pour autant. Comme d'autres, il croit naïvement que les sionistes finiront par convaincre les Arabes de la justesse de leur entreprise coloniale par leur force morale et leurs accomplissements dans le pays. Haam est sans doute un des précurseurs de l'idée d'un Etat binational. S'il ne semble pas l'avoir formulé précisément, tout ce qu'il exprime sur le sujet d'une patrie juive en Palestine va dans ce sens, comme lorsqu'il déclare que les droits des Juifs "n’invalidaient pas le droit du reste des habitants du pays qui disposaient d’un véritable droit de résidence et de travail", ce qui fait de la Palestine "une possession commune" (A. Haam, La Vérité, op. cité). Bien entendu, malgré les intentions sincères de l'auteur, les Arabes ne pouvaient pas, en toute logique, comme quiconque l'entendrait aujourd'hui du droit des immigrés, admettre la valeur égale des droits d'appropriation de la Palestine entre Juifs étrangers et Palestiniens de souche.
Une autre voix est portée par l'enseignant et écrivain d'origine russe, Yitzhaq Epstein (1862-1943), qui conseille aux Juifs qui s'installent en Palestine de le faire "sans pécher contre la justice et sans nuire à personne" (op. cité). Epstein s'installe dans la colonie de Rosh Pina en 1886, et rappelle que, "comme tout être humain, l’Arabe est très attaché à sa patrie", que l'heure "est venue d’extirper des esprits l’idée discréditée, répandue parmi les sionistes, que l’on trouve en Eretz Israël des terres incultes par suite du défaut de main-d’œuvre et de l’indifférence de ses habitants. Il n’existe pas de champs inoccupés. C’est tout le contraire : chaque fellah s’efforce d’agrandir le terrain dont il dispose en y adjoignant la terre en friche qui est contiguë pour autant que cela ne requière pas un labeur excessif." (Y. Epstein, Sh'eilah Ne'elamah : "La question cachée", 1907). L'auteur rapporte de manière très intéressante le "long processus d'acquisition du village druze de Metula au nord, entre 1897 et 1898 (...) La peqidouth (administration) des fonctionnaires du baron Edmond de Rothschild n’étant parvenue à aucune forme de négociation avec la population avant leur départ forcé pour Istanbul suite à un soulèvement druze, celle-ci entra en contact avec les derniers habitants restés sur place, accompagnée d’« un officier de l’armée, suivi de ses soldats, venu arrêter ceux qui s’étaient soustraits au service militaire […] et se tenant à prêts à emprisonner ceux qui refuseraient de signer les actes de vente » (p. 103). Cette difficile négociation, affirme-t-il, exposa les communautés sionistes au ridicule, révéla leurs faiblesses, et alimenta plus encore la « haine profondément ancrée dans [les] cœurs »" (Schlaepfer, 2018, citations d'Y. Epstein, op. cité). Comme Haam, Epstein alerte sa communauté du nouveau Yichouv "sur la présence massive d’Arabes sur la terre d’Israël, une présence dont il faudra tenir compte. Il dénonce la « légèreté d’esprit qui règne dans les rangs » du mouvement sioniste dont la majorité des militants ne sont encore jamais allés en Palestine : « Seule une question, négligeable, nous a échappé : sur cette terre qui est notre patrie bien-aimée vit tout un peuple qui y est établi depuis des siècles et n’a jamais songé à la quitter." (Bendavid, 2012). Ainsi, dès les débuts de la colonisation, Haam et Epstein reprochaient "à nombre de leurs contemporains sionistes... d’avoir « oublié » et « dissimulé » la question palestinienne, les deux auteurs identifient et dénoncent, amèrement et sans détour, une attitude qu’ils qualifient d’« arrogante » à l’égard des Palestiniens." (Schlaepfer, 2018),
Dissimulation, encore une fois.
A la seule lecture de citations en apparence très humanistes d'un certain nombre d'auteurs sionistes "modérés", il n'est pas possible de connaître l'arrière-plan parfois paradoxal et même (inconsciemment ?) pernicieux de leur démarche. Car, loin de proposer une solution acceptable par les deux parties, toutes leurs recommandations aux Juifs semblent se ramener à une stratégie habile de conquête bien connue des colons européens, qui compte sur le fait que la prétendue supériorité des Juifs finira par convaincre les Arabes de désirer de se soumettre... avec plaisir : C'est en apportant des améliorations agricoles, médicales et technologiques à la population indigène, dira par exemple Epstein, que "des centaines de villageois viendront demander aux Juifs de s’emparer de leurs terres" (Epstein, op. cité).
Même son de cloche chez Max Nordau, pour qui le rachat des terres non cultivées à l'ouest du Jourdain serait la solution : "Le vrai remède nous devons le chercher d'un autre côté. Il a été souvent répété que 12 % seulement des terres situées à l'Ouest du Jourdain sont cultivées. Les 88 % restant sont en friche et déserts. Non parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être cultivés, mais parce que les fellahin, avec leurs méthodes primitives, ne sont pas capables d'en tirer de bons résultats." (Max Nordau, Ecrits sionistes, Textes choisis avec introduction, bibliographie et notes par Baruch Hagani, chapitre V, "La question agraire en Palestine", p. 301, Librairie Lipschutz, 1936). Ce qui n'empêche pas Nordau de croire (naïvement mais sincèrement) travailler à une solution pacifique, l'importance de la concorde avec les Arabes étant souvent rappelée dans son œuvre, étant même pour lui la condition sine qua none du succès de l'entreprise sioniste : "Notre sort est entre nos propres mains et il dépend essentiellement des relations que nous serons en état d'établir avec les Arabes." (Max Nordau, op. cité, chapitre IV, "La Grande-Bretagne et la Palestine", p. 292). Et comme d'autres, Nordau idéalise une communauté juive unie dans l'idée du retour en Erets Israel :
"Depuis la destruction du second Temple par Titus, depuis la dispersion du peuple juif dans tous les pays, celui-ci n'a cessé de souhaiter ardemment, d'espérer fermement son retour au pays de ses pères autrefois perdu par lui." (M. Nordau, Ecrits sionistes, op. cité, Introduction au Sionisme, p. 19).
L'argument est récurrent chez les colonialistes européens, d'avancer leur supériorité technique (et au-delà, civilisationnelle) pour légitimer l'exploitation des terres (et plus largement le pays) qu'ils n'habitent pas. Il se double ici d'un énième regard fantasmatique sur l'ancien Israël. Littérature ou propagande sioniste évoquent avec nostalgie ce "pays où coulent le lait et le miel" (Exode 3 : 8) et ne manquent pas de le comparer, d'une manière ou d'une autre, au pays actuel, infertile, inexploité par les Arabes : "Il est souvent mentionné dans le Talmud que la vallée de Huleh possédait des oliviers et de l’huile d’olive en grande abondance. Au temps de Flavius Josèphe, c’était l’implantation juive la plus peuplée" (Livret de promotion de l'achat de la concession Hula, Jérusalem, Goldberg's Press). Comme de nombreux passages bibliques, ceux évoquant la Terre Promise comme un pays de Cocagne doivent être passés au crible de la critique historique. Prenons seulement ici l'exemple des vergers : si le cédrat avait été introduit à l'époque du Second Temple, tous les autres agrumes : citrons, oranges, mandarines, pamplemousses, originaires de Chine, ne gagnent les régions méditerranéennes qu'entre le temps des Croisades et le début du XIXe siècle, les Arabes de Palestine cultivant l'orange douce dès le XVIIIe siècle : "Les « jardins » de Jaffa sont en fait un lieu commun des récits de voyage en Terre sainte à la fin de l’époque ottomane et une réalité confirmée par les historiens : les Arabes de Palestine cultivaient et exportaient, certes à petite échelle, des agrumes, avant que ne commence l’immigration juive moderne au début des années 1880." (Nicault, 2014). Par ailleurs, entre 1860 et 1882, les colons juifs étaient aidés par des mécènes à l'installation mais n'avaient guère de capitaux pour développer une arboriculture commerciale et "ont largement imité le système vivrier des fellahin arabes. Comme eux, ils ont pratiqué une polyculture orientée vers l’autosubsistance, où seuls les surplus sont, éventuellement, écoulés dans le voisinage immédiat. (Nicault, op. cité).
"Eugen Laronne, né en 1914 et arrivé en Palestine à l’âge de 20 ans, se souvient avec une certaine admiration de la qualité du travail que fournissaient les travailleurs agricoles arabes, malgré leurs instruments « rudimentaires ». Les techniques agricoles qu’ils maîtrisaient ont même, pendant un temps, joué un rôle vital dans la survie du kibboutz Mishmar Haémek, reconnaît-il. (Farges, 2014).
Par ailleurs, la réalité économique de la Palestine semble démentir la propagande sioniste d'un pays arriéré économiquement, puisque le riche banquier allemand Otto Heinrich Warburg (1883-1970), en 1904, indique que le volume des exportations de Palestine avant la colonisation juive est plus important que les deux colonies allemandes les plus riches, l'Afrique orientale allemande et le Cameroun (Otto Warburg, Palästina als Kolonisationsgebiet, Revue Altneuland [1904-1906], 1, 1904, p. 3-13). Et quand bien même, la Palestine aurait été ce pays si misérable décrit par les sionistes, il n'autorise pas une société prétendument évoluée à exercer sur lui des actions de prédation.
Extrêmement minoritaires, les auteurs de la Haskala, sensibles à leur manière à l'altérité, aux sentiments légitimes des Arabes, seront complètement inaudibles et savamment occultés par les leaders sionistes : "les mises en garde d’Ahad Ha-Am avaient été soigneusement éludées par les premiers théoriciens du sionisme qui craignaient de décourager les candidats à l’émigration déjà peu nombreux." (Bendavid, 2012).
PARTIE III <-------------> PARTIE V



