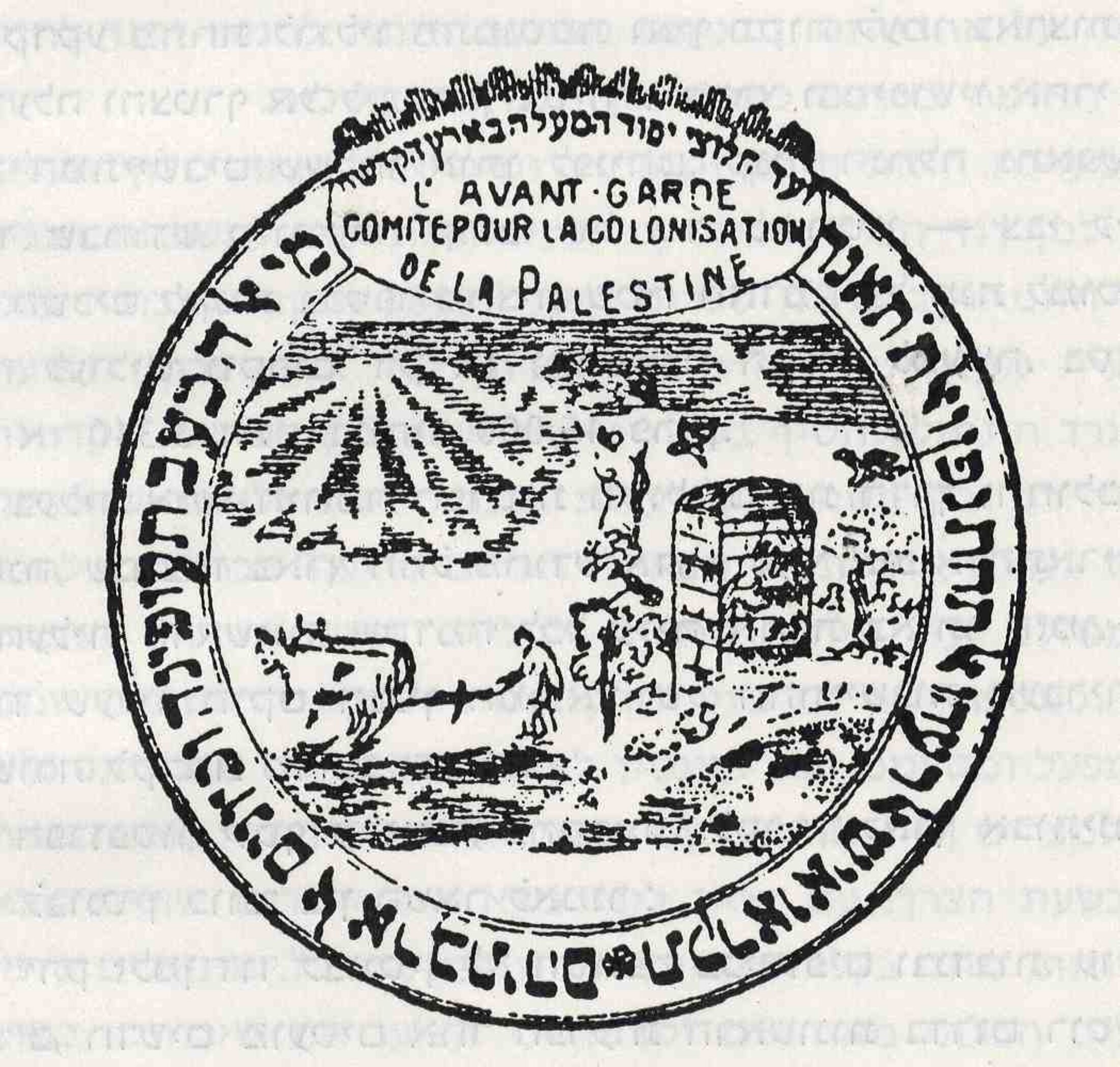Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM
-------------------------------------------
“ la civilisation contre la barbarie. ”
---------------------------------------------
Envers et contre tout, malgré une grande hostilité venue de la communauté juive elle-même, nous l'avons vu, les sionistes ont non seulement continué de donner corps à leur projet, mais ils ont aussi peaufiné un certain nombre de stratégies pour y réussir. Ainsi, c'est un plan, sinon secret, très discret, exécuté par le milliardaire français Edmond de Rothschild (1845-1934), qui a consisté à racheter des terres en masse, durant des dizaines d'années, opérant "un véritable maillage de la Palestine", à la barbe des autorités ottomanes (Henry Laurens, De Theodor Herzl à la naissance d'Israël, Le Monde Diplomatique, avril-mai 2008).
"Toutes ces colonies sont situées les unes près des autres et l'on peut quasiment parler d'un pays juif congloméré" (Jacobus Henricus Kann [1872-1944], "Erets Israël", le pays juif, 1907, édition en langue française de 1910, Librairie Falk fils, Bruxelles,
Cartes à l'appui, les chercheurs israélien et suisse Harsgor et Stroun démontreront à leur tour que "l'acquisition de nouvelles terres est effectuée toujours avec la volonté de transformer le patchwork que représentent les colonies juives en une seule toile, en se préoccupant de relier les diverses régions colonisées." (Michael Harsgor et Maurice Stroun, Israël-Palestine, l'histoire au-delà des mythes, Genève, Métropolis, 1996).
"L'arrivée d'Arthur Ruppin marque une date capitale puisque, après avoir ouvert en 1908 l'Office palestinien de Jaffa [Palästina-Amt, NDA], il systématisera la stratégie territoriale que Haïm Margalit-Kalvarisky avait commencé à mettre en œuvre à partir de 1900 en basse Galilée (Mesha, Yavneel...). En sa qualité d'ingénieur agronome de l'Association de colonisation juive (ICA), à laquelle le baron de Rothschild avait confié, en 1899, l'administration des colonies des Hovevei Zion, il avait eu l'idée de concentrer les achats de terres dans un même district de telle sorte que, par une maîtrise ordonnée de l'espace, les Juifs puissent constituer, même sur une aire réduite, la majorité de la population. Cette « stratégie de l'insertion », par laquelle il s'agit, dans des régions faiblement peuplées d'Arabes, d'édifier des noyaux d'implantations, proches géographiquement les unes des autres, fut reprise et amplifiée par Arthur Ruppin au cours de son long séjour palestinien entre 1908 et 1943." (Dieckhoff, 1989).
Haim Margaliot Kalvarisky (H. Margaliyot Kalvaryski, 1868-1947), administrateur des colonies agricoles de Galilée dès son arrivée en Palestine, en 1895, et pour de nombreuses années, est un exemple parmi d'autres de tous ces sionistes qui, tout en prônant avec constance la compréhension mutuelle entre Arabes et Juifs (voir le chapitre Brit Shalom, plus bas), n'ont cessé de développer tous les moyens possibles de coloniser le pays, plus ou moins légaux, plus ou moins retors, si possible discrètement et même secrètement. Membre du Vaad Leumi (Conseil National Juif, Jewish National Council, créé en 1920) après la première guerre mondiale, chef du Bureau arabe jusqu'en 1928, il présentera des vues instructives sur ce pseudo colonialisme à visage humain, lors d'une réunion en 1919 sur le sujet des relations judéo-arabes, à la Commission juive de Va’ad Ha-Tzirim ("Comité des délégués" sionistes) :
"J’ai réalisé à quel point la question de nos relations avec les Arabes est sérieuse lorsque j’ai acheté pour la première fois des terres aux Arabes (en Galilée)... J’ai réalisé à quel point les Bédouins sont proches de leur terre... Au cours de mes 25 années de travail colonial, j’ai dépossédé (« nishlti ») de nombreux Arabes de leurs terres, et vous comprenez que ce travail - déposséder les gens de la terre sur laquelle eux-mêmes et peut-être leurs pères sont nés - n’est pas du tout une chose facile, surtout quand on regarde ces gens comme des êtres humains... Je devais le faire, parce que c’est ce que le Yishouv demandait, mais j’ai toujours essayé de le faire de la meilleure façon possible... Je me suis familiarisé très tôt avec les Arabes et la question arabe."
Haim Kalvaryski, présentation intitulée : « Relation avec les voisins arabes », Archives sionistes centrales (CZA) J1/8777, citée par Jacobson, 2004 :
"Quand j’ai lu cette citation pour la première fois, ce qui m’est venu à l’esprit était l’expression courante « Yorim ve-Bochim » (en hébreu, « tirer et pleurer »). Kalvaryski avoue avoir dépossédé les Arabes de leurs terres, mais cette prise de conscience l’a-t-elle poussé à agir différemment ? Il ne quitte pas son emploi dans le mouvement sioniste. Pourtant, les mots de Kalvaryski expriment une sorte de dissonance à l’égard de son travail et de ses devoirs. C’est peut-être cette dissonance qui l’a rendu actif dans diverses tentatives pour parvenir à un accord entre Juifs et Arabes." (Jacobson, 2004).
Le XIXe siècle n'est pas terminé que certains militants sionistes utilisent tour à tour les termes de Palestine ou d'Eretz-Israël, d'autres combinent les deux, mais déjà, le chef des sionistes anglais, le colonel Goldschmidt, refuse d'utiliser le terme Palestine, et l'écrivain Moïse Lilienblum (1843-1910), pense que son vrai nom est celui de la patrie historique des Juifs, Erets Israel : "Tout d’abord nous devons savoir et croire que ce n’est pas en Palestine que nous colonisons le pays, mais en Terre d’Israël" (M. Lilienblum, article de la revue HaMelits, 1890, no 126).
En 1901, le Lithuanien Tzvi Herman Shapira, propose au mouvement sioniste de créer un fonds d’achat de terres en Palestine, ce sera le KKL (Keren Kayemeth LeIsrael, en hébreu : "Fonds pour la création d'Israël") connu à l'étranger sous le nom de Fonds national juif (FNJ, JNF : Jewish National Fund), au sein duquel des bureaux sont dédiés au développement agricole, auquel s'ajoutera quelques années plus tard la Palestine Land Development Company (PLDC, en hébreu Ḥevrat Hakhsharat ha-yishuv), en 1908, initié en particulier par O. Warburg, qui n'avait, soi-dit en passant, jamais reçu d'éducation spécialement juive (Baisez, 2019), ce qui ne l'empêchera pas d'être élu président de l'Organisation sioniste mondiale en 1911. Au sein de l'Organisation sioniste, Warburg participa aux commissions chargées d'examiner les propositions britanniques de colonisation du nord Sinaï (1903), où il se rendit en compagnie de l'agronome Selig Soskin (1873-1959) et d'Oppenheimer, mais aussi de l'Ouganda (1904), projet pour lequel avait été créée officiellement en 1905 la Jewish Territorialist Organisation (ITO), "l'Organisation juive territorialiste" (OJT), dirigée par Israël Zangwill. Son beau-père, le sioniste Gustav Gabriel Cohen (1830-1906), banquier de Hambourg, avait quant à lui proposé une colonisation juive de l'île de Chypre (Die Judenfrage und die Zukunft : "La question juive et l'avenir", écrit à partir de 1881, et qui sera édité en 1891).
En Palestine, un certain nombre de projets se tournent vers des zones peu peuplées, à défricher et à valoriser, de marécages en particulier (qu'il faut drainer et assécher), mais aussi désertiques ou de montagnes pierreuses, comme la première ferme-école de Mikveh-Israël, fondée au sud de Jaffa en 1870 par l'homme d'affaires et mécène Charles Netter et "construite sur un marécage infesté de malaria" (Mortier, 2019). Les zones de marais sont principalement situés au nord du pays, dans la vallée de Jezréel (Jizréel, Yzrael, plaine d’Esdraelon, vallée de Megiddo ; Marj ibn Amir pour les Arabes), en Galilée, à Kabarah ou encore dans le bassin du lac Ḥula (Houla, Huleh). Sur le sujet, les sionistes construisent alors un discours idéologique en guise d'argumentaire, de justification de la colonisation juive en Palestine. Dès l'origine, le JNF "est ainsi créé pour faciliter l’achat de terres aux propriétaires arabes ottomans dans le but de les enregistrer comme « propriété éternelle et inaliénable du peuple juif » [Katz 2005 : 35]" (Mortier, 2019). Des dispositions de la JNF ont été prévues dans ce but, car la "fondation n'aura pas le droit de vendre ses terres à des particuliers, auxquels elle ne pourra les concéder que sous forme de bail" (Cohen-Muller, 2019). Ainsi, pour les autochtones arabes, le problème n'est pas seulement la supériorité technique, par ailleurs reconnue, des Juifs européens (on devrait dire des Européens tout court), mais aussi le fait que l'ensemble des entreprises engagées par les sionistes démontre dès le départ, la volonté , encore une fois, d'appropriation progressive et soigneusement étudiée de l'espace.
Un argument récurrent pour défendre la légitimité de cette appropriation est donc celui qui compare un pays stérile, prétendument délaissé par ses habitants ("une terre sans peuple...), aux moyens primitifs de développement, à un pays qui deviendra un vrai pays de Cocagne par les moyens techniques européens et le travail acharné des pionniers. Ben Gourion écrira ainsi dès 1915 un texte où, par des tournures rhétoriques, il exprime ses sentiments de supériorité et de morgue envers les Arabes :
"Le pays attend un peuple culturel et travailleur. Enrichi de matière et ressources spirituelles; armé de l’arme de la science et de la technologie. Le pays aspire que ce peuple vienne s'y installer, fleurir ses montagnes arides, fertiliser ses les terres incultes, les forêts, les sables et le pays désertique se transformerait en paradis. […] Les Juifs, comme on peut déjà le constater dans leurs colonies agricoles, introduiront dans le pays des outils perfectionnés, moderniseront les méthodes agricoles et développeront des systèmes d'irrigation et de transport." (Ben Gourion, Vers le futur, article paru dans le mensuel HaToren, juin 1915). Vingt ans plus tard, il raille avec sarcasme la définition donnée par la puissance mandataire britannique (la puissance coloniale britannique défait le pouvoir ottoman en Palestine à la fin de 1917, cf. plus bas) d'un sol "non cultivable", que le directeur de l'Agence juive regarde plutôt comme "un sol qui ne cède pas aux moyens de cultures primitifs des fellahs" (D. Ben Gourion, Cahiers juifs, 1935).
"Dans ce passage caractéristique comme dans bien d’autres textes, les terres marécageuses, comme la région de Ḥula, sont depuis la fin du XIXe siècle, des espaces d’élaboration d’un discours sioniste sur l’environnement palestinien qui s’articule autour de trois principaux points : le dénigrement des modes d’appropriation arabes des marécages, la démonstration de l’efficacité des techniques développées par les sionistes jugées par eux comme « modernes » en opposition à la « primitivité » de celles des Arabes, et enfin la recherche d’un rééquilibrage des terres de Palestine pour mieux correspondre à la fertilité fantasmée d’Eretz Israël." (Mortier, 2019).
"Dans la reconstruction du Foyer national juif dans le pays de leurs ancêtres, les juifs ont “collectionné” des déserts, des marais, des montagnes rocailleuses, dont personne ne voulait et que personne n’habitait, et ils les ont changés en champs, en jardins, en vignobles, en vergers, créant ainsi de “l’espace vital” pour des milliers de leurs frères […]" (Cheskel Zwi Kloetzel, L’eau pour le Néguev. La lutte contre le désert et la sécheresse, Jérusalem, Kéren Kayémeth Leisraël, 1947).
"C'est pour cela qu'il faut le dire tout simplement : tout notre désir au pays d'Israël est de faire réellement, de nos propres mains, toutes les choses qui font la vie ... de ressentir ce que ressent le travailleur „.. nous aurons alors une culture, nous aurons alors une vie. C'est pour cela et pour bien d'autres raisons que les pionniers juifs ne sont pas des colonisateurs."
"Le peuple juif a été complètement coupé de la nature et emprisonné dans les murs de la ville pendant deux mille ans. Nous avons été habitués à toutes les formes de vie, excepté une vie de travail - un travail fait en notre nom et dans son propre intérêt. Il faudra le plus grand effort de la volonté à un tel peuple pour redevenir normal. Il nous manque le principal ingrédient de la vie nationale. Il nous manque l'habitude du travail. [...] Nous devons créer un nouveau peuple, un peuple humain dont l'attitude envers les autres peuples est remplie du sens de la fraternité humaine."
Aharon David Gordon (1856-1922), לבירור רעיוננו מיסוד , "Clarifier notre idée de fondation", 1920.
Mais ces scrupules sont contredits par bien des arguments qui rappellent plutôt ceux des colonisateurs européens de l'Amérique ou de l'Afrique : La terre doit revenir à ceux qui la mettent en valeur, qui apportent la civilisation aux peuples primitifs. Cette opinion conduit souvent les sionistes à glisser sur une pente idéologique douteuse, qui établit un lien direct entre improductivité, infertilité de la terre et absence d'humains dignes de ce nom, ou parfois, d'humains tout court : C'est un pays "inhabité" qui attendrait donc "ceux qui le coloniseront et le régénèreront" (E. W. Tachlenov, La guerre, la révolution russe et le sionisme, Copenhague, 1917 : 18-19). Les colons ignorent sûrement une importante raison qui empêche le fellah de cultiver davantage :
"La Palestine a un fermier général qui a lui même des sous traitants par districts et ceux ci ont des agents subalternes qui font la recette dans les villages. Il résulte de cette organisation que le peuple, les masses de fellahin (paysans) sont pressurés de cette manière qu'une grande quantité de terres fertiles restent incultes parce que le rapport qu'elles produiraient aux malheureux cultivateurs ne suffirait pas pour satisfaire la rapacité de tous ces fermiers ou sous-fermiers..." (Cohen-Muller, 2005).
Nous retrouvons-là l'idée de mission civilisatrice défendue par les nations coloniales depuis la colonisation de l'Amérique, que nous avons vu chez Laharanne ou Palmerston, et qui appartient aussi à la mentalité de nombre de dirigeants sionistes, dès le début de la colonisation : " nous formerions là-bas un élément d’un mur contre l’Asie, ainsi que l’avant-poste de la civilisation contre la barbarie", disait déjà Herzl ("L'État des Juifs", op. cité, 1896). En 1902, il partageait sa vision de cette civilisation technique dans son roman utopique, Altneuland ("le pays ancien-nouveau"), qui donne une définition à la fois succincte et limpide du sionisme :
"Le docteur Weiss, un simple rabbin d’une ville de province de Moravie, ne savait pas exactement en quelle compagnie il se trouvait, et hasarda quelques remarques timides. « Un nouveau mouvement est apparu au cours des dernières années, qui s’appelle le sionisme. Son but est de résoudre le problème juif par la colonisation à grande échelle. Tous ceux qui ne peuvent plus supporter leur sort actuel retourneront dans notre ancienne patrie, en Palestine.»" (op. cité, Livre I, ch. 2).
Le héros, le Dr Friedrich Loewenberg, Juif viennois non pratiquant, débarque une première fois en Palestine, au port "abandonné" de Jaffa, dont l'auteur nous dresse le portrait repoussant : "Les ruelles étaient sales, négligées, pleines d’odeurs nauséabondes. Partout la misère dans des haillons orientaux éclatants. De pauvres Turcs, de sales Arabes, des Juifs timides se prélassaient, indolents, mendiants, désespérés." (op. cité, Livre I, ch. 6). Dans les campagnes, entre le port de Jaffa et Jérusalem, par chemin de fer "misérable", le spectacle est tout aussi dégoûtant, les Arabes sont aussi repoussants que les précédents, et rien ne rappelle un pays civilisé : "Les habitants des villages arabes noirâtres ressemblaient à des brigands. Des enfants nus jouaient dans les ruelles sales. Au-delà de l’horizon lointain se profilaient les collines déboisées de Judée. Les pentes dénudées et les vallées mornes et rocheuses ne présentaient que peu de traces de cultures actuelles ou anciennes." (op. cité).
Ou encore : "Rien n’aurait pu être plus misérable qu’un village arabe à la fin du XIXe siècle. Les taudis en terre battue des paysans étaient impropres à la construction d’écuries. Les enfants gisaient nus et négligés dans les rues, et grandissaient comme des bêtes muettes." (op. cité, Livre III, ch. 1).
"Quand nous sommes arrivés ici, il n’y avait rien, rien du tout. Aujourd’hui, la Palestine est un pays modèle. Nous y avons plongé notre sang, notre sueur et notre labeur !" (op. cité, Livre III, ch. 2).
La description des colonies, ensuite, est l'occasion encore une fois pour l'auteur de souligner le contraste deux mondes opposés, celui des Arabes, inhospitalier, inculte, stérile et misérable, et celui encore embryonnaire, d'un Israël renaissant, formé alors de merveilleuses oasis , avec "des champs bien cultivés, des vignobles majestueux et des orangeraies luxuriantes." (op. cité). Vingt ans après, le héros revient en Palestine et la métamorphose a eu lieu, dans le pays entier cette fois. Par la voix de ses personnages, l'auteur dévoile par petites touches les étapes de la colonisation, non sans rappeler ses causes, à savoir les multiples humiliations subies par les Juifs en Europe. Puis, la "Nouvelle société" hébraïque se forme progressivement grâce à une association "organisée sous le nom de « Nouvelle Société pour la colonisation de la Palestine »" qui réussit à conclure un "traité de colonisation avec le gouvernement turc" (op. cité, Livre IV, ch. 2), dûment monnayé par d"'importants paiements annuel au Trésor turc" (op. cité). Les Européens juifs ont fini par investir la Palestine toute entière, ayant emporté l'adhésion de tous qu'eux seuls étaient en droit et en mesure de conduire le pays vers sa glorieuse destinée. C'est sans doute tant de concorde qui fait qu'il " n’y a pas d’armée dans la Nouvelle Société." (op. cité, Livre II, ch. 3). C'est ainsi que naquit une perle européenne transportée en Orient, avec ses autos silencieuses sur pneus de caoutchouc, ses bâtiments modernes, ses téléphones, ses phonographes, ou encore, ses lampadaires et son train aérien électriques, une énergie encore peu utilisée à l'époque. C'est donc un conte à l'eau de rose, qu'écrit Herzl, effaçant par avance des montagnes de difficultés et de douleurs par des pirouettes littéraires :
"Il est devenu évident que, dans les circonstances, ils devaient soit devenir les ennemis mortels d’une société qui était si injuste envers eux, soit chercher un refuge pour eux-mêmes. C’est cette dernière ligne de conduite qui a été prise, et nous y voilà. Nous nous sommes sauvés nous-mêmes." (op. cité, Livre II, ch. 2).
"Ce que Juda a eu autrefois, il peut l’avoir à nouveau ! Notre vieux Dieu vit encore ! Et le rêve s’était réalisé." (op. cité, Livre II, ch. 3).
"Seuls, nous, les Juifs, pouvions le faire », répondit calmement David. « Seulement nous... Nous étions seuls en mesure de créer cette Nouvelle Société, ce nouveau centre de civilisation.. (...) Cela n’aurait pu advenir que par nous, au travers de notre destinée. Nos souffrances morales étaient un élément aussi nécessaire que notre expérience commerciale et notre cosmopolitisme." (op. cité).
Et bien loin de copier le comportement de leurs bourreaux, les Juifs, magnanimes, auraient alors accueilli tous les hommes de la même façon : "Laissez-moi donc vous dire que mes associés et moi ne faisons aucune distinction entre un homme et un autre. Nous ne demandons pas à quelle race ou religion un homme appartient. Si c’est un homme, cela nous suffit" (op. cité, Livre II, ch. 2).
"Nous nous en tenons au principe que quiconque a donné deux ans de service à la Nouvelle Société, comme le prescrivent nos règles, et s’est conduit correctement, est éligible à l’adhésion, quelle que soit sa race ou sa croyance." (op. cité, Livre III, ch. 2)
Belles paroles, certes, mais qu'il faut mettre à l'épreuve de beaucoup d'autres, nous l'avons vu, qui placent les Juifs tout en haut de l'échelle sociale, détenteurs et dispensateurs du progrès et de la civilisation dans un pays arabe censé n'avoir avant cela connu que ténèbres, désolation, vide de toute trace de civilisation. Puis, après la glorieuse restauration juive du pays, le seul musulman digne d'être présenté au lecteur est un musulman qui a étudié à Berlin, qui est habillé d'un costume européen et qui répond en allemand quand on lui parle arabe. Pour faire couleur locale, Herzl lui a tout de même rajouté un fez rouge sur la tête (op. cité, Livre III, ch. 1). Libre d'exercer son culte ou ses affaires, il est plein de reconnaissance envers ses bienfaiteurs : "Tout ici a pris de la valeur depuis votre immigration." affirme Reschid Bey avec admiration. Dans un autre dialogue, avec le baron chrétien Kingscourt, compagnon de voyage de Loewenberg, le musulman développe son panégyrique :
"− Mais je voulais vous demander, mon cher Bey, ce qu’il est advenu des anciens habitants du pays qui ne possédaient rien, c’est-à-dire la majorité des Arabes musulmans ?
− M. Kingscourt, votre question est une réponse en soi, répondit Reschid. Ceux qui ne possédaient rien, n’avaient rien à perdre, donc, forcément, ils ne pouvaient qu'y gagner. Et ils y ont gagné : Des opportunités de travail, de moyens de subsistance et de prospérité. Il n’y avait rien de plus misérable et de plus désolant qu’un village arabe de Palestine, à la fin du XIXe siècle. Les paysans habitaient des masures en argile, dont les animaux n’auraient même pas voulu. Les enfants gisaient tout nus dans les rues, négligés et grandissaient comme de stupides animaux. Aujourd’hui, tout a changé. Ils ont profité, bon gré, mal gré, des mesures progressistes de la Nouvelle Société. Lorsque les marais furent asséchés, les canaux construits et les eucalyptus plantés pour drainer et « assainir » le sol marécageux, les indigènes (qui, naturellement, étaient bien acclimatés) furent les premiers à être employés et bien payés pour leur travail !"
Par ailleurs, la volonté affichée de Herzl de maintenir le religieux à distance peine à convaincre, tant son récit est parsemé de sentiments religieux et d'accents messianiques (Dayan-Herzburn, 2012 : 97)
"Pourtant, aussi splendide qu'il ait pu être, les Juifs n'aurait pas pu s'en plaindre pendant dix-huit siècles. Ils n’auraient pas pu pleurer simplement une maçonnerie en ruine ; ça aurait été trop bête. Non, ils soupiraient après quelque chose d'invisible dont les pierres avaient été le symbole. Il était revenu se reposer dans le Temple reconstruit, où se trouvaient les fils d'Israël rentrés chez eux qui élevaient leur âme vers le Dieu invisible comme leurs pères l'avaient fait sur le mont Moriah. Les paroles de Salomon rayonnaient d’une nouvelle vitalité... (Herzl, Altneuland, op. cité, Livre V, ch. 1)
Mentionnons tout de même au passage le discours moderne de Herzl sur l'égalité des hommes et des femmes (tempéré largement, cependant, par divers comportements et propos patriarcaux), la sécurité sociale, ou encore la critique de la professionnalisation de la politique, que l'auteur développe par le truchement de ses héros, ou encore le regard critique sur la richesse et le capitalisme :
"Ici, le pain des pauvres est aussi bon marché que le pain des riches. Il n’y a pas de spéculateurs sur les choses nécessaires à la vie. Vous savez comment la méthode coopérative est devenue, en effet, l’un des ressorts les plus puissants de la nouvelle colonisation palestinienne, due principalement aux efforts du mouvement ouvrier organisé. Elle est cependant beaucoup plus développée dans l’agriculture que dans l’industrie ou le commerce, où, autrefois on ruinait des centaines de milliers de personnes par leurs pratiques. Nous n’avons pas non plus permis l’existence de l’ancien type de petit commerce, mais nous avons créé des coopératives de consommateurs dès le début de notre entreprise. Vous avez là un autre exemple des avantages de nous être libérés des fardeaux dont nous avions hérités. Nous n’avions pas besoin de ruiner qui que ce soit pour alléger le sort de nos masses." (op. cité, Livre II, ch. 4).
"Ici, l’individu n’est ni broyé entre les meules du capitalisme, ni décapité par le nivellement socialiste. Nous reconnaissons et respectons l’importance de l’individu, tout comme nous respectons et protégeons la propriété privée, qui est son fondement économique." (op. cité).
Herzl n'est ni le premier, ni le dernier à avoir imaginé un Israël futuriste ou utopique, dont le genre se poursuivra bien après la création de l'Etat d'Israël, en 1948 (Eliav-Feldon, 1983 ; Encylopaedia Judaica, 1971-1994, vol. 16, pp. 1151-52). En 1882, le romancier slovaque Edmund Menachem Eisler (1850-1942), qui avait correspondu avec Herzl et d'autres dirigeants sionistes, écrit Ein Zukunftsbild ("Une image du futur"), qui sera publié anonymement en 1885 à Vienne. Le récit prend sa source dans l'affaire de Tiszaeszlár, en Autriche-Hongrie, autour d'une énième accusation antisémite de meurtre rituel imputé aux Juifs, entre 1882 et 1883. Rapidement, un parlementaire, Gyözo Istoczy en profitera pour réitérer une demande faite en 1878 déjà de transférer les Juifs en Palestine où ils pourront s'établir au milieu de leurs "compatriotes sémites" (Eliav-Feldon, 1983). Le récit d'Eisler commence donc par les pogroms, suivis de mouvements de révoltes juives qui se sont réellement déroulées, avant de bifurquer dans l'imaginaire par l'intervention de son jeune héros, Avner, qui poussera à l'action la communauté juive, sous forme d'une campagne de pétitions, de discours, qui finiront par persuader les gouvernements européens d'obtenir du sultan ottoman une concession juive en Palestine, où sera créé "un Etat de Judée prospère, juste et hardi défenseur de paix" (op. cité)., dont Avner deviendra le roi. Signalons qu'un exemplaire de son livre figurait dans la bibliothèque personnelle de Herzl, qui a pu s'en inspirer.
Le lithuanien Elchanan Liib Levinski (Elḥanan Leib Lewinsky, 1857-1910), ami proche d'Ahad Haam, marchand de céréales rêvant d'être un écrivain de langue hébraïque, est un des premiers dirigeant sionistes de Russie, membre du mouvement Hovevei Zion. Il a été élevé dans l'esprit du mouvement Haskala, fut un des fondateurs d'Ivryya (Ivriyya, Ivriya, עִבְרִיָּה :"femme hébraïque" ), un mouvement pour la renaissance de la langue hébraïque, et deviendra le représentant en Russie de Carmel, une des grandes sociétés viticoles de Palestine. En 1892, paraît son roman Voyage en Terre d’Israël en l’an 5800 du VIe millénaire (selon le comput juif, soit 2400 de l'ère chrétienne), dans le premier numéro de la revue annuelle Pardes (1892-1896), à Odessa. L'histoire raconte le voyage de noces d'un couple juif dans un pays d'Israël magnifié, comme dans beaucoup d'utopies sionistes, montrant à quel point la nation juive est redevenue un centre culturel et spirituel puissant, embellissant physiquement et spirituellement un pays "qui ne ressemblait à rien" avec des "champs incultes". Ne parlons pas des anciens habitants. Les Arabes ne sont pas mentionnés une seule fois, et leur mince souvenir ne se rapporte pas aux gens mais à des productions, celle du café (kava, kavah), forcément moins bon que celui que cultive désormais les Juifs dans la vallée du Jourdain, et celle du style architectural de certains bâtiments publics.
"Jérusalem est le centre de l'univers tout entier, le nombril du monde... Et particulièrement celui des Juifs. ... , les écoles d'enseignement supérieur de Jérusalem sont des centres de la Torah, de connaissance et de sagesse pour tous nos frères dans la diaspora. Des milliers d'étudiants se précipiteront vers eux des quatre coins du monde pour entendre des leçons dans toutes les branches de la Torah et de la connaissance, et, à partir de Jérusalem la Torah et la littérature se répandra sur tous les habitants de la terre." (E. Lewinsky, opus cité)
Faire partie du sionisme culturel, d'esprit pacifique, comme Haam ou Lewinsky, n'empêche pas, on l'a vu, de poursuivre un but colonisateur dans le but d'une prééminence juive sur l'ensemble de la société investie. Ainsi, dans l'Etat juif futuriste de Lewinsky "la loi prédominante sera la loi des Hébreux (...), en particulier les lois civiles ou celles du travail, basées sur "la Torah de Moïse, conformément aux gloses des sages.... s'opposant à toutes Les nouvelles lois européennes en matière de travail. Selon ces lois, il n'est question ni de propriété, ni de travail, en Terre d'Israël, car il n'y a pas d'un côté les ouvriers et de l'autre les maîtres, tous sont à la fois ouvriers et maîtres." (opus cité). Il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre que de telles dispositions, d'inspiration proprement coloniales, n'auraient jamais été applaudies par une population régie depuis des siècles par des lois inspirées par la charia islamique et l'örf ("coutume", cf. Inalcik, 2011 ) turque ottomane, ce sur quoi, nous l'avons vu, Haam avait bien mis en garde les sionistes moins regardants que lui sur la question. C'est ce que décide d'oblitérer l'ensemble de la production utopiste sioniste, préférant croire que, face à la grandeur et à la supériorité de la civilisation juive renaissante, ce sont les autochtones eux-mêmes qui finiront par désirer d'être conquis. Au-delà du problème nationaliste, on sait déjà que le préalable du travail et de la terre pour tous demeurera non seulement, comme dans les idéaux socialistes, un vœu pieux, mais qu'on aura là deux grandes causes de mécontentement arabe.
En 1893, paraîtra le roman utopiste du journaliste allemand Max Osterberg-Verakoff (1865-?), auteur de livres pour enfants et de guides touristiques, ouvrage intitulé Das Reich Judäa im Jahre 6000 (2241 Christlicher Zeitrechnung) : "Le Royaume de Judée en l'an 6000, 2241 de l'ère chrétienne"). Après l'expulsion des Juifs de Moscou, en 1891, un évangéliste américain, William Blackstone, présente un mémorandum à Benjamin Harrison, président des Etats-Unis de 1889 à 1893, afin de sauver en urgence les Juifs de la persécution tsariste et de créer un Royaume de Juda pour les accueillir, qui s'avèrera très conservateur et très patriarcal. Herzl le félicitera et promit de le citer dans son propre travail (Eliav-Feldon, 1983). Deux ans après, Isaac Fernhof, instituteur originaire de Galice, publie dans le deuxième numéro de sa propre revue de littérature hébraïque (Sifrei Shashuim, Sefer Sh'ashuim : "Les Livres des Délices") son propre récit utopique Shnei Dimyonot' ("Deux Visions"), fruit de l'imagination d'un voyageur juif transportée dans un Israël idyllique qui aurait retrouvé sa stature étatique et sa fierté (Eliav-Feldon, 1983). On citera enfin les romans utopiques de Jacques Bahar (1858-1923), journaliste, avocat, délégué algérien au premier congrès sioniste de Bâle, ami de Bernard Lazare (cf. plus bas), qui écrit en pleine affaire Dreyfus son livre L’Antigoyisme à Sion, publié pour la première fois dans le journal Le Siècle, du 20 au 25 mars 1898, puis par T. Herzl, la même année, en allemand, dans son journal Die Welt. L'action se déroule en 1997 et parodie le procès de Dreyfus où les rôles sont inversés, un juif accusant un goy injustement. Bahar nous dépeint un Etat Juif exemplaire, où, comme dans d'autres utopies sionistes, les étrangers chrétiens ou musulmans sont parfaitement assimilés aux Juifs et vivent en parfaite harmonie avec eux. Le pays est à ce point paisible que les prisons n'existent pas, si bien que la peine qui sera infligé à Isaac Nathaniel Viermond, coupable d'avoir écrit un infâme pamphlet, La Judée engoyisée, sera condamné à une peine originale et savoureuse... de bibliothèque forcée :
"Dans l’esprit du législateur, la diffamation est imputable à l’ignorance du délinquant, dont le châtiment doit être le retour forcé à la science. On le condamne donc à s’instruire et à créer un chef d’oeuvre dont le produit est à partager entre lui et le diffamé pendant dix ans. La bibliothèque forcée est en province. C’est un vaste bâtiment dans un parc immense, entouré de murs. Le régime, tout de liberté, est subordonné, quant à la nourriture et aux aises à la gravité du travail effectué. Tous les délinquants en sortent guéris et repentis. Certains en sortent très savants. Quant à la signature, c’est une aggravation de la peine. À la sortie, le libéré ne peut que publier sans ajouter sa signature: “Diffamateur de M. Un Tel” (J. Bahar, op. cité, dans Moraly, 2008).
Enfin, nous passerons rapidement sur Looking Ahead, le roman utopique d'Henry Pereira Mendes (1852-1937), qui fut rabbin de la congrégation séfarade de New-York et un des fondateurs de la Fédération américaine sioniste (Federation of American Zionists). Le titre de son livre est inspiré d'un autre récit utopique, Looking Backward, de l'écrivain américain Edward Bellamy, dont le contenu est cependant radicalement différent. Après avoir décrit et interprété de manière bien fastidieuse les plaies diverses de la civilisation aboutissant à une sorte d'apocalypse, Mendes met en scène un concile de pasteurs multiconfessionnel qui proclame sa Solution of Evils ("Solution des maux"), sorte de constitution destinée à restaurer la paix et l'harmonie sur Terre, extrêmement conservatrice et moralisatrice comme les premières utopies historiques (cf. sociétés utopiques). L'ensemble des Eglises s'accordent sur le fait du droit historique des Juifs à retourner en Terre Sainte et un Etat juif est créé en Palestine, où sa capitale, Jérusalem, devient l'arbitre international de tous les conflits planétaires : on retrouve là encore ce sentiment de supériorité de "race", voulu par Dieu, et revendiqué par les sionistes sur les autres peuples du monde. A noter cependant que les Juifs pouvaient continuer de vivre dans leur pays d'origine, ce qui permettait de contenter divers courants du sionisme. Finalement, l'utopie de Mendes est une sorte de "version des utopies eschatologiques chrétiennes, dans lesquelles la Palestine restaurée pour les Juifs est présentée comme une étape cruciale vers le millenium" (Eliav-Feldon, 1983), qui désigne le règne terrestre du Messie avant le jugement dernier, censé durer mille ans, selon le livre biblique de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament :
"04 Puis j’ai vu des trônes : à ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j’ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus, et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la Bête et son image, et qui n’ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans.
05 Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les mille ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection.
06 Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection ! Sur eux, la seconde mort n’a pas de pouvoir : ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et régneront avec lui pendant les mille ans."
Apocalypse 20 : 4-6, version ALF (Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones)
A l'appui du sionisme religieux, messianique, se développe aussi l'enseignement du rabbin Abraham Yitzhak Ha Cohen Kook, dit "Rav (1) Kook" (1865-1935), originaire de Lituanie, qui émigre en Palestine en 1904 et deviendra le grand-rabbin des ashkénazes: "Il faut savoir qu’avant la Shoa, durant les années d’activité de Kook en Palestine, la grande majorité de l’orthodoxie juive était profondément hostile au mouvement sioniste, considéré comme apostasie. L’audace de Kook a été de présenter une vision permettant de reconnaître le messie dans l’apostasie sioniste en tant que telle. En ce sens, le projet de Kook constitue un exercice essentiellement hérétique. Il n’est donc pas étonnant que Kook ait été effectivement perçu et traité comme un hérétique par plusieurs rabbins orthodoxes de son époque, et qu’il le soit aujourd’hui encore dans le monde ’haredi (2)" (Lapidot, 2022)
(1) Rav : Rov, Rouv, chez les Ashkénazes : "rabbin", en hébreu moderne.
(2) haredi : plur. haredim, litt. les "craignant-Dieu", qu'on appelle couramment "ultra-orthodoxes".
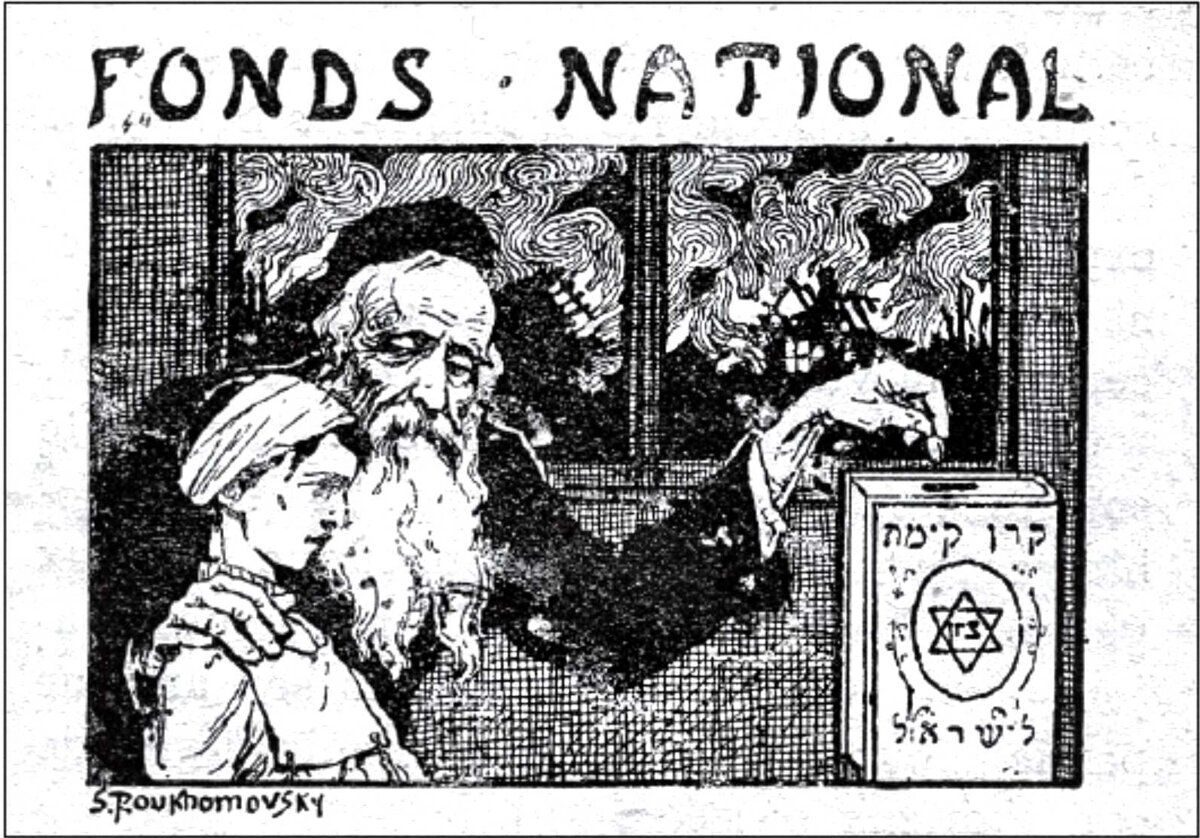
Agrandissement : Illustration 1

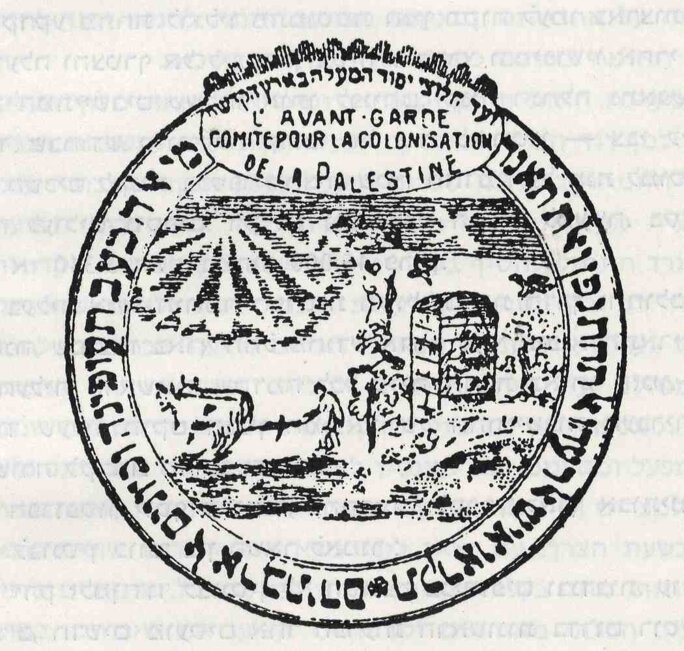
Agrandissement : Illustration 2