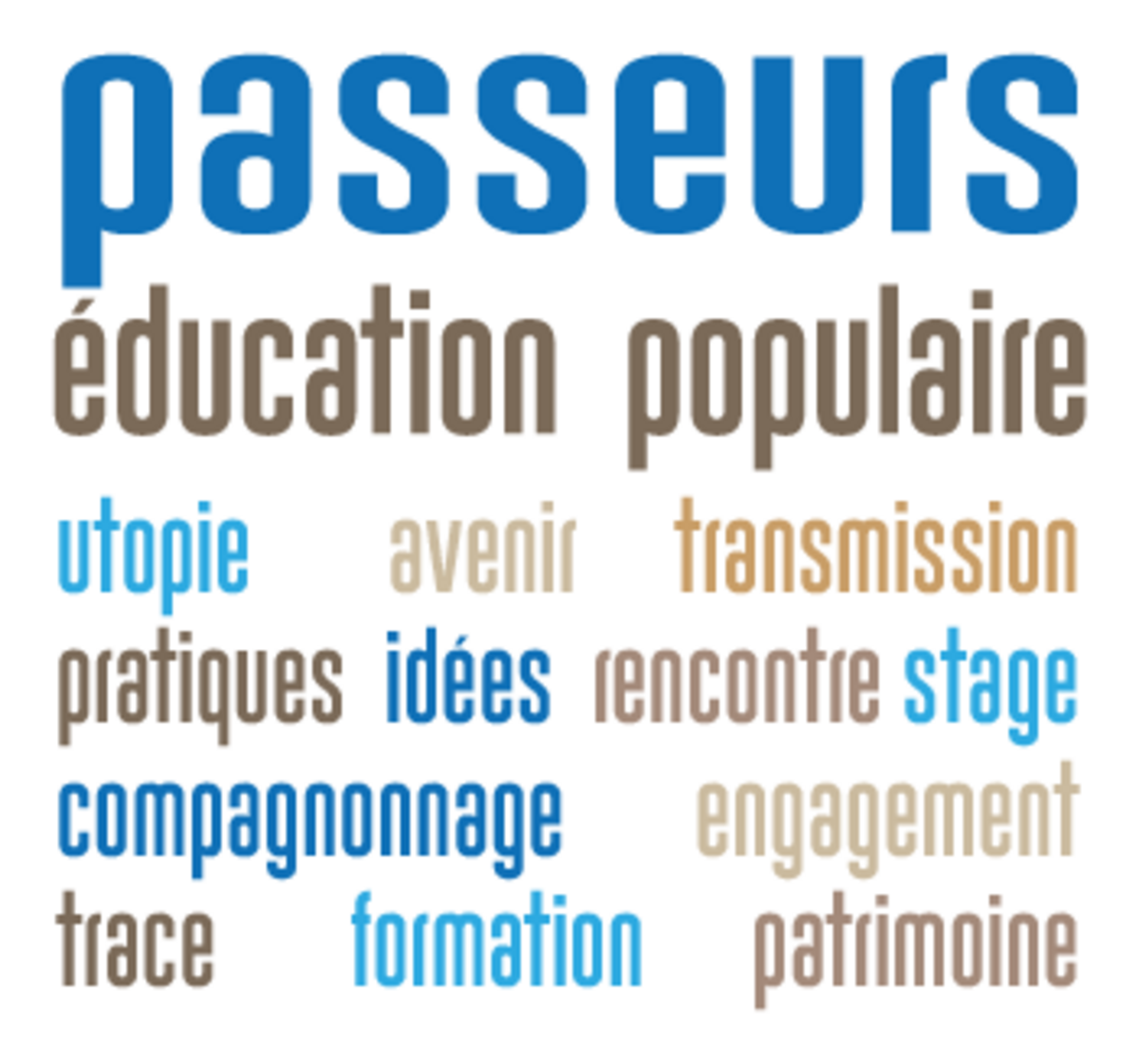
Dès la fin du 19e siècle, de nombreuses expériences se sont multipliées en Europe pour inventer une école différente de l’école « traditionnelle ». Un mouvement international de rénovation pédagogique voit d’ailleurs le jour et se concrétise à travers la création, en 1921, de la Ligue Internationale de l’Éducation nouvelle autour de grands pédagogues, de médecins, de philosophes, d’enseignants qui vont marquer cette école « active » durant de nombreuses années et favoriser le développement d’associations engagées dans des pédagogies progressistes.
Déjà, depuis quelques décennies, l’éducation populaire promouvait des objectifs d’émancipation, de promotion sociale, d’accès à la culture populaire. Avec le Front populaire en 1936, c’est une sorte de souffle, d’enthousiasme fort qui ouvre des droits nouveaux et qui permet la création de lieux d’éducation mutuelle où les jeunes se retrouvent entre eux et vivent des expériences originales et fondatrices. C’est dans cette dynamique que naissent les Ceméa, en 1937, en ouvrant le premier « centre d’entraînement pour le personnel des colonies de vacances et les maisons de campagne des écoliers ».
Une transmission de génération à génération par la cooptation et le compagnonnage
On le voit, les mouvements d’éducation nouvelle et les associations d’éducation populaire ont été étroitement liés à l’histoire de notre pays. Et très vite, les Ceméa ont proposé un modèle d’éducation transposable partout, dans différents domaines. En prise avec les réalités économiques et sociales et avec les besoins des publics, des acteurs intéressés par le succès des méthodes mises en œuvre, demandent aux Ceméa de former des éducateurs spécialisés, des infirmiers d’hôpitaux psychiatriques, des assistantes maternelles, etc… Il n’existe pas, à l’époque, d’école de formation des formateurs - même si quelques stages et des ouvrages permettent une diffusion des idées - et les pratiques éducatives se transmettent de façon privilégiée à travers la cooptation des militants qui s’engagent et qui deviennent, d’une génération à une autre, des passeurs de mémoire, avec le souci de former les plus jeunes afin qu’ils reprennent le flambeau et poursuivent l’action. Une mémoire une et multiple qui traduit bien l’unité et la diversité de ces mouvements. C’est encore, pour une part, sur ce modèle qu’ils fonctionnent.
En 80 ans, les Ceméa, comme tous les mouvements et associations, ont beaucoup changé. L’éducation populaire a changé. Les publics et les modes d’intervention ont changé. le militantisme a aussi changé. Les métiers et les formations professionnelles de l’action éducative et sociale se sont structurés et développés.
Des problématiques nouvelles sont apparues depuis une vingtaine d’années et exigent des réponses nouvelles sur autant de nouveaux terrains d’action : l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, le service civique, l’accompagnement scolaire, l’économie solidaire, l’éducation au développement durable, l’éducation critique aux médias, la solidarité internationale, etc. L’école, de son côté, est confrontée à de nombreuses difficultés. Elle doit faire face à l’échec scolaire, aux intégrismes, aux violences parfois, et elle doit consolider son rôle éducatif et préparer mieux au « vivre ensemble ».
Relever les défis d'aujourd'hui
L’éducation populaire, toujours au cœur des questions sociales d’aujourd’hui, est confrontée à ses propres contradictions et à ses limites mais, parce que c’est sa vocation, elle doit continuer à être porteuse d’espoirs. Avec des valeurs qui s’enracinent dans la vie quotidienne, sans nier les obstacles et les difficultés liés à des contextes socio-économiques de plus en plus difficiles. Les Ceméa sont engagés dans ces enjeux et leurs formateurs prennent toute leur part aux défis d’aujourd’hui. Mais toutes les valeurs de citoyenneté, de solidarité, de liberté que nous défendons, ne sont rien si elles ne sont pas portées par la société civile et, concrètement, par les acteurs de terrain.
Il nous faut donc passer de la conscience parfois malheureuse de ces acteurs trop contraints à réparer, à répondre à des appels d’offre « marchands », à l’impulsion de dynamiques qui contribuent à construire de vrais projets de transformation sociale où les mouvements ont un rôle central à jouer. C’est sans doute cette conjonction entre un projet politique soucieux de l’intérêt général, parfois porteur d’utopie, et l’innovation au quotidien des acteurs locaux, sorte de réservoirs des pratiques disponibles pour le changement, qui peut contribuer à construire l’avenir. En cela, chaque citoyen peut être un de ces passeurs d’avenir qui aide chacun à combattre le repli sur soi et à permettre l’émergence de vrais projets citoyens où la parole circule librement dans des espaces collectifs et collaboratifs.
Jean-Marie Michel
Tous les articles en lien avec cette thématique



