En 2009, la COP15, plus connue sous le nom de conférence de Copenhague, entérinait ce qui constitue encore le principal objectif des négociations climatiques : la limitation du réchauffement à maximum 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle.
En 2015, avec la COP21 et l’accord de Paris, les dirigeants de la planète s’engageaient à contenir « l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [à poursuivre] l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C ».
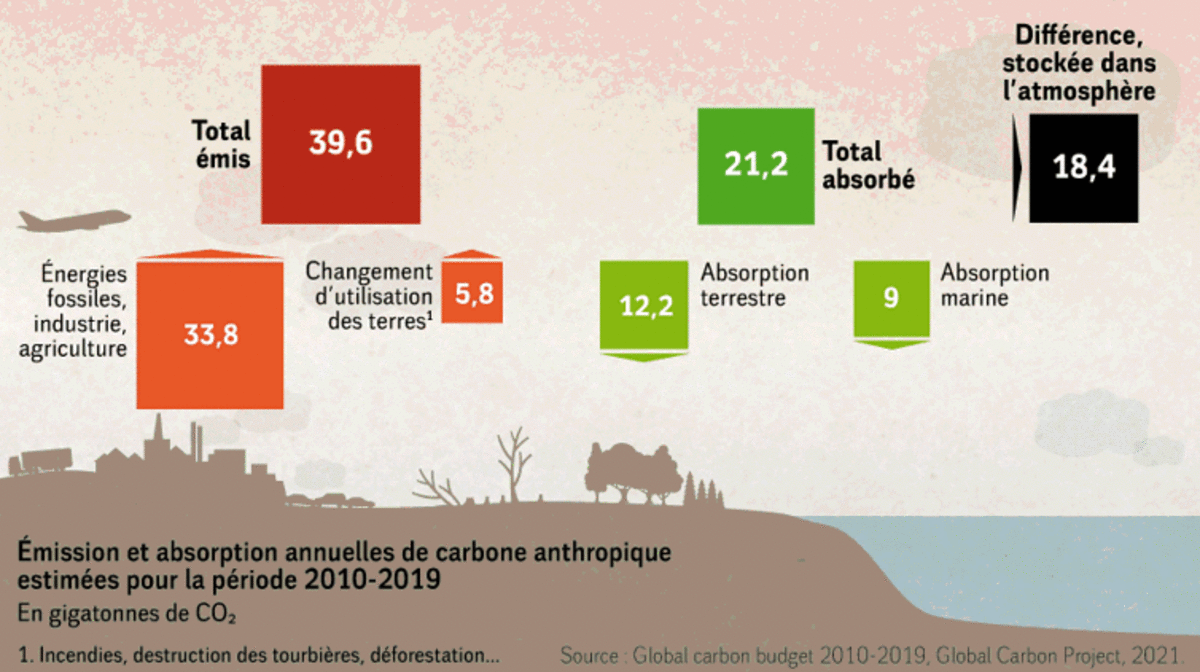
Agrandissement : Illustration 1
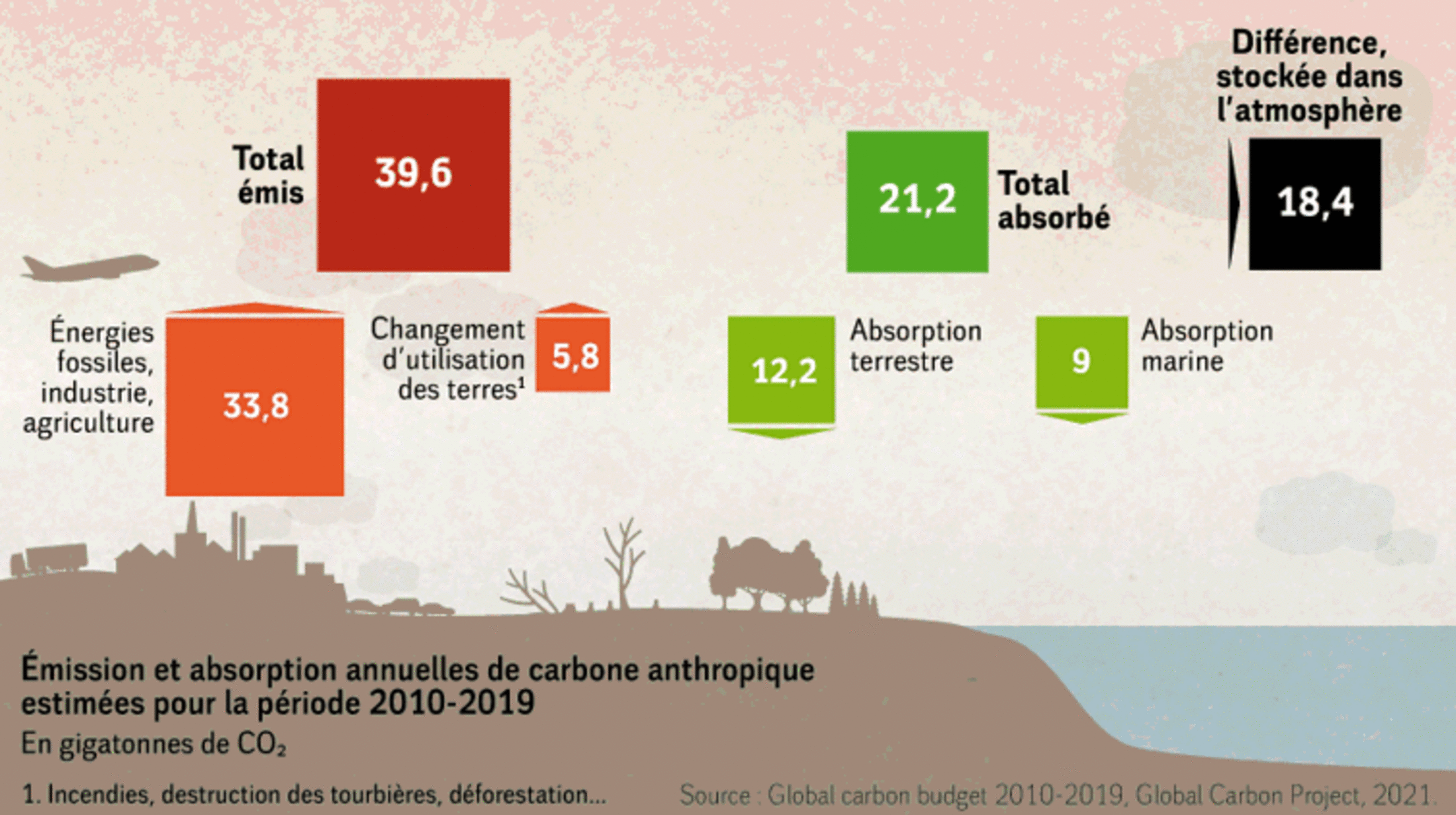
La COP26 qui se tient début novembre à Glasgow vise à traduire dans les faits l’accord universel signé à Paris en 2015. Les signataires de l’accord se sont accordés cinq ans avant de l’appliquer et la plupart des pays en ont profité pour laisser leurs émissions augmenter de 2016 à 2019. Les engagements actuels de l’ensemble des pays sont loin de suffire, car ils mèneraient à une trajectoire supérieure à + 3 °C à l’horizon 2100. Il y aurait donc nécessité pour cette conférence de réviser à la baisse les contributions déterminées au niveau de chaque pays.
Comme le confirme le dernier rapport du GIEC d’août 2021, la température moyenne de la planète a déjà augmenté de 1,1 °C, à cause des gaz émis depuis la révolution industrielle, au milieu du XIXe siècle[1]. L’investissement dans le secteur fossile continue de croître au niveau mondial[2]. La plupart des experts s’accordent donc à considérer, compte tenu de l’inertie du phénomène, que le réchauffement sera de toute manière supérieur à 1,5 °C autour de 2040. Pour rester en dessous d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, il aurait en effet fallu réduire les émissions mondiales de CO2 de 3,3 % par an à partir de 2010 ; comme elles ont augmenté, il faut désormais les réduire d’environ 7 % par an[3]. Patienter jusqu’en 2025 pour amorcer ce chantier, ce sera s’obliger par la suite à réduire de 10 % par an les émissions mondiales de CO2, etc. Vouloir transformer durablement, tous les ans 10 % de l’économie mondiale est une tâche proprement titanesque qui n’a pas grand sens.
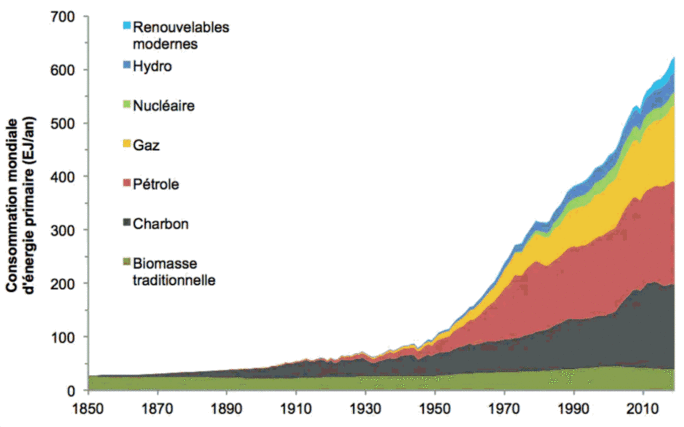
Agrandissement : Illustration 2
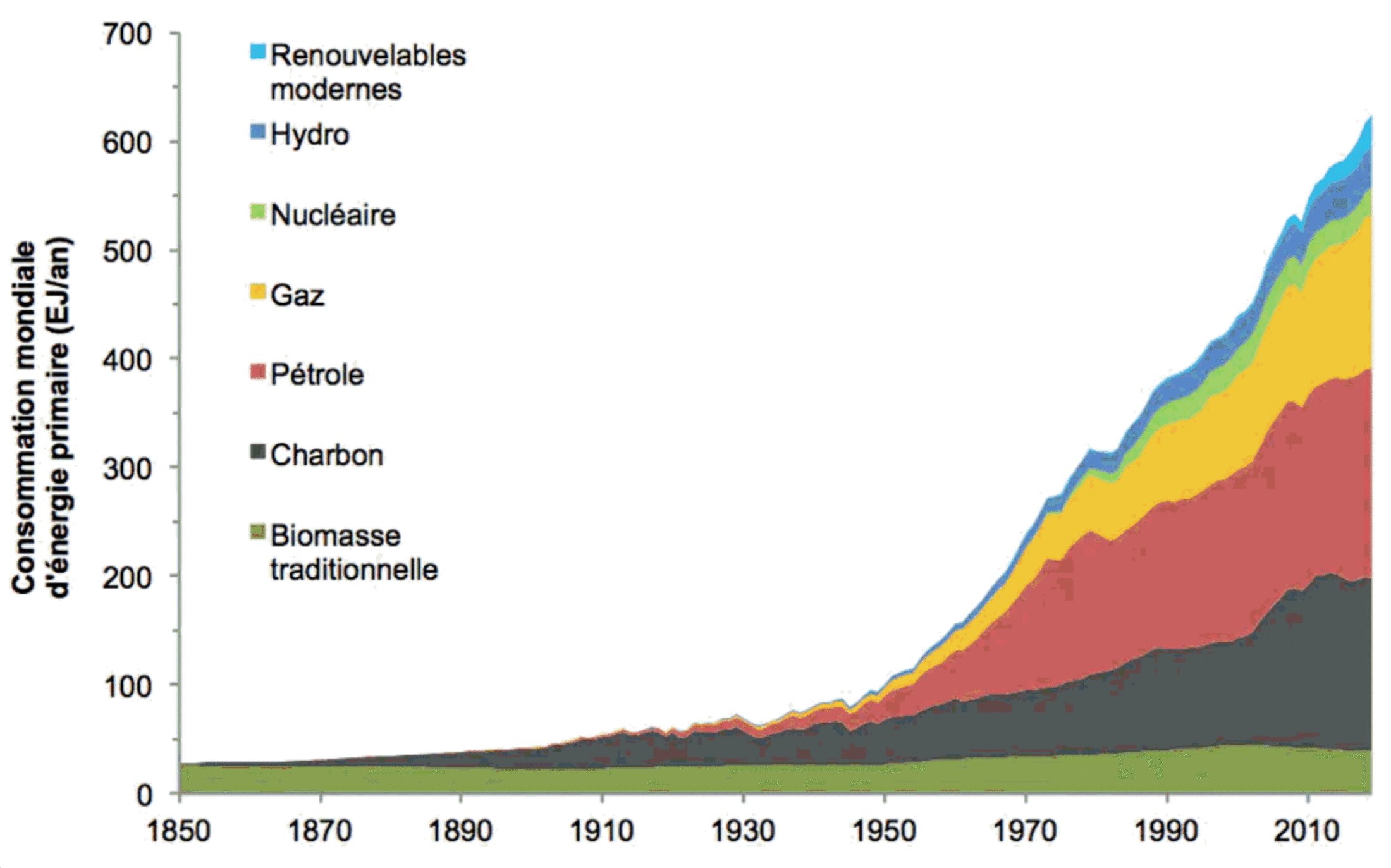
Les infrastructures industrielles aux durées de vie extrêmement longues – centrales et réseaux électriques, pipelines, raffineries, voies de communication, équipements lourds (sidérurgie et chimie) – impliquent une inertie gigantesque quand il s’agit de changer l’existant et de réaliser une transition vers un monde plus écologiquement soutenable. Les transitions énergétiques n’ont été jusqu’à présent qu’une succession d’empilements de ressources : il n’y a jamais, au grand jamais eu de remplacement total d’un système énergétique par un autre. Les renouvelables aujourd’hui ne font pas exception et s’additionnent aux fossiles alors que la transition énergétique nécessiterait une transformation radicale et non pas relative des sources. De toute manière, l’apparition de nouvelles formes d’approvisionnement énergétique engendre un surcroît d’utilisation des énergies existantes. La construction et l’utilisation des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des voitures électriques ne peuvent pas se faire aujourd’hui sans le charbon, le pétrole et le gaz. C’est en effet majoritairement l’emploi d’énergie fossile qui permet l’extraction de toutes les matières premières requises pour produire et utiliser les nouvelles énergies bas carbone.
Qui croit encore qu’un nouvel effort d’une ampleur gigantesque viendra s’ajouter tous les ans à ceux des années précédentes et qu’il sera possible ainsi de rester en dessous des +2°C fatidiques ? Dans vingt-deux ans, émettant au rythme actuel 40 Gt de carbone chaque année et dépassant les funestes 900Gt, les 2°C fatidiques seront très certainement dépassés. Le réchauffement est un fait et, au vu des maigres résultats des négociations climatiques, la catastrophe semble pour l’instant inévitable.
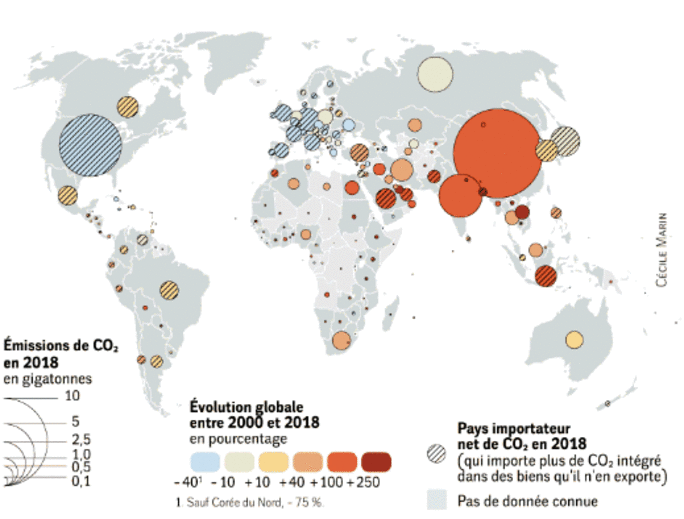
Naturellement, aucun homme de pouvoir aujourd’hui ne pense sérieusement possible de sauver le climat. Les efforts sur le papier des pays occidentaux sont d’ailleurs entachés de scandaleux biais. Ainsi la neutralité carbone en 2050 de l’Union Européenne, présentée comme une des parties les plus mobilisées dans la lutte pour le climat, ne signifie pas la fin de l’émission de GES, mais s’appuie en réalité sur des projets de captation du CO2 dans des puits de carbone aux modalités pour le moins incertaines ; ainsi le découplage annoncé des gaz à effet de serre de la croissance économique européenne au cours des dernières décennies[4] est un mensonge : une part significative des émissions des pays émergents est en effet liée à des délocalisations qui masquent l’augmentation des émissions pour produire dans le Sud des biens consommés dans l’union ; ainsi le renforcement de la financiarisation de l’économie et des bulles spéculatives via les marchés du carbone est nuisible et sans effet sur le climat …
Toutes ces années, le mouvement pour le climat n’a pas entamé la progression inexorable de l’exploitation des combustibles fossiles. Le sentiment de l’absolue impuissance du mouvement écologiste soulève dans ses rangs peu de questions sur les moyens d’action et les cibles potentielles. C’est un bilan optimiste du paraitre bigarrées des « manifestations jeunes, joyeuses, exubérantes, respectueuses et ordonnées » qui est généralement dressé. Le satisfécit est général pour les mouvements Européens, étasuniens ou mondiaux des années 2010 qui ont été, parait-il, crescendo et fortississimo. Le contentement de soi n’est pas moindre quant aux moyens d’action mis en œuvre : « Incontestablement, cette posture [« douceur et modération extrêmes »] a bien servi le mouvement. Elle confère beaucoup d’avantages tactiques [« le mouvement a séduit tout le monde »] »[5]. Les activistes satisfaits du happening et du déguisement semblent lier leur bilan et leur critique à rien de fondamental. Apparemment, ils n’aperçoivent nullement les conséquences politiques de leur positionnement, ils s’en tiennent toujours à un écologisme déclamatoire sans suite et à de simples postures. Il semble pourtant que le mezzo-voce, le pianissimo de leur protestation ait été peine perdue, après le decrescendo, le doloroso par où est passé l’absence assourdissante de solution sur le climat. La relativement modeste expression des écologistes a eu apparemment pour seule réponse positive aujourd’hui le «gueuloir» des médiats définitivement acquis au parlé vert, à l’esthétique toute adolescente, etc. La faiblesse du mouvement est sans doute liée en partie à l’origine sociale de ses acteurs engagés volontaires et intéressés sur les sentiers néolibéraux des fausses solutions et de l’accompagnement du capitalisme vert.
Alors que se tient l’ixième COP, tous les efforts se concentrent encore et encore sur l’atténuation, c’est-à-dire sur la réduction des émissions. Mais, quoi que l’on fasse désormais, compte tenu de la durée de vie des gaz dans l’atmosphère et de la captation réformistes du mouvement pour le climat, les perturbations prévues pour les trente prochaines années sont devenues largement inévitables. Parallèlement aux parcimonieuses réductions d’émissions, les mouvements écologistes d’arrière-gardes ne devraient-ils pas plutôt revendiquer les moyens de s’adapter à la hauteur des menaces, ce qu’aucun pays même européen n’a encore vraiment osé faire à grande échelle, pour ne pas effrayer sa population (catastrophes météorologiques, inondations, montée du niveau de la mer, accueil des réfugiés climatiques, etc.) ?
[1] « Climate change 2021. The physical science basis », GIEC, Genève, 9 août 2021.
[2] Publié récemment par un consortium d’ONG environnementales : « Banking on climate chaos. Fossil fuel finance report 2021 »
[3] « Rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions », Programme des Nations unies pour l’environnement, Nairobi, 26 novembre 2019.
[4] Cf. « Une planète propre pour tous. Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat », communication de la Commission européenne, Bruxelles, 28 novembre 2018.
[5] « Comment saboter un pipeline », Editions La fabrique juin 2020, Andréas Malm



