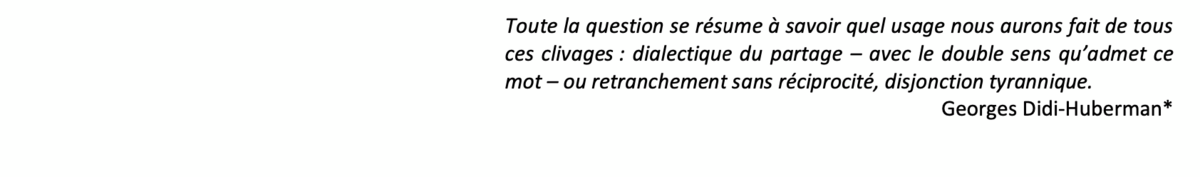
Agrandissement : Illustration 1


Agrandissement : Illustration 2

La métropole fantasme au sujet d’une jeunesse « sans foi ni loi » décrite en bandes de sauvages. Les titres de journaux ou d’articles les plus effrayants ornaient récemment les kiosques parisiens[1]. Pourtant les événements relatés ne dépassent pas en intensité ni en fréquence ce dont la population est ici accoutumée depuis des lustres. La France se préoccuperait-elle de sa terre lointaine qu’elle passe son temps à ignorer sinon pour la maltraiter ? Tout au plus s’amuse-t-elle à se faire peur. Des monstres menacent aux confins de la République.
La politique contre les habitants de l’île n’a jamais varié depuis près de trente ans, au moins depuis la publication en 1995 du décret Balladur soumettant à visa toute entrée sur l’ile de Mayotte des populations historiques de l’archipel des Comores.
Il s’agit d’une logique de séparation radicale qui ne peut être soutenue sans brutalité ni cruauté. Il devient impératif, pour tenir les voisins à distance, de définir un principe de distinction. Les habitants de l’île française sont mis en demeure de trouver enfin la petite différence qui les rendra définitivement inconciliables avec les habitants des autres iles, en dépit des liens historiques, géographiques, socio-culturels, familiaux…
Mythologie de la différence et arsenal législatif
Hélas dans le monde réel, le simplisme produit rarement des effets positifs. La dynamique de la frontière idéalisée ne s’exerce pas seulement contre les Comoriens du dehors qu’elle échoue à tenir à distance, mais bien évidemment contre tous les Mahorais, en dedans, puisque la ligne de fracture traverse chacun individuellement dans son histoire, dans sa famille, dans son village. Fondée sur la mythologie d’une différence introuvable, le rejet engagé ne pourra que s’abimer en intensité et en démesure. Le tri illusoire auquel chacun se trouve convié nourrit une malédiction indépassable.
Le traitement politique des problèmes de la région - et les élue.s les moins éclairé.es en redemanderont toujours plus - s’oriente vers une militarisation de l’île de Mayotte, un quadrillage policier et la suppression de tout lieu de repli et de repos[2]. La maltraitance de l’ensemble de la population s’organise au sommet de l’État, sans circonspection, dans un mouvement qui semble interdire tout retour en arrière.
Dès le début du premier quinquennat de monsieur Macron, deux lois emblématiques de cet enjeu séparatiste furent promulguées au cours du même automne 2018 dans l’intention aujourd’hui revendiquée de pourrir la vie des étrangers[3].
La première, la loi Asile et Immigration du 10 septembre 2018, a modifié le droit du sol pour les natifs de Mayotte. Il ne suffit plus dès lors de naître sur la terre française pour acquérir la nationalité après l’âge de 13 ans, encore faudra-t-il que l’un des parents au moins fût en situation régulière trois mois avant la naissance. Dans la nouvelle loi « Asile… » en préparation, le gouvernement espère reculer ce délai à un an, aspiré par la revendication extrémiste d’une suppression du droit du sol sur l’ensemble du territoire national[4].
Ainsi l’État français peut se vanter d’avoir trouvé la martingale anti-migratoire qui permet d’augmenter la part des étrangers dans la population sans que personne n’ait à se déplacer. Trois ans seulement après la mise en application de la loi, la part des enfants soumis à l’obligation de présenter un titre de séjour pour circuler atteindrait 60% des élèves dans les classes de terminale des lycées. Beau résultat !
La seconde loi, dite loi ELAN, promulguée le 23 novembre 2018, donne dans son article 197 des pouvoirs exorbitants au préfet de Mayotte. Toutes les mises en œuvre de la loi depuis deux ans montrent qu’elle a été clairement élaborée comme alibi qui sous couvert d’améliorer l’habitat, se retourne contre les populations pauvres, toutes suspectées d’être étrangères ou de l’avoir été. De fait la loi ELAN dans ses dispositions pour Mayotte et La Guyane se borne à délivrer les autorités et les administrations sous leur tutelle d’un doute quant à la légitimité de leurs actions, et surtout à effacer le scrupule moral qui pourrait les hanter, perplexité que l’on devine dans les premiers communiqués de presse de la préfecture qui suivaient les démolitions durant l’année 2021 : « La destruction des bidonvilles n’est pas humainement facile, mais c’est une décision fondée sur le droit, c’est une demande forte de la population mahoraise, c’est une exigence de sécurité publique, de salubrité, et de dignité humaine[5]. »
Ainsi les tours de passe-passe de la langue du pouvoir permettent d’inverser toutes les valeurs de la République en prétendant les respecter.
Pourquoi la destruction des bidonvilles serait-elle humainement difficile s’il s’agit réellement de mettre en œuvre un programme visant à améliorer l’habitat mahorais ? Réponse implicite : parce qu’il ne s’agit que de détruire des maisons habitées par des familles, composées d’enfants, de mamans, de jeunes et vieilles gens, de personnes plus ou moins fragiles ou vulnérables que le préfet de Mayotte et ses acolytes se bornent à mettre tout bonnement à la rue.
Aussi la remarque « forte » du préfet qui conclut un précédent communiqué de presse, par ailleurs particulièrement sournoise elle aussi, voudrait rappeler l’ambition vertueuse de la destruction des bidonvilles en dissimulant les cibles : « Permettre aux Mahorais d’habiter des logements dignes n’est pas négociable. Cet impératif suppose de construire et nécessite de détruire[6] ».
Tout devient très lisse, sans aspérité : disparaissent les soupçons de lutte xénophobe contre les populations étrangères pourtant documentées depuis près de deux ans, et s’affirme la revendication d’une saine politique de construction d'habitats dignes et de destruction de taudis. Tout est dit dans le bon ordre mais un retour-du-refoulé puissant trahit les mensonges du préfet : l’emploi du verbe « nécessiter » quand il s’agit d’imposer une obligation de détruire ne peut compenser la procrastination contenue dans le verbe « supposer » dès lors que sont évoquées des constructions hypothétiques futures. Ainsi il ne s’agit que de détruire. Mais cela n’avait échappé à personne, surtout pas aux victimes de l’État, les indésirables de la République que les traficotages avec le droit du sol, de principe constitutionnel, et la loi ELAN dans ses dispositions pour Mayotte tentent de priver des droits humains les plus élémentaires : dormir sous un toit et bénéficier de la protection de l’État dans son pays natal.
Bien que la politique de destruction de l’habitat pauvre ne cible pas des populations selon les nationalités, mais des logements et des quartiers en fonction de critères de confort, il est clair que l’article 197 complète l’arsenal des moyens dans la lutte contre l’immigration clandestine. L’atteste amplement encore l’exemple suivant : le lendemain de l’agression d’un car scolaire survenue le 16 novembre dernier dans le village de Majicavo, avant même de connaître les conclusions des enquêtes diligentées par le procureur de la République, le préfet de Mayotte publie un communiqué au titre dénué d’ambiguïté : « Renforcement de la lutte contre la délinquance, contre l’immigration clandestine et des décasages[7] ».
Une politique irrationnelle au service d’une illusion
Les administrations de Mayotte gouvernent le département d’outre-mer selon l’opposition binaire du bon et du mauvais qui fonctionne comme un opérateur de classement archaïque. De tels principes simplistes sont mobilisés en vue de purger l’île des marqueurs de la pauvreté et des fauteurs de troubles sans s’embarrasser d’une analyse plus subtile[8].
Il devient implicite que, sans la pression migratoire, le niveau de vie à Mayotte serait sans doute égal à la moyenne observée dans les autres départements d’outre-mer. Aussi les deux lois emblématiques du premier mandat de E. Macron, dans leur application locale, jouent sur deux tableaux pour un même objectif. Par la mise en cause du droit du sol et le rejet des enfants nés à Mayotte de parents étrangers, il signifie aux populations originaires des autres iles de l’archipel, qu’elles ne sont pas assimilables dans la Nation, en raison d’une nature spécifique que les Mahorais sont appelés à définir. Quand bien même tous les enfants, nationaux ou étrangers dans leur pays, auraient reçu même éducation et même instruction dans les écoles de la République et dans les écoles coraniques, le refus de la nationalité renouvelle solennellement à leur majorité la sentence d’exclusion et de rejet. L’accusation calomnieuse de délinquance ne vise qu’à rendre moralement acceptable l’ostracisme dont les jeunes de Mayotte sont accablés.
L’application de la loi ELAN sur le sol de Mayotte assène à l’ensemble de la population un semblable verdict. Qu’importe que 30% de la population habitant des constructions précaires soient de nationalité française, le soupçon d’une nationalité indue parce que trop récente, pèsera durablement sur elle. Aussi le préfet qui flatte les penchants les plus bas des extrémistes regroupés dans des collectifs soi-disant pour la défense des intérêts de Mayotte, détourne les facilités exorbitantes que lui ménage l’article 197 pour frapper les populations étrangères et les dégoûter du pays. Mais nullement dans l’intention de résorber l’habitat insalubre et d’améliorer le parc immobilier de l’ile. Il « décase » dit-il. Il harcèle les populations pauvres supposées issues de l’immigration illégale. Il détruit leur maison, leur vie, leurs biens.
Quel est le bilan de cette politique contre l’habitat illégal, ou indigne, ou insalubre, au choix selon les scrupules et les points de vue ?
En 2021, onze arrêtés de démolitions ont été exécutés, 1652 logements furent détruits selon la préfecture, et environ 7800 personnes ont été privées de leur logement.
D’après les documents de la préfecture, 370 personnes auraient accepté les propositions de relogement, mais seulement 154 auraient été effectivement relogées pour des durées variant entre trois semaines et six mois. Au terme de ce délai, toutes ont été chassées du logement qui leur avait été cédé provisoirement.
La préfecture annonce dans ses mêmes communiqués que 500 étrangers en situation irrégulières auront été interpelés et reconduits à la frontière lors des opérations de démolition.
Il faut retenir de ce bilan succin que le parc immobilier de Mayotte a été amputé de plus de 1700 logements, poussant à la hausse le prix des logements les plus indignes de l’île, les seuls accessibles aux populations pauvres privées de toute prestation sociale et maintenues hors du marché de l’emploi.
Fort de ce succès la préfecture fit part de son intention de programmer à l’avenir une démolition par mois. Mais les premiers recours contre les arrêtés déposés au tribunal administratif à la fin de l’année 2021 ont sapé cette prétention. Un premier arrêté fut suspendu par une ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2021. Cette suspension entraîna le gel d’un second arrêté que la préfecture souhaitait exécuter en même temps sur la même commune. Un second recours contre un arrêté concernant un quartier de la commune de Bandrélé fut déposé en janvier, arrêté que la préfecture préféra abroger.
Le préfet publia ensuite trois nouveaux arrêtés de destruction de mêmes quartiers qui tenaient compte selon lui des observations du juge.
Deux recours contre ces arrêtés seconde mouture ont été déposés au tribunal administratif qui les a cette fois rejetés. Deux arrêtés furent publiés en août contre deux quartiers de la commune de Bandrélé ; l’un fut contesté par une famille mahoraise revendiquant la propriété de la parcelle qu’elle occupait. Le recours fut à son tour rejeté. Sur les deux quartiers cependant, l’ensemble des familles avaient déménagé leur logement et leurs biens avant l’arrivée des bulldozers, montrant ainsi que l’expérience acquise des démolitions antérieures dissuadait de s’en remettre à l’État.
En 2022, selon les documents de la préfecture, près de 300 logements ont été détruits concernant une population totale d’environ 1100 personnes. 505 avaient accepté la proposition de relogement provisoire. 44 auraient effectivement été relogées[9].
Manigances et ambiguïtés
Les familles habitant les quartiers menacés de démolition par arrêté préfectoral déguerpissent avant le jour annoncé de la destruction. Tout le monde est à présent au fait du déroulé des opérations. Cinq semaines après la date de publication de l’arrêté, tout peut arriver. Gare à celui qui met quelque espoir dans les promesses de l’administration, il en sera pour ses frais. Il risque de tout perdre : les matériaux de sa maison, tôles et bois, ses biens-meubles, et surtout la maîtrise de son destin.
La préfecture anticipe à son tour ce type de réaction dans l’organisation de son programme de lutte contre l’habitat illégal. Elle peut ainsi se dégager des obligations de relogement que lui impose la loi. Et espérer échapper à la sentence du juge administratif en apportant la preuve que les habitants ont décliné la proposition de relogement qui leur était offerte.
La faiblesse juridique des arrêtés réside essentiellement dans le respect par le préfet de son obligation de reloger les habitants. La loi prévoit que soit annexée à l’arrêté une proposition de relogement ou d’hébergement adapté à chaque famille. Instruit par la première suspension d’un arrêté en décembre 2021, le préfet a imaginé une parade habile mais sournoise : il suffit d’inciter les parents à refuser le logement proposé et d'obtenir une signature attestant le refus, et le tour est joué. Ce refus sera présenté au juge en cas de contentieux.
Cependant au cours des enquêtes sociales préalables à la préparation de l’arrêté, les travailleurs sociaux missionnés par l’ACFAV[10] présentent l’offre de relogement de façon qu’elle soit inacceptable.
Les agents indiquent d’abord le nom de la commune et du village où se situe le logement proposé, le lieu est presque systématiquement très éloigné de l’endroit où les familles ont leurs intérêts. La proposition n’est pas négociable.
Il est toujours répondu aux questions concernant la poursuite de la scolarité des enfants que les parents devront procéder eux-mêmes à l’inscription de leur enfant à l’école du village après leur installation. Sur une île où les municipalités rivalisent d’imagination pour tenir à l’écart de leurs écoles[11] les enfants des familles étrangères, l’inquiétude des parents est légitime.
Les familles sont systématiquement alertées sur la durée du bail, qui varie entre trois semaines, trois mois renouvelable une fois, ou six mois, selon le statut administratif du parent le mieux loti, c’est-à-dire selon qu’il est titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour, d’une carte de séjour annuelle ou pluriannuelle, d’une carte de résident ou enfin de nationalité française.
Il est aussi bien clair pour tout le monde qu’il n’aura le droit d’emporter qu’une valise contenant quelques habits et les affaires des enfants.
Les administrations en charge de la lutte contre l’habitat illégal, ou insalubre, ou indigne, obtiennent sans peine les résultats attendus : les habitants auront décampé avant le jour J de la démolition, sauf les quelques familles qu’une vulnérabilité excessive aura contraintes à s’en remettre au soutien trompeur de l’État.
Témoigne encore de l’incurable désinvolture des administrations, le fait qu’aucune des familles n’aura été déplacée dans le nouveau logement avant la date de l’opération. Tous assistent à la démolition de leur lieu de vie.
Ces manœuvres contre les populations auront permis au préfet de duper le juge des référés lors des recours contre les seconds arrêtés des quartiers de Tsingoni et de Bandrélé suspendus lors d’un premier essai.
Il a fallu déposer un énième recours contre l’arrêté du 19 septembre de démolition du quartier dit Doujani[12] pour convaincre le juge que les propositions de logement et les signatures des habitants ne recouvraient rien de tangible. Le juge a rendu une ordonnance de suspension de l’arrêté contesté le 8 décembre 2022.
Le juge des référés a également transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État dans laquelle il est demandé de s’interroger sur la définition de la notion d’espace homogène et surtout sur la notion de proposition de logement ou d’hébergement adaptée à chaque occupant[13].
Est-ce la fin des dispositions de la loi ELAN spécifiques à Mayotte ?
Le préfet avait déjà prévenu : si la loi n’est pas applicable, il faudra la changer. Il y a exactement un an, juste avant la première suspension d’un arrêté par l’ordonnance du 13 décembre, le préfet avait confié au Journal de Mayotte : « Il faut qu’on adapte notre travail à son contrôle par la justice, et il faut qu’on tire des enseignements de cette première année pour avoir des adaptations législatives et réglementaires[14]. »
* * *
Extraits d’entretien avec les populations menacées de délogement.
« Les gens de la préfecture, ils sont venus un jour et ils ont numéroté les maisons. Ils ne nous ont pas parlé. Trois jours après, l’ACFAV est venue nous dire que les maisons allaient être détruites et recenser les habitants pour le relogement. Il y avait quatre policiers avec des pistolets à la ceinture et une arme dans les bras. Il y avait deux femmes : une qui posait les questions et l’autre qui écrivait. La dame m’a dit que j’aurai une maison à M’Tsangaboué[15] pendant six mois et qu’après je devrai partir. J’ai posé la question de l’école des enfants, elle m’a dit que ce sera à moi de me débrouiller. Par rapport à mes affaires et mes meubles, la dame m’a dit que j’avais qu’à trouver un endroit où les mettre parce que je ne pouvais pas les emporter. Il n’était pas possible de discuter. Elles voulaient juste une réponse par oui ou par non si je voulais la maison ».
ANCHIAT, mère de cinq enfants, le 12 novembre 2022
_______________________
« Il y a déjà deux ou trois mois, je sais plus, six policiers et trois femmes sont arrivés chez moi. Ils sont restés à l’extérieur de la cour et m’ont interrogé sous un manguier. Les policiers étaient armés, ils portaient un gilet pare-balle, un casque à visière, des pistolets à la ceinture et dans les mains un pistolet mitrailleur. Je me suis senti menacé. Les trois femmes sont venues pour me dire que la maison sera bientôt détruite. Moi j’ai construit ma maison sur une parcelle qui appartient à mon frère. L’une [des femmes] posaient les questions, une autre écrivait et une troisième regardait. La femme qui posait des questions m’a demandé combien d’enfants habitaient la maison et qui allait à l’école. La dame m’a dit que ma famille sera logée à Chiconi[16] pendant trois semaines et après dégage. La femme n’a pas voulu répondre à mes questions, j’ai signé un papier mais je ne sais pas ce qu’il y avait ».
AHAMED Z. Père de quatre enfants, handicapé. Le 12 novembre 2022.
_________________
« L’ACFAV me propose une maison loin de mes voisins. Si j’ai pas à manger pour mes enfants, je sais que je peux trouver de l’aide chez mes voisins. Si mes voisins ne trouvaient pas à manger, si moi, j’ai à manger, là je leur donne. Comment je fais dans la maison où on me met ? Personne ne me répond. Je n’ai pas le droit d’emmener mes affaires mais toutes mes affaires, c’est une horreur. J’ai 50 ans. Comment je fais ? Où je mets mes affaires, personne ne me répond. L’ACFAV me dit que je devrai garder [elle veut dire rendre] la maison dans six mois. Comment je fais après ? Où je vais avec mes enfants » ?
Bahati Bibi, mère de trois enfants scolarisés, le 15 novembre 2022.
________________________NOTES
* Georges Didi-Huberman, Le témoin jusqu'au bout. Les éditions de Minuit. 2022, p.39.
[1] On peut esquisser une liste non exhaustive : France Info du 21 novembre, Violences à Mayotte : "On est au bord de la guerre civile", alerte la députée Estelle Youssouffa ; Le Monde du 21 novembre 2022 ; Mayotte prise dans une spirale de violence entre bandes rivales ; Le Monde du 23 novembre 2022, A Mayotte, la population se barricade et l’Etat promet de nouvelles mesures ; Le Figaro du 25 novembre 2022, Mayotte : qui sont ces «terroristes» qui sèment la violence sur l'île française ? ; Dans Libération le 25 novembre, Guerre entre gangs de jeunes à Mayotte : « Je suis obligé de défendre mon village ». Et pour couronner la semaine, Mayotte fait la couverture de Paris-Match, le jeudi 1er décembre avec le « choc » d’une photo mise en scène et le poids de mots bien lourds : « Mayotte. Reportage au cœur du chaos. Gangs et pillards sèment la peur dans ce département français ».
[2] Sous prétexte de lutte contre l’immigration clandestine, le Conseil constitutionnel a récemment déclaré constitutionnel les contrôles policiers à Mayotte sans restriction dans le temps et dans l’espace entamant ainsi le principe constitutionnel de liberté de circulation, voir ici.
[3] Monsieur Darmanin exprime sans détour son vœu de rendre "impossible" la vie aux populations étrangères. Voir ici ou encore ici.
[4] Alexis Duclos, « Jordan Bardella : “Il faut supprimer le droit du sol, pas qu’à Mayotte, sur tout le territoire” », Mayotte-hebdo, le 9 décembre 2022, en ligne ici.
[5] Communiqué de presse de la préfecture, le 5 novembre 2021. Ici.
[6] Communiqué de presse de la préfecture, le 28 octobre 2021. Ici.
[7] Sur le site de la préfecture de Mayotte, ici. Il convient de s’attarder sur l’emploi du terme de décasage, employé lors des événements de 2016 alors que les populations de villages de brousse, excitées par les municipalités, avaient décidé de se débarrasser des populations natives des autres îles de l’archipel. Ce terme de décasage sous-entendait : sortir les habitants de leur case, les décaser et s’en débarrasser. La politique du gouvernement affiche au contraire une volonté d’améliorer l’habitat de Mayotte, telle est l’ambition de la loi ELAN. L’emploi par le préfet lui-même du terme trahit son intention, et celle du gouvernement qu’il met en œuvre, de décaser les habitants des quartiers pauvres et non d’améliorer leur habitat.
[8] Le président du Rassemblement national qui peine à dépasser la xénophobie gouvernementale, a clairement posé la pensée binaire dans son analyse des problèmes de Mayotte « si l’on règle le problème de l’immigration, celui des Comores, on règle le problème de la sécurité à Mayotte. Si on n'avait que des Mahorais ici, on n’aurait pas de problèmes de sécurité. Elle est là la réalité. Une grande partie des faits de délinquance et de criminalité, que subissent les Mahorais, est soit liée directement à des clandestins comoriens soit directement à l’immigration par le biais des enfants et petits-enfants de familles qui sont présentes ici. Il y a trente ans, on ne parlait pas de ces phénomènes-là ». Dans Mayotte-hebdo du 9 décembre 2022.
[9] Voir pour toutes ces données : « Démolitions des quartiers pauvres sous couvert de la loi ELAN. Rapports de la LDH ». I & II. En ligne ici.
[10] ACFAV, Association pour la condition féminine et l’aide aux victimes, chargée par la préfecture de l’enquête sociale auprès des habitants et du relogement.
[11] Voir GROS Daniel, « Privés d’école », Plein droit, 2019/1 (n° 120), p. 28-31. DOI : 10.3917/pld.120.0028. URL : https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2019-1-page-28.htm
[12] Cet arrêté a été présenté dans le portfolio : « Marquer les indésirables. Une tradition française », le Club de Médiapart, le 29 octobre 2022.
[13] Pierre Mouysset, « Tribunal adminsitratif :: suspension de l’opération de résorption de l’habitat insalubre de Doujani », Le Journal de Mayotte, Le 9 décembre 2022, en ligne ici.
[14] Yohann Deleu, « On doit être plus carré » estime le préfet, étrillé par la justice sur les décasages de cette année ». Le Journal de Mayotte, le 2 décembre 2021. En ligne ici.
[15] Village du Nord, dans la commune de Bandraboué, à plus de trente kilomètres du quartier Doujani.
[16] Village sur le littoral ouest à une trentaine de kilomètres du quartier Doujani.



