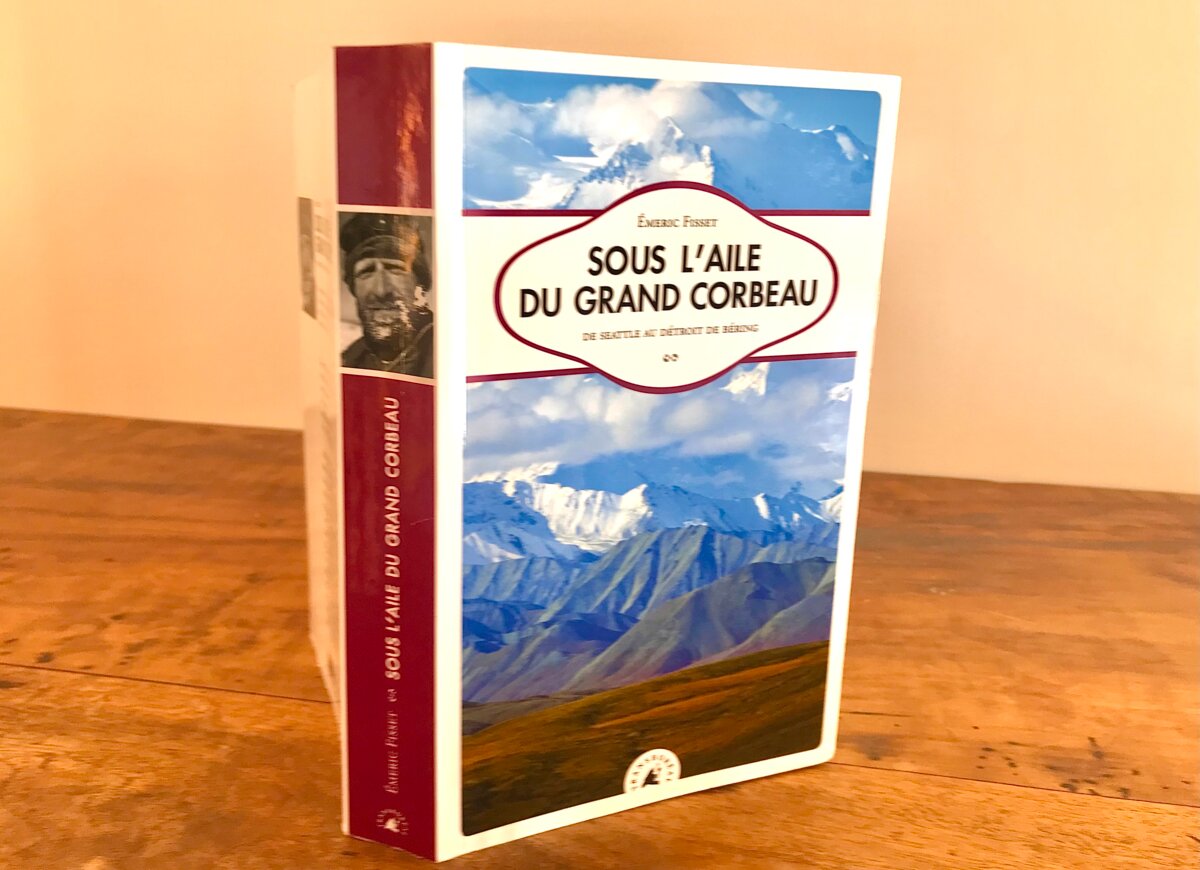
Agrandissement : Illustration 1
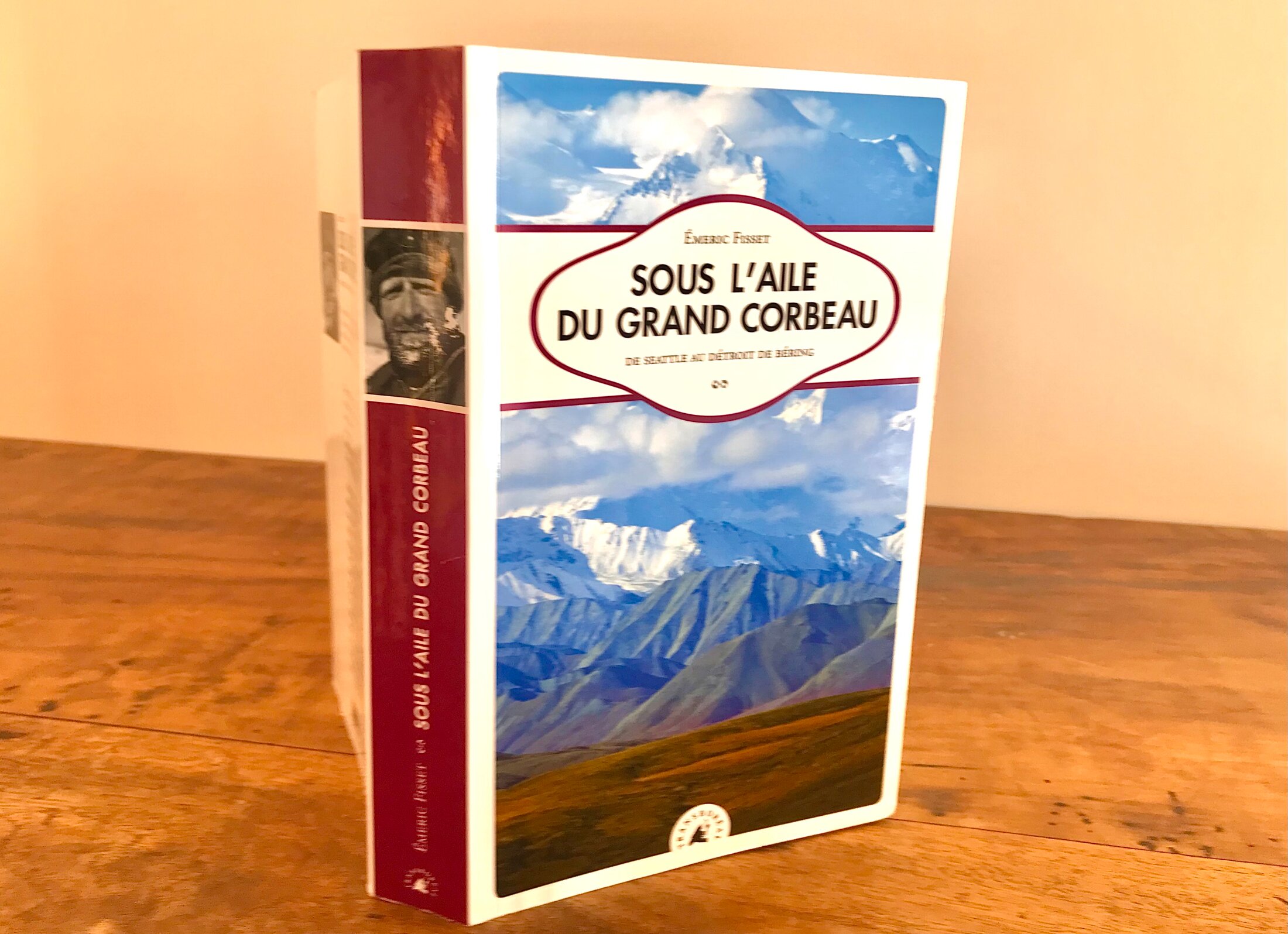
On a déjà parlé ici d’Émeric Fisset. De ses expéditions au très long cours, sans sponsor ni liaison radio, celui qui nous semble être le plus grand voyageur français a ramené des textes capitaux : en tête, son Ivresse de la marche - petit précis du voyage à pied qui ferait passer n’importe quel randonneur écrivain à succès pour un boiteux, et Dans les pas de L’Ours, qui narre sa première grande traversée en solitaire et dans le dénuement le plus complet de l’Alaska sauvage.
Puisque c’est mon éditeur, je crois connaitre un peu Émeric. Voilà pourquoi je le décris ailleurs comme un homme "mi ours, mi loup, mi Croisé, mi baladin", pensant qu'un type d'une trempe pareille en vaut au moins deux. Sauf que je n’avais jamais lu Sous l’aile du Grand Corbeau. C’était une erreur, la voilà réparée.
Ce livre parle d'un voyage époustouflant, de Seattle au détroit de Béring. Pour ce faire, d'abord marcher un mois et demi. De Vancouver, la métropole bien connue de l’ouest canadien, Émeric monte dans un kayak et gagne en sept mois Anchorage, au sud de l'Alaska, après en avoir franchi à la pagaie la totalité de son golfe. Sans doute pour se remettre du mal de mer, le voilà qui part à pied jusqu'à Saint Michael en plein Pacifique Nord, qu'il découvre après trois mois de marche. S'en suit un hivernage en compagnie des Eskimos Yuit et Inupiat pour apprendre à mener un traineau et surtout comprendre les bêtes qui vont le tirer. Enfin, c'est le départ pour le Détroit de Béring, avec pour ligne de mire, la Russie. Et tout cela seul, évidemment. Qui aurait le cran de le suivre ?
Seul ? Pas tout à fait. Ce diable d’homme ne l’est jamais, lui qui sait voir et dire les plantes, les animaux, le vent, le froid, la glace, la peur, les joies et les larmes. Et puis les hommes aussi. Tous les hommes. Donc les femmes. Blancs, Métis ou Autochtones, il s’est plongé par les livres et son effort dans ces cultures dont il parle avec d’autant plus de respect qu’il ne les idéalise pas. C’est beaucoup de ces humains des grands froids, qu’il est question dans ce livre, eux qui lui permettent de manger, se reposer, traverser parfois une rivière gelée, apprendre à pagayer ou à mener un traîneau. À eux aussi, il doit ses milliers de kilomètres parcourus à main nues.
Et puis, et puis… il y a cette force mentale et physique qui lustre chaque page. Car il n’est pas chose aisée de longer la côte Pacifique en kayak, surtout quand on n’en n’a jamais fait ! Dessaler, être déporté par les courants, voir des orques ou des baleines, se faire courser par des loups marins, le long de ces milliers de kilomètres sous une pluie incessante et glaçante ; tout cela aurait déjà été un exploit. Mais les voyages d’Émeric Fisset sont longuement mûris, donc ses épopées montent toujours crescendo.
Après avoir laissé son kayak, il charge son sac de 40 kg et taille la route. Harassé, on tourne les pages du fil de cette longue marche. Vidé par les tourbières ; recru de fatigue par les marécages gelés dans lesquels il s'enfonce jusqu'aux hanches - se blessant atrocement pieds et jambes - ; congelé à traverser les rivières si froides que l’hypothermie guette à chaque pas ; épuisé de marcher, toujours marcher, dans les taillis, sur des pentes glissantes, talonné par un ours noir. Mais il est impossible de ne pas coller aux basques de ce marcheur forcené, tant son texte nous entraine avec lui. Avec les Eskimos, on pense enfin souffler au coin du poêle, à manger du phoque et marquer des rennes. Mais Émeric Fisset a d'autres travaux d'Hercule à mener. Parmi eux : maîtriser un attelage de chiens et se construire un traineau. Parce que le temps presse, la banquise traitresse devrait bientôt geler.
"J'ausculte le ciel : il va faire froid, probablement - 40°C, mais je ne pense pas avoir à craindre le vent. Je stoppe les chiens, plante la pelle entre Bill et Spice pour tendre la ligne de trait et ôte les lanières de collier. Aussitôt, les uns et les autres se creusent un trou, se mettent en boule et se lèchent les pattes. Je distribue des cubes de graisse de phoque et prodigue mes caresses à chacun."
Sur la banquise, chantier de glace sculpté par les vents et la mer, ses chiens et lui tentent l'impossible, avancent mètre après mètre, slalomant entre les plaques aux arêtes vives et hostiles. Il faut tirer ou soulever le traineau énorme, encourager les chiens, les sauver de la noyade, tomber à l'eau trois fois, et se relever quatre. Après sept jours, tendu vers le cap Dejnev il "ressemble aux igaat du folklore de ce cap que j'aimerais tant entrevoir. Égarés dans la toundra, ayant oublié jusqu'à leur langue et considérés comme dangereux, ces parias de l'humanité passaient pour provenir de la Petite-Diomède et, ne possédant pas d'umiaq, devaient traverser le détroit en hiver, sur les glaces dérivantes, comme moi."
Sur le détroit mythique qui sépare l'Asie de l'Amérique, à 60 km du but, Émeric Fisset voit son rêve s'éteindre. Le pourquoi et le comment sont dans le livre, une folle équipée, une lecture haletante qui s'achèvent sur un lacrimosa gelé.
Premier échec, en seize années de voyage. Quel échec ? Et puis, des voyages, Émeric Fisset en connaitra d'autres. "À main nues. Plus au Nord. Plus seul encore."



