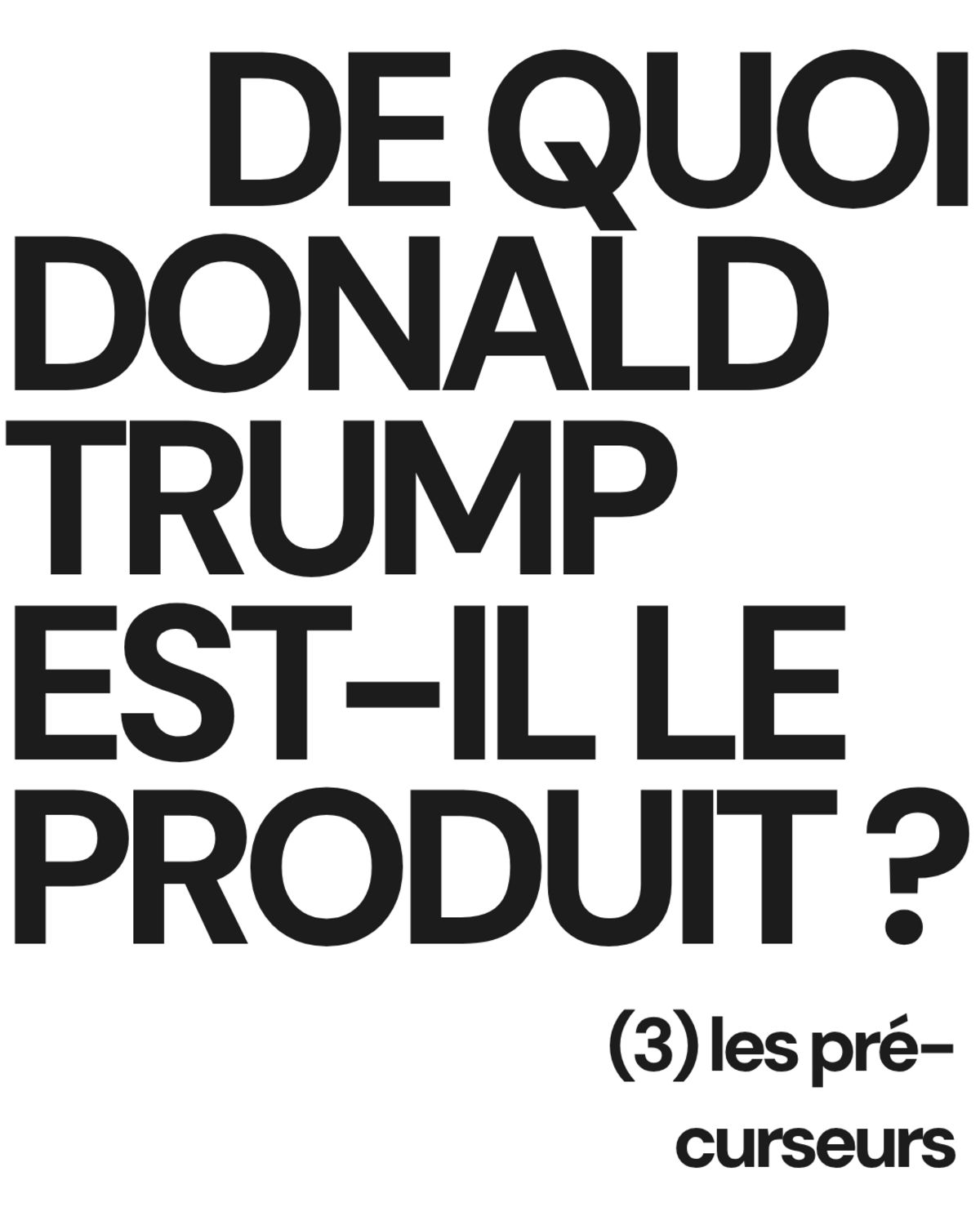
Agrandissement : Illustration 1
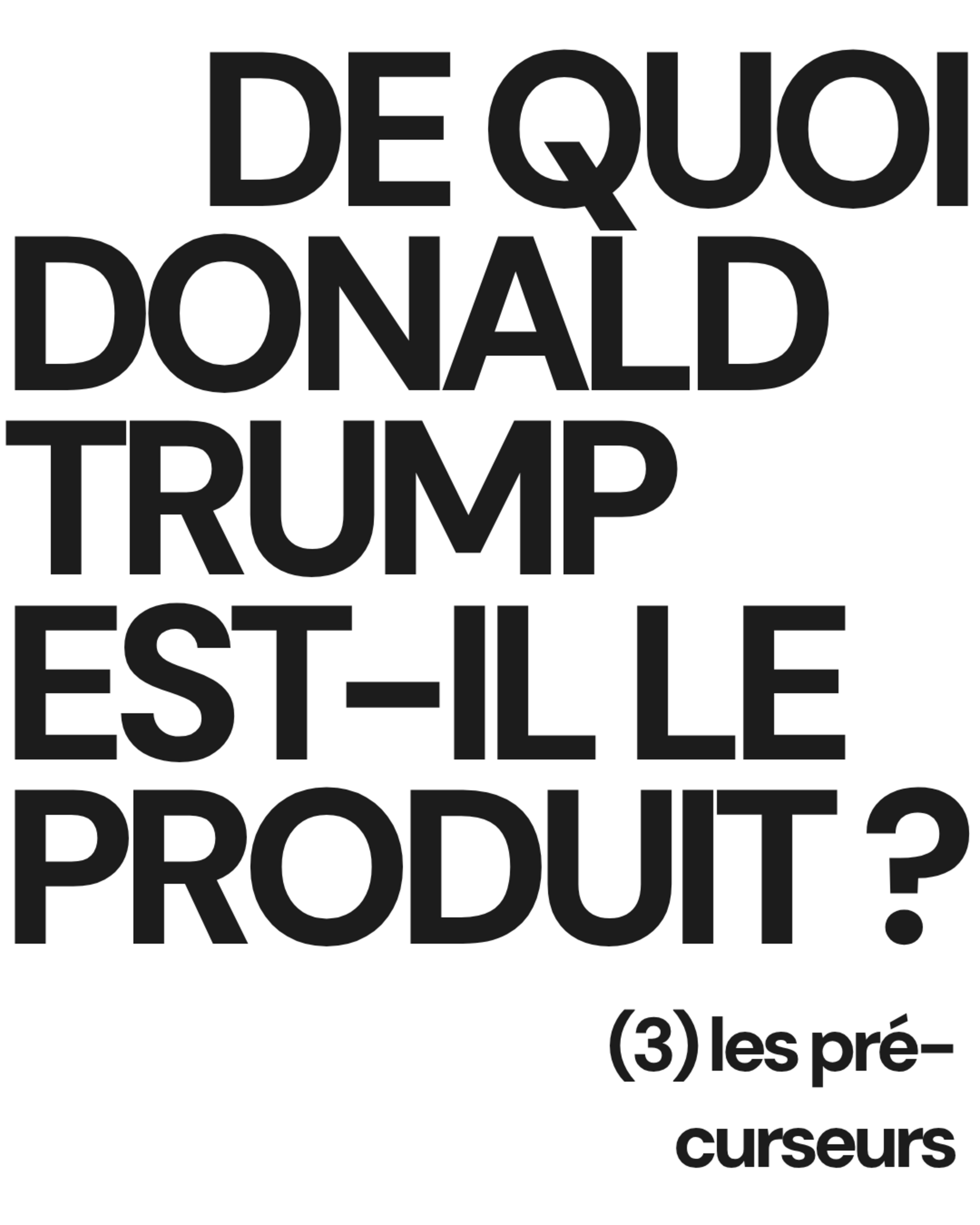
NEWT GINGRICH
Newt Gingrich revendique fièrement sa place parmi les précurseurs du trumpisme. Le programme du 47e président, écrit-il dans son dernier ouvrage intitulé Trump’s Triumph, s’inscrit dans “l’héritage de Barry Goldwater, de Ronald Reagan et, pour être franc, du mien”. Derrière cette emphase, son propos n’est toutefois pas dénué de fondement.

Agrandissement : Illustration 2
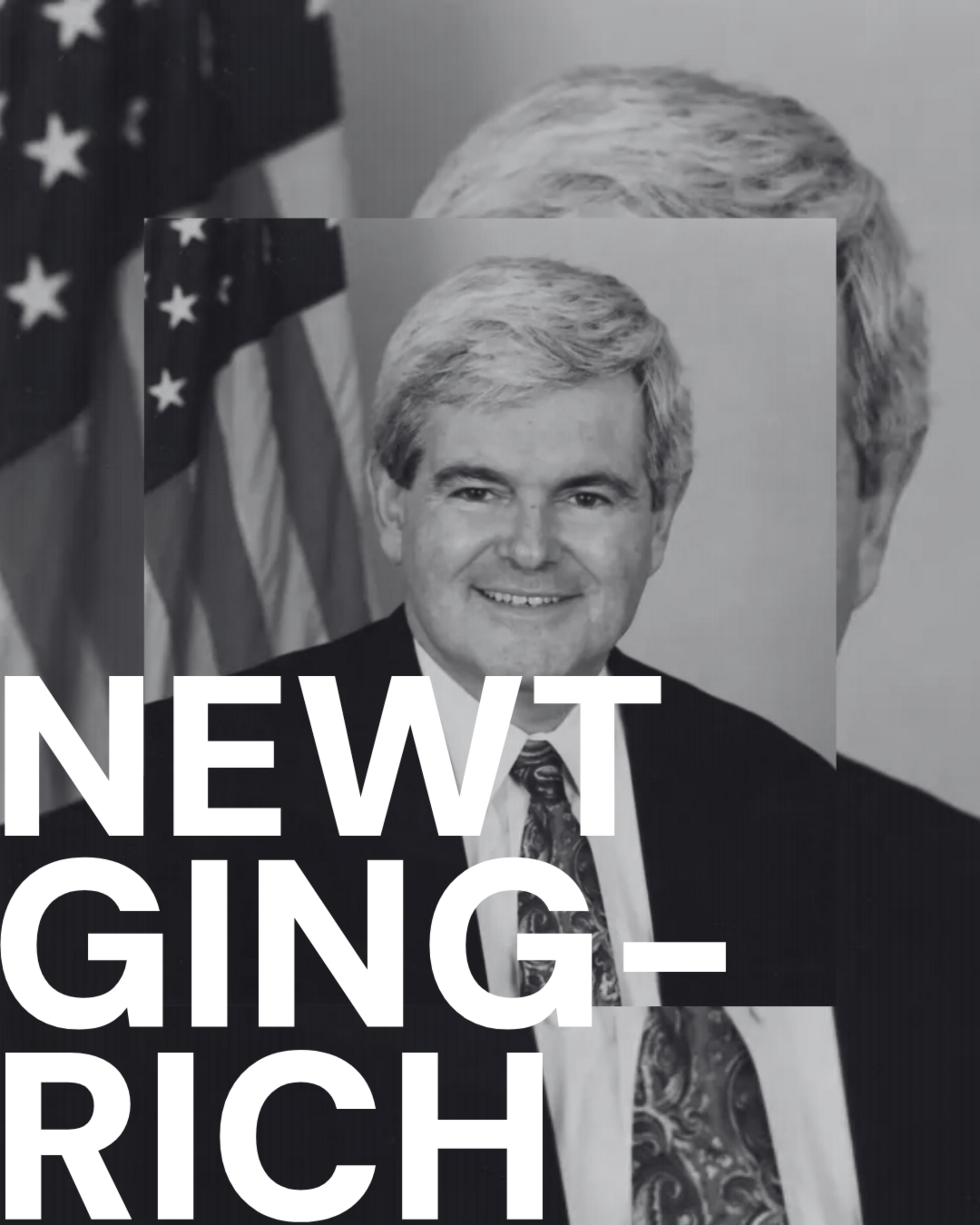
Né en 1943, fils de militaire en partie élevé en Europe, Gingrich s’installe en Géorgie avec sa famille à l’âge de seize ans. Diplômé de l’université Emory, il poursuit des études de doctorat en histoire à l’université Tulane, où il soutient en 1971 une thèse non publiée consacrée à l’éducation au Congo sous domination coloniale belge.
Très tôt, sa préférence va à la politique plutôt qu’à la carrière universitaire. Candidat au Congrès dès 1974, en tant que républicain modéré et nixonien, il remporte finalement le siège du 6ᵉ district de Géorgie lors de sa troisième tentative, en 1978. Entre-temps, il a rencontré Paul Weyrich, cofondateur de la Heritage Foundation et créateur du concept de moral majority. Weyrich, qui s’était donné pour mission de former une nouvelle génération de candidats conservateurs au Congrès, perçoit immédiatement le potentiel de Gingrich.
À peine élu, celui qui deviendra président de la Chambre des représentants affiche sans détour ses ambitions. Il entend les réaliser en bousculant les règles de préséance internes à son propre parti et en menant des attaques systématiques contre les dirigeants démocrates. Son arrivée au Congrès coïncide avec la création de C-Span (Cable-Satellite Public Affairs Network), qui retransmet pour la première fois en direct les débats parlementaires. Gingrich se montre particulièrement habile à exploiter ce nouveau dispositif médiatique à des fins personnelles et politiques.
Pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, que les Républicains n’avaient plus dirigée depuis 1952, Gingrich met en œuvre une stratégie offensive visant à discréditer la direction démocrate. Il cible successivement les présidents de la Chambre qu’il ambitionne de supplanter, d’abord Tip O’Neill, puis son successeur Jim Wright, qu’il accuse d’un manque de patriotisme et de manquements aux règles éthiques. S’il échoue à ébranler la réputation d’O’Neill, sa campagne finit néanmoins par provoquer la démission de Wright en 1989.
Ironie révélatrice : le grief principal qu’il adresse à Wright porte sur la vente de son livre lors d’événements publics organisés par le Congrès, en violation supposée des règles éthiques - accusation qui visait également Gingrich au même moment. Cette stratégie consistant à reprocher à ses adversaires des pratiques qu’il partage avec eux deviendra récurrente. En 1992, il accuse les Démocrates d’avoir abusé de leurs comptes bancaires parlementaires - pratique dont il s’est lui-même rendu coupable - et en 1998, il engage la procédure de destitution de Bill Clinton dans l’affaire Monica Lewinsky, alors qu’il entretient lui-même une liaison extraconjugale avec une femme beaucoup plus jeune.
Après la démission de Jim Wright, Gingrich est élu minority whip (chef de la minorité républicaine). Fidèle aux préceptes de Weyrich, il use de sa nouvelle position pour durcir encore l’agenda reaganien, allant jusqu’à s’opposer au président George H. W. Bush lorsque ce dernier renonce à son engagement de ne pas augmenter les impôts (‘read my lips: no new taxes”), tout en imposant à ses collègues républicains ses méthodes d’affrontement permanent.
Revigoré par l’élection de Bill Clinton à la présidence en 1992, Gingrich redouble d’efforts pour miner l’agenda du nouveau président. À l’approche des élections de mi-mandat de 1994, il rédige, avec Dick Armey - président de la conférence républicaine de la Chambre - et sous l’égide de la Heritage Foundation, le Contract with America. Ce programme visait à unifier les candidats républicains autour d’une plateforme nationale — seuls deux candidats républicains refuseront de le signer — et à signaler à l’administration Clinton qu’elle ferait face à une opposition parlementaire résolument conservatrice. Le contrat prévoyait notamment l’équilibre budgétaire couplé à des baisses d’impôts pour les PME et les familles, des réformes drastiques de la sécurité sociale et des prestations sociales, ainsi que l’instauration de limites au nombre de mandats parlementaires.
La victoire des Républicains lors des élections de mi-mandat leur permet de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants pour la première fois en quarante ans. Fort de ce succès, Gingrich accède à la présidence de la Chambre. Il s’engage alors à faire adopter l’intégralité des mesures du Contract with America dans les cent premiers jours du 104ᵉ Congrès. S’il n’y parvient que partiellement, malgré deux paralysies budgétaires imposées pour contraindre la Maison-Blanche, son intransigeance et sa stratégie d’obstruction finissent néanmoins par porter leurs fruits.
Les mesures les plus inégalitaires de l’ère Clinton portent clairement son empreinte — en particulier la réforme de l’aide sociale (Personal Responsibility and Work Opportunity Act) et la loi fiscale (Taxpayer Relief Act), qui comprend la plus importante réduction de l’impôt sur les plus-values de l’histoire des États-Unis. Par ailleurs, en polarisant la Chambre — ou peut-être grâce à cette radicalisation —, Gingrich parvient à maintenir la majorité républicaine lors des élections de 1996, malgré la réélection de Clinton.
Au début de l’année 1997 toutefois, le président reconduit de la Chambre va trop loin. Ses collègues républicains finissent par se lasser de la contradiction flagrante entre son ton inquisitorial et l’accumulation de mises en cause pour manquements éthiques. Après l’ouverture d’une procédure disciplinaire qui l’accuse d’avoir sciemment enfreint les règles parlementaires, une large majorité bipartisane vote le blâme.
Loin de renoncer, Gingrich tente de restaurer son autorité en reprenant la méthode qui a fait sa notoriété : abattre un haut responsable démocrate. Porté par l’émergence du scandale Clinton-Lewinsky, il prend la tête de la procédure de destitution du président, qu’il fait du même coup le thème central des élections de mi-mandat de 1998. Mais l’opération échoue : les Républicains perdent leur majorité à la Chambre. Conscient qu’un putsch interne se prépare contre lui, Gingrich se retire aussitôt de la présidence de la Chambre et annonce qu’il ne se représentera pas en 2000.
Éloigné du Congrès, l’ancien président de la Chambre demeure actif dans les cercles conservateurs, notamment à la Hoover Institution et à l’American Enterprise Institute. En 2007, il fonde l’organisation American Solutions for Winning the Future — financée par le milliardaire républicain Sheldon Adelson — chargée de promouvoir la déréglementation, l’exploitation pétrolière offshore et même l’extraction charbonnière. En 2011, il se porte candidat à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle. Battu par Mitt Romney lors des primaires, il consacre les années suivantes à restructurer la lourde dette de sa campagne.
En 2015, Newt Gingrich figure parmi les premiers responsables républicains de premier plan à soutenir la candidature de Donald Trump. Un temps pressenti pour être son colistier, il reste un conseiller informel et un soutien fidèle du président. Son épouse actuelle, Callista Gingrich - avec laquelle il entretenait une liaison lors de la procédure de destitution de Bill Clinton - occupe, sous l’administration Trump, des fonctions diplomatiques : d’abord ambassadrice des États-Unis auprès du Vatican durant le premier mandat, elle est aujourd’hui ambassadrice en Suisse.
Pour en savoir plus, regardez en libre accès notre entretien vidéo avec Melinda Cooper, sociologue du capitalisme américain en particulier le chapitre 7 : "Trouble dans l'hégémonie".
PATRICK BUCHANAN
Selon ses apologistes, Patrick Buchanan n’est ni raciste ni antisémite. Il tient simplement des propos racistes et antisémites. En tant qu’ancien rédacteur de discours et commentateur politique, Buchanan a certes eu recours aux mots pour gagner sa vie. Il serait toutefois injuste de suggérer que son racisme relève d’un rôle de composition destiné aux plateaux de télévision.
Au sujet des questions de race aux États-Unis, Richard Nixon, qui l’employait à l’époque, a résumé l’opinion de son conseiller politique par la formule “ségrégation pour toujours”. Quant aux juifs, les déclarations de Buchanan selon lesquelles Treblinka n’aurait pas été un camp d’extermination relève clairement de la négation de l’Holocauste – sans parler de ses propos élogieux à l'égard d'Hitler. Comme l’a fait remarquer le commentateur conservateur Charles Krauthammer, “ce qui est intéressant [avec Buchanan], c’est qu’il peut dire ce genre de choses et rester une figure nationale”.

Agrandissement : Illustration 3
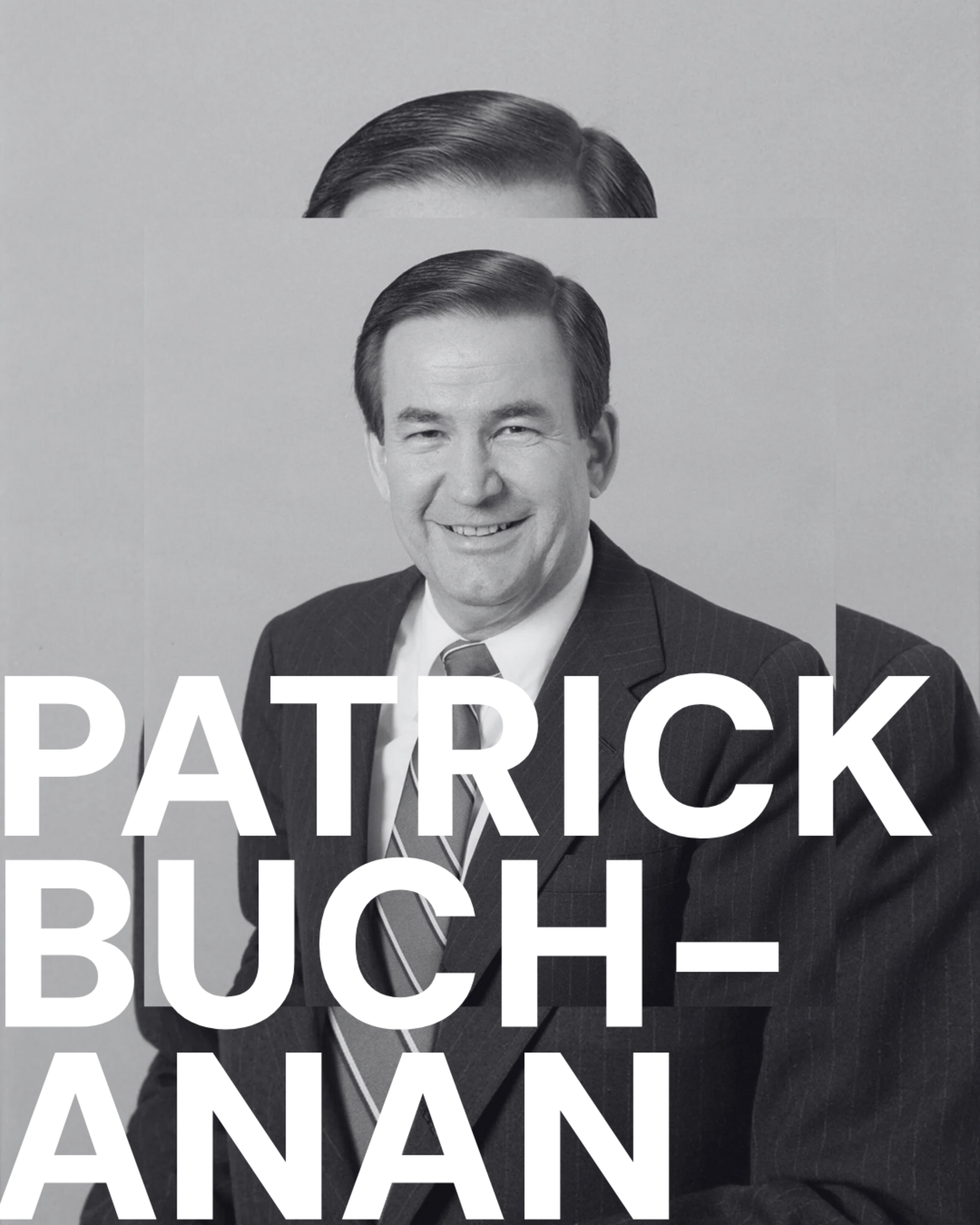
Même ses partisans les plus fervents n’ont jamais prétendu que ses diatribes homophobes, xénophobes et sexistes ne reflétaient pas sa vraie nature. Au mieux, ils ont justifié ses sorties sur l’épidémie du SIDA – une revanche de la nature contre les pratiques homosexuelles –, l’immigration – une menace existentielle – et le rôle des femmes – “construire le nid” comme “Maman Oiseau” – par son obédience religieuse : ces opinions ne seraient pas tant les siennes que celles du Dieu qu’il vénère.
Né à Washington en 1938, Patrick Buchanan a été élevé dans une famille catholique traditionaliste. Son arrière-grand-père a combattu sous le général Robert E. Lee, et il reste un fier membre des Fils de Vétérans Confédérés. Bagarreur et harceleur dans sa jeunesse – ses voisins juifs étaient sa cible favorite – “Pat” finit par mûrir, fait ses études à l’école de journalisme de Columbia et commence sa carrière de journaliste au Saint-Louis Globe-Democrat.
En 1966, Buchanan est recruté par l’équipe de campagne de Richard Nixon pour rédiger les discours ciblant la base électorale conservatrice du candidat républicain. Entre autres prouesses, Buchanan forge alors l’expression “majorité silencieuse”. Après la victoire électorale, il devient assistant et rédacteur de discours à la Maison Blanche, conserve son poste jusqu’à la démission de Nixon lors de son second mandat, Fidèle à son patron jusqu’à la fin, il va même même jusqu’à exhorter le président à brûler les enregistrements du Watergate pour rester au pouvoir.
Lors de l’arrivée au pouvoir de Gerald Ford, la nouvelle administration envisage brièvement de nommer Buchanan ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, le pays de l’apartheid. Toutefois, en raison de ses inclinations ségrégationnistes et de son enthousiasme excessif à l’idée d’obtenir le poste, le Département d’État finit par faire marche arrière. Temporairement retiré de la politique, Buchanan entame alors une longue et fructueuse carrière de commentateur dans les médias, d’abord à la radio NBC, puis à la télévision, où il rejoint successivement les émissions The McLaughlin Group diffusée sur NBC, puis Crossfire et The Capital Gang sur CNN. Dans ces émissions populaires, Buchanan tient le rôle du conservateur chargé de débattre avec un progressiste.
Le rhéteur de plateaux télévisés revient à la Maison Blanche en 1985 en tant que directeur de la communication de Ronald Reagan. Au cours de son mandat de deux ans, Buchanan joue un rôle clé dans l’organisation de la visite du président au cimetière allemand de Bitburg, où sont enterrés 48 membres de la Waffen SS. Tout en défendant la décision de l’administration face à l’indignation générale pendant ses journées de travail, le directeur de la communication utilise également son temps libre pour s’opposer à la déportation de criminels de guerre nazis présumés vers des pays du bloc de l’est. Pour Buchanan, honorer le sacrifice de la Wehrmacht et déjouer les plans des “chasseurs de nazis obsédés par la vengeance” sont les deux facettes d’une même mission – que son arrière-grand-père aurait sûrement approuvée.
Après avoir quitté l’administration Reagan et être retourné à ses activités de commentateur, Buchanan se sent plus libre de défendre ouvertement ses causes favorites. En 1989, par exemple, il rend un nouvel hommage à son ancêtre confédéré en écrivant une chronique sur l’affaire dite des “Central Park Five” : dans son article, il appelle à la pendaison publique d’au moins un des adolescents noirs accusés à tort d’avoir violé une joggeuse blanche.
À peu près à la même époque, Pat commence à encourager sa sœur Bay, qui a aussi travaillé pour l’administration Reagan, à poursuivre l’initiative “Buchanan for President” qu’elle a fondée. Le programme de la fratrie comportait deux volets.
Sur le plan intérieur, Buchanan fustige la politique d’ouverture des frontières prônée par l’aile globaliste du Parti républicain – ou au moins par les contributeurs des pages éditoriales du Wall Street Journal : l’immigration massive en provenance de pays non-européens, avertit-il, mettrait fatalement en péril le tissu culturel et moral des États-Unis.
En matière de politique étrangère, l’ancien rédacteur de discours soutient que la fin de la guerre froide devrait également marquer la fin de l’engagement militaire américain dans le monde entier. D’où son opposition farouche à la guerre du Golfe en 1990, qui l’a poussé à se présenter contre George H.W. Bush deux ans plus tard.
Lors des primaires républicaines de 1992, Buchanan se présente en tant que candidat paléoconservateur : il s’oppose au président sortant, qu’il accuse de poursuivre un agenda libéral et impérialiste. Selon Buchanan, Bush n’a pas seulement manqué d’honorer son engagement de ne mettre en place “aucune nouvelle taxe”, mais plus important encore, son administration n’a pas réussi à freiner l’immigration, à entraver l’accès des femmes à l’avortement et à supprimer les droits des homosexuels. Par ailleurs, ajoute-t-il, le lobby juif et ses relais néoconservateurs ont été autorisés à dicter les termes de la politique étrangère américaine.
Buchanan n’a pas remporté l’investiture, mais a tout de même obtenu près d’un quart des voix. À l’occasion de la convention républicaine, il a également délivré son célèbre discours sur la “guerre culturelle”, dans lequel il clame que l’Amérique est engagée dans une lutte décisive pour le salut de son âme, ayant le choix entre rester “le pays de Dieu”, ou s'enfoncer davantage dans la voie libérale et multiculturelle du déclin moral. Bien que certains commentateurs aient attribué la défaite républicaine à l'élection présidentielle à l'effet dissuasif de l'éloquence de Buchanan, le tribun paléoconservateur persistera. Après son retour à Crossfire, il crée une fondation appelée American Cause afin de se préparer pour sa prochaine candidature. Aux primaires de 1996, il se présente contre Bob Dole et est battu une nouvelle fois.
Après cette seconde tentative, Buchanan commence à désespérer du Parti républicain, qu’il quitte en 1999. L’année suivante, il est le candidat du Parti de la réforme. Alors que sa campagne échoue lamentablement, il joue involontairement un rôle décisif dans la victoire controversée de George W. Bush. À Palm Beach, en Floride, environ 2000 bulletins Al Gore, le candidat démocrate, lui ont été crédités par erreur. La Cour Suprême conservatrice ayant rejeté la demande de recomptage des voix formulée par Al Gore, son adversaire a été déclaré vainqueur en Floride, ce qui lui a octroyé suffisamment de grands électeurs pour devenir président.
Après 2000, Buchanan abandonne la course à la présidence et quitte CNN pour MSNBC, où il est l’un des rares éditorialistes à s’opposer à la décision de Bush d’envahir l’Irak. Il défend de plus en plus ouvertement ses causes préférées : dans l’une de ses chroniques, il déclare ainsi que le Royaume-Uni n’aurait pas dû déclarer la guerre à l’Allemagne nazie, tandis que dans son ouvrage Suicide of a Superpower, il déplore explicitement le déclin de la suprématie blanche en Amérique. Malgré cela, ce n’est qu’en 2011 que MSNBC se décide à mettre fin à son contrat.
Cinq ans plus tard, Donald Trump remporte l’élection présidentielle, sur un programme qui fait largement écho à celui de Buchanan. Ce dernier a évidemment apporté son soutien au candidat MAGA, même si le succès de Trump a dû avoir un goût amer pour le vétéran de la guerre culturelle – qui a continué à écrire des articles, principalement pour VDARE, le site web du suprémaciste blanc Peter Brimelow, jusqu’en 2023.
En dépit des similitudes entre leurs programmes, l’étendue de l’influence réelle de Buchanan sur le 47ème président reste sujette à débat. Ce que sa carrière florissante révèle cependant, c’est que bien avant Trump, les médias grand public et l’establishment politique de Washington étaient déjà prêts à accueillir un ségrégationniste décomplexé et un sympathisant d’Hitler comme l’un des leurs.
Pour en savoir plus, visionnez notre entretien de Joe Lowndes, spécialiste de la politique américaine, plus particulièrement de la politique de droite, du populisme et des questions raciales. Ce portrait de Patrick Buhanan est extrait du dossier documentaire qui accompagne le chapitre 1 de l'interview : "Le défi paléo-conservateur".
Les autres articles de la série :


