Comment est née l’idée de ce roman ? Plusieurs hypothèses viennent à l’esprit du lecteur : un ancrage très fort dans le réel, une histoire sociale et politique, avec ces références à Auschwitz, à l’Algérie, aux sans-papiers, au 11 septembre à la toute fin du roman. Mais aussi une quête identitaire. Ou un travail très dense sur le rapport du réel et de la fiction, avec le « mensonge » au centre de cette interrogation…
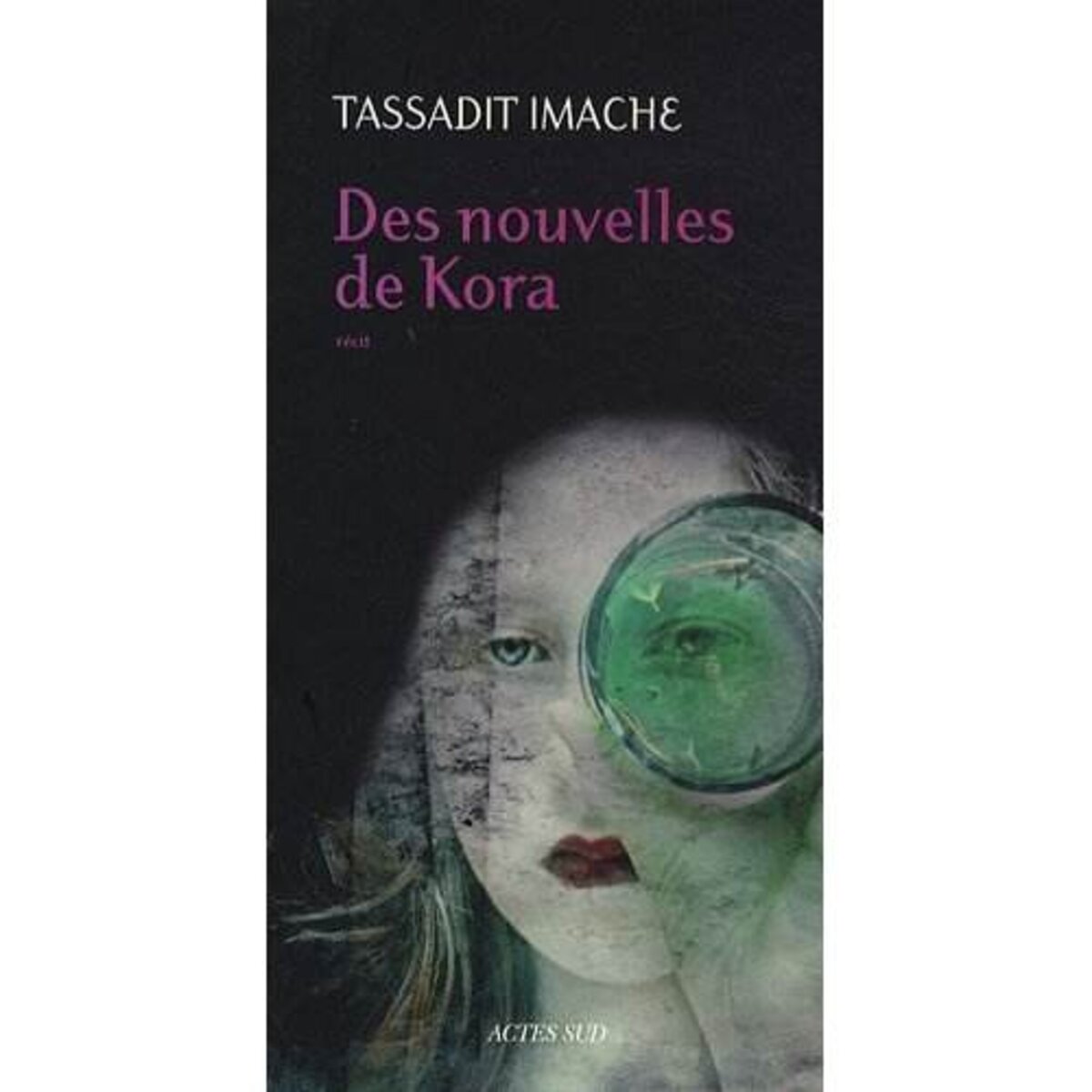
Si le lecteur visite toutes ces hypothèses, alors j’aurais réalisé ce désir inavouable - qui habite tout écrivain, me semble-t-il - toucher, donner à ressentir et à penser autrement, grâce à cette langue advenue par l’écriture. Plus juste et forte que la parole...
Une fois achevé, Des nouvelles de Kora n’était plus un roman. C’est un récit. Un livre pas tout à fait détaché de la vie et qui montre en certains endroits l’étirement, l’arrachement du texte au réel. C’est le chant polysémique de l’odyssée intérieure de Michelle, cette héritière improbable de sa propre histoire.
A l’origine du livre, il y a un personnage de Presque un frère, mon roman précédent : Lydia, cette fille indigne qui vient demander des comptes à sa mère sur son enfance. Chaque fois qu’elle ferme les yeux, lui dit-elle, elle est de retour aux Terrains, la cité où elle a grandi. Cela l’empêche de construire sa propre vie ! Michelle est un avatar de Lydia !
J’ai écrit ce livre, à un moment particulier de ma vie et de mon travail, une sorte de croisée des chemins où se posaient à moi âprement des questions importantes. Questions abordées dans un texte dont la première partie a été publiée dans la revue Esprit en novembre 2001 « Ecrire tranquille ? ». Je me questionnais sur les rapports qu’entretiennent, pour le meilleur et pour le pire, la littérature, l’identité, la politique. Quelle articulation du réel et de la fiction ? quid de la liberté et d’une responsabilité particulière de l’écrivain ? J’ai mis en exergue dans « Ecrire tranquille », des réflexions d’autres écrivains qui résonnaient fort là où j’en étais : Toni Morrison qui dit dans Playing in the Dark « les écrivains savent toujours à un certain niveau ce qu’ils font ». Et Hanif Kureishi : « les écrivains écrivent parce qu’il est essentiel pour eux de donner leur version de l’histoire sans être interrompu ». A cette époque, je me demandais pourquoi continuer à écrire, comment continuer à vivre. Des nouvelles de Kora a été forgé dans cette tension-là. Je l’ai écrit comme si chaque mot avait en charge tout le livre. Comme si mon écriture était réellement un outil de mort ou de vie. Heureusement c’est un livre libre maintenant, son destin n’est plus de mon ressort…
Ce livre est-il ancré dans l’Histoire sociale et politique ?
Voilà une femme, assise, tranquille, dans son living, sous un bon toit, assurée d’elle-même apparemment. Ses hôtes sont braves, de vielles personnes chaleureuses, inoffensives. Soudain au milieu de la conversation, quelque chose fond sur elle sans prévenir, la soulève et la cloue sur place tout à la fois, lui vole sa voix. Honte, colère, chagrin ! Soudain cette haine qui gicle, ce ressentiment : c’est la Guerre d’Algérie ! remontée du ventre de ses hôtes, jusqu’aux bord de leurs lèvres policées, le sang, le vomi ! Rester là ? Hurler ou feindre de ne pas avoir senti cette odeur-là ! Devenir sourde, muette, idiote. Fuir ? La femme s’est tue qui se taisait depuis toujours sur son histoire, sur une part de son identité. Ce genre de silence est un poison lent et mortel.Comment oublier ? Tout autour de nous se souvient, non ? Auschwitz et son effroyable onde de choc. L’organisation par notre pays de la déportation des enfants juifs. Octobre 1961 (à Nanterre lorsque j’ai 11,12 ans, le récit abrupt d’un témoin proche : ma mère). Moments d’incrédulité, de terreur et de honte ! Moi qui suis française, et aussi l’enfant de ces deux-là… Et aujourd’hui la façon inhumaine dont on traite chez nous les étrangers, en nous expliquant qu’il faut être raisonnable, que ces gens-là n’ont pas les bons papiers...
Une question, qui semble s’imposer d’elle-même à qui a lu votre roman, concernerait sa part autobiographique. Quand bien même votre roman serait totalement fictionnel, il puise dans une telle profondeur intime qu’il semble retrouver une part personnelle…
Les personnages ont en charge un matériau personnel, intime. C’est la langue que je travaille qui me ressemble le plus. Je m’efforce de faire de mes créatures des personnes libres. La violence du texte, c’est bien la mienne. Et quand bien même je voudrai assujettir mes personnages, ils m’échappent, reviennent à la charge, me donnent des nouvelles de certains autres, de mon enfance, des absents…
Michelle, le personnage central du roman – d’abord écrit à la troisième personne du singulier puis en « je », en un glissement qui fait entrer le lecteur au plus profond de cette recherche identitaire du personnage – est amputée d’une partie de son histoire. Elle travaille d’ailleurs un moment dans un hôpital, au service de chirurgie orthopédique…
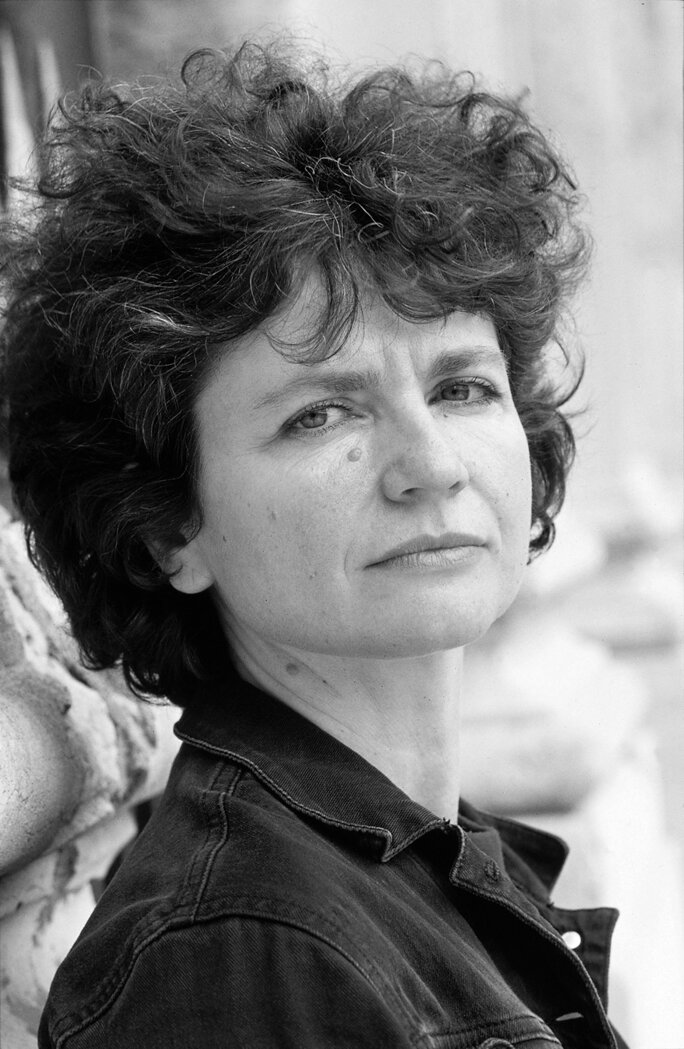
Agrandissement : Illustration 2

Michelle prend le « Je », une fois extirpée du silence au forceps, par le Docteur P., ce médecin de l’âme. Il est celui dans l’histoire qui entreprend de lui faire dire son nom, de la ramener au monde, en la délivrant de l’enfant muette, amnésique, tentée par la dépersonnalisation. Cette Kora qui aurait en charge le chaos et les ombres de son passé.
Nous vivons tous amputés d’une part de notre histoire, celle survenue avant que nous soyons en capacité de nous souvenir. Il y a une sorte d’oubli qui permet d’avancer, de créer son propre matériau, quitte à y reconnaître des éléments étrangement familiers ou de l’énigmatique. Le récit unique qui nous résumerait n’existe pas ! On peut aussi se souvenir à la manière des amputés…mais personne ne peut comprendre votre douleur.
Diriez-vous de votre roman qu’il est une quête identitaire ?
C’est la quête de la vérité qui est au cœur du livre, une quête dangereuse et mortifère, que Michelle expérimente et… dépasse pour continuer son chemin ! Elle est autant la fille de sa mère, qui a dû mentir sur sa vie pour survivre à la misère et au chaos, que celle de Reine qui écrivait dans des cahiers d’écolier les vies des enfants qu’elle sauvait, à la première personne, comme si c’était les enfants qui parlaient. Il y a un enjeu majeur de l’identité, me semble t-il, qui est de décider ce qui dans notre mémoire nous sert ou pas à vivre. « Oublie, fais-ta vie », dit la mère, repentie de la désespérance, à sa fille Michelle. Michelle qui vit mal, choisit d’écrire parce que l’écriture ne ment pas !
Le roman interroge le fondement de la généalogie, à travers plusieurs parcours : celui de Robert, celui de Reine, celui de la mère, de Michelle, du père également, ou de quelques amants de Michelle. Sur quoi fonde-t-on son identité ? une histoire personnelle, biologique ? une histoire collective ? celle, choisie, de l’engagement ?
Certains d’entre nous vivent plus que d’autres sous l’emprise de L’Histoire. Leur vie participe, malgré eux, à certains moments, d’une trame collective. Parfois l’actualité vous précipite sur le front social et politique, tire sur vos cicatrices. Les autres décident à votre place de vos attachements, de vos appartenances. Imposer sa qualité d’individu, sa singularité est un combat permanent pour chacun de nous. Se concentrer sur sa tache, son travail, avec la joie de la création, voilà un vrai privilège au milieu d’un océan de peine et de culpabilité ! Il y a de l’énergie pour continuer à travailler, le temps d’avoir la force de se regarder.
Il y a, dans Des nouvelles de Kora, un effacement volontaire des noms de famille : Michelle, Robert, l’initiale du Dr P. Est-ce là une manière symbolique de dire un manque absolu dans la filiation, la transmission ?
Peut-être une réminiscence heureuse de l’enfance. J’ai passé des années essentielles dans une maison d’enfants qui s’est appelée à un moment : « la Petite République »… des enfants. Une méfiance du social et du politique ? L’affirmation des prénoms au moins au milieu du cyclone de la généalogie qui menace !
La kora est un instrument de musique d’Afrique de l’Ouest, à la fois caisse de résonnance et instrument qui accompagne une ou plusieurs voix. C’est aussi une des énigmes de votre roman, son « chœur », son centre. Le choix de ce prénom est lié à l’instrument ? Pourquoi ce nom ?
La Kora c’est l’ « oud » africain. On dit de lui que « c’est un « instrument confidentiel et doux destiné à être écouté dans un périmètre restreint ou dans un espace confiné ». J’’ai découvert cela, par hasard, dans un livre sur l’art africain. Les instruments à cordes ont une âme. « Des nouvelles de Kora » repose sur une seule voix, isolée du chœur. Je suis consciente que la lecture de ce livre, son audition, réclame toute l’attention du lecteur, sa finesse, sa générosité…La caisse de résonance est celle, rêvée, de toutes ces voix qui trouveront dans ce texte leur texte, de ces sensibilités qui vibreront à la même corde…!
Des nouvelles de Kora est un roman extrêmement paradoxal, au sens le plus riche du terme : très ancré dans le réel, dans une histoire sociale, politique et en même temps onirique, explorant les dérives de la perte de soi, de l’amnésie, du cauchemar. Etait-ce un des défis de votre écriture ?
Oui !
Comment définiriez-vous votre rapport au roman ? Des nouvelles de Kora en offre une définition en creux, du côté de la mémoire comme du mensonge, du côté de la quête de soi, à travers une histoire autant personnelle que sociale ou politique, identitaire, du côté du secret, mais sans jamais figer la définition. Notre époque serait-elle celle de la réconciliation impossible que seul le roman, dans sa labilité, sa plasticité, sa capacité à tout absorber, peut dire ?
On écrit grâce à ses yeux, avec ses nerfs. Voit-on de mieux en mieux ce que l’on poursuit en écrivant ? J’appréhende ce moment où j’identifierai complètement mon matériau .Je gagne du temps, je me crée des obstacles supplémentaires, je travaille lentement. Et cependant mes livres surviennent. Mon travail inscrit-il dans le paysage commun un motif personnel et durable ? Peut-être ma langue dira t-elle un peu de ce monde.
N’y a-t-il pas dans vos romans – Une fille sans histoire (Calmann-Lévy, 1989), Le Dromadaire de Bonaparte (Actes Sud, 1995), Je veux rentrer (Actes Sud, 1998), Presque un frère (Actes Sud, 2000) et le dernier – une volonté de dépasser le personnel, l’anecdotique, le particulier, pour aller vers un sens intime, une essence, des trajectoires symboliques, « exemplaires » ?
Nous nous défendons tous contre l’anecdote. Sauf sur le canapé, assis devant les Journaux télévisés ! L’anecdote est totalitaire ! Elle prétendrait restituer la vérité d’un être, le sens d’une vie. Je crois à l’universalité du singulier, de la parcelle dans sa densité et son inachevé. Les vies sont insaisissables et susceptibles de remaniements jusqu'à l’interruption involontaire de l’histoire par la mort!
Vous êtes un écrivain engagé. Vous avez par exemple, signé une tribune dans Le Monde diplomatique, en novembre 2008, « Protocoles de l’expulsion », où vous analysez la manière dont « depuis des années, nous avons été nourris de constats fallacieux et de faux débats visant à définir comme problématique la présence des immigrés dans notre pays », montrant, dans les phrases de conclusion que « la façon dont aujourd’hui on traite chez nous ces étrangers-là, les plus vulnérables, dit quelque chose de grave sur la France et les étrangers, et sur l’Europe, au reste du monde. Sur ce que nous étions, et sur ce que nous risquons d’être demain. Etrangers à nous-mêmes ? »Cette question qui clôt votre texte « étrangers à nous-mêmes » entre en écho, de manière très profonde, avec votre dernier roman…
Contrairement à mon héroïne Michelle, à qui sa mère lance : « Ouvre donc les yeux, toi qui regardais tant quand tu étais petite », je suis restée la fille éveillée de mes parents. Fille d’ouvriers, d’immigré par mon père, je suis inquiète, comme d’autres aujourd’hui, par une évolution, un glissement sémantique et politique, qui organise la catégorisation de masse des personnes, qui veut imposer une lecture rétrospective négative de l’histoire de l’immigration dans notre pays, qui dit aux français que trop d’ étrangers sont parmi nous, que nous les avons assez subis et que nous devrions mieux choisir la composition de notre identité ! Le pays rêvé de M.Heurtefeux et de M Besson n’est pas mon pays réel.
Tassadit Imache, 30 mai 2009
Tassadit Imache, Des nouvelles de Kora, Actes Sud. 132 pages, 16 €.



