
On espérait Laura Kasischke pour le prix Médicis étranger 2013, tant son Esprit d’hiver avait imposé sa voix singulière dans cette rentrée littéraire. C’est une autre histoire tout aussi sombre et dure, chez le même éditeur, mais signée Toine Heijmans qui s’est finalement imposée. En mer entretient bien des liens avec Esprit d’hiver, le huis clos, les relations parents/enfants, un incident à partir duquel tout bascule, une écriture sans concession qui fouille au plus profond, un suspens qui ne naît pas d’une intrigue artificielle mais des pans les plus noirs de nos psychés.
En mer est de ces romans qui vous saisissent dès leurs premières lignes pour ne plus vous quitter et résonner longtemps en vous. Dès les épigraphes, en l’occurrence : un homme, Donald Crowhurst, navigateur, laisse en suspens la dernière phrase de son journal de bord, « il n’y a pas de raison de se risquer à… ». En écho, l’extrait d’un entretien que son fils donné des dizaines d’années plus tard au Times, « il a été l’architecte de sa propre ruine. Il a tenté quelque chose qui a tourné au désastre ». Le roman n’a pas encore commencé qu’il s’annonce comme la chronique d’une catastrophe, d’une disparition, d’une chute. Mais au couperet de cette aventure en quelque sorte balisée, s’ajoute un flou, un entre-deux : ce roman part-il du réel ? Dit-il un destin ? « Tout cela est à la fois prévisible et imprévisible », lirons-nous plus tard.
Impossible en tout cas de ne pas entendre, dans la première phrase d’En mer, une tempête annoncée : « je n’avais pas vu les nuages ». Un homme est en mer, le ciel se couvre, les vents se lèvent, la menace pèse. Et il n’a « plus le choix », il n’est « plus maître à bord » de son petit voilier, « une goutte dans la mer » ; dans la cabine, sa fille de sept ans dort, Maria. « Père et fille. Du Danemark jusqu’en Hollande, de Thyborøn jusqu’à la maison. Quarante-huit heures hors du monde ». La mère a eu peur de ce défi maritime, elle a finalement cédé au père et lui a confié leur fille. Les voilà embarqués, jusqu’à cette tempête qui menace.

Donald sait que quelque chose se prépare mais il s’entête à ne pas voir les signes avant-coureurs, il refuse même l’aide du gardien d’un phare qui propose que son bateau soit assisté pour rentrer au port le plus proche. Il s’enferre dans son défi, veut apprendre à sa fille Maria, à sa femme (comme sans doute se prouver à lui-même) « qu’on n’a pas besoin d’être une marionnette si on ne le souhaite pas. D’être une poupée dont les autres tirent les fils, au gré des situations, au gré de ce qui est acceptable ou comme il faut. Ou sans raison. Lui montrer qu’il y a un autre monde, avec d’autres règles. Je veux lui apprendre comment c’est de vivre en mer ». Le lecteur, pendant plusieurs chapitres, pense mieux dominer la situation que ce père. C’est se méprendre sur les véritables intentions de Toine Heijmans, qui n’aura de cesse de nous balader, comme la mer le frêle voilier. A la fin du chapitre 17, le récit revient partiellement à sa phrase initiale, « j’ai vu plein de choses à la fois, cette nuit-là en mer. Mais je n’ai pas vu les nuages » et « soudain, tout est à l’envers », un véritable cercle vicieux.
Alors que les vagues se forment, que les vents durcissent, le père est enfoncé dans ses pensées, il songe aux peurs irrationnelles de sa fille — la combinaison rouge de survie lui semble « un cadavre » —, aux doutes de sa femme comme à sa propre existence, ses certitudes, ses impuissances. « Si tu cesses de penser de façon claire, la mer t’emporte » et pourtant la tempête sous son crâne s’annonce elle aussi sévère, quand bien même le navire se nomme Ismaël, en hommage au narrateur de Moby Dick, un livre sans cesse présent dans ces pages.
« J’avais appelé mon voilier Ismaël, d’après le personnage de Moby Dick. Ismaël est celui qui finalement survit à tout. Il s’embarque sur un baleinier poussé par la vengeance et la fureur, à la recherche de la baleine blanche qui finira par avoir raison du navire tout entier ». Ici la motivation du voyage est tout autant la lassitude d’une vie de bureau monotone qu’une volonté de prouver à sa femme et sa fille qu’il est un bon père, un bon capitaine — « entre un père et un capitaine, il n’y a guère de différence » — et la baleine blanche sera tout au long d’En mer associé à des éléments différents, le bateau qui « crachait de l’eau fraîche, comme une baleine qui souffle », le sac à dos de Maria, figurant une quête impossible, une obsession, un manque fondamental…
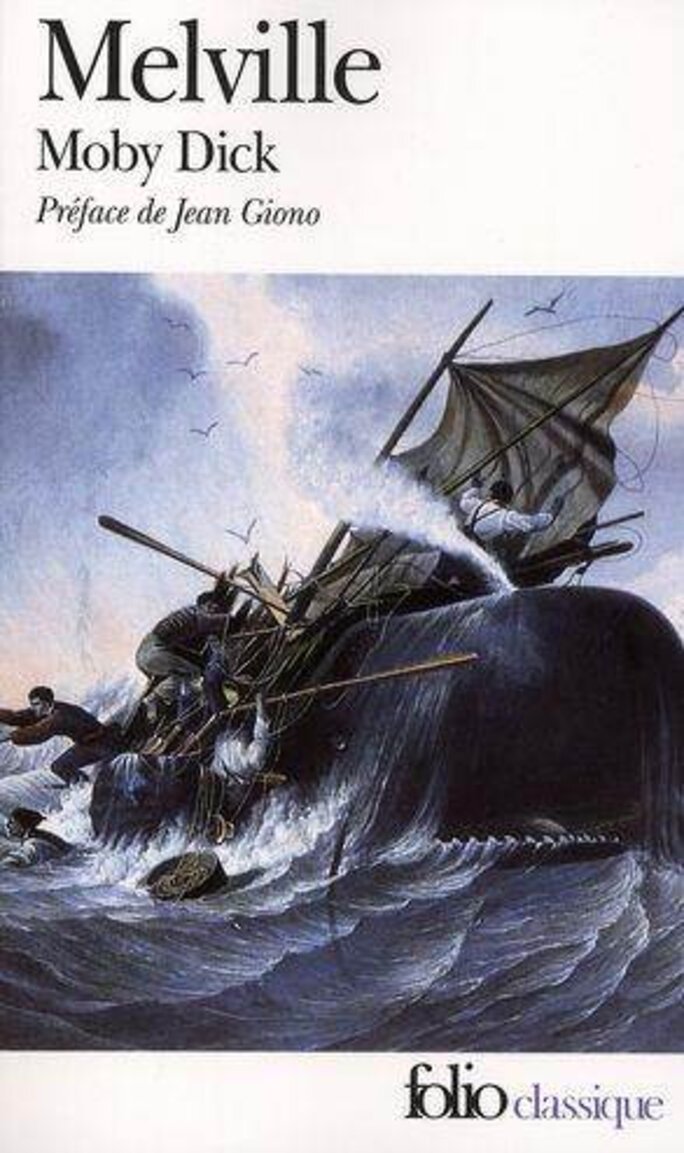
« Moby Dick est d’après moi le plus beau livre jamais écrit sur un bateau et son équipage », Donald l’a emporté sur son voilier, il trône dans sa « bibliothèque maritime. Où se trouvent les livres auxquels je tiens le plus. Les almanachs, les modes d’emploi, les manuels d’entretien ainsi que Le petit Capitaine de Paul Biegel, la traduction néerlandaise de Moby Dick et le recueil de poème de Slauerhoff ».
Le sujet du livre n’est pas la mer, en dépit de son titre (aussi trompeur qu’une mer calme) : le voyage a duré trois mois, « rien d’autre que moi, mes pensée, mon voilier et la mer. Ça s’était passé exactement comme je me l’étais imaginé ». Tout commence lorsque la fille de Donald le rejoint sur le bateau, pour la dernière étape de la traversée en mer du Nord. Là est le "nouveau" qui plonge Donald "dans l’inconnu" (le futur comme son propre passé), là l’événement où tout bascule, le moment où le personnage, d’abord d’un bloc, se fissure. Là le sujet du livre : la filiation, un curieux mal de père, comment se définir et pleinement exister ?
Dès le chapitre 3, Donald constate combien « il est impossible pour un père de comprendre combien une mère est attachée à sa fille. Les mères pensent différemment des pères quand il s’agit des enfants. Hagar s’est donné comme but depuis l’enfance d’être mère. Elle a gardé ses poupées pour Maria. C’est le secret des mamans : d’abord tu reçois des poupées de ta propre mère, puis tu veux toi-même des poupées, ensuite tu veux des enfants et ces enfants recevront à leur tour des poupées. Et des enfants. Avec des poupées. C’est ainsi que les générations se succèdent les unes aux autres ». Sans doute n’est-ce pas si simple, et Donald l’apprendra à son corps défendant.
En attendant, Donald veut exister aux yeux de sa fille, l’emporter vers un ailleurs, cette vie en mer qui lui semble un idéal : être loin de la vie monotone de son bureau, être libre, ne plus être un jouet ou une marionnette. « Les pères capitulent plus vite que les mères. Les mères savent que l’amour de leur enfant est inconditionnel. Elles peuvent se permettre pas mal de choses. Les pères doivent faire leurs preuves ». Alors, quand Maria et lui aborderont la côte néerlandaise, où Hagar les attend, « ce sera le plus beau retour à la maison de tous les temps ».
Mais le superlatif absolu et la perfection — quête obsessionnelle de Donald— ne se conquièrent pas si simplement et ce futur menace d’être hypothétique. Maria a disparu pendant la nuit. Dans la petite cabine du bateau, aucune trace de la petite fille. Le monologue intérieur vire à la torture mentale et au cauchemar, à mesure que la mer grossit et lorsque le père s’aperçoit qu’il avait laissé ouverte l’écoutille…
« Ce fut mon choix à moi. Je voulais l’aventure. Quand on lit des livres d’aventure, on lit des récits de héros. L’homme contre l’eau. L’homme contre la montagne. L’homme contre la jungle, contre la nature. Mais maintenant que moi-même je me retrouve dans une aventure, ça n’a rien de romantique. Ici règne un froid de pierre.
Les gens normaux évitent l’aventure – ils ont raison. Quand tu escalades une montagne, ton sort est entre les mains de la montagne. Qu’est-ce que ça peut lui faire, à la montagne, si tu tombes ?
Mon sort est entre les mains de la mer. Qu’est-ce que ça peut lui faire, à la mer, si j’échoue ? Jusqu’à présent, je voyais dans la mer une compagne, une amie pour faire route ensemble. J’avais trois vrais amis : Hagar, Maria et la mer. Mais la mer ne peut pas être une amie. L’eau n’a ni sentiment ni histoire. Elle ne fait rien, elle est, c’est tout. Si elle t’assassine, si elle te noie, il n’y a là rien à chercher que ta propre stupidité. La mer n’est ni une amie ni une ennemie ».
Le tour de force narratif de Toine Heijmans est de ne jamais laisser retomber la tension, impeccable, implacable, l’écrivain s’impose seul « maître à bord » de cette odyssée en solitaire. Il parvient à interconnecter plusieurs huis clos, la famille et le couple, la mer et l’univers du bureau (« si tu ne fais pas attention, il devient ta raison de vivre »), les aliénations et espoirs d’échappées. Le lecteur ne peut plus quitter ces pages, hypnotisé, sur les nerfs, atteint par la paranoïa et la « lucidité » du narrateur, aussi trompeuse qu’elle est à vif : c’est aussi dans cette tension que se joue une parenté avec le dernier roman de Laura Kasischke, les deux écrivains ravivant les ressorts du thriller en puisant dans nos angoisses primitives, nos quotidiens sous tension permanente — le couple, la famille, le travail, l’identité, ce qui la construit et la défait —, distillant des indices et il devient peu à peu impossible de démêler la part de réel et la part de fantasme. « Parfois les gens inventent des choses pour mieux tout comprendre »…
Difficile de croire que ce roman est le premier de Toine Heijmans tant sa maîtrise narrative — la tempête extérieure comme intérieure qui dézingue la surface en apparence étale de la prose — et sa mise à nu du cœur humain sont impressionnantes. L’écriture lui est lame de fond.
- Toine Heijmans, En mer, traduit du néerlandais par Danielle Losman, Christian Bourgois éditeur, 156 p., 15 €



