
« Ceci devrait être écrit au présent. Je n’ai pas écrit ». Il est rare de pouvoir citer la dernière phrase d’un roman dans un article : cela peut tuer le suspens (si tant est que le suspens soit le seul intérêt d’un livre…) ou donner des clés qui anticipent les lectures à venir. Avec Au présent d’Helle Helle, traduit du danois, aucun a priori de ce type, tant le sujet est ailleurs, dans la saisie sensible du quotidien d’une jeune femme, Dorte. Le récit avance par notations et sensations, dans un minimalisme qui transcende l’ennui de cette Chienne de vie (précédent roman de l’auteure traduit en français, au Serpent à plumes), un « je ne sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux faire » hérité de Godard qui devient un « je ne savais pas quoi faire ».

Agrandissement : Illustration 2

Pourtant ces notes au jour le jour, parfois en parataxe ou simplement juxtaposées, dans un flou temporel et chronologique constant, constituent une intrigue qui vous happe, tant ce quotidien est transcendé par la prose poétique de Helle Helle. La contemplation, l’emploi du temps, certains hasards concordants valent introspection, quand bien même aucun paragraphe ne joue de notations psychologiques.
« En m’habillant, et tandis que j’essayais de me coiffer devant le miroir de l’entrée, je les entendais parler dans le jardin. J’avais chaud et je n’étais pas encore bien réveillée. Leurs voix se répondaient au dehors, mais je ne distinguais pas les mots. Un jour, j’étais restée allongée sur la plage toute une journée, des voix étrangères parlant en sourdine autour de moi. Je repensais depuis à ce jour-là comme à un grand bonheur : rester ainsi allongée sans être remarquée dans un torrent de conversations laineuses ».
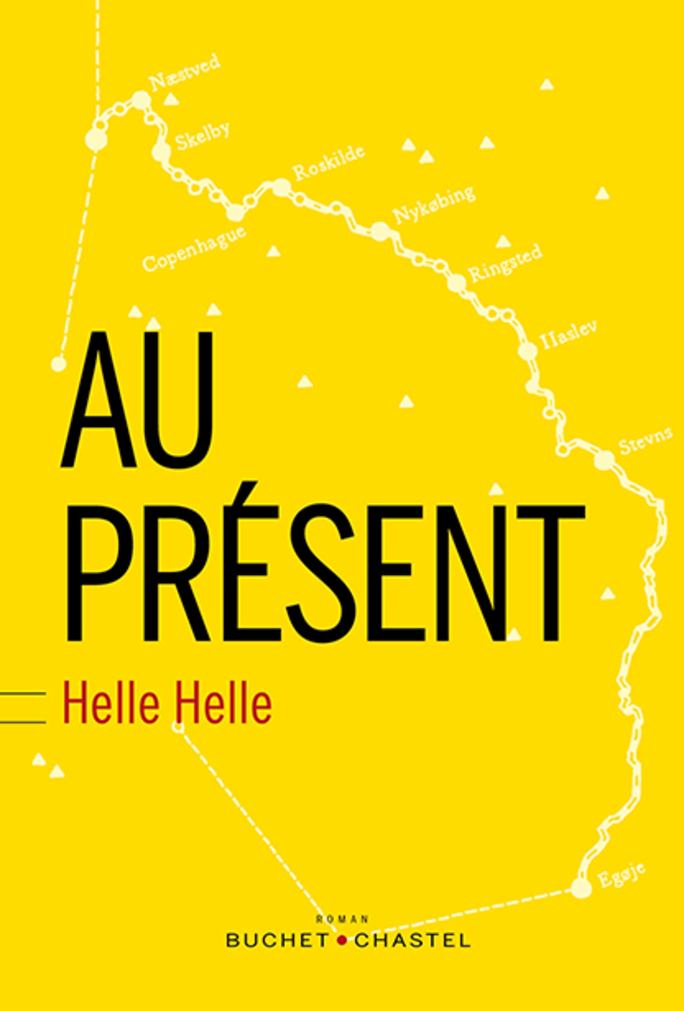
Agrandissement : Illustration 3
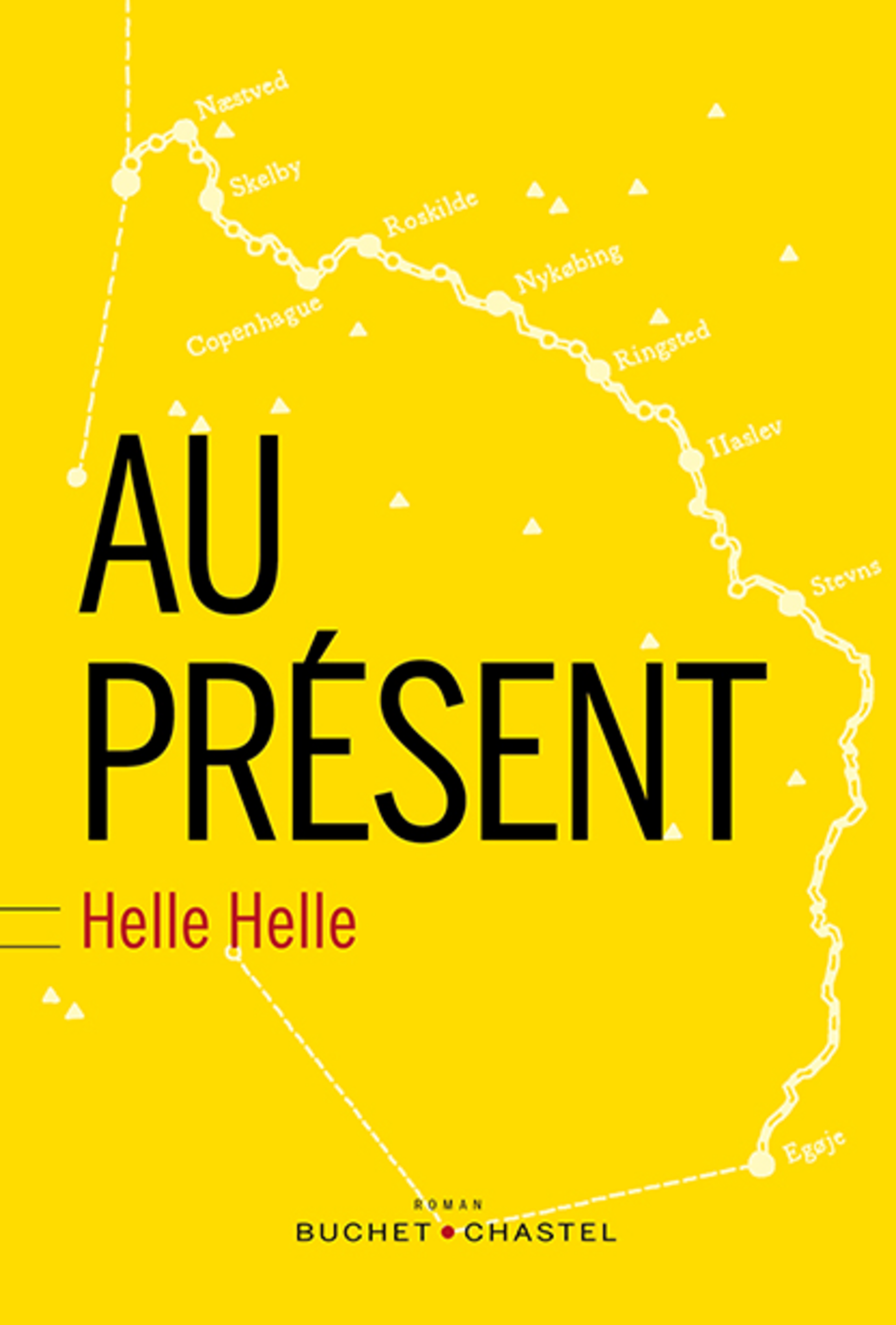
Les « Dorte Hansen x 2 » au centre du récit, la jeune femme dont nous suivons les déambulations, sa tante un peu plus âgée, même nom, tissent, en diptyque, deux portraits de femmes dans leur rapport au temps, à l’amour, à une vie qui ne répond pas toujours à leurs rêves et leurs attentes. En filigrane, toujours, avortement pour l’une, vain désir d’enfant pour l’autre — « on m’avait donné le nom de Dorte, parce qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants. Le diagnostic était tombé alors qu’elle n’avait que vingt ans » —, mais sans jamais s’appesantir, comme en passant, failles béantes de la prose aussi blanche que « les champs étaient blancs ». Sous la surface plane, en apparence, un bouillonnement « laineux », aussi dense et parfois angoissant qu’il semble lointain. Sous l’apparente objectivité du récit, une intimité : « on voit et on entend évidemment ce qu’on veut bien voir et entendre ».

Agrandissement : Illustration 4

Le récit est un concentré de voix rapportées, de choses vues, sous l’œil d’une jeune femme en retrait du monde : Dorte est inscrite à l’université de Copenhague, mais elle ne s’y rend jamais, sinon pour prendre, furtivement, un café et une part de cheese-cake à la cafétéria de la fac. Elle habite près d’une gare, écoute passer les trains, a des insomnies, croise des gens de hasard, les suit un moment. Elle lit un peu, longtemps on ignore quoi, puis plonge dans Kafka ou la quatrième de couverture d’un « fascicule sur l’usage des virgules », sans l’ouvrir. « Je lisais. Je ne lisais pas ». Dorte passe des bras d’un garçon à ceux d’un autre, Per « qui ne savait pas comment s’occuper lui non plus », Lars, Knud, Hase ; elle s’installe un temps avec eux, fuit, quitte, est quittée ; elle change de lieu, toujours entre deux histoires, deux « pas de porte », deux endroits, sa vie entière dans une valise qui, entre deux transits, lui sert de table de nuit (la valise, fil rouge du récit, comme d’ailleurs un saugrenu panier de pique-nique).
Dorte tente d’écrire, ne va jamais au bout d’aucun projet. Elle écrit des chansons, quelques textes de manière embryonnaire, on n'en connaîtra que les titres, parfois. Elle incarne une génération à part, singulière, en quelque sorte démunie, en attente : « je ne pensais à rien de particulier, je me sentais tiraillée de toutes parts ».
« — Qu’est-ce qu’on va faire ? murmura Per. Je ne sais pas ce qu’on va faire.
— Tu veux dire, maintenant ?
— Oui, maintenant aussi. Et en général.
— On attend un peu, on finira par trouver, murmurai-je en retour.
(...)
Je pleurais sur son épaule imberbe.
— Et puis je ne supporte pas qu’on soit si jeunes. On est beaucoup trop jeunes.
— Trop jeunes pour quoi ?
— Pour plein de choses. Pour tout ça. On n’attend qu’une chose, c’est que ça se casse en mille morceaux ».
Dorte est un personnage en transit, entre enfance et âge adulte, un être en devenir (« je ne savais que faire de moi-même, ni comment continuer »). Mais elle est aussi, sans doute, une image oblique de l’écrivain elle-même, disponible aux lieux, aux autres et aux choses, entre désillusion et plénitude, dans un entre-deux aussi sobre que fascinant et capable, elle, d’exprimer ce contre quoi bute Dorte, cet indicible en elle, ce « c’était trop. Jamais je ne pourrai partager cela avec quiconque ».
- Helle Helle, Au présent, traduit du danois par Catherine Lise Dubost, éd. Buchet-Chastel, 204 p., 18 €
- Lire un extrait
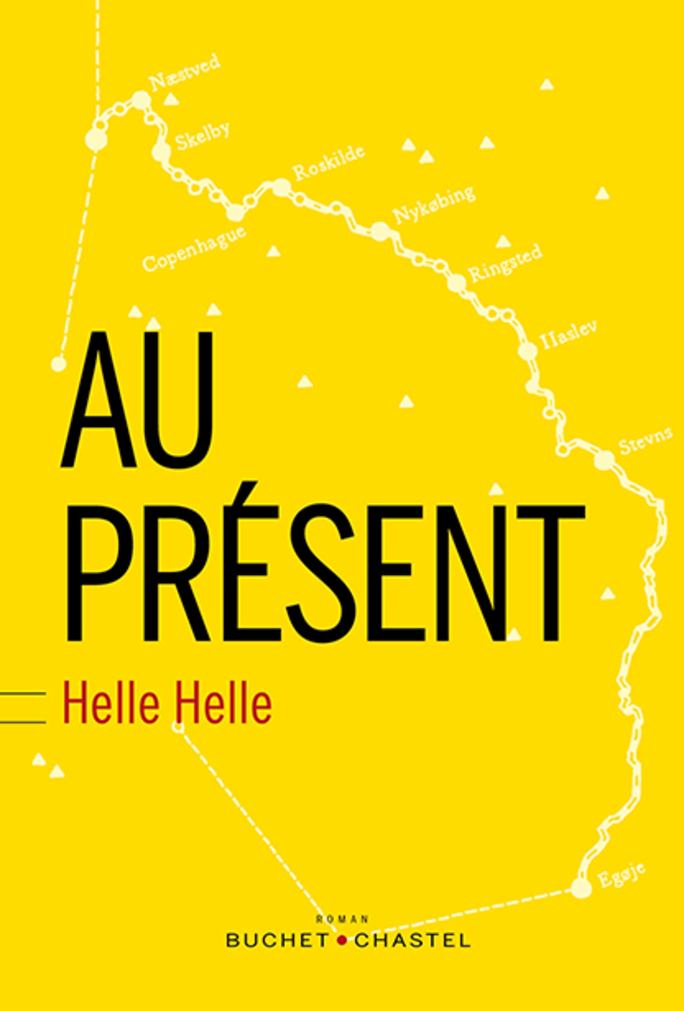
Agrandissement : Illustration 5
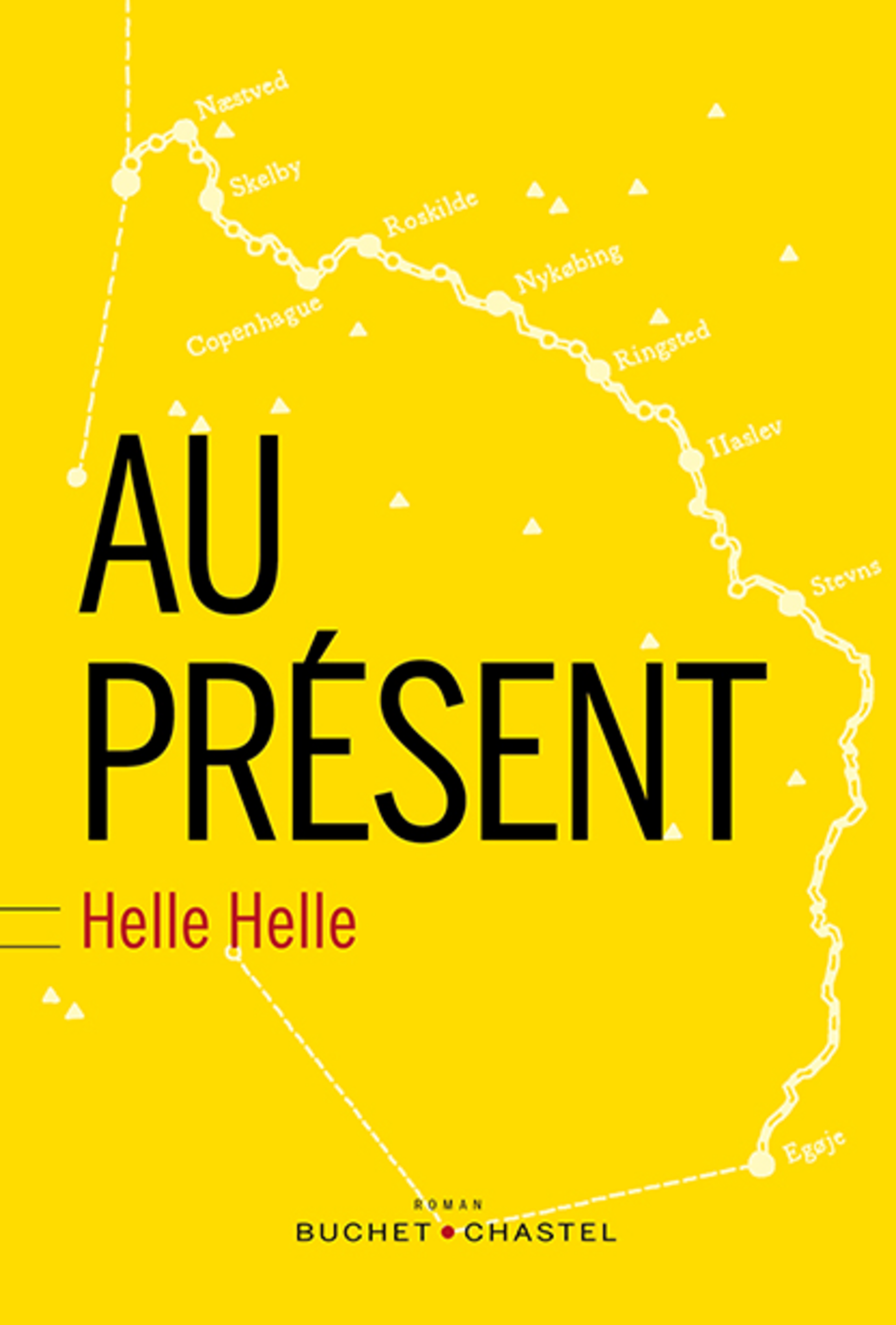
- Chienne de vie, traduit du danois par Catherine Lise Dubost, Le Serpent à plumes, 2011
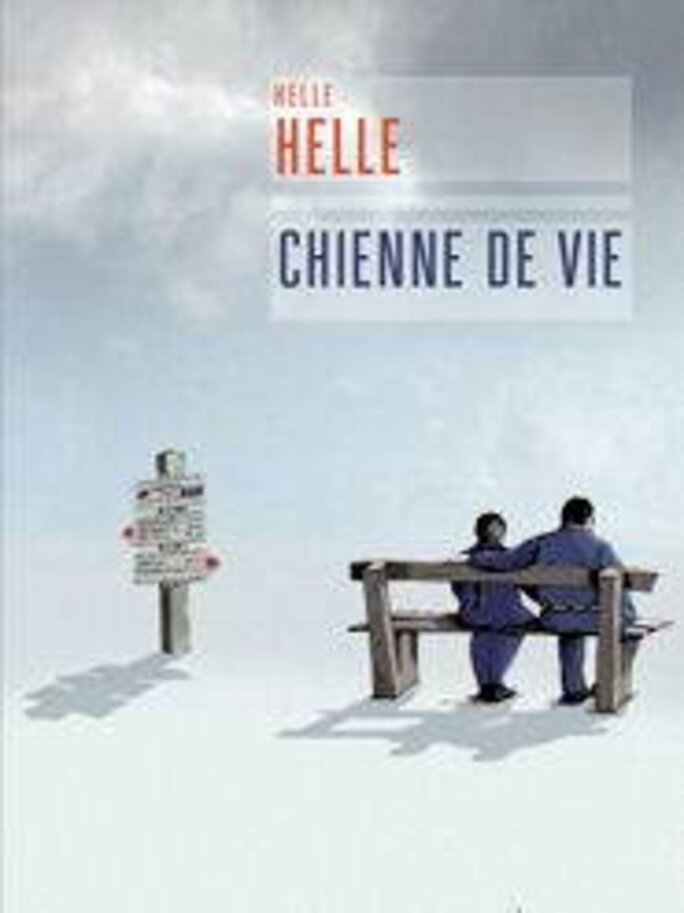
Chienne de vie est le cinquième roman de Helle Helle, le premier traduit en français de cette auteure née en 1965 qui a commencé à publier en 1993. Son œuvre (romans, recueils de nouvelles) est traduite en 14 langues et elle a reçu, entre autres distinctions, le prix Per Olov Enquist.



