En ces temps troublés de « retour du religieux », de problèmes de tolérance religieuse, de recours à une laïcité de moins en moins neutre en France, l’universitaire italien Maurizio Bettini a écrit un petit éloge du polythéisme antique comme contre-feu. Il part d’un exemple singulier en Italie qui éveilla son acribie :
« À l’occasion des fêtes de Noël, certains enseignants et responsables de différentes écoles italiennes ont décidé de renoncer à la crèche afin de ne pas heurter la sensibilité des enfants et des parents étrangers à la tradition catholique, et en particulier celle des musulmans. (…) Au moins dans un premier temps, on pourrait penser que cette décision a été déterminée par une attitude à la française qui, en se fondant sur un principe de laïcité, tend à éliminer tout signe religieux de l’espace public. À ceci près que, du moins dans la manière de présenter le fait divers, l’argument ne portait pas tant sur l’incongruité de l’objet comme tel – du type “la crèche, en tant qu’expression religieuse, ne sied pas à un lieu public” – que sur l’inconfort que ce symbole pouvait engendrer chez les enfants et les adultes qui professent des religions différentes du christianisme ».
Présentation
Le propos de l’auteur n’est pas de se positionner par rapport à ce fait divers en lui-même mais de s’interroger sur ce qui détermine de telles décisions : la conviction profonde, inconsciente, qu’il ne peut y avoir qu’un Dieu, qu’une religion et que, donc, une nécessaire tolérance préventive doit se mettre en place. Or, explique-t-il, cette conviction n’est propre qu’aux religions monothéistes fondées sur la nature exclusive d’une divinité, cela de la Bible au Coran. C’est pourquoi la notion de tolérance ne peut émerger qu’avec de telles religions, les religions polythéistes grecque et romaine, dont l’auteur est spécialiste, ne nécessitant pas de tolérance à l’égard de la religion d’autrui étant donné qu’il y avait possibilité de traduire/transposer une divinité étrangère dans son propre système : Zeus = Jupiter ; Aphrodite = Vénus, etc., voire d’accepter une divinité étrangère comme on accepte qu’un immigré s’intègre.
L’attention accordée à la notion d’interpretatio se trouvait déjà dans le livre de Philippe Borgeaud, À l’origine de l’histoire des religions, mais, ici, le propos vise à montrer comment les religions polythéistes étaient, en quelque sorte, plus raisonnables que des monothéismes prompts à déchaîner les passions. À la différence de Jan Assmann (Le prix du monothéisme), Bettini ne voit guère que l’idée d’une divinité unique ait pu être un progrès pour l’humanité. En effet, même si un œcuménisme bienveillant conduit parfois à affirmer que le dieu des trois monothéismes est un seul et même dieu – Dieu ! –, force est de constater que le lien filial entre eux entraîne plus de discorde que de fraternité.
Son ouvrage est agréable à lire et on y apprend bien des choses tant le propos se montre mesuré et nuancé. Le lecteur curieux d’histoire des religions trouvera bien des notions expliquées simplement, comme l’origine du terme de paganisme, l’origine des notions de polythéisme et de monothéisme. C'est aussi une très jolie édition au format poche.
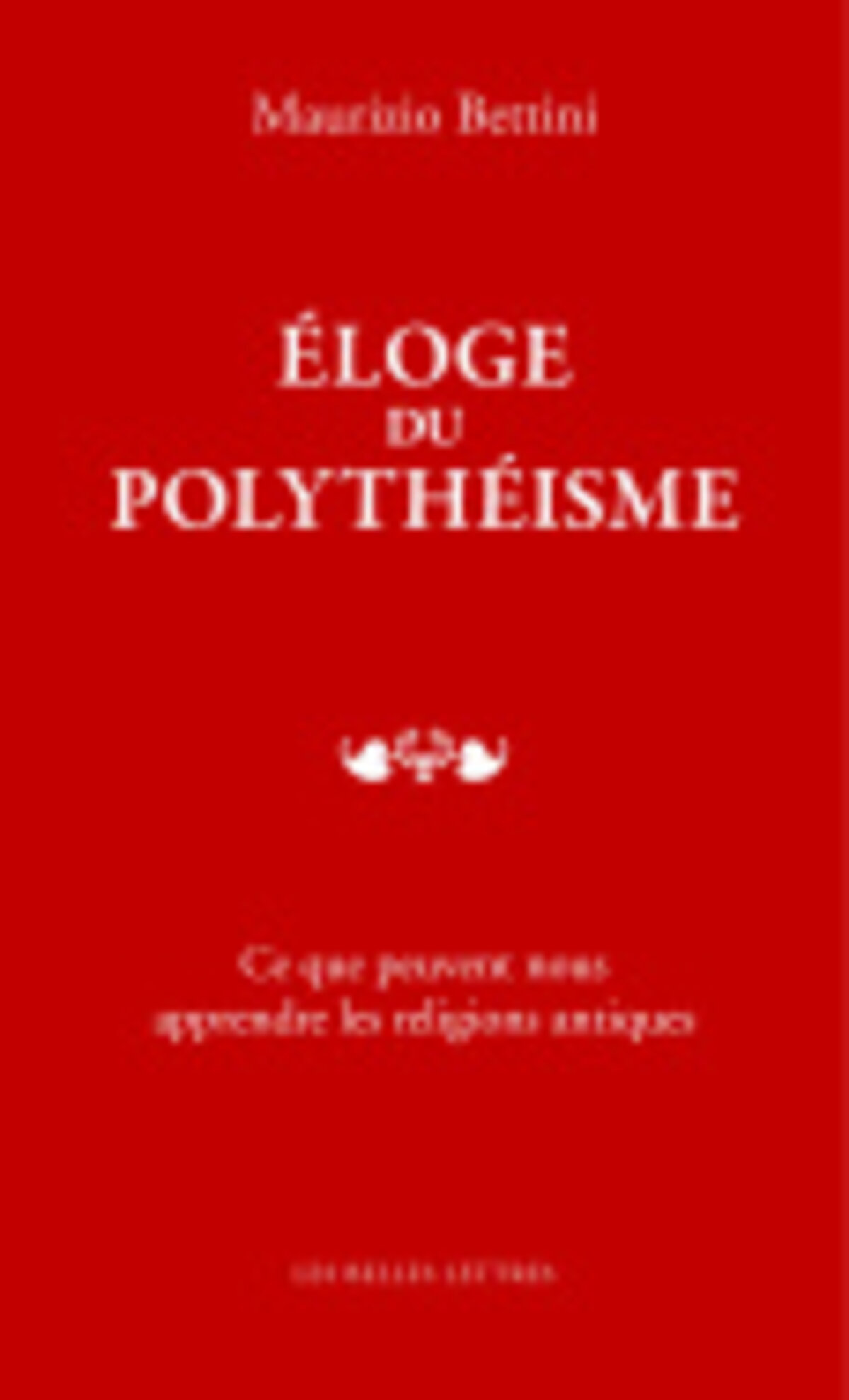
Critique
Malgré cela, il commet, de notre point de vue, une erreur d’appréciation, justement dans son chapitre consacré à la pratique antique et polythéiste de l’interpretatio. En effet, si les Anciens « traduisaient » les dieux étrangers, et cela bien au-delà d’ailleurs des Grecs et des Romains puisque la pratique est attestée bien avant au Proche-Orient ancien (p. 70), ce n’était pas seulement pour se rendre compréhensible des croyances exotiques mais aussi parce qu’ils vivaient dans un univers enchanté – pour reprendre la problématique de Max Weber du désenchantement progressif du monde passant par le monothéisme –, peuplé d’êtres visibles (hommes et animaux) et invisibles (dieux, démons et autres entités surnaturelles). Leur grande question était d’identifier ce que l’on ne voyait pas mais qui existait à leurs yeux.
En pensant que la pratique de l’interpretatio était dénuée de toute approche véritablement religieuse, Maurizio Bettini reconduit en fait ce qu’il y a dans l’Ancien Testament même : les dieux des étrangers sont des faux-dieux. Il reconduit même une approche qui se voit beaucoup chez les spécialistes de la Rome antique selon laquelle la spiritualité ancienne était bien secondaire par rapport au rituel. La piété des Anciens qui est esquissée est trop opposée aux notions de « sentiment religieux », de « spiritualité » et de « croyance » propres aux religiosités contemporaines. Car, si l’on peut penser que des différentes profondes existent, les gens de l’Antiquité étaient religieux dans tous les sens du terme : par exemple, ils faisaient des vœux, ce qui implique des rites et une croyance en l’efficacité d’une entité surnaturelle choisie, que l’on remercie une fois le souhait exhaussé. Penser ainsi, c’est appliquer de nouveau des schémas de pensée chrétiens qui réduisaient le « paganisme » au sacrifice sanglant.
En outre, le polythéisme dont l’auteur fait l’éloge repose trop sur l’héritage gréco-romain, négligeant toutes les représentations religieuses contemporaines (Thraces, Perses, Gaulois, Puniques etc.), surtout, il semble être immuable dans son ouvrage, non évolutif, alors qu’avant que l’empire romain ne devienne chrétien, les conceptions religieuses « païennes » étaient variées, complexes et, d’une certaine manière, en position de régénérer le vieux polythéisme des temps de César et d’Auguste. Nous en voulons pour preuve le culte officiel du Soleil institué le 25 décembre par l’empereur Aurélien. Or, un siècle plus tard, un empereur comme Julien, dit l’Apostat, argumente avec habileté contre le monothéisme biblique exclusiviste dans son texte Contre les Galiléens, dans le même temps, il expose sa croyance en un dieu-roi qui suppose bien un discours de vérité religieuse (Sur Hélios-Roi), donc porteur d’intolérance.
Prolongement
Pourquoi revenir aux valeurs du polythéisme ? Visiblement, nous n’irons pas en arrière tant les options religieuses et spirituelles risquent de se multiplier dans notre postmodernité (Charles Taylor, L’âge séculier). Sans doute serait-il d’ailleurs plus pertinent de dépasser une opposition occidentale, proche et moyen-orientale entre polythéisme et monothéisme. En Inde, le problème se pose tout autrement et, pourtant, la coexistence entre hindouistes et musulmans n’est pas moins difficile que celle entre juifs, chrétiens et musulmans. Ce que l’auteur ne parvient pas à dire simplement, c’est que les systèmes religieux les plus idéologiques – donc les monothéismes plus que les polythéismes, sauf quand le polythéisme fait système comme en Inde – vont à l’encontre de la liberté religieuse et, bien souvent, de la liberté tout court !
Pour finir, on peut tout de même ajouter que lorsque l’empereur romain Dèce imposa le culte impérial aux chrétiens sous peine de mort s’ils s’y refusaient, ce polythéiste-là n’était pas du côté de la liberté religieuse – pas plus les Athéniens qui condamnèrent Socrate à mort pour impiété. C’était de la politique et, malheureusement, hier comme aujourd’hui, les aspects religieux recouvrent des enjeux politiques. Quand Ariel Sharon va faire sa petite promenade sur le « Mont du Temple », pardon, l’Esplanade des Mosquées, il sait très bien ce que cela va produire.
Maurizio Bettini, Éloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les religions antiques, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 14 euros.



