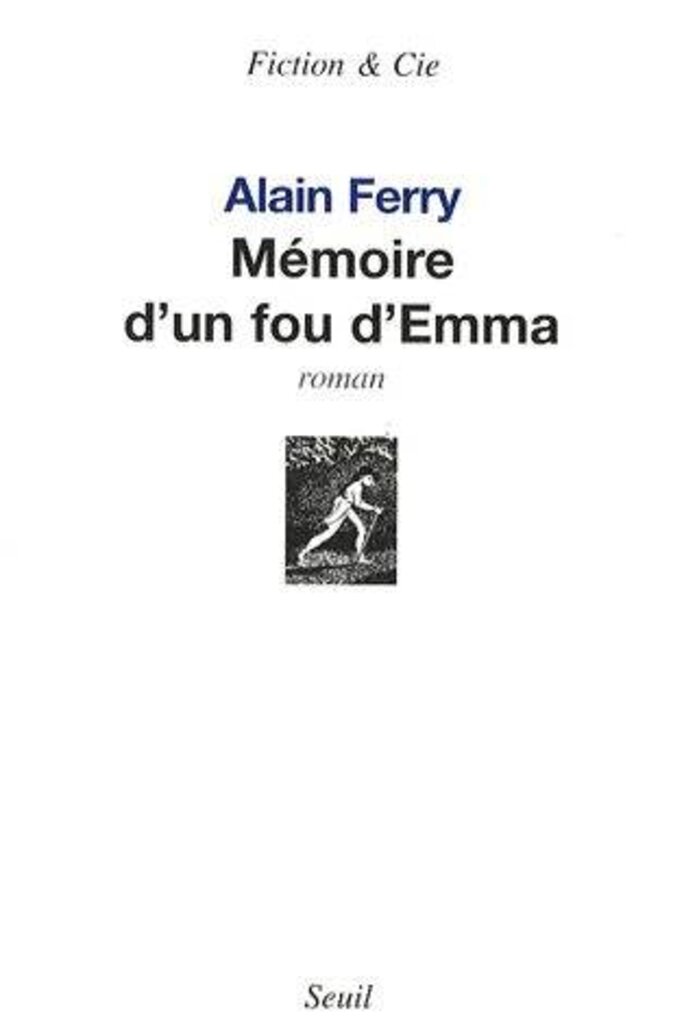Le narrateur, « sidéré par l’éclair de son apparition », offre justement L’Éducation sentimentale à Eva…
Deux septennats de mariage plus tard, Eva quitte le narrateur pour un capitaine au long cours, un marin d’eaux douces, d’autres rivages, nouveaux. Le plus expéditif, ironise le narrateur, aurait été de citer Godard, Brialy mouchant Anna Karina d’un « Eva te faire foutre »…
Mais le narrateur est homme de lettres, de pages, de mots. Comment dès lors oublier Eva sinon en sombrant dans les paradis artificiels de la lecture, et, surtout, dans le livre aimé par excellence – il a été « l’initiation au cercle infernal et céruléen de la littérature, de la grande littérature » –, celui d’une femme adultère justement, celle qui aima, mais aussi « trente-six livres tournant autour de Madame Bovary ». Emma lue, relue, mise en images, analysée par les critiques, représentée au cinéma, en bédé, dans un porno même. Tout lire, tout voir, ou presque.
Lire pour trouver l’antidote au deuil de l’amour, se projeter également. Si Eva est aussi belle et adultère qu’Emma, le narrateur est-il aussi « minable et misérable » que Charles ? Comment trouver des réponses à ses interrogations existentielles, ses misérables jalousies, quand tout part en « capitolade » ? Lire est-ce panser ou creuser les plaies, nourrit-on ses tortures de références littéraires et cinématographiques ? « Notre flaubertinage nous guérira-t-il ? »
Sur ce canevas de (double) départ, Alain Ferry tisse un roman du mystère de la féminité, de ses insondables beautés, citant, copiant, travaillant le texte de Flaubert, comme un forçat littéraire, un fou, un damné. Alain Ferry se projette en Charles, en Léon, en Rodolphe mais aussi en Emma. Ils ont en partage le goût des livres et de l’échappée dans l’imaginaire :
« Si Emma n’est jamais tout à fait autre que ce qu’elle est avec sa manière de pomper l’irréel de la littérature pour affronter et vivre la vie fadasse ; si elle aime ʺla littérature pour ses excitations passionnellesʺ, que lui jette la première pierre celui qui jamais n’en use de la sorte. To read, to sleep, perhaps to dream. La lecture est une seconde vie. Nous aussi nous aimons la littérature, la folie de la littérature, en grâce de sa porte de corne ouverte sur le rêve.
[…] Bovarysme : évasion dans l’imaginaire par insatisfaction. Bovaryste nous sommes, et les livres sont nos merveilleux nuages ».
« Nous » désigne le narrateur du roman. Une première personne du pluriel de majesté ironique ? Un « moi » interdit du fait de son pseudo-usage par Flaubert (le « Madame Bovary, c’est moi » qu’il n’aurait jamais écrit ou prononcé) ? Un nous d’une communauté de lecteurs, d’amateurs d’art, d’Emma ? Le nous pluriel du ressassement en tout état de cause, de l’obsession, du cercle vicieux : « les grandes pertes inclinent au silence. Ou aux redites. Nous, nous ressassons. […] Fatalement Eva nous hante… Aussi ne pouvons-nous faire bref pour nous la dire et la redire ».
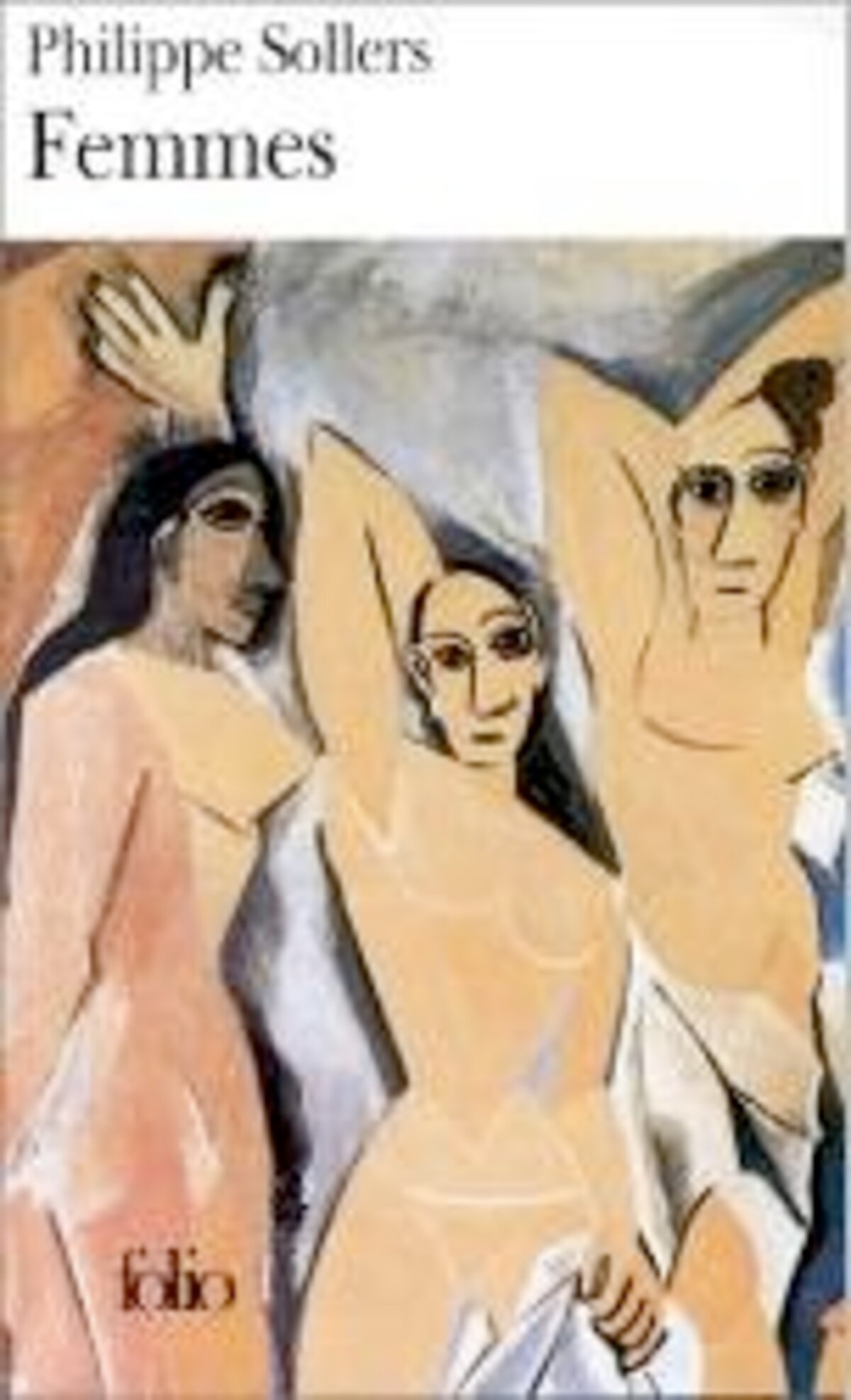
Dire Emma pour dire Eva, en passant par Joyce et ses pages sur la jalousie, Barthes et la mélancolie, Sollers et Femmes dont trois pages bizarres sont le « synopsis d’un remake du roman de Flaubert »… Une monomanie se tisse à travers des références plurielles, jouissives, une obsession du texte et du dire, de la lecture. Eva est traquée jusque dans les livres qu’elle a pu souligner, annoter (« nous la pourchassons dans sa bibliothèque »). Le titre même du roman singularise un texte de jeunesse de Flaubert (Mémoires d’un fou), y adjoint le prénom d’une autre héroïne, Emma, tend vers Aragon, non celui qui aima Elsa, mais le poète « morfondu de la Grande Gaîté » :
« Aima aima aima mais tu ne peux pas savoir combien
Aima c’est au passé
Aima aima aima aima aima aima. »
Une ronde au passé faussement simple, dans l’enfer de la répétition, pour dire la hantise, la possession. Le singulier du pluriel pour mieux rendre une expérience unique comme universelle : la perte, le manque, le deuil d’un amour, la quête de soi dans et par les mots.
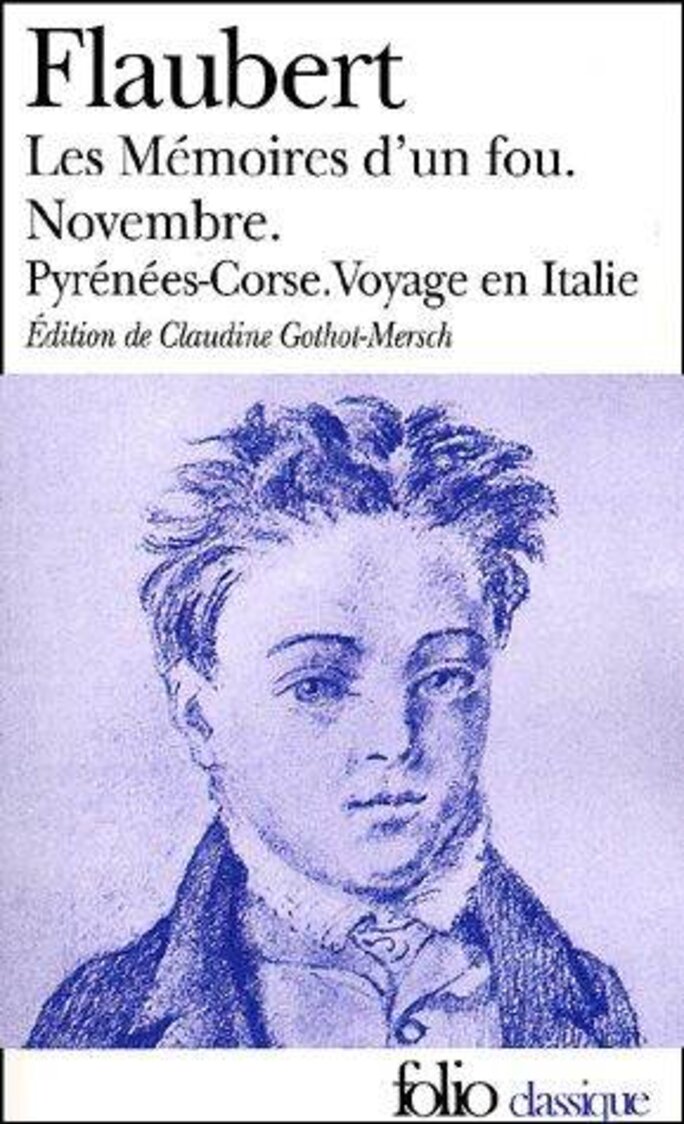
Le roman se donne comme un patchwork, avec en figure centrale, la femme perdue, ratée. A mesure que la plaie se pense, Eva se fictionnalise, Emma devient réelle, femme de chair, sexuée, un corps écrit, adoré en des blasons érotiques, sensuels. Les épaules d’Emma, ses yeux, son sexe, ses seins, sa vulve « plaie de feu mouillée », comme l’écrit Pierre Michon… « La sensualité est son génie, son démon, son horizon indépassable peut-être ». Figure d’une femme éternellement recommencée, idéale, une femme qui dit toutes les femmes ; et le narrateur devient rhapsode, auteur d’un centon halluciné. Eva, Emma, « un zibaldone de fragments dont notre icône, Emma Bovary, sera l’ange unificateur ». Elle est comme Marie, héroïne d’un autre texte de jeunesse de Flaubert, Novembre, toutes les femmes, la Femme, muse, inspiratrice, vampire et ange exterminateur, « un être satanique, dont la magie du nom seul me jetait en de longues extases » :
« J'aime l'automne, cette triste saison va bien aux souvenirs. Quand les arbres n'ont plus de feuilles, quand le ciel conserve encore au crépuscule la teinte rousse qui dore l'herbe fanée, il est doux de regarder s'éteindre tout ce qui naguère brûlait encore en vous. […]
Il y eut dès lors pour moi un mot qui sembla beau entre les mots humains : adultère, une douceur exquise plane vaguement sur lui, une magie singulière l'embaume ; toutes les histoires qu'on raconte, tous les livres qu'on lit, tous les gestes qu'on fait nous le disent et le commentent éternellement pour le cœur du jeune homme, il s'en abreuve à plaisir, il y trouve une poésie suprême, mêlée de malédiction et de volupté. » (Flaubert, Novembre)
Mémoire d’un fou d’Emma n’est cependant pas Novembre auquel le jeune Flaubert donne le sous-titre de Fragments d’un style quelconque. Au contraire, il faut à l’Emma/Eva de Ferry un style ample, recherché, pédant parfois, hautement citationnel, référent. Pour tenter de puiser en elle tous les vocables, tous les livres, aller au fond de cette « perversion » qui consiste à « chérir réellement cette amante irréelle, en « bookholic ».
Mémoire d’un fou d’Emma est le roman des Fragments d’un discours amoureux et un « la chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les livres », un texte dense, saturé, aussi sublime qu’insupportable, d’une « hystérique libricité », comme le condense son auteur en un néologisme parfait. Un narrateur librique, devenu fou parce qu’une femme « nous a jeté comme on fourgue au rayon des tocards un livre dont on n’a pas envie de lire les derniers chapitres ».
Alors, il lit jusqu’à la lie, délie, relit et relie, en une trinité du livresque, librique, libre, qui tourne au systématisme, à la fugue, à l’éternel retour. Fait naître un nouvel alphabet, une « picto-orthographie », les seins d’Emma sont rOOnds », ses cuisses évoquent une nouvelle graphie de son prénom :
« Nous sommes tenté d’écrire eMMa, avec au centre de cette graphie, frappée deux fois en majuscule, le M qui dans les vieux alphabets est représenté par des jambes repliées sur des cuisses ouvertes. Un M pour Rodolphe Emma encore candide écarte son compas et c’est son cœur qui s’écarquille, noir et rouge comme l’A et comme l’I des Voyelles de Rimbard. Le deuxième M est calligraphié par le pinceau de Léon ».
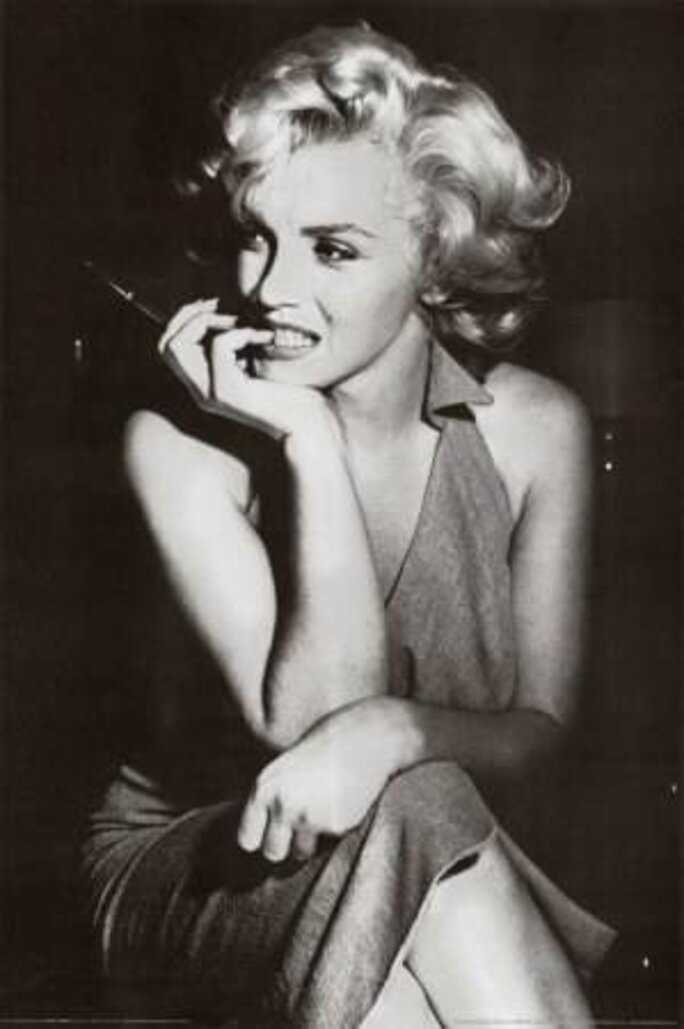
Emma est une « Eve éternelle », cette femme qui cherche l’idéal quitte à brûler ses ailes, belle comme « Norma Jeane Baker, la petite fée de Los Angeles qui mesurait 1,61 m, chercha l’homme idéal jusqu’au sommet de la pyramide américaine, et ne le trouva pas », figure du lyrisme et du vide, de la fiction et du manque, d’un absolu qui se solde dans la mort, « Emmarilyn ». Son corps est un espace, le lieu de l’érotisme comme du texte, « avec Emma, en Emma, tout est littérature ».
Mémoire d’un fou d’Emma est un livre étrange, séduisant, captivant. D’une beauté singulière, dérangeante parfois tant elle est saturée, emplie de référents. Un livre érudit, baroque, ivre de mots, un hymne intense au pouvoir du livre, de la fiction, de l’imaginaire, du fantasme.
Mémoire d’un fou d’Emma est une rhapsodie plus qu’un roman, la mémoire d’une femme devenue réelle à force de fiction, la fabrique d’un livre et de son auteur. Il dit l’infini manque compensé par un trop plein, le deuil avant un nouveau départ, l’inconnu entier après tant de pages, le mythe de la femme. « L’histoire d’Emma est mythique. Elle est interminable. Jamais aucune dernière phrase ne la fixera » :
« N’est-ce pas ainsi que nous regardons Emma ? Chaque rencontre nous la montre sous une lumière différente. Elle est vraiment insaisissable. Aucune étude ne fait le tour de ses propriétés. Conclure serait à son sujet une sombre bêtise ».
Alain Ferry, Mémoire d’un fou d’Emma, Seuil, « Fiction & Cie », 266 p., 21 €