Gabriel est étendu sur son lit de douleur, lavé, nourri de purée à la cuillère, soigné. Il n’est plus qu’un « on », passif, ballotté : « on me dépose sur une chaise roulante le temps de changer mes draps. On me passe une bassine. (…) On me tapote, on me poussotte, on me pinçote, et je tressaute. On me pince, on me pique puis on me cajole. Mon existence n’est qu’une longue succession d’humiliations ».
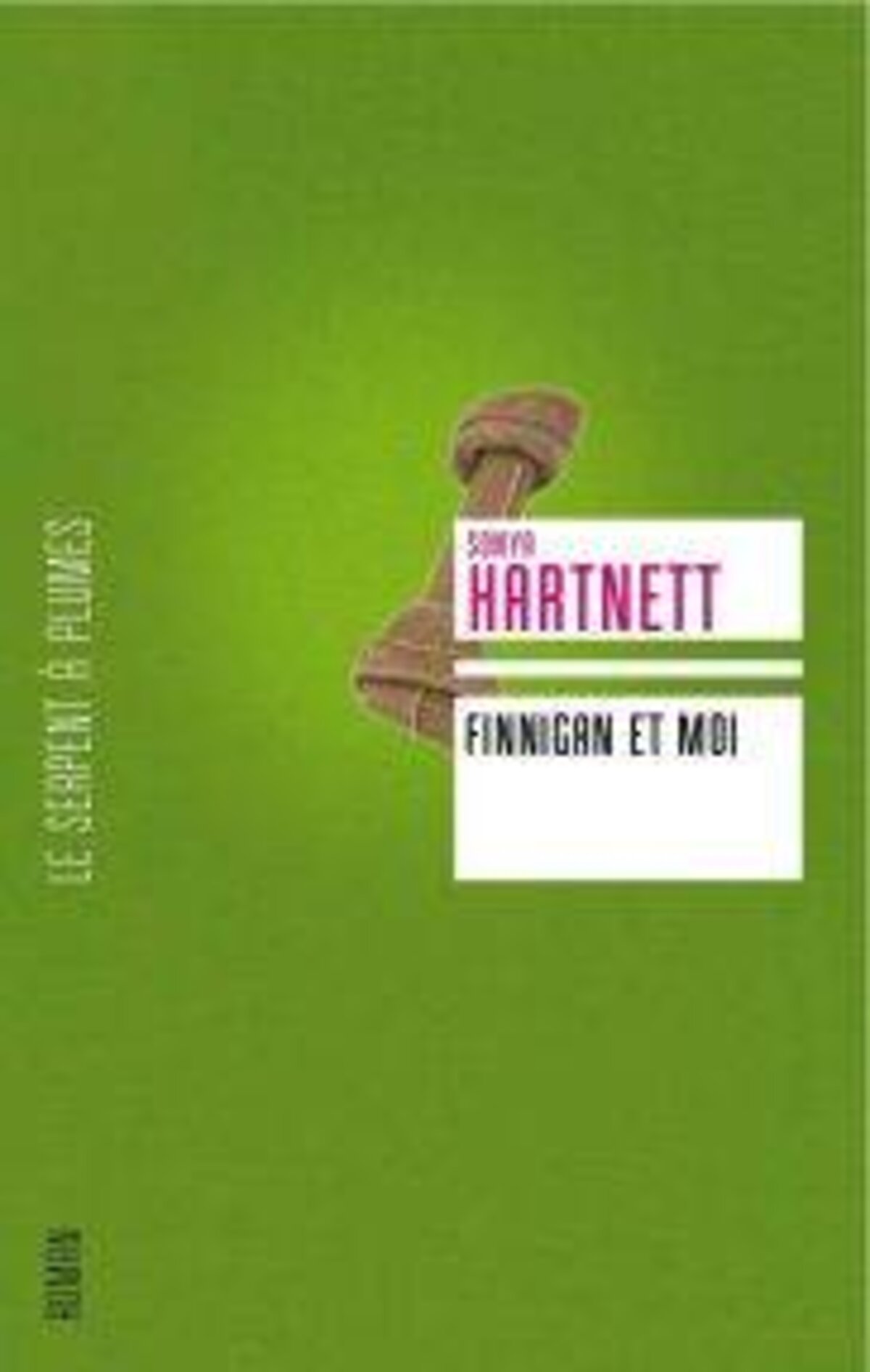
Une courte existence. Gabriel a vingt ans et sa vie tout entière est résumée par cette phrase de la première page du roman : « mon existence n’est qu’une longue succession d’humiliations ». Son corps est immobile, son esprit vagabonde, plonge dans les souvenirs, l’enfance, l’amitié avec Finnigan, les premiers émois amoureux, les hontes, les haines, la mère, le chien, Surrender, le père. A mesure que le corps de Gabriel sombre, son esprit s’élève, se souvient et le roman se construit sur ces flash-backs : « mon âme s’élève peut-être, mais mon corps me tire vers le bas, acceptant l’inéluctable retour vers l’origine ».
Le lecteur découvre pan par pan une histoire chaotique, celle de Anwell/Gabriel et de sa famille, les zinzins (« the kooks »), la mort (accidentelle ?) du petit frère, le pourquoi de cette maladie qui ronge le jeune homme, mais aussi une enfance et une adolescence profondément bouleversées par la rencontre avec Finnigan, un garçon épris de liberté, d’indépendance, entre enfant sauvage et démon.
Finnigan échappe aux règles, à la société, se nourrit de chapardages, il ne fait qu’un avec la nature, vit dans la forêt, « un endroit pour les créatures souples et agiles, pour les fugitifs, pour ceux qui, comme nous, sont à la lisière du monde ».
Finnigan est l’idéal de Gabriel mais aussi son double. Les deux enfants ont passé un pacte. Gabriel, qui s’appelle encore Anwell, a l’impression de vendre son âme au diable. Mais il est si seul, face à la violence de ses parents, à son passé, qu’il accepte de devenir le double de Finnigan. Gabriel incarnera le bien ; Finnigan la vengeance, la haine, la colère :
« - On serait tout le contraire l’un de l’autre, comme des images dans l’eau…
- C’est ça, des reflets. Pareils, mais différents. Comme des jumeaux. Comme des frères de sang ! »
Anwell devient donc l’ange Gabriel. « Je serais toujours un solitaire, mais plus jamais je ne serais seul ».
Le récit alterne les récits de Gabriel et ceux de Finnigan. L’un est tourné vers le passé, l’autre n’accepte que l’avenir. Les deux temporalités vont pourtant se croiser et livrer leurs clés. A travers le portrait de Gabriel et de Finnigan, c’est un espace qui apparaît, une ville australienne coupée du monde, en vase clos, une « île déguisée en ville », Mulyan, « ville de secrets abominables et de mythes » :
« Un point essentiel à propos de Mulyan : personne ne choisit de venir ici. Dans cette petite ville enveloppée dans ses montagnes en mâchoires de requins, nous sommes loin. Très loin. Nous nous connaissons tous sans exception, et nous ne connaissons que nous. Le temps passe, et les noms gravés sur les tombes demeurent identiques ».
Un huis-clos donc. Peu de personnages, des identités redéfinies, floues, schizophréniques, un chien, Surrender (titre original du roman) qui sert de pont entre les deux enfants, de symbole de la violence de l’histoire, aussi. Lorsque le récit commence, Gabriel se meurt, Finnigan laisse exploser sa rage, sa haine, « je suis la lèpre, l’épidémie, la malédiction. Je suis l’infection. Je suis le mauvais œil », des incendies ravagent la ville. Des ossements sont découverts. Un secret pèse sur la ville, peu à peu dévoilé au lecteur, tenu en haleine jusqu’aux dernières pages. Un secret détenu par Gabriel, « le messager. Celui qui rapporte des vérités stupéfiantes ».

Il est impossible de rendre compte de ce roman, d’une densité, d’une poésie, d’une intensité absolument remarquables. Finnigan et moi, roman à deux voix, d’une violence glacée, lourde de secrets, de trahisons, de pactes, de jalousies, tisse une réflexion souterraine remarquable sur l’identité, l’imaginaire, les peurs. Premier roman traduit en français de Sonya Hartnett, Finnigan et moi est un roman polyphonique, qui se joue des genres – à la croisée du thriller, du fantastique, du récit d’enfance et du poème en prose – comme des registres, fonde la narration sur la schizophrénie, comme voix du roman et clé des identités. C’est sombre, profondément beau, violemment troublant. Sonya Hartnett reste dans l’ambiguïté, le non-dit, travaille le suspens de manière diabolique. Elle fait du lecteur sa victime consentante, dans ce roman hallucinant, au sens le plus littéraire comme le plus trivial du terme.
Sonya Hartnett, Finnigan et moi, traduit de l’anglais (Australie) par Bertrand Ferrier, Le Serpent à Plumes, 313 p. 21 €.



